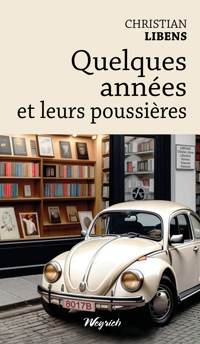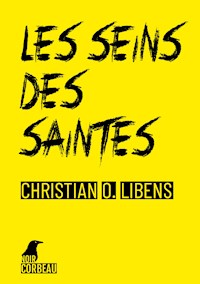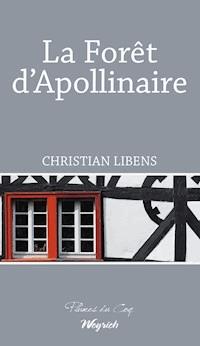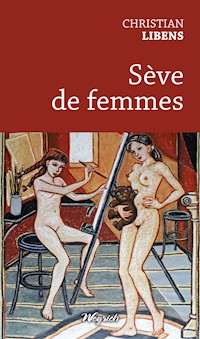
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Comment traverser la nuit quand on est immobilisé en montagne par une méchante foulure ? Voilà trois amis contraints à bivouaquer sans ressources et, pour tuer le temps en attendant le jour, à créer leur petit Décaméron…
Sève de femmes parle essentiellement d’amour, c’est-à-dire d’histoires d’âmes et de sexes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Écrivain et animateur littéraire,
Christian Libens a publié une quarantaine de livres : romans, anthologies poétiques, essais, ouvrages journalistiques…
Les seins des saintes, un polar parodique, a paru en 2019 dans la collection Noir Corbeau. Avec
Sève de femmes, il renoue avec la manière qui était la sienne dans
La Forêt d’Apollinaire (un roman qui a déjà connu cinq éditions et deux générations de lecteurs) ou encore dans
Amours crues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes amis
Alain Bertrand et Jacques Thonnart,
in memoriam
Préface
Christian Libens est pétri de littérature. Il en est le messager inlassable, l’intercesseur hyperactif, s’employant à la faire rayonner dans toutes les directions, en intercesseur tous terrains s’adressant aux plus vierges comme aux plus avertis. Il la connaît sous tous les angles, et maîtrise tous les discours pour en révéler les sortilèges, auprès des profanes comme des initiés.
Son secret est simple, mais des plus rares : c’est qu’il est, tout simplement, un écrivain authentique. Il n’a que faire des affèteries, des ruses, des stratégies douteuses qui encombrent et dénaturent par trop les pratiques littéraires. Il sait où est le noyau de cet art qui n’a pour d’autre véhicule que le verbe, instrument qui fait la particularité, au sein des espèces vivantes, de l’humain. Le noyau, c’est la plongée verticale dans la quête du sens et l’exercice, pour ce faire, des pouvoirs révélateurs des sens.
L’ensemble des pages réunies ici en témoigne à foison. On peut déduire de la prodigalité des textes que cet ensemble rassemble les exigences, les audaces, les puissances spirituelles que suppose une pratique qui n’atteint ses ultimes ambitions qu’au prix d’un courage intellectuel impressionnant et d’une disposition sensible hors du commun.
Des indices nous sont livrés ici d’une quête entamée dès le plus jeune âge et sans cesse prolongée et enrichie au fil d’un parcours existentiel d’une permanente acuité et d’un mûrissement sans cesse approfondi. Il est des pages dans cet ensemble qui sont presque insoutenables à force de pénétration des mystères de la nature humaine. Il en est d’autres qui sont d’une luminosité exceptionnelle. Entre ce zénith et ce nadir notre explorateur des extrêmes tient le log-book patient et passionné de l’aventurier que peut être l’écrivain s’il n’a pas froid aux yeux. Et dispose d’une puissance expressive sans cesse raffermie et raffinée par l’expérience d’une rare témérité d’abord, et le retrait ensuite, le refuge souverain dans l’alchimie de l’écriture.
Jacques De Decker
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique
Sève de femme
Ils ne sont que chair, un souffle qui s’en va sans retour.
Psaume 78 :39
Maintenant, la nuit recouvrait l’Oberland. Seule une lueur diffuse soulignait encore la crête qui nous séparait du versant rhodanien. À cette altitude, l’air est vite glacial. Nous nous étions tassés tous trois dans une sorte d’abri sous roche. « Camera obscura… », avait maugréé Claudio qui, même avec une cheville vilainement abîmée, ne perdait pas ses réflexes de prof de philo.
Il n’y avait plus qu’à s’abandonner à l’attente de l’aube. C’était l’affaire d’une demi-douzaine d’heures tout au plus. En juillet, le soleil se lève tôt sur la montagne. Seuls le froid et l’inconfort du bivouac menaçaient de rendre le temps long et le sommeil court.
Le contenu de nos sacs, volontairement réduit aux besoins d’une seule journée de randonnée en moyenne montagne, n’était guère en mesure d’adoucir notre nuit. Une fois les fruits secs dévorés et l’eau des gourdes réduite à l’étiage, les petits havresacs s’étaient métamorphosés qui en tapis de sol, qui en coussin de siège, qui en oreiller. C’est ainsi qu’un relief inattendu sous ma pommette m’avait alerté… Aussitôt redressé, j’avais lancé un fiat lux triomphal. N’avais-je pas miraculeusement oublié au fond d’une poche latérale une lampe-torche ? Et pas n’importe quel modèle, un petit engin rechargeable à dynamo intégrée.
Quelques moulinets prudents plus tard, nous pouvions fêter le chiche faisceau comme un feu d’artifice. Et nous installer de façon moins spartiate. J’avais ainsi repéré une pierre concave qui me ferait un dossier presque accueillant ; Alain m’avait demandé de l’éclairer pour écarter les cailloux qui lui labouraient le dos ; quant à Claudio, il avait réclamé mes lumières pour examiner une nouvelle fois sa blessure.
— L’œdème ne grossit plus, tu échapperas sans doute à l’amputation…
— Comme c’est malin ! Facile de se foutre de moi alors que je souffre de plus en plus ! Tu es médecin et tu n’es même pas fichu de me dire si j’ai quelque chose de cassé…
— Je suis psychiatre, pas orthopédiste.
C’est alors qu’Alain avait eu la pacificatrice idée de proposer :
— Pour tuer le temps en attendant le jour, on va faire les Boccace ! Tous les trois… C’est le moment idéal pour jouer au Décaméron, non ? Chacun va raconter une histoire, une histoire qui lui est arrivée vraiment…
J’avais renchéri, heureux de la diversion :
— Bonne idée ! Mais il faut que ce soit autour d’un même thème ! Pourquoi pas… euh…
— Le foot ! Ou alors les femmes ! avait rigolé Alain.
— La femme, bien sûr ! Et pas n’importe laquelle… La femme qui nous a offert une émotion qu’on n’a jamais oubliée, qu’on n’a jamais retrouvée ! avais-je précisé. Et c’est Claudio qui va commencer, ça lui fera oublier sa cheville…
* * *
Dans ces années-là, les soutiens-gorge n’entravaient plus les poitrines des femmes, et les chemisiers ouverts accueillaient volontiers le regard des hommes. J’avais seize ans, une faim de lectures sérieuses et une fringale d’images légères. Sartre et ses Mouches, Romy nue dans La Piscine, Camus et Caligula, Jane offerte au Polaroïd de Gainsbourg, et puis les Danièle, Dominique, Marie-Christine, nos petites lycéennes aux longues jambes libres dans la cour de l’école.
Dès mon arrivée en octobre à l’athénée de Verviers, la Planète des Livres est devenue mon repaire. J’y passe mes pauses de midi à bouquiner et à rêver au chaud. À admirer la belle libraire, aussi. Son chemisier est blanc comme du bon lait, pareil aux seins qu’il laisse admirer.
Le plus souvent, elle porte le même genre de tenue : le chemisier blanc, bien sûr, et une jupe en jean, tantôt longue et ample, tantôt courte. Ces jours-là, il m’arrive d’oser… Je force mon air de bon élève pour lui demander l’un ou l’autre auteur latin, dont les petits volumes s’empoussièrent sur la plus haute étagère d’un rayon.
Et les jambes nues gravissent l’escabeau de bois… Et la libraire se penche pour attraper le bon « Classique Hachette »… Sa peau claire m’emballe les sens, emballe mon cœur. (Évidemment, pour continuer à bénéficier de la scène de l’escabeau, je dois bien consentir à un achat, même si je ne sais lire ni Cicéron ni Suétone.)
— Vous serez bientôt le plus latiniste de mes clients, sourit-elle.
Est-elle dupe ou complice ? Peu m’importe, alors, car la vision de ses jambes, nues jusqu’en haut des cuisses, m’accompagne dans ma chambre d’adolescent.
Ce jour-là, j’entre à la Planète des Livres pour me procurer un titre précis, évoqué en classe comme étant l’ancêtre du surréalisme.
Derrière le comptoir, la libraire se débat avec un emballage compliqué, penchée sur un colis biscornu. Son chemisier est plus ouvert que jamais et l’apparition fugace d’un téton dressé me paralyse.
Elle lève le regard, croise le mien puis demande, d’un ton agacé :
— Qu’est-ce que vous voulez ?
Je reste muet, interdit. Pourtant, j’ai appris par cœur la référence du bouquin. Je finis par sortir de ma poche un bout de papier et, comme un gosse, j’ânonne :
— Les Chants de… Maldoror par… le comte de Lautré… amont, s’il vous plaît.
Elle revient bientôt avec un épais volume de poche qu’elle me tend, un étrange sourire aux lèvres :
— Je n’ai à vous proposer que les Œuvres complètes d’Isidore Ducasse. C’est 45 francs !
Vous n’allez peut-être pas me croire, mais je n’ai gardé aucun souvenir de la suite et je ne suis jamais retourné à la Planète des Livres. Il ne me reste de cet épisode que la parfaite mémoire d’une phrase d’Isidore Ducasse, comte de Lautréamont : « Tremdall, debout sur la vallée, a mis une main devant ses yeux, pour concentrer les rayons solaires, et rendre sa vue plus perçante, tandis que l’autre palpe le sein de l’espace… »
* * *
— Voilà, vous comprenez peut-être mieux pourquoi j’ai consacré ma thèse à la symbolique du sein !
Puis, d’autorité, Claudio avait désigné Alain :
— Maintenant, au suivant ! Je suis blessé, moi, crevé. C’est au tour de notre bouquiniste favori… Et ne nous dis pas que tu manques d’inspiration, toi qui as la plus célèbre collection de curiosa de toute la principauté !
— Je vais d’abord vous offrir une petite lecture en guise d’introduction… Pierre, tu peux me passer ta lampe ?
Alain avait sorti de son sac un livre fourbu, ou plutôt un petit tas de feuillets délesté des couvertures, qu’il emportait à chaque randonnée et qu’il ouvrait parfois quand la pause se prolongeait.
— Voilà, j’y suis… C’est encore de Kazantzakis, de son Alexis Zorba… Je choisis ce petit extrait pour que Claudio puisse se pardonner d’avoir cassé notre seule bouteille de vin, et du johannisberg du Valais, en plus !
— Oh, quel menteur ! Alors que c’est toi-même qui… et ma cheville que j’ai… ! s’était étranglé Claudio.
Alain avait attendu que notre blessé s’essouffle avec nos rires pour, de sa belle voix grave, lire comme on ferait d’une épître à l’ambon : « D’une vieille souche poussent des rameaux, il y a des espèces d’ornements acides qui pendent, et le temps passe, le soleil les mûrit, ils deviennent doux comme du miel et alors on les appelle raisins ; on les foule, on retire le jus qu’on met dans des tonneaux, il fermente tout seul, on le découvre à la fête de Saint-Georges-le-buveur, il est devenu du vin ! Qu’est-ce que c’est encore que ce prodige ! Tu bois ce jus et voilà ton âme qui grandit, elle ne tient plus dans la vieille carcasse, elle défie Dieu à la lutte. »
Alain avait arboré son grand sourire espiègle en répétant « Elle défie Dieu à la lutte », puis il nous avait demandé :
— Pourquoi d’abord cette lecture apéritive ? Eh bien, vous allez comprendre…
* * *
J’avais alors dix-huit ans et j’étais amoureux d’une Suissesse de seize. Elle habitait à Liège où elle avait suivi sa mère et son jeune beau-père qui y terminait sa thèse. Marie-Chantal avait grandi chez ses grands-parents, des petits vignerons du lac de Neuchâtel, et c’est là qu’elle continuait à passer chaque été. Nous nous étions rencontrés à l’athénée de Chênée et nous sortions ensemble depuis l’automne précédent. Nous nous voyions tous les jours entre les cours et nous nous débrouillions toujours pour nous retrouver les week-ends, parfois même dans son appartement. D’ailleurs, sa mère ne me faisait pas mauvais accueil et il lui arrivait de m’inviter à manger avec eux une cuisine à la suisse qui, je l’avoue, me séduisait surtout par la compagnie de ma petite amie… Quelle expression idiote ! Marie-Chantal n’était pas vraiment petite et elle n’était pas mon amie. Non, elle était tout simplement mon amour ! Sa présence m’était devenue nécessaire, et vitale la perception de son corps… Oh, je sais bien, les grands mots et les beaux sentiments sont volontiers moqués et, à dix-huit ans, on a l’impression de n’être pris au sérieux par personne ; et peut-être ne l’étais-je pas toujours par elle-même. Mais quoi ! j’étais habité par elle, passionnément. Et je ne pouvais concevoir de vivre tout l’été sans la regarder, sans la toucher, sans la respirer.
Alors, nous avons imaginé des plans, des scénarios pour nous retrouver là-bas « en cachette » car Marie-Chantal me présentait ses grands-parents comme des éducateurs sévères, à la morale de pasteurs calvinistes – calvinistes patentés qu’ils étaient d’ailleurs. Je pilotais depuis peu une petite auto, une Simca sans âge, qui devait me conduire jusqu’à ma belle puis servir à faciliter nos amours. Le plus délicat, s’inquiétait-elle, serait d’échapper aux vieux cerbères, car ils n’étaient pas du genre à se désintéresser de l’emploi du temps de leur protégée chérie. Les semaines passaient et j’imaginais mille embûches, ma Simca en panne au milieu de la montagne jurassienne, ma princesse cloîtrée dans sa chambrette, ma tête mise à prix par la gendarmerie cantonale.
Les vacances se rapprochaient dangereusement quand le miracle advint… En fait, une simple ambassade de la mère auprès des grands-parents régla tout. J’obtenais sauf-conduit et droit de visite grâce à ma qualité de « petit ami » avec la complicité de ma future belle-mère. Victoire ! Evviva la mamma ! Toutefois, les restrictions calvinistes seraient draconiennes, tant sur les moments et les circonstances de nos rencontres que sur la durée de mon séjour là-bas. Mais bon ! j’ai choisi de considérer l’offre comme généreuse et de m’en réjouir fort… On verrait bien sur place !
Le voyage m’avait paru long et lent ; pas d’autoroute alors, ou presque, et les quarante chevaux du petit moteur fourbu s’essoufflaient vite dans les cols des Vosges puis du Jura. Et il me tardait de serrer Marie-Chantal dans mes bras, tant la quinzaine que nous venions de vivre séparés m’avait paru interminable.
Comme convenu, je m’étais installé dans une auberge de jeunesse située sur la même rive du lac, à quelques kilomètres plus au sud. Entouré de vignes, Gorgier était un bien joli village, au pittoresque de carte postale. Comme les vignobles, les maisons et les rues s’étageaient de plus en plus en s’écartant du lac et la vue s’ouvrait à mesure jusqu’aux Alpes. C’était magnifique, mais je ne pensais qu’à Marie-Chantal. Même le nom du bled, Gorgier, m’évoquait aussitôt sa gorge magnifique et je voyais presque se dessiner, sur le lointain horizon des neiges éternelles, ses beaux seins dressés vers le ciel. Comme quand nous conquérions un moment d’intimité, à Liège ou dans la campagne alentour, et que, enfin nue, elle se couchait sur le dos… Oh ! je sais que tout cela peut paraître bien naïf et que le lyrisme amoureux devient vite ridicule. On peut se moquer de moi tant qu’on voudra, je m’en fiche car ces moments-là ont été les plus heureux… non, peut-être pas les plus heureux, mais les plus intenses de toute ma vie.
Ce dont je ne me fichais pas, par contre, c’est que l’auberge fermait pendant la journée et que les dortoirs étaient encore strictement unisexes, ce qui différait des pratiques belges ou françaises. Inutile d’espérer y recevoir Marie-Chantal.