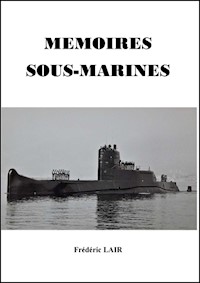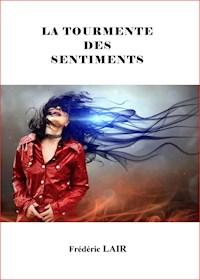Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
J'ai vécu mon enfance dans un charmant village comme on en trouve des centaines en France et ailleurs. J'en ai gardé le souvenir de vieilles personnes aussi originales qu'attachantes, l'odeur des champs de blé et des prés. Je revois, comme si c'était hier, les chevaux ou les boeufs qui traînaient la charrue, la herse en bois ou la charretée de foin au sommet de laquelle se chamaillaient mes copains. J'ai couché ces souvenirs dans ce recueil de 102 pages qui vous replongera dans l'atmosphère des années 50 à 68. Plus de 60 ans ont passé et je n'ai jamais oublié ma campagne!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Si vous saviez...
Si vous saviez...Table des matièresL'ExilLa vieille Dame sous son manteau blancUne étrange fêteMa première séanceBoule de plumesLes rendez-vous de la HoguenneLe chemin des écoliersLa Chapelle aux ChatsLa bonne annéeDeux mains jointes sur un linceul blancLe dernier galopLa clairièreLa glace aux fraisesLa fausse noteCes choses qu'il ne faut surtout pas dire !île était une fois...A propos de l'AuteurPage de copyrightSi vous saviez...
Table des matières
1
L’exil
2
La vieille Dame sous son manteau blanc
3
Une étrange fête
4
La première séance
5
Boules de plumes
6
Les rendez-vous de la Hoguenne
7
Le chemin des écoliers
8
La chapelle aux chats
9
La bonne année
10
Deux mains jointes sur un linceul blanc
11
Le dernier galop
12
La clairière
13
La glace aux fraises
14
La fausse note
15
Ces choses qu’il ne faut surtout pas dire
16
Île était une fois…
L'Exil
Je n’ai gardé aucun souvenir de l’endroit précis d’où je venais. Ni de cet endroit ni de ma mère biologique. Par contre, je revois sans trop de peine les images de mon arrivée chez celui qui se présenterait bientôt comme étant mon père.
J’allais avoir trois ans. On m’avait installé sur une selle minuscule fixée sur le cadre d’un vélo d’adulte.
Nous avons abandonné une route empierrée pour nous engager sur un large sentier herbeux, en légère descente. Le jeune homme qui m’accompagnait – et qui s’avéra par la suite être mon oncle – marchait à côté de sa bicyclette et me tenait en équilibre, une main posée sur mon épaule. Il a sans doute effectué tout le trajet de la sorte, par crainte de me voir chuter de mon fragile strapontin.
Nous nous rapprochions d’une longue bâtisse ceinturée par une haie de troènes aux fleurs odoriférantes. Tout d’abord, je n’aperçus qu’un immense toit de tuiles brunâtres. Puis, mon oncle s’arrêta devant un portail grillagé amarré à la haie, et je découvris alors la façade d’une ferme. Une vieille ferme grise aux portes et fenêtres vert foncé. Au centre de la cour en terre battue, se dressait un immense tas de fumier dont les effluves
nauséabondes me firent grimacer. Quelques poules picoraient aux alentours. Un couple de pigeons roucoulait sur le faîte du toit. Un chien se mit à aboyer.
J’étais toujours installé sur mon siège, les mains rivées au guidon. À cet instant, les premiers signes de vie se firent jour dans cette demeure inconnue. Plus précisément au centre de la façade, au niveau d’une étrange porte coupée en deux, dont seule la partie basse était fermée.
Dans l’ouverture supérieure, apparut d’abord le buste d’une femme vieille et menue. Puis, en arrière-plan, la silhouette plus élancée d’un homme encore jeune, aux cheveux frisés.
Tous deux s’avancèrent résolument vers nous, le regard méfiant… ou hostile. Un autre homme, beaucoup plus âgé et chauve, les rejoignit en traînant quelque peu la jambe.
La vieille dame portait un chignon et présentait une énorme bosse dans le haut du dos. Outre son étrange façon de piquer de la tête vers le sol, ses joues creusées, ses lèvres pincées et ses yeux de fouine enfouis dans leurs orbites lui conféraient un air de sorcière.
— Vous n’avez rien oublié ? Tous ses habits sont là ? demanda-t-elle sèchement au garçon qui m’accompagnait.
Le regard embué, celui-ci acquiesça sans lever les yeux. Alors, la vieille dame bossue ouvrit le portail et m’arracha de mon petit siège. Sans un mot et, surtout, sans ménagement.
En une fraction de seconde, je me retrouvai pressé contre sa poitrine, la tête dans le vide. Puis, elle se tourna vers le monsieur frisé au regard sombre, qui restait gauchement à l’écart :
— Qu’est-ce que vous attendez… ? Allez chercher son baluchon ! décréta-t-elle.
Le sac en toile attaché au porte-bagages passa des mains maladroites du monsieur frisé, à celles du vieux monsieur chauve qui me caressa les cheveux au passage. L’attitude attendrie de ce vieillard au visage buriné, comparée au comportement sévère de la dame bossue, m’aida sans doute à ne pas trop pleurer.
Ensuite, ce fut à mon tour de changer de bras :
— Allez près de votre papa ! lança la vieille dame en me tendant au jeune homme frisé.
Je me sentis soulevé, transporté, secoué jusque dans la cour. Le portail battit contre son cadre. La vieille dame s’adressa une dernière fois à mon oncle :
— Maintenant, retournez d’où vous venez ! maugréa-t-elle, le doigt pointé vers la route.
Mon oncle souleva son vélo, tenta un dernier regard à travers le grillage, émit quelques sanglots et rebroussa chemin. Le monsieur qui se présentait désormais comme mon papa m’empêcha de le regarder disparaître derrière la haie. On referma aussitôt les deux parties de la porte coupée et je découvris, jour après jour, ce lieu d’exil où j’allais passer ma jeunesse…
L’étable captiva en premier lieu mon attention. Elle hébergeait deux vaches blanches tachetées de noir que mon grand-père – c’est sous ce vocable qu’on m’apprit à désigner le vieux monsieur chauve – utilisait pour cultiver son lopin de terre. Dociles et paisibles, elles tiraient de concert, et sans jamais rechigner, la charrue au soc brillant ou la herse triangulaire en bois. Grand-père les accompagnait plus qu’il ne les guidait. À force d’arpenter notre unique champ, elles auraient pu effectuer, toutes seules, leur besogne ingrate et monotone.
Au fil du temps, grand-père m’installa sur leur dos. Accroché à leurs cornes, fier comme Artaban, je me sentais porté par des épaules de géants. Et peu nous importait si nos voisins, plus fortunés, travaillaient leurs champs avec chevaux ou tracteurs. « Nos bêtes » étaient les plus belles du monde !
La journée de labeur terminée, elles retrouvaient leur gîte et leur mangeoire en pierre. Le piétinement bruyant de leurs sabots sur les pavés de l’étable faisait fuir un court moment les hirondelles dont les nids s’accrochaient aux voussettes en briques chaulées. Elles étaient légion, attirées par les mouches. On m’a soutenu qu’elles portaient bonheur. À la réflexion, je continue à le croire.
Un autre endroit m’attirait, plus insolite encore. Un endroit mystérieux, assez sombre et plutôt encombré : la grange ! Les betteraves rouges et longues qui serviraient de pitance aux bêtes durant une bonne partie de l’année, s’amoncelaient dans un coin. Chaque soir, grand-père actionnait énergiquement la manivelle d’une large trancheuse aux couteaux acérés. Les betteraves s’y déchiquetaient en émettant des crissements saccadés. Elles retombaient en lamelles dans une manne ajourée en fer blanc.
À côté de cette trancheuse gisaient les collets et les fanes que grand-père avait sectionnés préalablement à grands coups de serpe. Aux alentours, quelques machines obsolètes et fragiles que nous étions sans doute encore les seuls à utiliser dans le village : un tamis à grain, un semoir en bois, ainsi qu’un long soc, en bois lui aussi, destiné à creuser les sillons dans lesquels nous irions planter les pommes de terre au printemps.
Au-dessus de cet espace au contenu hétéroclite, répartis sur un enchevêtrement plus ou moins régulier de rondins, s’entassaient la paille et le fourrage destinés à nos deux bêtes durant l’hiver.
Curieux de tout, impatient comme un enfant avant Noël, je gambadais derrière grand-père à longueur de journée. Jusqu’au jour où j’ai trébuché sur le sol inégal et chuté la tête la première sur la serpe abandonnée par mégarde au pied du la trancheuse. Mon front en porte toujours la cicatrice… Le visage en sang, j’ai aussitôt reçu les soins assidus de grand-mère, tandis que mon guide catastrophé se voyait affubler de tous les noms d’oiseaux présents au dictionnaire.
Le dernier endroit saugrenu où j’allais chaque jour traîner mes savates se trouvait à l’extrémité gauche de la ferme. Grand-père y avait aménagé son pigeonnier au-dessus de l’ancien fournil transformé en atelier. On y accédait à l’aide d’une échelle rudimentaire posée à travers une étroite ouverture pratiquée dans le plancher.
En accédant à ce local, la première impression était plutôt désagréable. En effet, sous l’effet de la chaleur, une odeur piquante d’excréments me prenait aussitôt à la gorge. Néanmoins, à mesure que je progressais parmi les cages et les nichoirs, d’autres senteurs atténuaient mon dégoût : celle du maïs concassé et des graines choisies qui constituaient le repas des pigeons ; celle de la chaux dont on badigeonnait les murs ; l’odeur poussiéreuse des pigeons eux-mêmes.
Certains portaient une bague en métal gris. D’autres nichaient dans de larges soucoupes en terre cuite au creux desquelles grand-père avait déposé un œuf en plâtre blanc. Leurs roucoulements harmonieux, interrompus lors de notre intrusion, reprenait crescendo pendant que nous remplissions d’eau fraîche les abreuvoirs.
Grand-père leur parlait, les bichonnait, leur déployait minutieusement les ailes, attentif au moindre bobo. Il lisait dans leurs yeux et sélectionnait en silence les valeureux champions qui participeraient au prochain concours. Une dernière caresse, un dernier regard puis, nous quittions – à reculons et silencieux – nos hôtes occupés déjà à se rafraîchir.
La vieille Dame sous son manteau blanc
La campagne est une vieille dame coquette et digne. Elle pleure en silence sous le regard menaçant de mars, elle charrie ses sanglots en rigoles disciplinées dans les replis de ses sobres atours, mais elle se console bien vite et succombe au charme des roulades qu’un pinson amoureux lance dans les cerisiers blancs. Elle illumine alors d’émeraude les feuillages renaissants et dispose avec talent une palette harmonieuse de teintes réjouies sous le ciel rassuré.
Ensuite, elle se taille un séduisant chemisier dans un tapis de coquelicots ; subtile rivière de rubis et de jade entremêlés de marguerites immaculées. Ce pastel bigarré exalte sa fraîcheur adolescente et sa rayonnante féminité.
Pour compléter son élégance, elle se tisse un jupon soyeux aux reflets des champs de lin que des vagues miroitantes chargées d’azur et de nacre parent de mouvantes étincelles. Puis, couronnement suprême, l’or des champs de blé s’écoule en cascades éblouissantes jusqu’au creux de ses reins ; chevelure angélique aux doux frémissements, qu’un souffle divin caresse et rassure avec déférence et volupté.
Elle est comblée, fière et paisible. Elle respire à peine, par crainte de se froisser. Mais les saisons suivent la mode… elles ne font que passer.
Les blés sont moissonnés, ils gisent sur les champs. On retourne les javelles sous un soleil de plomb. Un frou-frou cadencé accompagne le geste des paysans. Les femmes suivent, plus voûtées qu’un vieux pont, un large mouchoir rouge à pois blancs noué dans les cheveux. D’une poignée de fétus, elles tressent un lien solide, et naissent entre leurs mains agiles des gerbes régulières qu’elles dressent par groupe de quatre, telles des huttes lilliputiennes.
Puis, le flot des gerbes coule ses longs cils dorés à travers les ridelles des grands chars à bœufs qui s’en vont, cahotants, rejoindre les hangars et les greniers.
Mais bientôt, revient le temps des couleurs ternes et des guenilles. Dame campagne se dénude lentement. Elle offre son vrai visage et son corps imparfait aux griffes de l’automne. Les récoltes engrangées, la campagne se retrouve toute chauve, impudiquement nue. Çà et là, son corps meurtri exhibe des taches de rousseur… C’est que les feuillages, eux aussi, prennent la couleur du temps.
Las de nous gratifier de son éclat, le soleil se couche alors sur les dernières meules de foin perchées sur leur support de rames entrelacées.