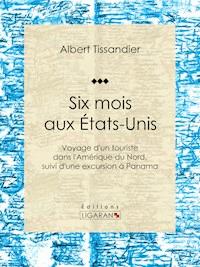
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le voyage d'Amérique est aujourd'hui facile ; dans quelques années il le deviendra plus encore, grâce aux progrès incessants accomplis par nos paquebots transatlantiques. Une chose même est faite pour étonner, c'est le petit nombre de nos compatriotes qui se décident encore à passer l'Océan pour aller voir ce beau pays, où il y a cependant tant à apprendre pour nous."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043167
©Ligaran 2015
Le voyage d’Amérique est aujourd’hui facile ; dans quelques années il le deviendra plus encore, grâce aux progrès incessants accomplis par nos paquebots transatlantiques. Une chose même est faite pour étonner, c’est le petit nombre de nos compatriotes qui se décident encore à passer l’Océan pour aller voir ce beau pays, où il y a cependant tant à apprendre pour nous.
Certes, les États-Unis n’ont pas les monuments d’art, les souvenirs historiques qui abondent en notre pays, mais on ne doit pas oublier que les Américains sont un peuple jeune encore, datant de cent ans à peine. Ils nous donnent cependant un exemple extraordinaire dans l’énergie extrême et l’ardeur qu’ils mettent au travail. En cela ils sont admirables et peut-être même commencent-ils à nous dépasser aujourd’hui ; on ne saurait trop aller chez eux pour étudier les résultats de leur intelligence, et voir les œuvres grandioses qu’ils entreprennent.
C’est dans cette pensée que je me décidai à entreprendre un voyage de six mois aux États-Unis.
Après douze jours de traversée, on est heureux de voir terre, surtout lorsque c’est l’admirable baie de New-York qui se présente à vos yeux, mais il faut se débarrasser des ennuis de la douane. L’administration américaine est inexorable ; elle vous inflige un vrai supplice. À peine ai-je pu serrer la main de mon ami G… qui m’attendait en dehors des barrières posées par les douaniers. Avec un peu de patience, beaucoup même, devrais-je dire, tout est terminé et mes malles me sont promises pour mon arrivée à l’hôtel. Me voici libre enfin et nous partons aussitôt avec mon compagnon faire une promenade dans la ville à l’aide des Elevated ou chemins de fer aériens.
Rien de plus curieux que ce chemin de fer qui décrit des courbes tortueuses à travers les rues et fait des détours les plus invraisemblables (PI. I). J’en ai gardé une impression des plus bizarres et certainement on ne peut pas se figurer une manière de voyager aussi pittoresque et aussi rapide. Les wagons passent quelquefois dans d’étroits passages des rues ; ils arrivent alors presque à toucher les maisons et on est tout étonné de se trouver de plain-pied avec une chambre à coucher ou un salon dont les fenêtres ouvertes ont vue sur votre voiture. On pourrait alors serrer la main du locataire. Il y a foule dans les wagons, bien entendu. Les dames, en toilette fort élégante, sont toujours assises malgré tout ; aucun homme ne resterait à sa place si une lady devait rester debout ; la politesse la plus stricte est observée partout. Dans tous les lieux publics, une dame est toujours certaine de passer la première et d’être respectée.
Tout ce monde se meut silencieusement, personne ne cause, on a l’air absorbé. Cela est étonnant, car on devait s’attendre à tout le contraire d’après la réputation que l’on a faite aux Américains. Le silence est, paraît-il, le grand mot d’ordre ici. Dans les bars, les restaurants, les rues, pas un cri, pas de conversations à voix haute. Ce silence est d’autant plus curieux, que le mouvement des rues est vraiment fébrile. La masse des voitures, active, et le nombre de voyageurs transportés par an dépasse 60 millions.
Les chemins de fer aériens de New-York sont établis presque tous directement au-dessus des avenues principales de la ville, qu’ils suivent dans toute leur longueur ; ils sont formés par des poutres en fer en treillis dont la hauteur varie, au-dessus de la 2e avenue par exemple, de 6m, 10 à 15m, 20. Ces poutres sont supportées elles-mêmes par des colonnes en fonte, au nombre de deux par travée, qui sont entrecroisées par des croix de Saint-André dans le sens transversal ; dans le sens longitudinal, ces colonnes sont distantes de 13 mètres, et au dehors des tirants diagonaux, elles sont reliées également par une poutre horizontale régnant sur toute la longueur de la voie (fig. 2).
Les colonnes en fonte soutiennent les poutres en treillis qui supportent elles-mêmes la voie ferrée. Les travaux des Elevated ont été poussés avec une rapidité vraiment surprenante. Un délai de neuf mois seulement avait été accordé par la Compagnie du Metropolitan aux entrepreneurs, MM. Carke, Rewes et Cie, pour la construction de deux sections ayant une longueur totale de 17 kil 800. Dans ce travail, ils avaient à mettre en œuvre 44 700 tonnes de fer, comprenant 1 562 kilomètres de fers cornières, 505 kilomètres de fers en barres, 8 090 mètres carrés de tôle, 732 200 mètres de colonnes, et ils devaient employer 5 500 000 rivets et poinçonner 22 millions de trous. En tenant compte des pertes de temps inévitables pour les travaux préparatoires, il leur restait seulement 190 à 200 jours de travail ; on voit combien cette œuvre était minutieuse et difficile à exécuter et quelle ardeur il a fallu aux ouvriers pour tout terminer. Le travail se poursuivit nuit et jour, grâce à l’emploi de la lumière électrique, et il aurait été achevé dans le délai exigé, si la Compagnie n’avait pas désiré elle-même retarder volontairement l’ouverture du dernier tronçon.
Les voies des chemins de fer aériens de New-York ont toutes la largeur du type normal de 1m, 450 ; elles restent presque toutes en ligne droite, mais on y rencontre cependant des courbes d’un rayon très faible, s’abaissant même parfois jusqu’à 27 mètres. Toutefois, les véhicules qui sont portés sur des boggies, suivant une disposition constamment adoptée aux États-Unis, s’inscrivent facilement dans ces courbes sans amener une usure excessive des rails et des bandages. D’ailleurs, les barres d’attelage des voitures sont fixées directement au centre des boggies, afin de faciliter le déplacement latéral, et dans la traversée des courbes, elles oscillent jusqu’à une distance de 0m, 46 de leur position d’équilibre.
Les voitures ont 11m, 30 de long et 2m, 70 de large, l’écartement des centres des boggies est de 9m, 10. Elles comportent des plates-formes aux deux extrémités, et elles renferment chacune 48 places, dont 32 en long et. 10 en travers dans le milieu de la voiture (fig. 3).
Les trains sont composés de quatre wagons au plus, ils sont remorqués par une petite locomotive-tender. Cette machine entraîne traîne avec elle un volume de 1450 litres d’eau, suffisant pour le plus long parcours qu’elle peut avoir à effectuer. Elle a deux essieux accouplés, convenablement rapprochés pour permettre le passage dans les courbes, elle est portée également à l’avant et à l’arrière sur un truck articulé ; son poids total est de 5 800 kilogrammes, et son poids adhérent de 5 700 kilogrammes.
La circulation sur les chemins de fer aériens n’entraîne d’ailleurs aucun danger spécial, car les ponts sont munis de balustrades et construits avec toutes les précautions nécessaires pour conjurer les conséquences terribles que pourrait avoir un déraillement à pareille hauteur. Les trains se succèdent aujourd’hui de trois en trois minutes sur presque toutes les lignes depuis cinq heures du matin jusqu’à huit heures du soir ; on compte ainsi sur la 3e avenue, par exemple, 850 trains qui ne représentent pas moins de 2975 voitures, et qui entraînent 93 929 voyageurs ; sur la 6e avenue, le nombre de trains reste peu différent, car il est encore de 839, et comprend 2 820 voitures.
La compagnie des Elevated a eu, depuis l’ouverture de son chemin de fer, bien des réclamations et bien des procès à supporter. Sur tout le parcours de la ligne, l’existence devient affreuse pour les habitants qui ont vue sur la voie.
La fumée et les mauvaises odeurs, le bruit et tous les désagréments produits par les locomotives sont pour eux. On tâche aujourd’hui d’écarter une partie de tous ces inconvénients.
Au mois de juin 1885, M. Edison a fait des essais fort intéressants et qui paraissent devoir réussir complètement. Il s’agirait de remplacer les machines à vapeur des Elevated par l’électricité. Les voitures auraient alors beaucoup moins d’ébranlement ; cela préserverait les viaducs de fer construits et qui en certains endroits déjà, paraît-il, ont besoin de fortes réparations.
Le va-et-vient des Elevated et l’activité considérable qui règne dans les rues ne laissent pas que d’étourdir un peu le voyageur curieux de voir toutes choses, mais ce sont des aspects qu’on peut se figurer facilement si l’on a vu des grandes villes comme Paris ou Londres. Le spectacle tout à fait hors ligne et qui ne saurait avoir aucun point de comparaison est celui qui vous est donné lorsqu’on se trouve sur le tablier du pont de Brooklyn. Ce travail extraordinaire pourrait bien passer pour la huitième merveille du monde. Si les Américains sont fiers d’une œuvre semblable, ils en ont le droit à juste titre, car rien n’est plus grandiose, ni plus saisissant.
L’agglomération humaine new-yorkaise, après Londres et Paris la troisième sur la terre par ordre de population, comprend près de deux millions d’individus et se compose de quatre villes juxtaposées : New-York, couvrant l’île de Manhattan, comprise entre le détroit appelé rivière de l’Est, l’estuaire de l’Hudson et la bouche secondaire de ce fleuve, dite rivière de Harlem ; Brooklyn, occupant en face de New-York, sur l’autre rive de l’East River, l’extrémité sud de l’île Longue ; Jersey City et Hoboken, de l’autre côté de l’embouchure de l’Hudson. Les deux principales cités sont New-York, comptant plus d’un million d’habitants, et Brooklyn, qui en renferme plus d’un demi-million, bâties vis-à-vis l’une de l’autre sur les deux rives du détroit qui sépare Long Island du continent. Ce canal est, entre les deux villes, étroit et sinueux comme une rivière, si bien qu’il en a pris le nom ; mais ce n’en est pas moins un bosphore maritime incessamment sillonné par d’innombrables vaisseaux, portés par les ondes salées de l’Atlantique sur cette prétendue rivière aussi bien qu’en plein océan.
Il y a quelques années ces deux villes ne communiquaient que par l’intermédiaire des bacs à vapeur qui traversaient à tout instant la rivière, à la grande gène des autres navires et en étant à leur tour entravés par ceux-ci dans leur mouvement transversal de navette. Les glaçons flottants de l’hiver suspendaient aussi quelquefois les différents services pendant des heures entières. Pour supprimer ces inconvénients il y avait à établir un pont transformant New-York et Brooklyn en deux quartiers d’une même capitale ; mais il fallait en même temps que les cent vaisseaux qui passent à chaque heure dans le canal pussent continuer à y naviguer toutes voiles dehors.
L’ingénieur John Roebling avait remis en honneur aux États-Unis les ponts suspendus en exécutant, de 1851 à 1855, celui du Niagara, le seul pont de cette espèce qui porte des locomotives et, de tous les viaducs, celui qui présente la plus vaste travée franchie par ces lourds engins. Le pont suspendu du Niagara a 244 mètres d’ouverture et est supporté par quatre câbles de 254 millimètres de diamètre contenant chacun 3640 fils.
Comment l’ingénieur Roebling était-il parvenu à faire passer les convois sur les ponts suspendus, abandonnés en Europe comme trop peu solides ? C’était en modifiant leur construction, en ajoutant à la force de résistance des câbles de suspension celle de poutres métalliques supportant le tablier et de haubans fixés aux piles et partageant avec les câbles une partie de la charge.
C’est en 1845 que M. Roebling construisit les premiers ponts de ce système, mais il n’aborda les très grandes portées qu’au pont du Niagara. Coup sur coup, après avoir achevé ce viaduc, il construisit deux ponts pour voiture plus longs encore, l’un en 1866 à Cincinnati, d’une portée de 322 mètres, suspendu à deux câbles de 305 millimètres de diamètre contenant 5 200 fils chacun ; l’autre, de 387 mètres de portée, en 1869, aux chutes du Niagara.
C’est en 1867 que John Roebling conçut le projet du pont de l’East River. Cet illustre ingénieur est mort en 1869, mais son fils, le colonel Washington Roebling, a exécuté le projet paternel sans en modifier les données principales.
Le pont de New-York à Brooklyn se compose d’un pont suspendu de trois travées dont l’arche centrale a 486 mètres d’ouverture ; c’est, la plus large qui existe sur notre terre, c’est-à-dire qu’elle est plus grande que deux fois la longueur du plus long pont de Paris, le Pont-Neuf, qui a 233 mètres et comprend douze arches. Les deux travées latérales ont 283 mètres, ce qui fait 1 052 mètres pour le pont. Il est suspendu à quatre câbles de 39 centimètres de diamètre comprenant chacun 6224 fils d’acier parallèles et non tressés ensemble ; chaque câble peut supporter 11 380 000 kilogrammes ; il a une longueur de 1090 mètres et pèse 80 400 kilogrammes. Les câbles sont soulagés par six poutres métalliques faisant partie du tablier du pont et par 280 haubans attachés aux piles centrales.
Ces deux piles entièrement en granit s’élèvent à 84 mètres au-dessus de la haute mer, c’est-à-dire à la hauteur des tours de Notre-Dame de Paris surmontées d’une maison à six étages. Les deux tours ne plongent pas seulement jusqu’au fond de la mer, à cinq mètres et demi sous l’eau, elles pénètrent et s’enfoncent, au-dessous de ce fond lui-même, dans le lit maritime jusqu’à une profondeur qui, pour la pile de New-York, la plus profonde, atteint 30 mètres (114 mètres au-dessous du sommet) et comprend 36 160 mètres cubes de maçonnerie pesant 100 millions de kilogrammes.
Les câbles passent au sommet des tours et supportent le tablier vers la moitié de la hauteur de celles-ci, à 36 mètres au-dessus de la haute mer, près des piles ; mais le tablier s’élève vers le centre de façon à y laisser un passage libre de 41 mètres pour les vaisseaux. Les soixante-dix millions de personnes qui, chaque année, circulent entre New-York et Brooklyn passent ainsi au-dessus des mâts de cacatois des navires, entre ciel et mer, dominant les vagues de la hauteur de la colonne Vendôme au-dessus du sol. Ce tablier aérien a la largeur d’un boulevard : 26 mètres ; dans cet espace il y a, de chaque côté, deux voies charretières (soit quatre en tout) garnies d’ornières de fer pour le passage des voitures, puis, en dedans de celles-ci, deux voies ferrées, et, au centre, une passerelle pour les piétons d’une largeur de 4 mètres et demi, surélevée de 3 mètres au-dessus du tablier (fig. 4). Les piles sont ajourées, au niveau du plancher du pont, de deux immenses porches gémellés sous lesquels passent voitures et wagons ; la passerelle occupe l’épaisseur du pilier séparatif des deux porches et, en se bifurquant, elle contourne, au-dessus des trains, ce pilier central. Le pont est continué sur chaque rive par deux viaducs de maçonnerie qui s’abaissent, au niveau du sol au centre de New-York et de Brooklyn. À New-York, le viaduc enjambe un grand nombre de maisons dont la hauteur a été diminuée et dont le toit a été recouvert d’un blindage incombustible, mettant le viaduc à l’abri de l’incendie. Le viaduc d’accès de Brooklyn a 206 mètres, celui de New-York 476 ; avec le pont suspendu intermédiaire, l’ouvrage total a une longueur de 1825 mètres. Malgré sa solidité, le pont n’est pas destiné au passage des convois ordinaires et des locomotives, mais les deux voies ferrées sont parcourues sur toute la longueur de la ligne (soit 1825 mètres) par deux trains de wagons spéciaux faisant alternativement la navette et remorqués par un double câble mis en mouvement par une machine fixe.
La dépense totale pour ce travail sans précédent s’élève à près de 70 millions de francs.
Les travaux, commencés en 1869, ont été terminés en 1880. Les ingénieurs ont eu à surmonter des difficultés sans nombre pour achever cette œuvre extraordinaire. Aujourd’hui il n’y a plus qu’à admirer et rendre hommage aux travailleurs éminents qui ont pu tout achever si parfaitement et doter leur ville d’un monument si grandiose (Pl. II).
Si la journée est occupée à New-York, au milieu d’une foule affairée, les soirées ne sont pas moins curieuses dans un autre genre. – Dès la fin du jour, à six heures du soir, tout change dans cette grande cité. La tranquillité, le repos commencent à régner en maîtres. – Les magasins se ferment pour la plupart, les affaires sont terminées et chacun va chez soi penser aux choses du lendemain dans le calme de la famille ou aux quelques distractions qu’on prendra le soir.
Il y a des cercles remarquables à New-York. Le League Club par exemple est somptueux, on pourrait réellement le comparer à un palais. – Les décorations intérieures sont du meilleur goût et très luxueuses. Des salons de toutes sortes pour des réceptions particulières, une bibliothèque considérable, des salles de billard et de jeux divers, des salles de gymnastique, etc. Une salle à manger splendide, au plafond élevé, en bois sculpté rehaussé d’ornements d’or, avec larges fenêtres encadrées de belles draperies, vous offre les vues grandioses de la cité. Le séjour de cet Union League club est enchanteur, surtout pour un Américain qui n’a pas de distractions dans sa ville comme celles que l’on peut avoir à Paris. Ils sont 1600 membres dans ce cercle, et peuvent fournir à une dépense de plus de 500 000 francs par an pour l’arrangement de toutes choses. On ne peut se faire idée du confort extrême qui règne partout et dans les moindres détails de ce club modèle.
En dehors des cercles, les distractions sont assez abondantes encore dans la ville. Une des plus amusantes est certainement le spectacle de Barnum. Il a non seulement un cirque inouï, des plus complets en tous genres, mais il joint à cela une ménagerie tout à fait extraordinaire.
Tous les monstres de la terre sont là sur une estrade : la femme squelette, les Aztèques, les nains et géants, les albinos, les femmes à barbe, puis des échantillons superbes d’animaux divers, 20 éléphants savants, etc. Dans le grand amphithéâtre, où plus de 15 000 personnes peuvent trouver place, trois cirques sont toujours occupés à la fois. On voit tout un monde de clowns sautant, gesticulant au milieu des exercices des écuyers et écuyères, puis dans les combles de la salle, des saltimbanques des deux sexes occupés sur leur trapèze ou sur les cordes raides. Une musique infernale excite toute cette foule de clowns pendant deux heures durant, car il n’y a pas d’entracte. On sort de là à dix heures et demie, absolument étourdi, mais on peut se vanter d’avoir vu un spectacle unique dans le monde entier.
Je ne puis parler de toutes les salles de spectacle, leur directeur s’ingéniant à utiliser les lumières Édison de la façon la plus originale, mais il y a un théâtre nouveau, le Lyceum, ouvert depuis peu, qui offre une particularité assez curieuse.
La salle contient 1200 personnes environ, elle est plutôt arrangée en salle de concert. La décoration est pleine de goût, sauf de rares détails : c’est un genre mélangé de persan et d’indien ; beaucoup de boiseries apparentes, surtout au plafond. Toutes ces boiseries sont incrustées d’argent, de nacre et d’ivoire (imitations, bien entendu).
Le balcon de la première galerie est décoré de grandes rosaces de verre éclairées par la lumière Edison. Elles forment ainsi de grosses émeraudes encadrées de montures très délicates en argent et sont posées sur un fond marron du plus joli effet.
Il n’y a pas de loges, mais trois avant-scènes situées de droite et de gauche, dont les séparations de bois ajourés et sculptés à l’indienne complètent l’effet gracieux de cette petite salle.
L’idée originale de ce théâtre est d’avoir un orchestre de trente musiciens situé derrière la toile. Il est disposé sur un ascenseur aussi large que la scène même, et on le monte dans les frises lorsque l’entracte est terminé. Il redescend ensuite avec tous les musiciens aussitôt l’acte achevé.
Cet orchestre mouvant est décoré d’une façon délicieuse. Colonnettes en bois niellé d’argent, lustres en forme d’œufs d’autruche rehaussés de mille perles de verres de couleurs diverses, vitraux chatoyants et banderoles de perles, tout cela éclairé à la lumière Edison ; c’est charmant. Enfin le plafond de la salle est orné d’un vaste caisson rempli d’une centaine de globes de forme ovale suspendus par des fils d’or. Ils remplacent le lustre habituel et répandent dans la salle une douce lumière.
La lumière Edison est fort employée à New-York dans les théâtres, les restaurants, les grands magasins et les clubs. Le First district central lighting Company se trouve non loin du pont de Brooklyn et il envoie la lumière dans la ville par 20 000 milles de conducteurs ; 8 machines à vapeur de 150 chevaux sont en activité avec 8 dynamos de 1200 ampères. Depuis l’année 1882, où les premières installations ont été faites, il est facile de se rendre compte des progrès énormes de la lumière électrique dans la cité de New-York. La chambre des régulateurs et celle des instruments de mesure, la salle des dépôts des conducteurs de rechange, sont intéressantes, mais la plus curieuse est celle où sont placées les machines et les dynamos. Toutes ces pièces différentes sont basses et construites en cloisons de planches ; elles n’offrent aucun intérêt au point de vue de l’arrangement ou du goût, le côté pratique seul est remarquable. Tout cela est provisoire ; on voit que les agrandissements seront facilement faits au fur et à mesure des besoins du public. Les autres parties de la ville sont éclairées par les Compagnies Brush et Swan. Elles s’occupent principalement de l’illumination des rues et des places publiques. À Madison Square, entre autres, on peut admirer la grande couronne de lumière composée de six lampes qui se trouve suspendue en haut d’un mât de 50 mètres environ. Elles envoient leurs feux dans toute la place, et sous les beaux arbres du jardin on croirait volontiers à un clair de lune perpétuel.
On monte tous les soirs cette couronne à l’aide d’une manivelle actionnant des poulies ; le matin on la redescend à la hauteur du balcon pour réparer ou nettoyer les appareils. Sur la place du Carrousel de Paris l’appareil électrique offre un aspect agréable comme lumière, mais il est moins élevé et l’éclairage est loin d’être aussi intense que les lampes Brush dont Madison Square est pourvu.
Dans la ville de New-York ainsi qu’à San-Francisco, etc., on s’est contenté d’un simple mât pour élever les lustres électriques Brush ; mais dans la petite ville de Détroit, au bord du lac Saint-Clair, il y a une installation beaucoup plus jolie au point de vue de l’effet dans les rues ; elle est d’une hardiesse remarquable (fig. 5).
C’est une carcasse triangulaire composée de tiges de fer assemblées en croix de Saint-André et ayant une élévation de 50 mètres environ. Cette sorte de tourelle à jour, d’une légèreté étonnante, est maintenue seulement en deux endroits de la hauteur par des fils tendus à des poteaux plantés dans les rues mêmes et qui ne figurent point sur notre croquis.
Elle est posée sur une colonne de fonte à une certaine hauteur du trottoir pour ne pas gêner la circulation. Le gardien monte au premier balcon à l’aide d’une échelle ; là, il entre au centre du triangle dans une petite nacelle qu’il peut faire monter lui-même au balcon supérieur, en s’aidant des cordes enroulées autour des poulies. Un contrepoids, qui descend au fur et à mesure que l’homme monte, facilite l’ascension. Cent tours de ce genre éclairent la ville de Détroit, et elles sont placées à tous les 500 mètres environ. Dans les faubourgs, l’espace est plus grand, il est de 800 mètres. Pour les grandes places, les tours sont plus hautes, elles ont 60 mètres environ et sont munies de 8 lumières. Outre ces appareils électriques, la ville possède, comme New-York, les becs de gaz habituels.
Dans la ville d’Indianapolis, province d’Indiana, une tourelle d’un modèle un peu différent a été aussi installée par M. Adams, ingénieur de la Jenney electric company. Cet appareil n’a point d’ascenseur comme celui de Détroit pour faciliter à l’employé l’ascension qu’il doit faire chaque jour à 40 mètres de hauteur pour nettoyer et réparer les 4 lampes destinées à distribuer la lumière. Il se compose d’un simple mât garni d’échelons qui conduisent jusqu’à la petite plateforme placée à son extrémité. Pour donner de la rigidité à cette légère installation, le mât a été élevé par parties de 5 mètres qui sont assemblées entre elles. À chaque point de jonction, un collier de métal porte des arcs boutants horizontaux, qui sont maintenus entre eux par des fils d’acier. Pour éviter le balancement de cette sorte de tourelle, on a fixé, comme à celle de Détroit, des haubans en cordes d’acier qui vont s’attacher à des pieux plantés à une certaine distance du pied de l’appareil.
Un dimanche, à Philadelphie, n’est pas une chose absolument gaie, il s’en faut.
900 000 habitants sont chez eux, retirés et tranquilles, les rues sont presque désertes : c’est un vaste cimetière ! Dans les principales voies cependant les tramways courent encore, et à la sortie du Temple on voit quelques personnes se hâtant de rentrer chez elles. Sous les nombreux fils télégraphiques, téléphoniques et autres, les rayons du soleil ne sauraient vous atteindre. Les ombrages de fils métalliques les plus épais sont situés à l’angle de Chestnut Street et de Third Street. Les poteaux télégraphiques remplacent les arbres, les feuilles vert tendre du printemps sont représentées par les isolateurs de verre ou de porcelaine perchés sur leur tige de bois. Ils maintiennent l’immense toile d’araignée formée par les innombrables fils de fer (fig. 6).
Les magasins restent ouverts en apparence dans les rues, il n’y a point de volets, de sorte que les devantures sont brillantes et parées comme dans la semaine. Cette mesure gêne les voleurs, paraît-il ; le soir, une lumière est placée dans le fond du magasin et les policemen pourraient voir facilement les travaux malfaisants de ces messieurs. Il est certain que le vol qui a eu lieu à Paris, chez un bijoutier de l’avenue de l’Opéra, n’aurait pu être réalisé à Philadelphie. Les volets du magasin enlevés, nos sergents de ville auraient vu les tentatives nocturnes de nos pickpockets parisiens.
Les rues désertes de Philadelphie ne sauraient vous retenir longtemps, et on se sent attiré vers les rives de l’admirable Delaware.
Les bassins grandioses remplis de navires de commerce et les belles lignes bleues tracées par les eaux du fleuve au courant rapide offrent un spectacle superbe, qu’on voit avec plus de plaisir le dimanche. On peut tout contempler à loisir et rêver à l’aise. Les autres jours, c’est le business perpétuel et l’ardeur fiévreuse du travail.
Sous un des nombreux hangars situés auprès des bassins, je suis bientôt arrêté à la vue d’un assez grand nombre de spectateurs ; beaucoup d’entre eux sont debout, quelques-uns sont assis sur des ballots de marchandises diverses, au milieu d’eux un soi-disant clergyman chante des cantiques avec sa femme. Il fait ensuite un long discours sur la malignité des temps. Il menace la foule des foudres du ciel ; Philadelphie, New-York, etc., seront brûlés, précipités dans les abîmes, si nous autres, pauvres auditeurs, nous ne voulons pas suivre ses préceptes.
Après ces avis charitables mais effrayants, écoutés sous un soleil ardent, on éprouve le besoin de se reposer un instant et même de prendre un rafraîchissement. Hélas, c’est dimanche ! les bars, sans exception, sont fermés. Un pauvre touriste a soif cependant ; comment faire ? Il est avec les règlements dominicaux des accommodements. Les bars sont fermés, vive le pharmacien ! On trouve chez lui tous les sodas et limonades inventés par la civilisation humaine. Les pharmaciens ont dans leur magasin, à côté de toutes les drogues, des vasques à l’antique en marbre rare ; elles sont munies de beaux robinets à col de cygne et, pour quelques sous, on a le dimanche tous les rafraîchissements réconfortants que les bars ne sauraient vous vendre ce jour-là. Nous autres Français, nous ne comprenons guère ces nuances, fort délicates, paraît-il ; mais enfin le but est rempli : on avait soif, on a bu. Le touriste a trouvé ainsi de nouvelles forces, et c’est le splendide Fairmount Park qui va l’attirer. Ce parc est aux environs de la cité, il est grandiose. De liantes collines, des arbres séculaires et la jolie rivière la Schuylkill le traverse. La nature a tout arrangé elle-même dans ces lieux charmants, et il faut avouer qu’ils ne ressemblent en rien à notre bois de Boulogne.
Le dimanche passé, Philadelphie reprend son mouvement extraordinaire. Les maisons de briques avec fenêtres aux chambranles de marbre reprennent leur aspect accoutumé. C’est la résurrection. Les magasins sont remplis de clientes venant faire leurs achats.
Dans Chestnut Street, la rue élégante par excellence, les grands magasins de MM. Sharpless frères, qu’on peut considérer comme le Bon-Marché ou le Louvre de Philadelphie, possèdent un appareil curieux : c’est le cash railway, le chemin de fer des recettes, qu’on peut appeler la boule payante. M. Lamcon en est l’inventeur. Rien de plus ingénieux et de plus commode, et le système est employé déjà dans plusieurs villes des États-Unis, Philadelphie, Cincinnati, San-Francisco, etc. (fig. 7).
Au Louvre et au Bon-Marché, les dames surtout le savent, on est fort ennuyé pour aller payer à la caisse. Il y a toujours une bousculade à affronter. Dans ce beau magasin de Chestnut street cela n’existe pas. Les acheteurs n’ont pas à se déranger. Ils payent directement à l’employé qui les a servis et s’assoient à l’aise. Celui-ci met l’argent et la note dans une boule de bois B. Il la fait monter jusqu’à la petite glissière CC qui s’abaisse aussitôt la boule reçue et la lance sur un petit chemin de fer incliné à rails de bois bordés de cuir pour éviter le bruit (Voir la coupe n° 1). La boule arrive ainsi au centre du magasin, aux bureaux de la caisse. Ces bureaux sont au nombre de deux ; ils sont suspendus, comme la nacelle d’un ballon, au milieu du grand Hall de l’établissement. Ils communiquent cependant aux galeries par de légers escaliers en fer. Il y a tout un réseau de rails de bois pour le parcours de ces boules, correspondant aux différents comptoirs ; ils desservent le rez-de-chaussée et le premier étage des magasins. Les acheteurs ont la vue perpétuelle de cette sorte de canalisation aérienne avec les boules courant en silence à leur destination respective. C’est un aperçu qui ne manque pas d’originalité.
Les comptoirs sont nombreux, les boules ont toutes un diamètre différent et portent des numéros pour éviter la confusion. Les diamètres différents obligent la boule à suivre un embranchement voulu, les rails de bois étant de largeur correspondante, et les numéros rappellent aux employés la place de leur comptoir. Lorsque le caissier central a reçu l’argent envoyé, il donne la monnaie, acquitte la note et met le tout dans la même houle. Il la lance sur le plan incliné inférieur. La houle arrive à destination, l’employé n’a plus qu’à tirer à lui le filet E (Voir détail n° 2), ouvrir la petite boîte et remettre le contenu à l’acheteur qui a pu attendre à sa place sans être inquiété. L’opération tout entière n’a pas duré plus de deux minutes.
Si les magasins sont remplis d’une foule élégante, dans les usines de la ville, des armées d’ouvriers sont à leur intéressante besogne.
Les immenses ateliers Baldwin, entre autres, sont extraordinaires en leur genre. C’est la plus grande fabrique de locomotives et de wagons-réservoirs à pétrole des États-Unis.
À l’entrée de ce palais du travail, grâce à la recommandation d’un de mes bons amis de la ville, on me remet obligeamment un laissez-passer pour visiter tous les ateliers.
J’entre d’abord dans l’immense pavillon où s’achève le montage des locomotives et des wagons-réservoirs à pétrole. Le mouvement y est extraordinaire. On s’y fait cependant, on admire alors l’entrain des ouvriers et le soin qu’ils mettent à terminer et perfectionner leur œuvre ; on pénètre ensuite dans un autre pavillon de même grandeur. Là se trouvent les machines à vapeur destinées à percer ou à tailler les pièces de tôle et de fonte ; puis toutes les fonderies, les marteaux-pilons en marche, les salles où la fonte liquide coule dans les moules, les nombreux ateliers où l’on fait les pièces de moindre importance pour les machines, telles que vis de toutes sortes, objets de cuivre ou d’acier, etc., les salles de dessins pour les modèles, etc. ; on sort de là ébloui. Le bruit assourdissant des travaux vous fatigue dans ces forges de Vulcain où le mutisme absolu chez les ouvriers est commandé. Il est absolument défendu de causer ou de questionner les travailleurs, enveloppés de flammes et de fumée, qui sont occupés dans l’usine, où l’application et l’intelligence règnent en maîtresses.
De Philadelphie à Washington le trajet est court, mais grâce à toutes les facilités que les chemins de fer américains vous procurent, les voyages sont toujours aisés à faire. À l’hôtel même j’avais fait prendre mon billet, et mes bagages ont été enlevés de ma chambre sans que je m’en sois occupé pour ainsi dire.
On entre dans le wagon à l’heure dite, puis, pendant le trajet, un employé vient vous demander dans quel hôtel vos bagages doivent être portés à votre arrivée dans la ville. À l’hôtel, presque en même temps que vous, ils sont portés exactement. Pour tout cela, il n’y a eu que quelques mots à dire à des agents polis et intelligents ; il n’y a rien de plus pratique.
Lorsqu’on vient de quitter Philadelphie et New-York, Washington semble monotone, presque triste. On ne voit point dans ses larges avenues le grand mouvement d’affaires qui règne dans les autres cités des États-Unis.
Les monuments publics sont les curiosités principales. Le Capitole domine tout par son grand aspect. Son dôme est immense, ainsi que les bas-côtés tout encombrés de colonnes. Les salles intérieures sont luxueusement décorées, mais tout cela n’a aucune valeur artistique. Le seul point vraiment intéressant consiste dans le vaste panorama de la ville que l’on découvre, sur les terrasses qui entourent ce grand monument de marbre blanc, et du haut de son dôme.
Là évidemment Washington est superbe. Les belles campagnes, les eaux brillantes du Potomac, lui servent de cadre ; ce spectacle vaut à lui seul plus que tous les monuments de la cité.
On venait de terminer cette année le grand obélisque construit en l’honneur de Washington. C’est le plus haut monument du monde, disent fièrement les Américains ; cela, je le crois sans peine, puisque les chiffres sont là pour le prouver (fig. 8) ; mais il est loin d’être le plus beau en tout cas. Cette grande aiguille n’offre d’intérêt que par la difficulté de sa construction. J’ai pensé qu’il serait curieux d’en signaler les principaux détails.
Le monument de Washington fut commencé en 1848 par une Société particulière.
Le projet, dressé par M. Robert Mills, comprenait un obélisque de 600 pieds de hauteur, soit 180 mètres environ. Cet obélisque devait être entouré d’une colonnade à la base.
Ce projet fut bientôt modifié. On renonça à la colonnade, et l’on réduisit la hauteur de l’obélisque à 152m, 39. C’est dans ces conditions qu’il a été construit, mais en le surmontant d’un pyramidion de 16m, 77, ce qui porte la hauteur totale à 169ra, 16.
La fondation, telle qu’elle avait d’abord été établie par la Compagnie, se composait d’un massif de maçonnerie en gros blocs de gneiss. Ce massif, dont la partie supérieure était à 2m, 30 au-dessous du niveau du sol, avait la forme d’un tronc de pyramide quadrangulaire, de 7 mètres de hauteur, la base inférieure ayant 24 mètres de côté et la base supérieure 17m, 55 de côté.
Cette fondation a été notablement renforcée plus tard, comme nous le verrons.
L’obélisque a 16m, 90 de côté à la base. Chaque face a, en cet endroit, 4m, 50 d’épaisseur, ce qui laisse un vide intérieur carré, de 7m, 90 de côté. Ces faces sont en maçonnerie et moellons de gneiss, avec revêtement de marbre blanc. Les blocs de marbre ont 0m, 60 de hauteur d’assise, avec 0m, 45 à 0m, 38 de longueur en queue.
En 1854, on était arrivé à la hauteur de 45m, 60. En 1856, on ajouta 1m, 20 environ.
Les travaux furent alors abandonnés jusqu’en 1877.
Le 19 janvier 1877, la Compagnie transmit tous ses droits au gouvernement des États-Unis, et les travaux reprirent en 1878, sous la direction de M. Thomas Lincoln Casey.
On commença par renforcer la fondation. Pour cela, on coula, sous l’ancien massif de gneiss, une couche de béton de 4m, 05 d’épaisseur, sauf dans la partie centrale, où l’on conserva un noyau en terre de 13m, 20 de côté. La couche de béton fut prolongée au-delà du massif, de manière à donner à la nouvelle fondation une base carrée de 37m, 95 de côté.
Pour bien répartir la pression sur la nouvelle fondation, on démolit en partie le massif de gneiss, sous la base de l’obélisque, à peu près jusqu’à moitié de l’épaisseur des faces, et l’on remplaça la partie démolie par un massif de béton rejoignant la couche générale de 4m, 05 dont nous avons parlé.
Ces nouveaux travaux de fondation en sous-œuvre furent achevés le 29 mai 1880.
Comme nous l’avons dit, l’obélisque, au moment où les travaux avaient été abandonnés, atteignait la hauteur de 46m, 80 environ. On démolit les dernières assises de manière à ramener la hauteur à 45 mètres, et l’on acheva la construction, en suivant le même système, jusqu’à 150 mètres. À cette hauteur, le côté de la pyramide, qui a 16m, 90 à la base, a 10m, 33. L’épaisseur des faces est de 0m, 45.
À partir de 135m, 60 jusqu’à 150 mètres, les faces sont entièrement en marbre (fig. 9).
Le pyramidion se compose de plaques de revêtement en marbre, de 0m, 18 d’épaisseur, reposant sur douze espèces d’arbalétriers, trois pour chaque face, composés de voussoirs de marbre. Les naissances des arbalétriers sont au niveau de 141 mètres, c’est-à-dire à 9 mètres au-dessous de la base du pyramidion. Sur cette hauteur de 9 mètres, ces arbalétriers ne sont que des nervures en saillie sur l’intérieur des faces de l’obélisque. Dans l’intérieur du monument, on a disposé une ossature métallique qui sert de support à une cage d’escalier et, en même temps, à un élévateur.
Le poids total de la construction est de 81 120 tonnes de 1 015 kilogrammes, et est ainsi réparti :
La dépense totale s’est élevée à 1 187 710 doll. 31, soit 5 938 530 francs, en comptant le dollar à 5 francs. Sur cette somme, 1 500 000 francs avaient été dépensés par la Compagnie qui avait commencé le monument.
Le grand monument de Washington a été déjà atteint par la foudre plusieurs fois. Heureusement que les précautions avaient été prises à cet effet. Le cône terminal de l’obélisque est en aluminium ; il se trouve relié électriquement au sol par les quatre colonnes métalliques de l’ascenseur. Cette disposition a fait victorieusement ses preuves. La foudre n’a causé aucun dégât.
Non loin de cet obélisque, dans un parc considérable planté de beaux arbres, on a construit des pavillons fort bien aménagés pour les travaux divers des hommes de la science. La géologie, la botanique, la paléontologie, etc., ont là leur service particulier. Les laboratoires, les bibliothèques, sont installés largement et d’une façon aisée pour l’étude. Un curieux bâtiment réservé aux pêcheries et à la pisciculture complète tout cet ensemble qui entoure les grandioses galeries du Muséum d’histoire naturelle. M. le professeur Spencer Baird a bien voulu m’en montrer tous les détails. Dans quelques années les collections fort nombreuses auront pu être mises en place méthodiquement ; ce sera alors un des plus curieux musées qu’on puisse voir. Le public ne peut considérer actuellement qu’une faible partie de toutes ces richesses. Il y a déjà dans de grandes salles des échantillons de minéralogie du pays et des fossiles remarquables ; des objets de toutes sortes forment ensuite un curieux mélange ; cela donne une idée de ce que sera plus tard ce bel ensemble de curiosités de la science et de la nature.





























