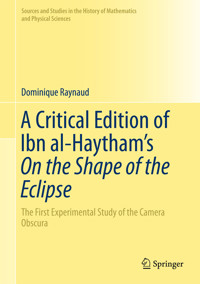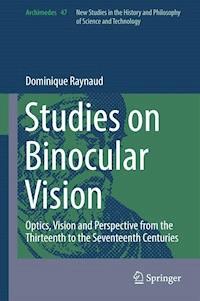Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Matériologiques
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Pourquoi l’activité scientifique est-elle conflictuelle ?
Brisant l’image idéale de la science consensuelle, les controverses scientifiques sont aujourd’hui devenues un sujet privilégié de la sociologie et de l’histoire des sciences. Elles sont par ailleurs impliquées au cœur des débats sur les méthodes des sciences sociales. Si l’analyse des controverses scientifiques doit beaucoup aux approches inaugurées par les courants relativistes et constructivistes des années 1970-1980, ce livre montre que les études contemporaines ont tout à gagner à réintroduire ce qui a été le principal tabou des trente dernières années : la vérité. Cette conclusion n’est pas le résultat d’une méditation abstraite sur le destin de la sociologie et de l’histoire des sciences. C’est le résultat d’études de cas, portant sur des disciplines telles que la biologie (la thèse des générations spontanées, débattue entre Pasteur et Pouchet), de la médecine (le vitalisme opposé à la médecine expérimentale naissante), de la stéréotomie (les « Guerres perspectives » qui ont agité le Paris des années 1640), de la perspective (la mathématisation de la perspective linéaire dans l’Italie du XVIe siècle) ou de l’optique (la question de l’intromission, discutée à Oxford). L’auteur défend une théorie incrémentaliste du progrès scientifique : pour autant qu’il suive des règles, le débat est un moyen pratique de tester la robustesse d’une théorie et de départager les théories rivales. Le fait que les débats soient marqués par la passion et les émotions est sans intérêt ; l’important est que ces échanges réglés puissent, par la production d’arguments publics, s’approcher de la vérité. C’est une façon de répondre à la question : Pourquoi l’activité scientifique est-elle conflictuelle ?
Plongez dans cet ouvrage qui cherche à interroger les rôles de la rationalité, des conventions et des croyances collectives dans la construction des théories scientifiques.
EXTRAIT
Cette corrélation entre le style de raisonnement, la formation, et le type de comportement social du chercheur n’est pas pour surprendre. Toutes proportions gardées, Terry Shinn (1980) a observé qu’il existe une correspondance entre la formation reçue par un chercheur et le mode de comportement social qu’il adopte par la suite. Les contextes de production scientifique sont sans doute trop différents pour extrapoler les résultats de Shinn à la controverse entre Pasteur et Pouchet, mais sa démonstration éclaire le type de relations que l’on est en droit de rechercher à partir des « styles de raisonnement ».
À PROPOS DE L'AUTEUR
Dominique Raynaud enseigne à l’Université de Grenoble Alpes. Architecte de formation, sociologue et historien des sciences, il a consacré l’essentiel de ses recherches à la géométrie, à l’optique, à la perspective linéaire et aux sciences de la conception, en étudiant notamment les relations entre théorie et pratique (mathématisation et application). Parmi ses productions récentes :
Géométrie pratique. Géomètres, Ingénieurs, architectes, XVIe-XVIIIe siècle (Besançon, 2015, livre collectif);
Scientific Controversies. A Socio-Historical Perspective on the Advancement of Science (New Brunswick, 2015) qui cerne les limites de la sociologie des sciences relativiste-constructiviste à partir de documents d’archives;
Optics and the Rise of Perspective. A Study in Network Knowledge Diffusion (Oxford, 2014) qui explore la diffusion de l’optique dans le réseau des universités médiévales;
La Sociologie et sa vocation scientifique (Paris, 2006) qui est une étude d’épistémologie comparée des sciences naturelles et des sciences sociales. Il est également l’auteur d’articles dans
Annals of Science, Archive for History of Exact Sciences, Early Science and Medicine, Historia Mathematica ou
Physis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 864
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dominique Raynaud
Sociologie des controverses scientifiques
Préface de Mario Bunge
Nouvelle édition revue et augmentée
Éditions matériologiquesCollection « Sciences & Philosophie »
La collection « Sciences & Philosophie » aux Éditions Matériologiques dirigée parPhilippe HUNEMAN (IHPST), Guillaume LECOINTRE (MNHN), Marc SILBERSTEIN (EM)
Extraits du catalogue :
Larry Laudan, Science et relativisme. Quelques controverses clefs en philosophie des sciences (décembre 2017).
Marc Silberstein (dir.), Qu’est-ce que la science... pour vous ? (mars 2017).
Françoise Parot, La Psychologie française dans l’impasse (janvier 2017).
Mario Bunge, Entre deux mondes. Mémoires d’un philosophe-scientifique (septembre 2016).
Dominique Raynaud, Qu’est-ce que la technologie ? (février 2016).
Jean-Pascal Capp, Nouveau regard sur les cellules souches (décembre 2015).
L’évolution, de l’univers aux sociétés, sous la direction de Muriel Gargaud & Guillaume Lecointre (novembre 2015).
Jean Génermont, Une histoire naturelle de la sexualité (décembre 2014).
La Biodiversité en question. Enjeux philosophiques, éthiques et scientifiques, sous la direction de Elena Casetta & Julien Delord (juin 2014).
Apparenter la pensée ? Vers une phylogénie des concepts savants, sous la direction de Pascal Charbonnat, Mahé Ben Hamed, Guillaume Lecointre (février 2014).
Matériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain, sous la direction de Marc Silberstein (décembre 2013).
Dominique Raynaud, Sociologie des controverses scientifiquesNouvelle édition revue et augmentée (1re édition, PUF, 2003)
ISBN (papier) 978-2-37361-135-9eISBN (PDF) 978-2-37361-136-6eISBN (ePub) 978-2-37361-158-8ISSN 2275-9948
© Éditions Matériologiques, janvier 2018.
51, rue de la Fontaine au Roi, F-75011 Paris
materiologiques.com / [email protected]
Conception graphique, maquette, PAO, corrections, couverture : Marc Silberstein
Fabrication de l’ePub : Vahagn Terzian
DISTRIBUTION LIVRE PAPIER : Éditions MatériologiquesDISTRIBUTION EBOOKS : Cairn, Numilog, Primento, etc.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français du copyright, 6 bis, rue Gabriel-Laumain, 75010 Paris.
Préface de Mario Bunge
PhilosopheMcGill University, Montréal
Jusqu’aux années 1950, l’étude des communautés scientifiques était une tâche pour les philosophes, les sociologues et les historiens des sciences qui cherchaient des vérités sur la science, cet animal si convoité mais tellement insaisissable. Il suffit de se souvenir des études d’Henri Poincaré, Émile Meyerson, Federigo Enriques, le Cercle de Vienne, Karl Popper, Ernest Nagel, Richard Braithwaite, Aldo Mieli, George Sarton, Robert K. Merton.
Dans son classique « Science and the Social Order » paru dans la jeune revue Philosophy of Science en 1938, Merton soutenait que les particularités de la science fondamentale sont le désintéressement, l’universalité, le communisme épistémique et le scepticisme organisé – pas le doute d’un chercheur isolé, donc, mais l’examen critique conduit par la communauté tout entière.
Contrairement à ce qu’on dit ses critiques ultérieurs, Merton n’était pas un parachutiste improvisé mais le premier sociologue professionnel de la science. Ses professeurs furent les principaux sociologues de son époque : Pitirim Sorokin, George Sarton, Talcott Parsons – et aussi le chimiste, biologiste et sociologue Lawrence J. Henderson, à qui l’on doit d’avoir adapté et popularisé le concept de système social. Grâce à sa femme, Harriet Zuckerman, Merton a connu de nombreux lauréats du prix Nobel, qui lui ont expliqué en détail ce qui les avait motivés, comment ils avaient travaillé et comment leurs communautés scientifiques respectives les avaient tantôt stimulés, tantôt freinés.
En résumé, vers 1950, Merton était reconnu comme le plus savant des membres de la petite communauté des études sur la science. Il était aussi le plus équilibré d’entre eux. Merton n’était pas idéaliste, mais il mettait l’accent sur le désintéressement de la recherche fondamentale ; il n’était pas positiviste, mais il admettait la nature continue et cumulative des sciences ; et quoique n’étant pas marxiste, il reconnaissait pleinement le rôle de l’intégration sociale au sein de la communauté scientifique, et les pressions économiques et politiques auxquelles elle est soumise.
Tout le monde ne partageait pas ses conceptions, très populaires à cette époque. Certains pensaient qu’elles ressemblaient aux descriptions de l’éléphant données par les six aveugles de la légende indienne. Pourtant, l’une ou l’autre de ces descriptions pouvait aider à trouver l’éléphant qui s’est échappé du cirque, car toutes portaient un grain de vérité. Oui, la vérité : la bête noire des postmodernes.
Soudain, en 1962, les éléphants et les aveugles indiens ont disparu : dans La Structure des révolutions scientifiques, Thomas S. Kuhn, un esprit obscur, a estimé que les scientifiques ne recherchaient pas la vérité parce qu’une telle chose n’existe pas – pas plus que le corpus des connaissances qui se développe en étant constamment corrigé et approfondi.
La thèse centrale de Kuhn était que, de temps à autre, apparaissent des révolutions scientifiques qui balaient tout ce qui précède. Ces changements radicaux ne résoudraient pas les problèmes scientifiques posés de longue date, mais répondraient à des changements de Zeitgeist ou des modes culturelles, comme Wilhelm Dilthey l’avait évoqué. Par conséquent, les scientifiques ne trouveraient, ne confirmeraient et ne réfuteraient rien du tout. Comme l’a déclaré son ami et compagnon d’armes, Paul Feyerabend, « anything goes ».
Bref, pour Kuhn comme pour Feyerabend, l’idée de la recherche scientifique comme quête de la vérité était en crise ; la science n’était qu’une question d’opinion et de changement social. Par la suite, tout prétendant pourvu d’assez de chutzpah1 a obtenu un poste dans l’un des centres de « Science Studies » ou l’un des programmes « Science et société », qui ont proliféré dans les décennies suivantes.
Cette contre-révolution a été si massive et si brutale qu’elle a pris de court la communauté universitaire. Je me souviens d’avoir assisté à la confrontation mémorable entre Popper et Kuhn qui a eu lieu au Bedford College dans l’été 1965. J’ai vu de mes yeux comment Popper a adopté une tactique défensive et a tenté de minimiser ses différences avec Kuhn. Popper disait ne s’être jamais intéressé à ce que Kuhn appelait « la science normale » et tentait même de gagner les bonnes grâces de son adversaire en l’appelant Tom2.
Karl aurait pu demander à Tom de donner sur le champ des exemples de révolutions qui avaient remplacé des hypothèses confirmées et congruentes avec l’essentiel des connaissances acquises. Mais il ne pouvait pas employer cette tactique en raison de son scepticisme radical et de son mépris pour la sociologie de la connaissance. Par ailleurs, Popper ne pouvait pas demander à Tom des exemples, car il avait affirmé dans ses textes que seuls importent les contre-exemples !
Dans son Popper and After (1982), le philosophe australien David Stove a montré que le scepticisme radical de Popper était proche de l’antiscientisme de Kuhn, de Feyerabend et de Lakatos. Cependant, sa critique était si irrévérencieuse, et l’alternative proposée si naïve – le retour au sens commun et à l’inductivisme – que personne ne le prit au sérieux.
Au début, j’ai sous-estimé les bouffonneries antisciences des Kuhn, Feyerabend et de leurs homologues français. Je pensais qu’il s’agissait d’une mode passagère qui avait eu un peu de succès parce qu’elle surfait sur la vague de la défiance envers la science, que les contestataires du campus de Berkeley venaient tout juste de dénoncer comme complice du complexe militaro-industriel.
Je pensais aussi que ces prétendants qui se donnaient le titre d’experts scientifiques utilisaient l’astuce que Diderot avait suggérée à Rousseau quand il était venu à Paris en quête de célébrité : attaquer l’opinion dominante, selon laquelle les sciences et les arts contribuent au progrès de la civilisation. Rousseau suivit le conseil et son Discours sur les sciences et les arts (1750) lui valut une renommée immédiate.
Il m’a fallu environ deux décennies pour comprendre la gravité des dommages que les cyniques infligeaient au fonctionnement du milieu universitaire et pour comprendre la raison de leur succès : ils flattaient tous les étudiants et tous les chercheurs qui avaient choisi la « grande porte », celle des études culturelles, des études de genre et de la communication scientifique. Toute révolution se déroule selon le même scénario, en raflant le pouvoir aux élites de la génération précédente.
J’ai finalement réagi dans deux articles de 1991 et 1992 parus dans Philosophy of the Social Sciences, où j’examinais non seulement les positions des principaux anti-mertoniens, mais aussi celles de certains de leurs précurseurs, de Karl Marx à Ludwik Fleck – le premier qui a prétendu que les « faits scientifiques » sont inventés par les scientifiques. Le jeune Kuhn connaissait cette thèse scandaleuse, mais Bruno Latour l’a brillamment exploitée en l’instillant dans des esprits ayant déjà subi le matraquage de Louis Althusser et de Michel Foucault.
Dans ces articles, j’ai également retracé les racines philosophiques de la contre-révolution en marche : le subjectivisme de Berkeley et de Kant, ainsi que le sociologisme (ou externalisme) de Marx, qui jugeait en 1859 que « la société pense à travers l’individu ». Boris Hessen, l’« intellectuel organique » russe, comme Gramsci l’aurait appelé, a appliqué cette thèse à Newton et l’a exposé avec grand succès au Deuxième Congrès international d’histoire des sciences, qui s’est tenu à Londres en 1931.
Mes articles eurent infiniment moins de succès qu’Impostures intellectuelles (1997) des physiciens Alan Sokal et Jean Bricmont, publiées à la suite du canular hilarant de Sokal : « Transgresser les limites : vers une herméneutique transformationnelle de la gravité quantique » (1996). Sa publication dans Social Text révéla la totale ignorance de ses éditeurs. Les Science Wars, qui ont tiré toute leur énergie de l’enthousiasme et du soutien à la science engendré par cet « ovni », sont encore actives.
Le scientisme3, fort et prestigieux il y a un siècle, est maintenant faible et discrédité dans les humanités. La conception mertonienne réaliste de la science fondamentale a été désertée par les étudiants de la métascience, ceux de droite comme ceux de gauche.
Le scientisme est aussi abhorré dans les sciences sociales, où les déclarations d’idéologues conservateurs comme Friedrich Hayek, Leo Strauss, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Samuel Huntington et Francis Fukuyama sont davantage connues que les études sobres de Robert Merton, son professeur George Sarton, ou Joseph Needham, biochimiste de formation et historien érudit de la culture chinoise.
Mais tout à coup, à Grenoble, loin des lumières de Paris, apparaît Dominique Raynaud, architecte de formation, sociologue et historien des sciences – une combinaison singulière. Raynaud reprend la ligne de travail rigoureuse de Robert Merton et de son école. Le travail de Raynaud est silencieux et solide. Ses études de cas minutieuses n’étant pas tape-à-l’œil, elles ont peu de chances de déclencher l’hystérie populaire.
La plupart des publications de Raynaud sont des études de cas approfondies de contributions particulières à la science et à la technologie. Ses travaux précédents ont porté principalement sur les « sciences géométriques » – pour reprendre le mot de d’Alembert –, de la géométrie à l’optique, de la perspective linéaire à l’architecture. Il a aussi fortement insisté sur l’inscription du processus scientifique dans la longue durée : la géométrie et l’optique ont mis deux millénaires à être développées ! La géométrie descriptive a évolué lentement grâce à sa mathématisation progressive, de la coupe des pierres médiévale jusqu’à Gaspard Monge, ce mathématicien révolutionnaire qui fut un acteur central de la création de l’École normale de l’an III et de l’École polytechnique.
La visée de Raynaud est de trouver des vérités enterrées dans les documents d’archives et les revues spécialisées. Oui, Raynaud cherche la vérité, et non le pouvoir que Foucault et ses partisans imaginent tapi au cœur de la science, laquelle n’est pour eux que de « la politique par d’autres moyens ».
Raynaud poursuit le travail de mes vieux amis, Robert Merton et Raymond Boudon, et celui de son mentor, Joseph Ben David. Dans ce livre, Raynaud s’attaque aux controverses scientifiques, telles que le débat sur la génération spontanée entre Pasteur et Pouchet, ou la controverse relative à la propagation de la lumière qui divisait les savants du Moyen Âge.
Raynaud a également une vision claire des Science Wars de ces dernières décennies. Pour lui, les controverses scientifiques sont des débats sur la vérité. Évidemment, certaines d’entre elles ont des harmoniques motivationnelles et idéologiques. Mais aucune d’entre elles n’a été résolue par une décision politique arbitraire. Même si des autorités extrascientifiques ont pris part à de grandes controverses, comme celle de l’héliocentrisme défendu par Galilée ou de la génétique attaquée par Lyssenko, à la fin, la vérité l’a emporté.
Ma propre expérience de polémiste confirme la thèse de Raynaud selon laquelle ces luttes portent sur la vérité, et non sur le pouvoir. Elles impliquent exclusivement des désaccords conceptuels. En particulier, la conception selon laquelle la mécanique quantique se réfère à des événements mentaux, et non à des objets physiques autonomes, suggère d’extraire les référents des concepts fondamentaux de la théorie plutôt que d’écouter les opinions ex cathedra de ses fondateurs. Les prétentions scientifiques de la théorie du choix rationnel exigent de savoir si les concepts fondamentaux – ceux d’utilité subjective et de probabilité subjective – sont bien définis sur le plan mathématique et si l’expérience soutient l’hypothèse du comportement de maximisation. La valeur de la psychanalyse peut être évaluée à la fois en laboratoire et dans la clinique psychiatrique, ainsi que par le fait de tester sa prétention au statut de science.
Que la vérité, et non le pouvoir, soit en jeu dans tous ces cas, ainsi que dans ceux discutés par Raynaud, est un argument en faveur du scientisme – thèse selon laquelle il est avantageux que tout objet de recherche soit étudié en suivant des méthodes scientifiques4. C’est aussi un argument contre l’intuitionnisme caractéristique de l’école « humaniste » et le sociologisme typique des premières écoles, marxiste et durkhémienne, de sociologie de la connaissance.
Dans ses travaux de sociologie ou d’historiographie, Raynaud considère ces disciplines comme des branches de la science, et non des Geisteswissenschaften nécessitant une méthode particulière, comme le Verstehen ou la compréhension empathique exaltée par Dilthey dans son manifeste antiscientiste de 1883. Pour sûr, se mettre dans la position de A (ça ne coûte rien !) peut aider à expliquer pourquoi A pense ou fait B, mais n’explique pas B lui-même. De même, situer A dans son contexte social peut aider à expliquer pourquoi B a été valorisé ou non au sein d’une organisation sociale, mais ne rend compte de B lui-même.
En raison de son adhésion à la méthode scientifique, Raynaud écrit clairement et justifie toujours ses vues. Les idées à l’emporte-pièce comme « anything goes ! », ou les formules creuses comme « la science est de la politique par d’autres moyens », ne sont pas pour lui. Raynaud cherche à construire, pas à déconstruire ; à clarifier, pas à obscurcir. C’est un chercheur prudent, pas un idéologue en quête de célébrité immédiate. Par conséquent, nous pouvons apprendre de lui et, le cas échéant, engager avec lui des dialogues féconds plutôt que des foires d’empoigne. Il est, en somme, un chercheur pré-post-moderne, comme aurait dit Merton.
[1]Ndé : mot yiddish que l’on peut traduire par assurance, audace, culot...
[2]Ndé : cet épisode est décrit en détail dans l’autobiographie de Bunge, Entre deux mondes. Mémoires d’un philosophe-scientifique, Paris, Éditions Matériologiques, 2016, dans la section « Le match Kuhn-Popper » du chapitre 7, p. 246-248. Voir aussi p. 507-510.
[3]Ndé : comme ce terme est très péjoratif dans son usage courant en France depuis le XIXe siècle, il convient d’avertir les lecteurs que Bunge l’entend différemment : « Doctrine selon laquelle la recherche scientifique est la meilleure façon d’acquérir une connaissance factuelle, précise et fondamentale. À ne pas confondre avec la doctrine selon laquelle la recherche scientifique est la seule source de connaissance, ou celle selon laquelle tout résultat scientifique est vrai et définitif » (extrait de l’entrée « Scientisme » du Dictionnaire philosophique de Mario Bunge, Paris, Éditions Matériologiques, trad. fr. par François Maurice, à paraître en 2018).
[4] Voir les contributions de Mario Bunge et de Dominique Raynaud au volume collectif Elogio del cientificismo, Pamplona, Editorial Laetoli, 2017.
[Avant-propos]
Je suis heureux de livrer cette nouvelle édition – revue et augmentée de quatre chapitres – de Sociologie des controverses scientifiques. Ce livre, paru aux Presses universitaires de France en 2003, était épuisé depuis longtemps et n’était plus disponible en français (une adaptation américaine a été publiée par Transaction Publishers en 2015).
Le regain d’intérêt pour l’étude des controverses (Gingras, dir. 2014 ; Pécharman 2016 ; Ragouet 2014 ; Turner 2014 ; Keuth 2015 ; Vons 2015 ; Acevedo-Díaz et al. 2016ab, 2017 ; Ragouet 2016 ; Martín-Pastor et Granado-Castro 2017 ; Zilsel 2017) me donne le prétexte de situer ce livre, ses enjeux et ses résultats.
Dans une étude de la controverse sur la mémoire de l’eau – qui doit être saluée comme l’une des rares études de controverse scientifique parue en langue française, même si elle se fonde trop sur des sources de deuxième main, Pascal Ragouet (2016) met avant un principe de retrait épistémologique, selon lequel la description et l’analyse d’une controverse ne sauraient être « des objectifs subordonnés à l’ambition de défendre un parti épistémologique quel qu’il soit » (2016 : 21). C’est, selon lui, l’un des principaux travers de la sociologie des sciences « relativiste constructiviste », mais « les sociologues portés par le rationalisme n’ont pas fait mieux » (2016 : 21). Après avoir défini la controverse comme une « dynamique des échanges argumentatifs et contre-argumentatifs », il avance que, « dans les études proposées par les constructivistes relativistes, [cette dynamique] est généralement fortement négligée, et, dans les travaux des rationalistes, est orientée par l’objectif de défendre avant tout le rationalisme » (2016 : 22).
L’auteur cherche une troisième voie entre relativisme et rationalisme, constructivisme et réalisme. Je ne crois pas que soit une position viable dans l’étude des faits scientifiques. Voici pourquoi.
D’abord, ce retrait implique que les chercheurs subordonneraient leur étude « à l’ambition de défendre un parti épistémologique ». L’expérience montre pourtant qu’ils mobilisent une position épistémologique pour renouveler la saisie des données empiriques. L’ordre est donc plutôt : toute position épistémologique oriente le choix d’une méthode, toute méthode oriente la recherche d’un résultat, ce qui n’a pas de rapport avec la « défense d’un parti ».
Ensuite, la proposition du principe de retrait épistémologique repose sur une conception un peu schématique des positions formant le bipole : le constructivisme et le rationalisme. Le rationalisme paraît assimilé au rationalisme à la Descartes, fait de longues chaînes de raisons tirées de vérités premières. Or, de Karl Popper (1935) à Susan Haack (1993), diverses tentatives ont été faites pour réintroduire les apports de l’empirisme au sein du rationalisme. En évitant de jargonner, on peut dire que la connaissance vise le vrai, et compte tenu de ce que vrai veut dire, on ne peut pas mieux dire que le rationalisme contemporain se caractérise par son attention à la dimension matérielle et probatoire de l’investigation scientifique.
Enfin, se tenir à égale distance du constructivisme et du rationalisme présuppose que ces deux positions présentent les mêmes dangers. C’est oublier qu’historiquement la haine de la raison a toujours conduit à l’obscurantisme, lequel est incompatible avec la pratique de la science, et donc de la sociologie. Dans certaines alternatives, il n’y a pas de troisième voie : il faut choisir. Mon choix est fait.
Je poursuis cette revue par le dossier sur les controverses préparé par la revue Zilsel (2017 : 123-184)1. On trouve dans ce dossier – qui ne comporte aucune étude empirique de controverse scientifique – l’idée que le champ de recherche serait saturé, qu’il provoquerait des redites et, par suite, une certaine lassitude (Lamy 2017 : 128). Il suffit pourtant de relire des analyses anciennes du débat sur la « force vive » (Hankins 1965 ; Laudan 1968 ; Iltis 1970, 1971) ou des travaux exotiques (Li 2010, 2011 ; Junges 2013) pour faire disparaître ce sentiment. L’impression ne provient pas d’un état objectif des recherches mais de la sélection unilatérale des travaux répétitifs d’une même école de pensée – on notera que la cartographie des controverses est souvent en ligne de mire. La conclusion aurait été différente, si l’enquête avait eu plus d’épaisseur.
Le dossier témoigne aussi d’une certaine impatience à voir s’ouvrir une nouvelle ère de la sociologie des sciences. Pourquoi pas, mais l’impatience n’est toujours pas bonne conseillère. Dans le compte-rendu très injuste du livre de Ragouet – qui témoigne d’une méconnaissance du sujet des controverses : toute attaque ad hominem est disqualifiée – on lit que les sociologues des sciences seraient tous des « réalistes » :
Insister... sur les questions de flexibilité interprétative et de contingence n’est pas nier tout rôle à la matérialité du monde et aux objets. Cela consisterait à réduire la pratique scientifique à une pure spéculation, position que n’assume, à notre connaissance, aucun chercheur au sein des SSK puis des STS2 (Kenotita 2017 : 177).
C’est tellement faux qu’un philosophe a pu dresser une liste des antiréalistes qui intègre à peu près tous les auteurs importants du domaine :
La sociologie de la connaissance, la théorie de la culture et les études des sciences sont des domaines où l’antiréalisme est aujourd’hui devenu l’approche orthodoxe (voyez par ex. Barnes 1985 ; Fuller 1989 ; Knorr-Cetina & Mulkay 1983 ; Latour 1987 ; Latour & Woolgar 1979 ; Rouse 1987 ; Woolgar 1988a, 1988b). De là, la diffusion rapide des thèses de la philosophie des sciences récente (post-kuhnienne), qui offrent un puissant soutien à la thèse antiréaliste (Norris 2004 : 262).
Après tout, un exemple suffisait : « Avant Koch, le bacille n’a pas de réelle existence » (Latour 1998 : 84).
L’antiréalisme du « Ramsès II » avait été épinglé par François Sigaut au moment de sa sortie – il s’amuse de « cette leçon magistrale à la Pierre Dac » (Sigaut 1998) – avant d’être revisité par Paul Boghossian (2006 : 26).
Cette nouvelle édition de Sociologie des controverses scientifiques apporte des réponses un peu différentes. Pour commencer, les effets de répétition notés par certains observateurs résultent avant tout du défaut des méthodes employées, et notamment : 1/ Le recours parfois extrêmement ténu aux preuves matérielles à partir desquelles construire l’explication ; 2/ La dépendance du discours à des slogans idéologiques comme : « voir les théories comme des inscriptions littéraires », « donner une deuxième chance aux vaincus », etc. ; 3/ Une définition tellement élastique du fait « controverse » – toute discussion non close – que l’objet n’a plus de limites.
Ce livre fait le pari inverse. 1/ Partir d’une définition stricte des controverses scientifiques et se tenir à cet objet : même si d’autres sujets sont intéressants, il ne faut pas tout mélanger. 2/ Documenter matériellement la description et l’explication, en se tenant au carrefour de la sociologie des sciences par le sujet d’étude, de l’épistémologie et de l’histoire des sciences par la façon de procéder.
Le lecteur trouvera une définition des controverses scientifiques identique à celle de 2003 mais précédée d’une section inédite : « Ce que (ne) sont (pas) les controverses scientifiques », à même d’expliquer le choix de cette définition. J’ai également conservé la classification des controverses en huit traits, qui a été beaucoup reprise depuis 2003 – et même plagiée3.
Cette nouvelle édition reprend, à quelques détails près, les chapitres 1 (les Science Wars), 2 (Pasteur et Pouchet), 3 (les écoles de médecine de Paris et de Montpellier), 7 (les théories de la vision) et 9 (les emprunts à Duhem, Quine et Wittgenstein).
Quatre chapitres du livre sont inédits. Le chapitre 4 présente une controverse constructive du XVIIIe siècle, dans le contexte d’un abandon des règles empiriques d’évaluation de la poussée des voûtes au profit d’une application des premières lois de la statique.
Le chapitre 5 traite de l’implication de l’architecte-mathématicien Girard Desargues dans les « Guerres perspectives » dans le Paris des années 1640. Cette dispute marginal-sécante est relativement célèbre, mais la découverte de nouveaux documents dans les fonds du Parlement de Paris justifiait d’en préciser le déroulement et les enjeux. Je remercie Clément Costarella de m’avoir autorisé à joindre notre étude à ce livre.
Le chapitre 6 analyse la controverse du XVIe siècle sur la mathématisation de la perspective linéaire. Comme on le verra, ce débat est une controverse multidimensionnelle, qui fait intervenir plusieurs questions articulées les unes aux autres.
Le chapitre 8, s’amusant de la conversion d’une certaine « sociologie des sciences » en « anthropologie des sciences », se décentre du contexte de la « science institutionnelle » pour s’intéresser à la façon dont les controverses scientifiques ont été perçues dans le monde arabe médiéval. Ce sera l’occasion de présenter la première théorie des disputes savantes, élaborée par le mathématicien astronome al-Samarqandī aux environs de 1302.
Au total, l’ouvrage a été augmenté de quatre nouveaux chapitres, passant ainsi de 222 pages à 428 pages.
&&&
Je remercie Mario Bunge d’avoir rédigé la préface de ce livre : son nom suffit à indiquer qu’une preuve peut être reconnue comme telle par un philosophe, par un sociologue et par un historien des sciences. Puisse cette démarche faciliter l’échange entre les trois communautés. Je remercie Marc Silberstein, des Éditions Matériologiques, d’avoir produit ce livre avec rigueur et enthousiasme.
Qu’ils soient assurés de ma gratitude.
Grenoble, 21 septembre 2017
[1] Ma sympathie pour ce collectif de jeunes chercheurs est tempérée par une question : pourquoi s’être placé sous l’égide de Zilsel ? « The Social Roots of Science » s’ouvre sur une phrase fausse : « Pleinement développée, la science ne se trouve que dans la civilisation européenne et américaine moderne » et se ferme sur une phrase fausse : « Vers 1600, avec les progrès de la technique, la méthode expérimentale est adoptée par des chercheurs habitués à raisonner, issus de la classe supérieure cultivée. » Je ne dirai pas ce que je pense de ce qui se trouve entre la première et la dernière phrase (Zilsel 2003 : 3-6).
[2]NdDR : SSK : Sociology of Scientific Knowledge. STS : Science and Technology Studies.
[3] « Nous avons formalisé un cadre méthodologique adapté à nos travaux autour de huit dimensions à visée descriptive... objet... intensité... polarité... forum... extension... reconnaissance... durée... règlement » (Barbier et al. 2012: 18).
[Introduction]
Les controverses au carrefour de deux spécialités
Les controverses scientifiques peuvent être définies provisoirement comme des débats organisés se donnant pour but des valeurs de connaissance. Elles relèvent en droit de deux spécialités de la sociologie.
Si l’on privilégie la forme, les controverses sont assimilables à des débats ou à des joutes oratoires publiques qui rentrent dans la catégorie des conflits. Ce qui distingue les débats des autres formes de conflit est, si l’on suit Anatol Rapoport, qu’« ici le but n’est ni de nuire à son adversaire [combat], ni de le surpasser par sa finesse [jeu agonistique] ; il s’agit de le convaincre, de lui faire adopter son propre point de vue. [...] Si ce but n’est pas perdu de vue, le débat nous apparaît comme très différent du combat ou du jeu : on devra utiliser des concepts différents pour son analyse » (Rapoport 1967 : 7).
Si l’on privilégie le contenu, maintenant, les controverses portent sur des énoncés qui sont liés étroitement à une forme d’activité spécifique : produire des connaissances vraies (stables et robustes) sur le monde. Les controverses scientifiques risquent d’adopter des formes de développement et de règlement qui ne coïncident pas totalement avec celles qui caractérisent une controverse politique, religieuse ou artistique, et ce, en raison même de la spécificité des connaissances engagées dans les débats. C’est pourquoi l’étude des controverses scientifiques doit absolument tenir compte des acquis de la sociologie de la connaissance scientifique – notée SSK (Sociology of scientific knowledge).
On rappellera à la suite les orientations générales et les principaux résultats de ces deux spécialités.
1] La sociologie des sciences
La sociologie des sciences est une spécialité issue de la sociologie de la connaissance et, en particulier, de la Wissensoziologie allemande (Scheler 1926, Mannheim 1952). Créée à la fin des années 1930 par Robert K. Merton, la sociologie des sciences est longtemps restée marquée par l’impulsion que lui avait donnée son fondateur.
Après une thèse portant sur le développement scientifique de l’Angleterre du XVIIe siècle (Merton 1938a), ses recherches ont concerné divers aspects de l’activité scientifique.
On lui doit tout d’abord une contribution importante à la méthodologie de la sociologie de la connaissance. Dans un article publié dans Isis en 1937, Merton énonce cinq paradigmes de la spécialité (1973 : 7-40). Face à une connaissance donnée, le sociologue pourrait se poser les questions suivantes :
Où :
Quelle est la base existentielle des connaissances
1
? Que sait-on des acteurs qui adhèrent à une connaissance, du point de vue social : âge, sexe, mode d’organisation, etc., ou culturel : opinion, ethos,
Weltanschauungen
, etc. ?
Quoi :
Qu’analyse-t-on sociologiquement dans ces connaissances ? Quelles sphères : savoirs scientifiques, idéologies politiques, croyances morales ou religieuses, etc., et quels aspects : relation théorie-pratique, rapport à l’expérimentation, etc., sont concernés ?
Comment :
Comment les connaissances sont-elles reliées à leur base existentielle ? S’agit-il d’un lien causal : détermination, conditionnement, interdépendance, influence, etc., d’un lien sémantique : harmonie, congruence, analogie, etc. ?
Pourquoi :
Pourquoi (ou « en vue de quoi ») les connaissances sont-elles reliées à leur base existentielle ? S’agit-il de produire des savoirs théoriques ou utiles, de contrôler la nature, d’orienter l’action, de prendre le pouvoir ?
Quand :
Dans quelles conditions socio-historiques cette relation entre connaissance et base existentielle est-elle obtenue ? S’agit-il d’une connaissance dépendante du contexte socio-historique ? d’une connaissance universalisante ?
Ces cinq questions définissent une approche canonique des problèmes de la sociologie de la connaissance. Mais on remarquera également que les points 4 et 5 contiennent en germe tous les éléments d’une autonomisation de la connaissance scientifique vis-à-vis de la connaissance tout court. En effet, une théorie scientifique n’a pas pour but de répondre aux fonctions manifestes d’une idéologie politique : parvenir au pouvoir, galvaniser l’esprit des militants, etc. (point 4). Les concepts scientifiques sont, au contraire des dogmes religieux, des connaissances universalisantes (point 5). Une fois ce point acquis, il fallait s’interroger sur les conditions qui permettent à des connaissances scientifiques de s’universaliser et qui garantissent l’autonomie des institutions scientifiques au sein de la société.
Dans l’article consacré à la « Structure normative de la science », Merton (1942) définit le concept d’ethos par « l’ensemble des valeurs et des normes teintées d’affectivité, auxquelles l’homme de science est censé devoir se conformer » (1973 : 267-278) ; « teintées d’affectivité » parce que ces normes n’ont pas de caractère technique, comme l’usage du système d’unités MKSA, mais un caractère déontologique ; « censé devoir se conformer », parce que le savant n’est pas obligé de les suivre, c’est juste une attente de ses pairs. Les normes principales de l’ethos scientifique sont (sans s’y limiter) l’universalisme, le communisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Des objections ont été soulevées contre cette théorie (Barnes et Dolby 1970, Mitroff 1974, Vinck 1995 : 31-40). Face à l’universalisme, ils ont fait valoir que les chercheurs sont en proie à des biais idéologiques (Norton 1978) ; face au communisme, qu’ils aiment le secret (Petroski 1996) ; face au désintéressement, qu’ils pratiquent la fraude (Kolata 1987) ; face au scepticisme organisé, qu’ils manifestent un attachement aux idées (Weschler 1978). Ces critiques, qui se limitent à la recherche de contre-exemples (Vinck 1995 : 31-40), conduisent à des résultats douteux, non pas parce que les transgressions sont inexistantes – les premiers cas ont été étudiés par Merton ! (1942, 1957, repris en 1973 : 274-276, 309-316) – mais parce qu’un contre-exemple ne peut rien contre une norme.
C’est un problème de méthode : si l’on veut réfuter la thèse de Merton, il faut travailler à partir de son organisation logique. La normativité ne peut être appréciée qu’à partir de la réponse à la transgression de la norme. Si les normes de l’ethos scientifique n’existent pas, on devrait pouvoir trouver : 1/ des comportements « normaux », ajustés à la norme, qui entraînent une sanction ; 2/ des comportements déviants valorisés. Une norme de comportement ne peut pas être réfutée par la simple présentation de comportements déviants mais seulement par la preuve que la communauté valorise les comportements déviants. Or, c’est impossible car un comportement valorisé par la communauté est par définition un comportement normal. C’est toute la limite de la démarche des sociologues anti-mertoniens qui ont exhibé des fraudes : l’enquête n’a jamais été poussée au-delà de la présentation de contre-exemples. On sait pourtant que lorsqu’ils sont découverts, les fraudeurs paient généralement un lourd tribut2. De ce point de vue, la critique de l’ethos scientifique est volumineuse mais de faible portée.
L’une des particularités les plus saillantes des études mertoniennes est d’attirer l’attention simultanément sur les principes de l’organisation scientifique et sur les effets pervers qui résultent de leur mise en place. Ainsi, le contrôle par les pairs témoigne du fait qu’il existe une relative indivision des taches en science (par exemple : le rapporteur d’un article n’est pas spécialisé dans le contrôle des manuscrits qui lui sont soumis). Mais de cette apparente égalité de droits émane en réalité une solide gérontocratie (les rapporteurs sont choisis parce qu’ils sont des spécialistes d’une question ; un spécialiste se reconnaît au nombre et à la qualité de ses publications ; publier des travaux de qualité exige du temps ; par conséquent, les jeunes chercheurs sont rarement appelés aux fonctions de rapporteur). Autre exemple d’effet pervers, le système méritocratique de la science, qui récompense les chercheurs pour leurs découvertes, est inégalitaire en vertu de l’effet Matthieu (1973 : 439-459). Celui-ci rend compte du fait que les chercheurs reconnus ont plus de chances d’attirer la reconnaissance. Ainsi, lorsqu’on présente à des physiciens des articles collectifs et qu’on leur demande ensuite quels étaient les auteurs de tel ou tel article, ils ne se souviennent que des noms les plus prestigieux, en oubliant fréquemment les coauteurs de l’article : le prestige appelle le prestige.
Assez paradoxalement – puisque la sociologie des sciences est née dans le giron de la sociologie de la connaissance – la sociologie mertonienne s’est surtout attachée à étudier les facteurs sociaux qui orientent la production des connaissances plutôt que la connaissance elle-même. Ce trait se déduit de ce que les connaissances scientifiques sont, pour Merton, des connaissances à visée universelle extirpées des conditions socio-historiques dans lesquelles elles sont nées. Ce faisant, le marin n’a pas de raison de préciser qu’il utilise une « boussole d’origine chinoise », le calculateur de rappeler qu’il utilise un « zéro d’origine indo-arabe ». Les conditions universelles qui régissent l’usage de la boussole et du zéro, rendent inutile – sauf peut-être pour l’historien des sciences, soucieux d’étudier la diffusion des connaissances – de signaler l’attachement de ces inventions à leur contexte d’invention. Jusqu’à une date récente, la sociologie des sciences laissait à l’épistémologie et à l’histoire des sciences l’analyse des connaissances scientifiques.
La publication de La Structure des révolutions scientifiques de Thomas S. Kuhn (1962), alliée à la redécouverte de certains textes, comme ceux de Pierre Duhem (1914), Ludwig Fleck (1935) ou Karl Polanyi (1958), a marqué l’avènement d’une nouvelle façon d’envisager l’étude des sciences, qu’on a pris l’habitude de désigner social turn (ce qui est un peu abusif, puisqu’il y a eu en réalité plusieurs tournants). Le trait le plus saillant de ce courant – en rupture avec la sociologie mertonienne – est que les connaissances scientifiques peuvent elles-mêmes être un objet d’étude sociologique. Le livre de David Bloor s’ouvre sur la phrase : « La sociologie peut-elle enquêter et expliquer le contenu et la nature mêmes de la connaissance scientifique ? » (Bloor 1976 : 1). Peter Slezak a bien vu que « l’idée radicale au cœur du programme fort est de dépasser les études sociologiques précédentes qui ont reculé devant l’idée que le contenu réel des théories scientifiques – les idées – pouvait être un domaine de recherche sociologique » (1994b : 143). Ainsi est né le projet de la SSK réalisant, du coup, une extension et une offensive de la sociologie des sciences sur le terrain de l’épistémologie et de l’histoire des sciences. La volonté de renouer avec les sociologues pré-mertoniens (Durkheim, Mannheim, etc.) y est souvent sensible.
Ce courant d’étude des sciences a porté une attention particulière à la construction des connaissances scientifiques. C’est sans doute la raison pour laquelle l’étude des controverses scientifiques est devenue un sujet privilégié de cette spécialité. Sans chercher l’exhaustivité, on recense une centaine de publications spécialisées sur ce thème3. Pour des raisons diverses, cet objet d’étude n’a commencé à susciter l’intérêt qu’à la fin des années 1960 (chapitre 1). Il est devenu un objet régulier de recherche à la fin des années 1980. À trente ans d’intervalle, il est tentant de faire un bilan.
Les textes de sociologie des sciences rédigés dans les années 1980 contiennent des indices clairs de la valorisation de cet objet d’analyse. Dans l’introduction de La Science telle qu’elle se fait, Michel Callon et Bruno Latour parlent ainsi d’une « entrée royale par les controverses » (1991 : 26). Ce n’est qu’ultérieurement que ce terrain d’élection a été réinvesti par des positions critiques.
2] La sociologie des conflits
Cette spécialité, plus ancienne que la sociologie des sciences, a suscité de nombreux travaux au nombre desquels on peut citer ceux de Simmel (1908), Coser (1956), Rapoport (1960) et Caplow (1968), pour se limiter à quelques contributions classiques4.
L’étude de Georg Simmel sur le « conflit » (Streit)occupe une place à part, tant en raison de son plan erratique que de l’extrême variété des cas qui y sont étudiés. Simmel met l’accent sur le fait que, en dépit de leur antagonisme, les adversaires se « soumettent à des normes et des règles reconnues des deux côtés. [...] La même chose se produit partout où les parties sont animées par un intérêt objectif » (1992 : 48, 52). La deuxième proposition importante de Simmel est que des facteurs sociaux peuvent être responsables de la force de l’antagonisme : existence de qualités communes et appartenance à un contexte commun (1992 : 59). Des relations étroites favorisant un antagonisme plus fort, l’appartenance de scientifiques à une même discipline et à une même communauté devrait pousser une controverse à un degré de tension plus élevé que la moyenne. Selon Simmel, l’existence d’un médiateur aurait pour effet de réduire l’antagonisme, en expurgeant le conflit de ses éléments passionnels et agressifs. Il faut enfin remarquer que l’appendice (1992 : 141-157), consacré aux formes de résolution des conflits, force l’attention, non tant par l’exactitude de sa typologie empirique, que par le caractère visionnaire des remarques qui précèdent les travaux actuels sur le règlement des controverses scientifiques. Au total, si l’on devait se risquer à un jugement, on pourrait dire que les remarques touchant à la science5 paraissent moins importantes que les propositions générales, dont les conditions de transposition aux controverses scientifiques restent encore à étudier.
L’étude de Lewis Coser, Les Fonctions du conflit social (1982), prolonge les observations de Simmel dans un cadre plus systématique. Le principal intérêt de cette analyse est de combler un vide dans la tradition fonctionnaliste, qui s’était toujours détournée de l’analyse des conflits. La critique avait été formulée par Merton (1953 : 96-99), mais c’est à Coser que l’on doit l’initiative d’une analyse fonctionnaliste des conflits. Trois propositions forcent l’attention. 1° Un conflit est d’autant plus violent que les adversaires sont liés, alors que l’interdépendance des groupes et des individus freine l’apparition des clivages (1982 : 53)6. 2° Un conflit entre deux groupes renforce la cohésion à l’intérieur de chaque groupe (1982 : 63). 3° la fin d’un conflit est d’autant plus rapide que le conflit se déroule dans un cadre institutionnalisé (1982 : 104). Les démonstrations de Coser sont convaincantes, mais leur extrapolation aux controverses scientifiques n’est pas acquise. Par exemple, il est difficile d’affirmer que les intérêts qui sont en jeu dans un débat scientifique sont de même nature que ceux que l’on trouve dans un conflit social.
Les recherches de Theodor Caplow (1971) sur les coalitions s’inscrivent aussi dans la perspective simmelienne. Elles partent d’un examen de la fonction du tiers dans un conflit. Le tiers peut être : un médiateur, un tertius gaudens ou un despote (1971 : 39). Dans le premier cas, l’apparition d’un médiateur impartial présuppose l’absence de coalition des parties. Dans le second cas, un tertius gaudens exploite à son avantage le dissensus entre les rivaux. Le troisième cas est celui où un despote entretient un conflit entre deux autres acteurs de manière à servir ses propres intérêts. C’est sur cette base que sont étudiés les types de coalition qui apparaissent dans une triade. Après avoir exposé les résultats expérimentaux obtenus sur le jeu indien de pachisi, Caplow passe en revue un certain nombre de situations dans lesquelles on assiste à la formation de coalitions.
On trouve ainsi une analyse détaillée du différend qui opposa, en 1949, l’office du logement, le conseil municipal et le maire de Chicago, au sujet de la construction de logements publics (Caplow 1971 : 236-246). Le point de vue de l’office du logement était qu’il fallait augmenter la capacité résidentielle de la ville ; celui du conseil municipal, qu’il valait mieux entreprendre une politique de rénovation urbaine. L’office du logement (libéral) tenta alors de former une coalition avec le maire, de manière à contraindre le conseil municipal (conservateur) d’adopter la première proposition. Après une phase initiale de neutralité, le maire finit par se coaliser, non pas avec l’office du logement, mais avec le conseil municipal. Au cours de cette controverse politique, le maire fit l’objet d’expectations diverses, en raison de sa position privilégiée. Comme le souligne Caplow : « Le maire était soumis aux forces en présence, mais il jouissait d’assez de liberté d’action pour faire pencher la balance [...] à chaque tournant du conflit » (1971 : 246).
Je me suis attardé sur cet exemple – sans aucun rapport avec la science – parce qu’il illustre parfaitement les difficultés qu’on peut rencontrer dans l’application des résultats de la sociologie des conflits aux controverses scientifiques. Le type de coalition politique qui vient d’être décrit, où le différend est réglé à l’avantage du camp le plus puissant, peut-il être transposé aux débats scientifiques ? La question reste entière. Deux lignes argumentaires sont envisageables. Si l’on argue de la généralité des conduites humaines (on peut appeler cela : ordinarisme, anti-différenciationnisme), on peut être tenté de répondre oui. Si l’on argue de la spécificité des pratiques scientifiques, on répondra non. C’est là toute la difficulté : on pressent que les résultats de la sociologie des conflits pourraient s’appliquer aux débats scientifiques, mais on ne sait pas exactement comment et dans quelle mesure. La littérature produite sur les controverses scientifiques occupe d’ailleurs à peu près tout le spectre entre la position selon laquelle les pratiques et les intérêts scientifiques sont indifférenciés, et celle selon laquelle les pratiques et les intérêts scientifiques sont hautement différenciés. Selon la deuxième position, il n’existe pas de structure homogène de la sphère des intérêts et des valeurs, mais plutôt une construction spécifique de valeurs et d’intérêts relatifs à l’activité propre des acteurs. Cette spécificité ne permet pas de mettre sur le même plan : un débat politique, un acte de concurrence économique ou une controverse scientifique. Les règles du jeu sont, à chaque fois, différentes.
3] Ce que (ne) sont (pas) les controverses scientifiques
La première tâche qui incombe à qui veut étudier les controverses scientifiques est de définir correctement l’objet d’étude. On reconnaît immédiatement la grande polysémie du domaine. Les incertitudes touchent à la forme : parlera-t-on de discussion, de débat, de différend, de dispute, de querelle, de polémique ? au statut des discutants : les débats ont-ils lieu seulement entre scientifiques ou agrègent-ils d’autres individus ? au fond : les débats portent-ils sur les théories ou sur d’autres aspects de la vie scientifique ? Comme toutes les combinaisons sont possibles, la définition de l’objet n’en est que plus compliquée. Cette section passera en revue des situations limites. Elle servira à proposer une définition des controverses scientifiques.
3.1] Échanges de vues
Les controverses sont des exercices dialogiques : il faut au moins deux locuteurs pour qu’il y ait controverse. Tout dialogue, toute conversation, tout échange de vues présente des points communs avec une controverse scientifique. Est-ce suffisant ?
On trouve sur les blogs dédiés aux sciences, une grande variété de discussions portant sur des questions controversées. Le débat Big Band Alternatives : Could Light Just Get Tired ? (Alternatives au Big Bang : la lumière peut-elle seulement être fatiguée ?) a duré près de huit mois sur Scienceblog.com (8 octobre 2010-30 mai 2011). Rappelons quelques éléments d’histoire pour mieux comprendre l’enjeu du débat. En 1929, Edwin Hubble et Milton Humason établissent par l’étude spectroscopique de 46 galaxies une relation entre distance des galaxies et vitesse de récession. Ils observent que les raies d’absorption et d’émission du spectre de la galaxie sont décalées vers le rouge en proportion de sa distance. Comme ce décalage peut être interprété comme un effet Doppler-Fizeau, il indique la vitesse relative de la galaxie par rapport à l’observateur (ce sera le principal appui expérimental de la théorie du Big Bang proposée par Georges Lemaître en 1922). Cette théorie, qui a progressivement acquis le statut de théorie standard, a soulevé des oppositions dès sa parution. Fritz Zwicky a avancé une hypothèse alternative dès 1929 : les photons perdraient de l’énergie durant le vol (par interaction avec d’autres photons, avec la matière, ou par un mécanisme inconnu). Cette perte, qui serait proportionnelle à la distance, expliquerait autrement le décalage vers le rouge de la lumière provenant de galaxies lointaines (Zwicky 1929). Si un tel phénomène existait, il réfuterait la thèse de l’expansion de l’univers. Depuis 1929, l’hypothèse de Zwicky a été régulièrement reprise dans la littérature astrophysique et cosmologique (e.g. Finlay-Freundlich 1954ab ; de Broglie 1966 ; LaViolette 1986 ; Pecker et Vigier 1986 ; Marmet 1988). Cette théorie est incompatible avec les données actuelles.
Scienceblog.com ayant publié un exposé à charge contre l’hypothèse de la « fatigue de la lumière », on trouve dans le fil de discussion une vingtaine de commentaires, parfois acerbes, sur l’exposé de départ. Les éléments passionnels qui affleurent dans les échanges suffisent-ils pour déclarer l’existence d’une controverse scientifique ? L’analyse rélève un obstacle majeur : les discutants ne se sentent pas tenus de débattre de la même question. Les débats ne sont pas suivis. Ils sautent rapidement d’une question à une autre. Il est question de l’univers primordial (8 octobre 2010, 8:42), de la matière noire (9 octobre, 4:53), de l’énergie (9 octobre, 9:17), du temps (11 octobre, 4:58), etc. Même s’il y a désaccord entre les discutants, il est difficile de reconnaître ici l’existence d’une controverse scientifique au sens strict. Il manque au cas de la « lumière fatiguée » une dimension essentielle de l’objet que nous avons en vue : les discussions ne sont pas focalisées. Tant que des individus ne s’astreignent pas à débattre d’un sujet défini, il n’y a pas controverse, mais simple échange de vues. Employer, comme le font Latour et les promoteurs de la cartographie des controverses (Venturini 2010 ; Yaneva 2011, etc.) le terme « controverse » à propos de toute discussion techno-scientifique « non stabilisée » déspécifie totalement l’objet d’étude « controverse scientifique » (sur ce point, voir chapitre 4). Il vaudrait mieux parler ici de dialogue, échange ou conversation7.
3.2] Différends, désaccords
Lorsque des chercheurs sont en désaccord, il arrive parfois qu’ils choisissent de ne pas exposer publiquement leur différend, ou que des médiateurs se présentent spontanément pour apaiser les tensions avant que le désaccord ne devienne public. Ils évitent ainsi le phénomène de l’escalade assez typique des controverses scientifiques. Dans les deux cas, le problème est « réglé » (enterré ou abandonné) sans atteindre le seuil de visibilité nécessaire pour donner lieu à une controverse.
Une dispute de ce type a eu lieu dans années 1930-1940 entre Hubble et Adriaan van Maanen à propos de la vitesse de récession des galaxies. Le profil particulier de cette dispute s’explique en partie par l’appartenance des deux astronomes au même observatoire du Mont Wilson. Pour van Maanen, les galaxies (on les appelait alors des « nébuleuses ») étaient des objets stellaires-gazeux situés au sein de notre galaxie. Pour Hubble, qui venait de découvrir la loi du redshift (décalage vers le rouge)qui porte son nom (Hubble 1929), les galaxies étaient dotées de vitesses si élevées qu’elles ne pouvaient être que des objets extragalactiques. Van Maanen ayant produit des mesures de vitesse favorables à sa thèse, Hubble déclara que ses résultats tombaient « dans la fourchette d’incertitude ». Il vit alors – selon son propre témoignage – sa critique repoussée d’une façon « sauvagement personnelle » par van Maanen. Dans le même temps, un allié de van Maanen rapporte que Hubble faisait preuve d’un « esprit vindicatif [...] en s’exprimant de façon intolérante et immodérée » à l’égard de van Maanen. Toutefois, le différend entre Hubble et van Maanen sur la nature des galaxies ne parvint pas à se constituer en véritable controverse. Elle fut étouffée par deux médiateurs : l’administrateur de l’observatoire Walter S. Adams, et le responsable des publications Frederick H. Seares. Le second écrit notamment :
Deux hommes appartenant à la même institution ont la possibilité de se rencontrer et de discuter ensemble de leurs travaux, ils ont donc l’occasion de résoudre leur conflit d’opinion. Il me semble que l’institution est dans l’obligation de veiller à ce que tous les conflits soient autant que possible résolus avant publication. S’il n’y a pas moyen de mettre les gens d’accord, l’institution peut être amenée à dire comment les résultats seront présentés au public (lettre de janvier 1945 ; Sharov et Novikov 1995 : 85).
Adams et Seares firent tout leur possible pour que les deux hommes résolvent leur différend en privé. Hubble décida finalement d’ignorer la contradiction avec les résultats de van Maanen et de se taire. Il manque donc à cette dispute entre Hubble et van Maanen une dimension importante des controverses scientifiques régulières : les arguments n’ont pas été produits publiquement. Dans ce cas, il vaut mieux parler de différend privé8.
On retrouve ce caractère dans la correspondance échangée entre 1692 et 1700 par Leibniz et Papin au sujet de la force vive (vis viva) – même s’il a existé une controverse publique sur cette question (Iltis 1971 ; Freudenthal 2002 ; Smith 2006 ; Rey 2013). On trouve un caractère mixte dans la lettre sur la saignée, dans laquelle Vésale prend le parti des Modernes contre les Anciens, c’est-à-dire préconise la « saignée dérivative » et non la « saignée révulsive ». Cette lettre est adressée explicitement à un ami et parent médecin, Nicolas Florenas. Mais sa publication à Bâle en 1539 donne à Vésale un moyen détourné d’attaquer les partisans de la manière ancienne, notamment Jeremias de Drijvere ou Thriverius (1504-1564), professeur de médecine à Louvain (Vons 2015).
Parfois encore, un désaccord passe insensiblement du différend privé à la controverse publique. Ce fut le cas de la discussion sur la nature des taches solaires qui opposa Scheiner et Galilée. En avril 1611, le père jésuite Christoph Scheiner observe des taches sur le disque solaire avec une lunette. Il adresse, sous un pseudonyme, trois lettres publiques au banquier et humaniste Marcus Welser. Ses Tres Epistolae de maculis solaribus (1612) réfutent la réalité des taches qui entacheraient la perfection du Soleil : « Je juge que ce ne sont pas de vraies taches, mais plutôt des corps qui éclipsent le Soleil partiellement9. » Galilée s’étant fait connaître par ses observations astronomiques, Welser lui demande de donner son avis. Galilée lui adresse tout d’abord plusieurs lettres privées, entre le 14 mai et le 1er décembre 1612, dans lesquelles il maintient que les taches solaires, qu’il a lui même observées, ne sont pas des ombres portées mais des accidents de la surface même du Soleil. Scheiner, qui avait continué entre-temps d’étudier le phénomène, adressera trois nouvelles lettres à Welser entre le 16 janvier et le 25 juillet 1612. Elles seront publiées sous le titre De maculis solaribus et stellis circa Iovem errantibus accuratior disquisitio, sans que son auteur ne démorde de son explication initiale : « À la fin, que les taches soient dans le Soleil ou hors de lui, qu’elles soient engendrées ou non, qu’on puisse les appeler des nuages ou non, tout cela reste douteux10. » Devant l’immobilité de Scheiner – et aussi parce que le bruit courait à Bologne que l’explication de Galilée était ridicule11 – le savant italien décida de parfaire sa réfutation et de la communiquer à ses amis Maffeo Barberini et Giuliano de Medici. Le prince Federico Cesi, fondateur de l’Accademia dei Lincei, demanda que ce texte soit publié. Dans Istoria e dimostrazioni intorno alle machie solari e loro accidenti (Galilei 1613), Galilée apporte des preuves physiques et géométriques que les taches sont des accidents de la surface du Soleil. On voit ici que, si les jésuites n’avaient pas propagé la rumeur que Galilée était dans l’erreur, celui-ci se serait probablement contenté de ses réponses privées à Welser. Le qu’en-dira-t-on est à l’origine de la transformation de ce différend privé en controverse publique (Shea 1970 ; Van Helden 1996 ; toutes les pièces de la controverse ont été traduites en anglais : Galilei et Scheiner 2010).
3.3] Querelles de priorité
La littérature sociologique et historique emploie parfois le nom de controverse lato sensu pour se référer à des conflits – parfois très vifs – entre des chercheurs responsables d’une découverte scientifique.
La découverte du VIH en 1983 a été âprement discutée pour savoir si elle devait revenir à l’Américain Robert Gallo (Institute of Human Virology, Baltimore) ou au Français Luc Montagnier (Institut Pasteur, Paris). En 1974, Gallo est un pionnier de la recherche virologique qui identifie le premier rétrovirus humain, le HTLV (Human T-Cell Leukemia Virus). En 1983, avec ses collaborateurs Jean-Claude Chermann et Françoise Barré-Sinoussi, Montagnier met en culture les lymphocytes d’un malade atteint du sida, hospitalisé à la Salpêtrière. Le rétrovirus dont il est porteur, le LAV, est observé au microscope électronique le 4 février 1983. Pendant ce temps, l’équipe américaine travaille sur le rétrovirus HTLV-1, également suspecté d’être responsable de la maladie. Le 20 mai 1983, Science publie les papiers de Montagnier (LAV) et de Gallo (HTLV-1) côte à côte. Gallo, corrigeant le résumé de Montagnier, souligne la parenté entre le LAV et le HTLV. Quelques mois plus tard, lors de la conférence de Long Island, Montagnier présente ses résultats sur les rapports entre LAV et sida ; Gallo objecte que c’est son rétrovirus, le HTLV-3, qui est responsable de la maladie. Comme l’équipe française classe le LAV dans les lentivirus, Gallo prétendra que HTLV (oncovirus) signifie Human T-Cell Lymphotropic Virus, de manière à le faire rentrer dans la même catégorie des lentivirus. En août 1984, la comparaison entre le HTLV-3 et le LAV montre qu’ils sont issus du même patient. Cela pose la question de l’origine des souches mises en culture par les laboratoires. En 1986, une commission indépendante rebaptisera HIV les deux virus, désormais identifiés, nom qu’il a conservé depuis. Rétrospectivement, la querelle entre Gallo et Montagnier n’avait pas beaucoup de sens : le LAV et le HTLV-3 étaient le même virus (Heilbron et Goudsmit 1987).
On sait désormais que le 17 juillet 1983, Montagnier transmit le LAV à Mikulas Popovic, du laboratoire de Baltimore. Comme le HTLV-3 fut mis en culture le 15 novembre 1983, l’antériorité revient au LAV. Le règlement de cette dispute se fera en plusieurs étapes. En 1987, Montagnier et Gallo finissent par s’entendre sur un partage des redevances des droits de brevets sur le test sérologique de dépistage du VIH. En 1992, la dispute ayant été rendue publique, une enquête est diligentée par le comité d’éthique des National Institutes of Health : Gallo, qui n’a jamais reconnu l’origine du HTLV-3, est accusé de faute déontologique. En 2008, après vingt ans de polémique, le prix Nobel de physiologie et médecine est décerné à Montagnier et à Barré-Sinoussi pour leur découverte du VIH. L’absence de mention du nom de Gallo vaut reconnaissance de la paternité de l’équipe de l’Institut Pasteur. Peut-on parler d’une controverse scientifique Montagnier versus Gallo ? Non, car s’il existe bien un conflit, le désaccord porte exclusivement : 1° sur l’antériorité de la découverte ; 2° sur le partage de la redevance ; 3° sur la notoriété des laboratoires français et américains. Aucune de ces questions ne concerne la connaissance du monde proprement dite. Il s’agit de questions historiques, économiques ou de prestige.
Il manque à la dispute sur le VIH une dimension constitutive importante des controverses : les chercheurs sont en désaccord, non pas sur un point de science (LAV = HTLV-3) mais sur des questions périphériques de la pratique scientifique : à qui revient la découverte ? Il s’agit simplement d’une querelle de priorité. Les confusions sont fréquentes dans la littérature. Le texte « History’s scars – A Scientific Controversy in 1965 » (Audin 2011) expose en réalité une querelle de priorité mathématique entre Gaston Julia et Paul Montel à propos des « points de Julia » dont Montel revendiquait la paternité : les travaux de Montel dataient de 1903-1904, ceux de Julia des années 1917-191812.
3.4] Controverses technologiques
Il existe d’autres situations historiques qui ressemblent à des controverses scientifiques et n’en sont pas quand on en fait l’analyse détaillée.
Le bug de l’an 2000 a été l’une des dernières grandes peurs du XXe siècle. Les premiers ordinateurs étaient extrêmement volumineux et n’avaient pas beaucoup de mémoire. Les informaticiens de l’époque ont utilisé toutes les stratégies possibles pour réduire l’espace de stockage des données. C’est dans ce cadre qu’ils ont choisi d’écrire une année par ses deux derniers chiffres, par exemple : « 80 » pour 1980. Aucune réflexion n’a été menée sur les conséquences de ce choix avant que le deuxième millénaire pointe le bout de son nez. On s’est donc rendu compte assez tard que les ordinateurs allaient passer de « 99 » à « 00 », c’est-à-dire à une date antérieure qui risquait d’effacer les données des ordinateurs. Dans les années 1990, plusieurs informaticiens (Peter de Jaeger, Vincent Balouet, etc.) ont commencé à s’inquiéter des incidents que cela pourrait causer. Beaucoup de services (électricité, banques, trafic aérien, hôpitaux, armée) utilisent des programmes informatiques. Il était normal de s’en inquiéter et de concevoir le cas échéant des procédures ad hoc permettant d’éviter le risque. On a alors prétendu qu’IBM avait reconnu le bug de l’an 2000 avec l’arrière-pensée de faire des bénéfices en renouvelant le parc des ordinateurs. Des ingénieurs ont essayé de rassurer la population, d’autres furent plus alarmistes.
Le cas de l’aviation civile est un bon indicateur des incertitudes et des lectures contraires données par les uns et les autres à cette époque. Les systèmes informatiques de l’aviation sont anciens, donc « archaïques » par rapport aux secteurs où l’informatique a été introduite plus tard. Aux heures de pointe, le trafic est toujours à la limite du système. Sur les grands aéroports historiques (Chicago, New York, Paris), des ordinateurs s’occupent de réguler le trafic aérien. Que faire en cas de panne ? Un responsable de l’aviation civile déclarait : « Aucun problème. Si une anomalie apparaît, nous repasserons en manuel. » À condition toutefois que les autres services (distribution d’électricité, communications, etc.) fonctionnent normalement13. Aux États-Unis, un rapport du General Accounting Office (1998) estimait au contraire que l’aviation civile n’était pas du tout prête pour le passage à l’an 2000. Certains porte-paroles du constructeur Boeing firent même des annonces contre-productives : « Les avions ne s’écraseront pas. [...] Si quelque chose arrive, ils ne décolleront pas. » Ce message a évidemment renforcé les inquiétudes : il reconnaissait que quelque chose pouvait arriver et ne parlait que des avions au sol. Qu’allait-il advenir des avions en vol ?
Le fait que le bug de l’an 2000 ait entraîné des débats et des réponses émotionnelles suffit-il pour reconnaître l’existence d’une controverse scientifique ? Il manque à ce cas un nouvel aspect essentiel des controverses scientifiques. Dans le cas du bug de l’an 2000, les acteurs ne furent pas en désaccord dans l’interprétation de la nature du problème, mais, dans le meilleur des cas, dans la façon de résoudre un problème matériel. Il vaudrait mieux réserver à ce cas le terme de controverse technologique. Cette réserve n’est pas gênante : les controverses technologiques sont elles-mêmes bien étudiées (voir notamment Kurrer 2008 ; Chatzis 2011 ; Acevedo-Díaz et al. 2016).
3.5] Débats publics sur les sciences et techniques
Le cas précédent se décline différemment lorsque le débat ne touche pas les spécialistes d’une discipline mais l’opinion publique.