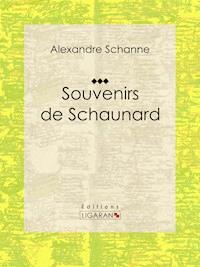
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le livre de la Vie de Bohème met en scène quatre personnages principaux ; mais il ne fait leur biographie que par à peu près ; et s'il donne leur portrait, c'est sans ressemblance garantie, car la main d'un romancier-poète les a transfigurés à plaisir. Je les ai connus vivants. Rodolphe, c'est Murger. Colline est un composé du philosophe Jean Wallon et de Trapadoux dit le « Géant vert »..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076554
©Ligaran 2015
À la mémoire de mes Parrains de Lettres
HENRY MURGER
ALBERT DE LA SALLE
Le livre de la Vie de Bohème met en scène quatre personnages principaux ; mais il ne fait leur biographie que par à peu près ; et s’il donne leur portrait, c’est sans ressemblance garantie, car la main d’un romancier-poète les a transfigurés à plaisir.
Je les ai connus vivants.
Rodolphe, c’est Murger.
Colline est un composé du philosophe Jean Wallon et de Trapadoux dit le « Géant vert ».
On retrouve dans le peintre Marcel Lazare et Tabar.
Schaunard, c’est Alexandre Schanne ; c’est moi.
Mais pourquoi Murger m’a-t-il, seul entre tous, attifé d’un pseudonyme transparent ?
Dans les sobriquets qui me furent prodigués (vers 1840) pour parodier mon nom lorrain de Schanne, j’avais le choix parmi ceux-ci : Schannard-sauvage, Schanne-en-jonc, Schanne-à-pèche et bien d’autres. Ils trouvaient cela drôle.
J’en oublie un que cependant j’ai gardé longtemps : Maréchal Nez ! Mes camarades trouvaient sans doute que si, dans l’état militaire, le nez s’augmente par la progression du grade, j’étais digne, partant caporal, d’arriver maréchal.
Or, il se trouva que Murger, publiant dans le Corsaire ses premières scènes de la Vie de Bohème, m’y donna un rôle en m’appelant Schaunard. Le premier n du mot, ayant été renversé par l’imprimeur, devint un u, ce qui faisait Schaunard. Mais la faute ne fut point corrigée, probablement parce qu’elle n’avait pas l’importance qu’elle prend dans des papiers d’héritage ; si bien que c’est à cette « coquille » que je dois l’orthographe définitive de mon nom de guerre.
Champfleury est, je crois, le premier qui m’a désigné devant le public sous les deux syllabes Schanne, à moi appartenant. Voici au surplus mon portrait tel qu’il l’a dessiné dans ses Souvenirs des Funambules :
« L’occasion est trop belle pour que je ne donne pas ici le portrait d’un ami qui ne m’a guère quitté depuis dix ans, et qui s’est jeté avec moi corps et âme dans la musique, dans la faïence, dans les chansons populaires, dans la peinture naïve. Joignez à cela un vif sentiment de la littérature, une ardente curiosité pour la médecine, une sensibilité extrême qui ferait croire qu’il a un harmonica dans le cœur, une vive supériorité sur les femmes, des mélodies franches et mélancoliques à la fois, une grande gaieté de caractère ; un certain laisser-aller dans la toilette, un nez remarquable, et vous aurez mon ami Schanne tout entier, quittant le chevalet pour le piano, et se demandant à toute heure du jour : "Suis-je peintre ou musicien ?" De l’art il n’a pris que le dessus du panier, et il a laissé les inquiétudes, les soucis, les tristesses, les amertumes qui sont au fond. Tel est mon brave ami Schanne, qui doit certainement une partie de sa gaieté à l’influence permanente des polichinelles suspendus au plafond de son père, fabricant de joujoux, rue aux Ours. »
Ce morceau de prose si net et si senti, trop bienveillant à coup sûr, j’aurais dû le transcrire à l’encre rouge pour marquer la confusion où il me jette, et l’atteinte qu’il porte à ma modestie. Ne devait-il pas suffire à l’ambition d’un homme qui se croyait oublié depuis trente ans qu’il cherche à s’effacer ? Eh bien ! non. Il me va falloir y ajouter des notes et commentaires anecdotiques qui, à vrai dire, auront surtout trait aux autres. Si donc je vous entretiens de moi et me mets en scène dans les pages qui vont suivre, c’est que j’ai besoin d’un prétexte pour raconter la vie des chers compagnons de ma jeunesse.
D’ailleurs, dernier survivant du « quatuor Murger », me voilà réduit au rôle de soliste, et, comme tel, je dois parler pour tout dire.
Mon aïeul paternel, ouvrier habile, fabriquait des vernis et broyait des couleurs. (Est-ce donc d’héritage que j’ai un tel amour pour la peinture ?) Il fut apprenti avec Giroux père, qui laissa à ses enfants l’un paysagiste, l’autre marchand de tableaux et fantaisies curieuses rue du Coq-Saint-Honoré, une véritable fortune acquise en commençant par la vente des couleurs dans les ateliers d’artistes du Directoire. Moins entreprenant, mon grand-père resta ouvrier trente-quatre ans dans la même maison.
Vers la fin de sa carrière, il appela près de lui son fils aîné, en le faisant venir de Roussy-le-Village (Moselle) pays dont il était originaire.
Comme il fallait beaucoup d’argent pour l’établir fructueusement dans son métier, il le plaça d’abord chez son voisin fabricant de jouets, nommé le père Guibard qui demeurait dans la rue des Gravillers, passage de la Marmite.
Tout jeune, mon père assista et aida aux travaux de défense des Buttes-Chaumont en 1814. Il appartenait à la classe qui fut licenciée sous Louis XVIII. Muni de son certificat de libération, sans perdre de temps, il se maria et s’établit avec quinze cents francs en 1817 ; travaillant dur (comme il a toujours fait), aidé de sa femme et d’un garçon de son pays âgé de quatorze ans.
Mon grand-père qu’il avait pris chez lui, put vivre encore six années et assister à ses succès commerciaux, dus à l’heureuse idée qu’il eut le premier à Paris, de remplacer sur ses animaux en carton, la peinture et le velouté en les couvrant de véritables peaux avec laine et poil.
C’est donc rue des Gravillers N° 54 au quatrième étage, dans la maison du marchand de couleurs où mon grand-père avait tant travaillé, que le vingt-deux décembre 1823, j’aspirai pour la première fois une bouffée d’air ; habitude que j’ai conservée depuis !…
Quelque temps après, mon père abandonna ce logement trop petit pour son industrie et prit en totalité une maison rue Jean-de-l’Épine, disparue aujourd’hui dans les démolitions de la place de l’Hôtel-de-Ville.
Possesseur de quarante-deux-mille francs en écus, gagnés dans son métier, il faillit acheter une ferme dans son pays où la terre, par suite de deux invasions successives, se vendait pour rien. Ce qui aurait fait de moi un petit laboureur. Ma mère, en vraie parisienne, ne voulut pas s’enterrer vivante à la campagne, selon son dire.
C’est alors qu’ils vinrent se fixer rue Montmartre, près de celle des Jeûneurs, où mon père continua sa fabrication de jouets pendant que ma mère tenait une boutique passage des Panoramas, à la place où se trouve aujourd’hui la petite galerie conduisant à la rue Vivienne.
J’avais trois ans et demi, lors de ce deuxième déménagement. Colis bipède, je faisais partie de la dernière voiture ; on m’avait hissé sur des matelas disposés de façon à me garantir des chocs et d’une chute.
Les enfants aiment le changement de place. Déménagez donc souvent, si vous aimez les vôtres.
En face notre magasin du passage, se trouvait un marchand de musique appelé Frère. Très probablement il tenait de près à l’éditeur du même nom, qui, dans le passage du Saumon et pendant la Révolution, mit au jour un si grand nombre d’exemplaires de la Marseillaise et autres chants patriotiques de l’époque.
Il avait deux fils ; l’aîné Théodore, peintre de talent et très apprécié pour ses vues du Nil et des sables d’Égypte avec Pyramides obligées ? Le plus jeune, Édouard, a été aussi remarqué comme peintre de genre.
Nous nous sommes avec Édouard retrouvés plus tard, tous deux dessinateurs sur bois pour les romans à quatre sous. Excellente idée commerciale, mise en pratique par Jules Bry ! Cet éditeur payait ces dessins vingt-cinq francs au début ; il les fit tomber à la moitié de ce prix. N’étant pas aussi habile que Frère, je dus lui céder la place, sans toutefois me fâcher avec Bry. Les derniers bois que je lui dessinai pour cette publication, étaient destinés à une Histoire des Étudiants par Auguste Vatripon, et à une Vengeance sous la Terreur.
Mais n’anticipons pas sur les évènements de ma vie de peintre.
Dans ma première jeunesse, je voyais peu Édouard qui était au collège ; mais Théodore, qui avait un atelier chez son père, voulait bien m’y admettre à mon grand plaisir de le voir peinturlurer. Je m’exerçais déjà à dessiner avec du charbon sur les dalles du passage, et avec du blanc que je savais me procurer, sur les volets des boutiques fermées.
Mon farceur de Théodore m’envoyait porter des charges très osées aux jeunes demoiselles employées chez Flore, une des grandes modistes en vogue. Ces dernières me recevaient très mal, mais je trouvais moyen de me venger en me glissant à quatre pattes le long du comptoir et en me levant subitement le visage barbouillé, je me sauvais avant d’être pris au milieu des cris causés par la peur que je leur avais faite.
La révolution de 1830 arriva le lendemain du jour qui me donna un petit frère. Je vois encore ma mère dans son lit, et mon père en garde national dans le passage. Les coups de canon et la fusillade m’amusaient. J’étais dans l’âge « sans pitié. » Malgré les précautions prises pour cacher à ma mère ce qui se passait sous nos fenêtres pendant la bataille, des bruits confus de voix mêlés aux plaintes des blessés arrivaient jusqu’à elle. Et si elle avait pu voir !…
Entre autres tableaux dramatiques, il me souvient encore d’un grand peuplier au pied duquel on avait amoncelé des cadavres provenant d’une ambulance voisine.
Je parle de Frascati, de ce fastueux tripot qui a fait place, depuis, au prolongement de la rue Vivienne jusqu’au boulevard. Souvent je m’échappais de chez mes parents pour m’y introduire à la sourdine, attiré par le spectacle des danses et du remuement de l’or. Les gens de service me toléraient, parce que j’étais connu de tout le quartier. Je n’avais alors que sept ans, et cependant je me rappelle encore un grand jeune homme absolument perdu de boisson, que les valets en raison de sa mauvaise tenue voulaient jeter dehors. Un vieux monsieur s’approcha de l’ivrogne, et lui dit :
– Malheureux, allez donc prendre votre or !
Celui-ci le regarda d’un air hébété et se laissa conduire à la table sur laquelle il avait préalablement déposé quelques louis sans plus s’en inquiéter… Je le vis ramasser une vraie fortune en espèces et en billets, ce qui le dégrisa complètement. (Tiens, je crois bien !)
Je devais retrouver à l’atelier Cogniet, l’élève Dehodencq qui, devenu peintre de talent, habita Madrid et envoya au salon des combats de taureaux et autres sujets madrilènes. Son père tenait en 1830 le café des Variétés. Il me souvient d’avoir reçu du mien une collection de gifles assorties pour avoir emprunté, à notre étalage extérieur, un groupe de jouets qu’on appelait des Catalans, très à la mode en ce temps, et composé de deux marionnettes traversées d’une ficelle que l’on s’attachait à la jambe ; l’autre bout était fixée à une colonne montée sur une planche ; et ayant, comme supplément, un fifre et un tambour. Nous les mettions en mouvement devant les habitués du café accoutumés à nos gamineries ; et l’on nous donnait en riant quelques sous que nous nous empressions de porter chez Félix le pâtissier du passage, célèbre par ses bouchées et ses brioches. Nous demandions des « rassis » (gâteaux de la veille) remplaçant ainsi la qualité par la quantité !
Déjà galants ! nous invitions les petites filles, nos voisines, à faire la dînette sur une table que l’on dressait devant une boutique. Tous assis sur les dalles, nous mangions, avec un appétit qui ne connaissait pas d’obstacles, le gain d’aventure acquis par un métier qui n’était pas le nôtre.
Aussi, pour tempérer mes jeunes effervescences, mon père me plaça-t-il dans une petite école du faubourg Montmartre.
À deux pas de notre boutique, et du côté qui lui était opposé, se trouvait, comme maintenant, la galerie en coude conduisant à la rue Saint-Marc, et sur laquelle donnait l’entrée des artistes des Variétés. J’y jouai à cache-cache avec les enfants du passage, certaines parties sombres de son parcours semblant disposées pour ce jeu. Le laboratoire de confiserie de mademoiselle Métais s’y trouvait placé ; j’ai encore présent un grand tonneau ouvert, plus ou moins rempli de pièces sucrées non réussies et remises à la fonte. Les jours de bonne humeur des employés, je me risquais à allonger la main dans le tas, et d’autant mieux que le sucre ne me faisait pas tomber les dents.
J’étais connu aussi de tout le personnel des Variétés. Comédiens et comédiennes étaient de nos clients, ce qui fait que, si on avait besoin d’un gamin dans la figuration, j’étais choisi de préférence. Je fus notamment exhibé dans un acte du répertoire avec deux de mes jeunes camarades. Jenny Colon nous présentait à notre oncle, qui était je crois Potier. Le rideau tombé, la charmante actrice nous embrassait, et complétait ses faveurs en octroyant à chacun de nous une superbe brioche de chez Félix en guise de cachet.
J’entrais donc, de temps à autre, dans les coulisses du théâtre ; de son côté, le contrôle me laissait volontiers passer, à la condition de monter avec la sagesse d’un ange au paradis. Ma mémoire a gardé les images confuses d’un méli-mélo de pièces, dont la plupart avait trait à la politique du jour. Leurs titres que j’ai retrouvés depuis, étaient par exemple : Philippe Charte et Liberté, Les Ouvriers, Le Moulin de Jemmapes, La Veille et le Lendemain, Les Saint-Simonistes de la rue des Précheurs, conférence mêlée de bêtises etc…
D’autres vaudevilles de la même époque et qui ne tenaient pas compte des évènements récents, s’appelaient : La Grisette mariée, Pique-assiette, Le voyage en Suisse, La semaine des amours etc…
La troupe se composait de Potier, Odry, Brunet, Vernet, L’hérie, Lebel, Hyacinthe ; et de Mesdames Jenny Colon, Flore, Herfort etc…
Pour le dire en passant, le grand comédien Vernet que je viens de nommer, était l’oncle du miniaturiste Alfred Vernet tué par la photographie, et qui, doué d’aptitudes diverses, trouva une mélodie si heureuse sur Musette, la chanson de Murger.
Voilà le bon temps de mon enfance qui devait se terminer brusquement.
Les émeutes qui suivirent la révolution de juillet, ainsi que l’apparition du choléra en mars 1832, apportèrent un coup terrible au commerce des joujoux.
Je voyais ma mère et mon père s’attrister de jour en jour ; ils devenaient maussades. Il est vrai que, de mon côté, je leur donnais force occasion de se fâcher. Un jour par exemple, mon père fut obligé de me dételer de la voiture de Lafayette que le peuple surexcité, tirait à bras au retour de l’enterrement du général Lamarque.
On voit que l’auteur de mes jours n’admettait pas que je fisse acte politique.
Le passage des Panoramas n’était plus tenable pour ma famille, qui y avait englouti tout l’argent qu’elle avait pu gagner avant la révolution et le choléra. Mon père ne se découragea cependant pas, et bien qu’il eût cinq enfants à élever, il recommença la lutte, ayant pour aides ma mère et ma verte grand-mère.
La chance voulut qu’il trouvât à louer pour son industrie animalière, et au prix de mille francs seulement, trois étages dans une rue dont le nom aurait pu lui servir d’enseigne. Sa nouvelle adresse était en effet : « Schanne aîné, fabricant d’animaux laines et poils, 24, rue Aux-Ours, Paris ».
Nous y restâmes vingt-sept années ; peut-être y serais-je encore sans le percement du boulevard Sébastopol. Il existe toujours, de ce côté, le mur mitoyen de notre maison.
Ma petite école bourgeoise du faubourg Montmartre étant trop éloignée, fut remplacée par des cours du soir. Le jour on me ceignait les reins d’un petit tablier vert, et l’on m’employait à l’exécution des choses faciles du métier ; en même temps, j’aidais Pierre, notre ouvrier, à livrer la marchandise faite. Un panier d’osier sur ma tête, je m’en allais le long des rues cherchant à jouer du flageolet, mon premier instrument. C’était un cadeau qu’un commis supérieur de la maison Deschevailles (jouets en gros) disparue depuis longtemps, m’avait promis et donné au jour de l’an, pour récompenser la régularité de nos livraisons qui étaient fréquentes. Deschevailles et Giroux étaient nos meilleurs clients.
Mes parents très occupés ne pouvaient surveiller ma conduite à la sortie de l’école du soir. Ils me croyaient au troisième étage, lorsqu’ils étaient dans l’atelier qui se trouvait au quatrième. J’en profitais pour mésuser de ma liberté en prenant part, avec des coquilles d’huîtres, aux combats de quartier que se livraient les moutards de mon temps.
Voulant exercer ma valeur sur une plus grande scène, et entraîné par les apprentis bijoutiers habitant notre maison, je me laissai enrôler par eux dans l’armée des « Saint-Denis » qui livraient bataille aux « Montmartre ». Ce besoin belliqueux est observé chez les gamins après chaque secousse révolutionnaire.
Un dimanche, je me rendis donc à deux heures (heure militaire) au clos Saint-Lazare, où se trouvait en construction l’église Saint-Vincent-de-Paul. Pour gagner la barrière Poissonnière, il existait un chemin creux. C’était le lieu ordinaire de la lutte ; mais, ce jour-là, l’ennemi en occupait avant nous un des talus. Notre état-major, posté derrière les planches de l’église, donna l’ordre à ma compagnie de faire une marche oblique sur la rue d’Hauteville sans être vue, s’il était possible, et afin que nos adversaires fussent pris entre deux grêles de pierres.
Le signal de l’action était un coup de pistolet que tirerait le général en chef, vieux grognard âgé d’au moins quinze ans. L’affaire commença, et elle fut chaude. Les Montmartre, qui avaient l’avantage du nombre, nous battirent, je le reconnais de bonne grâce ; d’ailleurs, notre mouvement tournant avait été aperçu par un corps d’observation que nos éclaireurs n’avaient pas remarqué. On me compta parmi les blessés ; une ardoise m’avait en effet atteint derrière l’oreille, me faisant perdre beaucoup de sang ; le chirurgien ennemi lava ma plaie dans une mare et me banda la tête avec un mouchoir. Puis mon bouclier avait été brisé. Ce n’est pas tout encore. Les vainqueurs m’avaient pris comme impôt de guerre ma fronde ; ainsi que tous les boutons en métal qui servaient à retenir mes vêtements. Ah ! j’étais dans un joli état pour rentrer dans ma famille… Aussi comme j’y fus reçu !
Du resté, j’avais déjà la réputation d’un petit vagabond au foyer paternel, parce que si l’on m’envoyait en course au faubourg Saint-Antoine, pour chercher des roulettes en cuivre, destinées aux pattes des gros animaux de notre fabrication, j’y mettais un temps infini. Il faut dire que je rencontrais, sur la route, une occasion irrésistible de baguenauder : cet « éléphant de la Bastille » que les vieux Parisiens n’ont pas oublié, et dans lequel les polissons d’alors aimaient à jouer à cache-cache.
Plus hospitalier que la baleine de Jonas, le monstre de plâtre pouvait donner asile à une trentaine de personnes. On y accédait par un escalier de bois construit dans l’une de ses jambes. La police fermait l’œil pendant la journée ; elle se réservait de venir la nuit faire des rafles de gens sans aveu, dans le ventre du pachyderme. Les carrières d’Amérique n’étaient pas encore inventées en 1833.
Mon père, après quelques années d’un travail heureux, Voulut faire de moi quelque chose ; il se décida à m’envoyer aux cours des Arts-et-métiers. Là, on enseignait, un jour le dessin de figure et d’ornement, le lendemain la géométrie et le dessin mécanique, suivi le surlendemain du lavis appliqué aux différents ordres d’architecture.
Admis après examen, j’y apportai naturellement mes défauts ; la gourmandise était un des plus capitaux.
Notre surveillant, un brave homme que je n’ai jamais connu que sous le nom du père Crispin, vrai type de l’officier retraité, décoré de la Légion d’honneur, se promenait toujours dans notre salle coudée, avec l’attitude de Napoléon Ier, une main dans son gilet ou entre deux boutons de sa redingote, l’autre dans le dos ; il était suivi d’un chien de chasse noir et taché de roux.
Vers le milieu de la séance, près de son bureau placé dans l’angle des deux salles, il tirait de sa poche une belle et bonne brioche de trois sous qu’il brisait en morceaux devant son ami poilu. Nous profitions du moment où, continuant ses allées et venues, il nous tournait le dos, et nous disputions au chien sa fine pâture. Aussi bon enfant que son maître, il se plaignait à peine ; mais un jour, et c’était mon tour, sur un grognement plus prolongé, Crispin se retourna rapidement et n’aperçut que mes jambes, étant moi à quatre pattes. Il me reconnut à la couleur de mon pantalon ; en ce moment n’osant ni mâcher ni avaler, j’avais sur la joue la grosseur d’une chique. Crispin m’enleva par ma ceinture comme une plume, me tira les oreilles l’une après l’autre sans mot dire, peut-être pour ménager mon amour propre. Depuis ce jour, il ne quittait plus son vieux toutou pendant sa laborieuse mastication.
Je mordais surtout au dessin mécanique ; mon professeur, M. l’ingénieur Armengaud, m’envoya un matin chez un lamineur de la rue Fontaine-au-Roi pour croquer, d’après nature, une des premières machines à vapeur que l’on ait vu fonctionner dans Paris. Il fut si satisfait du lavis que je rapportai, qu’il écrivit immédiatement à mon père lui demandant s’il pouvait payer demi-pension à l’école de Châlons-sur-Marne ? La réponse de mon père fut ce qu’elle devait être : ayant alors six enfants à élever, il ne voulait pas en favoriser un aux dépens des autres, par un sacrifice d’argent qu’il ne pouvait répéter six fois.
Je ne partis donc point pour Châlons, mais cela ne m’a pas empêché de garder beaucoup de reconnaissance à M. Armengaud, qui m’avait marqué tant de bon vouloir.
Cependant, mon père ayant fait rencontre d’un gardien chef au musée du Louvre, nommé Tubeuf, celui-ci ayant apprécié mes dessins, conseilla de me faire étudier la peinture. Après réflexion, mon père accepta. Tubeuf me présenta à M. Schopin, prix de Rome, élève de Gros et d’Horace Vernet. Mon nouveau maître, qui demeurait rue de l’Est, m’envoya le matin aux cours de dessins de la Rue de l’École de Médecine, ensuite de une heure à quatre au musée du Louvre pour dessiner d’après l’antique.
C’est chez lui que je fis la connaissance d’Hyppolite Boileau son premier élève, plus âgé et plus avancé que moi. Il allait à l’École des Beaux-Arts et peignait au Louvre. C’était un bon et joli garçon très distingué et très fin, me reprenant toujours sans beaucoup de succès sur le sans-façon de ma tenue et de mes manières. Il habitait chez son père, professeur de mathématiques, rue de la Harpe.
C’est par Boileau que je connus Jules Rozier, le paysagiste élève du père Bertin. Un soir, ce Rozier avait découvert le théâtre Comte, où à l’aidé de billets meilleur marché qu’au bureau, billets d’auteur que nous trouvions chez un marchand de pain d’épices du passage Choiseul, nous étions devenus « trois messieurs de l’orchestre ». Dieu me pardonne, nous envoyions des bouquets aux jeunes comédiennes. Amour platonique de collégiens. Nous osions même reconduire, quand on voulait bien nous supporter marchant à côté sans même que l’on prit notre bras. C’était enfantin et grotesque.
Il me souvient à cette occasion d’avoir entendu au moins trente fois cette littérature :
Les étoiles du moment étaient les jeunes demoiselles : Aline Duval, Cavalié, Léontine etc… qui depuis, comme étoiles, ont longtemps étincelé dans les ciels de théâtre ; mais, des trois satellites, tournant autour d’elles sans les atteindre, il ne reste plus que moi de vivant.
J’abandonnai cet Éden, où nous ne donnions que des coups d’épée dans l’éther ; et plus sagement, je suivis des cours de dessin que M. Mulard faisait le soir aux Gobelins. On y dessinait une semaine d’après le plâtre, et l’autre d’après nature, (modèle homme).
C’est là, que je fis la connaissance de cet excellent Eustache Lorsay, artiste de talent et auteur dramatique (pièces militaires) ; ainsi que d’une partie « des Buveurs d’eau » : Tabar, Vastine, Cabot, Villain, et les frères Bisson, mes introducteurs dans le cénacle où plus tard je devais rencontrer Murger.
Ensuite, et comme on va le voir, je devins élève du célèbre peintre Léon Cogniet.
Mon premier atelier était situé, en 1841, au n° 19 de cette sombre rue du Fouarre, que les leçons d’Abeilard et de Buridan illustrèrent jadis.
J’avais pour voisin Léon Noël, dessinateur lithographe (qui n’est pas celui du même nom, dont la notoriété était alors assez grande).
Il ne travaillait que juste ce qui lui était nécessaire pour ne pas mourir de faim à des en-têtes de romances ou de factures, et restait couché une partie de la journée à rêver et écrire des tragédies qui n’ont jamais vu le feu de la rampe.
Cependant ce n’était pas le premier venu. Il nous déclamait des scènes qui nous émerveillaient. Spectateurs naïfs, nous applaudissions à tout rompre ce Don-Quichotte de la pensée travaillant dans le vide.
Son signalement eût été un squelette vivant ; peau jaune claire tendue sur les os ; long comme un manche de fouet ; chevelure abondante ; œil noir fiévreux ; traits fins et accentués.
Le maigre mobilier de la chambre qu’il habitait tremblait sous les efforts de sa voix caverneuse dans le récit vibrant des vers à effet.
Un soir, la pléiade de rapins et d’étudiants dont je faisais partie, était rassemblée chez le poète, pour entendre la lecture d’un acte de tragédie qu’il venait de terminer.
De temps en temps il s’interrompait intentionnellement à la césure, semblant guetter l’arrivée d’un nouveau visiteur. En effet, la porte ne tarda pas à s’ouvrir : un jeune homme entra ; c’était Murger.
Nous nous étions tous rangés à droite et à gauche pour lui faire place et pour que la lumière de la fenêtre, traversant des petits carreaux dont quelques-uns, dans le haut, étaient à cabochons, l’éclairât en plein ; il sentit que nous l’observions. Sa figure ne m’était pas inconnue. Nature inquiète et timide, ainsi qu’il a toujours été, il en fut tout interloqué, nous regarda à peine, donna la main à Léon Noël qui nous le présenta comme un jeune poète d’avenir, à qui il voulait bien donner des conseils de versification.
On lui offrit du tabac ; il bourra sa pipe, l’alluma, et, assis au pied du lit, regarda dans le vide pour ne fixer personne pendant la lecture de l’acte reprise par son auteur.
La déclamation terminée, Murger fit effort pour vaincre sa timidité qu’il sentait ridicule, et nous étonna par quelques appréciations littéraires et artistiques qui lui appartenaient bien.
À cette époque, la question d’argent était absente de nos discussions ; mal venu eût été celui qui aurait fait de l’art un négoce. Nous n’admettions que le travail indépendant, sans aucune concession au mauvais goût. On était encore en plein romantisme.
L’église Notre-Dame, vue de profil dans l’encadrement de la fenêtre, le ton verdâtre des vitres, combiné avec la fumée des pipes, formaient un tableau avec des parties embues, qui n’étaient pas sans charmes.
Je ne sais si la vue de la vieille basilique fit tourner la conversation sur Victor Hugo ; mais Murger en saisit l’occasion, et nous déclara avec mille adjectifs a giorno l’admiration sans réserve que lui inspirait le grand poète.
Peut-être ici serait-il temps de faire son portrait ? On l’a fait tant de fois que cela me semble inutile. Je me contente de dire qu’à cette époque il n’avait pas cette maladie de la glande lacrymale qui faisait pleurer l’œil gauche, pendant que le droit souriait à Mimi ! Quant à ses vêtements dont la coupe avait été certainement prise dans un numéro très arriéré du Journal des chasseurs, ils pouvaient rivaliser avec les nôtres par leur élégance moins que relative. Mais il me souvient d’un proverbe ayant cours dans notre jeunesse : Il ne faut blaguer ni les parents ni les effets.
À propos de costumes, il me revient une anecdote que Nadar m’a racontée. Une année il existait en novembre dans Paris trois chapeaux blancs forme clarence ; en janvier, on n’en rencontrait plus que deux, le sien et celui d’un inconnu qu’un jour il croisa sur le Pont Neuf. Ils se saluèrent confraternellement devant Henri IV ébahi, qui n’a aucun couvre-chef pour rendre cette politesse (économie de métal). Cette royale victime de Ravaillac, qui semble d’ailleurs peu se soucier de ce détail de toilette, n’en continue pas moins avec ses yeux de bronze à surveiller le baromètre de Chevalier, attendant que l’aiguille, dans ses évolutions, lui marque avec les variations du temps un changement de régime politique.
En quittant Léon Noël, il fut convenu avec Murger qu’il assisterait à la plantation de la crémaillère dans le nouveau logement que j’allais prendre à l’hôtel de Sens.
Murger avait alors près de vingt ans ; j’en ai la preuve authentique par la pièce que voici, et qui est son acte de baptême dont j’ai pris copie sur les registres de Notre-Dame-de-Lorette.
« L’an mil huit cent vingt-deux, le jeudi 28 mars, a été baptisé Louis Henry.
Né d’hier, fils de Claude-Gabriel Murger, et de Hortense-Henriette Tribou, son épouse, demeurant rue Saint-Georges, n° 17.
Le parrain a été Louis-Henri Burdet, rue Verte, n° 24.
La marraine a été, Emilie-Louise Franklin, rue de Miroménil, n° 15.
Lesquels ont signé avec nous. »
Je venais de quitter la rue du Fouarre. Voici comment cet évènement s’était accompli. En passant devant l’hôtel de Sens, j’avais vu se balancer au vent, sous l’ogive de la grande porte, un écriteau qui disait cabinet à louer.
On sait que ce logis, situé rue du Figuier-Saint-Paul, derrière l’Hôtel-de-Ville, est daté du quinzième siècle, et qu’il est intact dans son architecture gothique.
Je m’adressai au portier, espèce de savetier grognon dont l’œil gris était abrité par un sourcil roux formant visière ; il portait des lunettes en fer épais à verres ronds, posées sur un gros nez rouge couvert de petites bosses lenticulaires, le tout brillant comme une lanterne d’omnibus.
Il jeta sur moi un regard protecteur ; mon nez lui plut ; il prit dans une boîte à ferraille une forte clé ouvrée, travail antique abîmé par la rouille, passa devant moi me conduisant dans la tour, à gauche de la cour, en haut de laquelle on arrivait par un escalier de pierre en colimaçon avec meurtrières pour l’éclairer, un vrai nid d’archers.
Sous l’influence romantique, en gravissant les interminables marches usées conduisant au donjon, et précédé de mon écuyer, je me voyais paré d’une coiffure à plumes, d’un pourpoint de velours, et ceint de la dague et de l’épée, avec le faucon favori attaché sur le gant par sa chaîne d’argent.
Mais quittant l’illusion pour la réalité, je me hâtai de demander à mon affreux porte-clé le prix de location par an. Il était de soixante francs ; après débat, je l’obtins pour cinquante livres parisis, plus le denier à Dieu.
La chambre était une assez grande pièce, éclairée par deux fenêtres agrandies depuis peu par un architecte impie manquant de respect pour le style gothique. Un des côtés était occupé par une grande cheminée d’alchimiste ; plus tard j’y plaçai des cornues ainsi qu’un fourneau grossier en terre à poêle ayant lui-même la forme d’une tour crénelée.
Il ne fallait rien moins qu’un intérieur aussi pittoresque pour me faire abandonner le vieux quartier latin où toutes mes relations de travail et de sentiment auraient dû retenir.
Cependant je ne perdais pas de vue ma crémaillère, pour laquelle j’avais invité Murger et quelques camarades.
Or il arrive des périodes, où dans la vie d’un homme, il devient plus difficile de planter une crémaillère, que dans la vie d’un peuple, planter un arbre de la liberté.
Le denier à Dieu, donné au Suisse sans hallebarde de mon palais gothique, avait commencé ma ruine.
Un espoir me restait. Modeste rapin, j’avais une commande : celle du portrait à l’huile d’un bourgeois du voisinage. Ledit bourgeois avait entendu vanter mes talents par le père d’un enfant de la rue que je prenais de temps à autre comme modèle, et à qui je donnais des leçons de dessin.
Je me mis à l’œuvre. Après neuf séances, j’en jugeai une dixième nécessaire pour terminer cette toile qui devait m’être payée soixante francs. (Quel festin pour pareille somme en ces temps déjà si loin de vous !)
Je tardais trop à finir, et c’était imprudent, car mon modèle se trouvait alors menacé d’une apoplexie à bref délai qui pouvait d’un moment à l’autre me l’enlever. D’ailleurs il m’avait fallu beaucoup d’éloquence pour l’amener sous mes infaillibles pinceaux. Je lui avais persuadé que la peinture à l’huile résistait à l’humidité, bravait tous les ravages du temps, et avait bien d’autres avantages que la nouvelle invention du daguerréotype.
– Allez voir au Louvre, lui disais-je, allez voir une fois dans votre vie les immortels chefs-d’œuvre de Raphaël… Pourquoi sont-ils immortels ? Parce que leur auteur s’est bien gardé de se servir de la plaque argentée, et de toutes les drogues chimiques que l’on met dessus aujourd’hui. Et comme ils se conservent malgré tout dans le quartier le plus humide de Paris ! Ni le brouillard, ni l’influence délétère du regard de tant d’imbéciles fixé sur eux, depuis des siècles, n’ont pu altérer leur fraîcheur !
Ces raisonnements le touchaient d’autant plus que Raphaël était le seul peintre connu des bourgeois d’alors. Mais que de petites humiliations pour moi dans cette maison ! À tout instant mon modèle amenait ses amis, sa bonne, ses voisins, pour leur demander en ma présence si ce que je faisais était ressemblant ? J’avais mille impertinences à subir pendant que je lassais mes brosses à peindre cette tête de veau qui avait conquis la fortune et avec elle l’insolence dans le métier de coupeur de poils de lapin ! Que de fois je fus tenté d’achever mon œuvre en étendant un glacis de blanc bleuté sur sa face rubiconde et d’augmenter l’illusion d’une tête cuite à l’eau, en y ajoutant des bouquets de persil dans les oreilles et les narines. Cela n’aurait pas sensiblement troublé la ressemblance.
Nous étions à la dixième et dernière séance. Allais-je être payé de suite ? Mon coupeur de poils me sembla froid.
– Seriez-vous indisposé ?
– Non, me répondit-il, mais je suis pressé aujourd’hui ; c’était hier lundi, ils n’ont rien fichu à l’atelier.
L’homme fit une pause et sembla réfléchir. Inquiet, j’attendais.
– Écoutez, reprit-il, pendant que vous préparez vos couleurs, je vais secouer ces gueules de bois.
Il sortit, je respirai plus librement. Étant revenu un quart d’heure après, je le trouvai plus calme. La séance commença.
– Dites-moi, depuis ma dernière visite sans nul doute, vous avez montré votre portrait à vos connaissances ? Qu’en pensent-elles ?
– Généralement on en est assez content, à l’exception de ma bonne qui me trouve l’œil mort.
– Ah ! votre bonne, elle est difficile à satisfaire ; heureusement que vous ne me semblez pas de son avis. Molière consultait bien la sienne, mais c’était un auteur dramatique du temps de Louis XIV ; vous n’avez donc rien de commun avec lui !
– Ma foi non, me répondit-il d’un air de triomphe !
– Écoutez, il peut y avoir dans sa critique un semblant de raison, le point visuel n’est pas encore fait, tenez, j’y suis… Attention : regardez-moi bien ; généralement je garde cela pour le bouquet de la fin !
Je passai un petit glacis d’huile blanche sur l’iris gris brun et la pupille de l’œil, ce qui détruisit l’embu ; avec un pinceau fin, je pris avec précaution un peu de blanc d’argent légèrement atténué par une pointe de cobalt ; j’assurai bien ma main, et je plaçai mon point visuel en carré reflétant la fenêtre, bien à sa place (gare au strabisme) cela donnait réellement la vie.
Je me rappelle à ce sujet que le peintre Hervier, mort depuis peu, me racontait qu’au-dessus de lui, dans son logement de la place Dauphine, restait l’argentier de Louis-Philippe, chargé du surtout et des couverts au palais des Tuileries. Ce fonctionnaire ayant probablement de bons appointements, cumulait comme argentier et portraitiste militant. D’un talent modeste, il n’en obtenait pas moins des commandes. Un portrait terminé il allait chercher sa femme et ses enfants au deuxième étage ; arrivé dans l’atelier, il les faisait mettre à genoux devant sa peinture, prenait un pinceau d’un air solennel, levait les yeux au ciel, et criait d’une voix vibrante et convaincu.
– Je vais donner la lumière !
L’opération terminée, il les renvoyait, certain que la foi naïve de sa famille lui attribuait ce commandement de la Genèse : « Dieu dit à la lumière d’être, et la lumière fut. »
C’est grotesque, mais très exact, je l’ai connu personnellement, son nom m’échappe.
– Maintenant, dis-je à mon homme, admirez-moi ça !
Il se campa devant le tableau en gardant le silence ; mon inquiétude augmentait.
– Appelez votre bonne et demandez-lui son avis.
– Joséphine…
– Joséphine arriva.
– Comment me trouves-tu l’œil ?
– Très bien maintenant, Mosu me regarde et va me parler !
C’est bien… tu peux t’en aller.
Il se contempla quelques minutes sans mot dire, cherchant probablement à exercer sa critique… Ne trouvant rien, il gagna son bureau à pas lents. Pendant ce temps, et d’un air qui semblait indifférent, je me mis à ranger mes couleurs sur une partie propre de ma palette.
J’entendais le bruit argentin et régulier des pièces de cent sous que l’on compte une à une ; je cherchais inutilement à en suivre le nombre… Enfin il parut.
– Combien donc est-ce ? me demanda-t-il, (ce monstre à tête de ruminant le savait bien.)
– Le prix convenu, soixante francs ; c’est pour rien, je ne vous compte même pas l’huile.
L’aplomb m’était revenu devant la façon mesquine que ce croquant avait de me solder mon compte. Il daigna sourire, je veux dire faire une horrible grimace, et me remit l’argent sans marchander.
Je pris les pièces et les laissai tomber une à une dans la poche de mon pantalon. La première heurtant ma clef rendit un son flatteur. C’est ce que je voulais, car il était bon que mon homme qui m’observait ne supposât point que ses écus tombaient dans le vide. En pareille circonstance, et devant un Crésus aussi glorieux, il faut toujours sauver son amour-propre.
Il se retira en me saluant gauchement. Je lui rendis son salut tout en prenant la direction de la cuisine, ainsi que d’habitude pour y laver mes brosses et pinceaux. D’ailleurs il restait la bonne à exécuter.
Pour mieux faire sonner mes poches et lui mettre en tête une idée de pourboire, j’avais pris le pas gymnastique. En effet, cette fille, si malveillante d’ordinaire, était devenue subitement ma propre servante, ma vassale, mon esclave. Le savon noir et la terrine pleine d’eau tiède étaient disposés d’avance sur l’évier comme complément ; il y avait un linge propre sur le dos d’une chaise ; toutes les chatteries, enfin ! Je gardai d’abord le silence sans avoir l’air de m’apercevoir des soins inusités dont j’étais l’objet.
Un peu embarrassée, elle commença l’attaque avec son affreux accent à l’ail.
– Ça coûte cher un portrait comme ça ?
– Heu ! heu !… j’en fais souvent pour rien.
– Comment ?
– Si la demoiselle est jolie, je me trouve généreusement payé par l’honneur qu’elle me fait en me choisissant pour son peintre.
– Ah ! mais moi pour m’envoyer au pays, j’ai envie de me faire tirer. Combien me prendrez-vous ?
– Pour vous, Joséphine, ce serait une somme énorme, plusieurs années de vos gages.





























