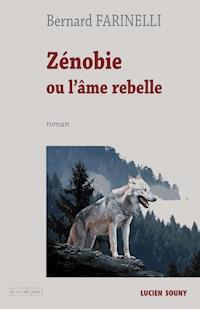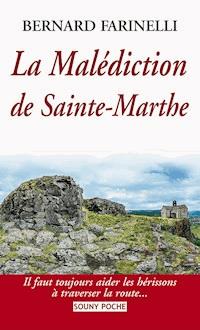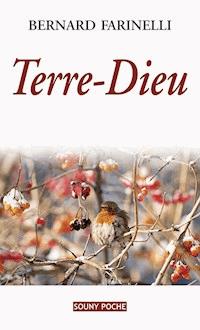
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un retour aux sources bouleversant...
Jean revient à Terre-Dieu pour enterrer son père. La ferme, en ruine, est promise à une vente à la sauvette et abritera une casse automobile. Bouleversé par les terribles changements qu’il observe, les souvenirs affluent de plus belle… sa grand-mère, ses parents, Marie son unique amour, son maître d’école…
Jean appartient à cette génération qui a rompu les liens avec son histoire familiale, son patrimoine, avec tout ce qui constitue l’essentiel de la vie. Il a quitté le monde paisible pour l’aventure et les voyages. Il a délaissé Marie. Elle, n’a jamais quitté leur campagne. Elle l’a attendu. Peu à peu, Jean prend sa décision. S’il a été le chaînon manquant durant des décennies, désormais il doit passer le témoin. Marie lui tend la main. Il ne peut plus l’ignorer.
Terre-Dieu est un hymne à la nature, à la vie simple, à l’équilibre. Il démontre que la voie du bonheur est possible, et que la résilience n’est pas un vain mot.
EXTRAIT
C’est une ferme comme toutes les autres, sans ostentation, mais construite génération après génération, agrégée souffrance après souffrance. Elle vient du fond des âges. Une famille a grandi là, a fait sienne une parcelle de terre sans doute depuis des siècles et a fait souche par défrichements successifs de la hêtraie originelle. C’est le cas pour celle de Jean. Les archives municipales et les cahiers de la paroisse se souviennent de son nom, d’une issue patrimoniale toujours favorable aux mâles. Au Moyen Âge, la trace antérieure se perd pour tous sauf les seigneurs, la signature s’efface, seuls témoignent des prénoms asservis qui ne se démarquent pas encore. L’identification se fait par des surnoms et des sobriquets qui attendent la lente mouvance du temps pour devenir des patronymes de la terre.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Bernard Farinelli est l’auteur de nombreux romans parmi lesquels,
La Mémoire des cendres,
Le Maître des pierres,
Les Grands lointains, parus aux éditions Lucien Souny.
Terre-Dieu, publié en 2000, est le premier roman de Bernard Farinelli qui annonce tous les suivants.
Dans tous ses romans, l’auteur concrétise son fort attachement à la terre et il y insère les valeurs inattaquables qu’il défend, et plus particulièrement, les campagnes vivantes, l’économie locale, l’identité, la mémoire, les traditions, les liens intergénérationnels, etc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1956 - Dès la fin du mois d’août, entre moissons et vendanges, l’écolier sait qu’avec le beau temps s’achève sa liberté de « buissonner ». Certes, ce sont seulement des orages violents qui balaient le ciel, éclatent avec fracas, font tout trembler. Mais Jean, comme les autres, en voyant Julius, le percheron, tirer le dernier charroi de seigle coupé admet que dans un mois, exactement le 2 octobre, la liberté s’éteindra dans une toilette générale de ses vêtements de ville et de son corps noirci par l’air et le soleil. Un mois, c’est terriblement court quand on n’a pas envie de reprendre la classe.
Il n’a pas conservé un bon souvenir de l’année précédente, avec ce vieux maître à moitié chauve, aux pellicules qui tombaient sur les cahiers, qui scandait les règles de grammaire en les accompagnant d’oreilles tirées et de coups de baguette sur le bureau comme un métronome. La connaissance entrait par force dans les cerveaux revêches comme la mèche d’un vilebrequin, et Jean comme ses congénères n’avait jamais opposé le moindre mot, y compris dans la cour, de peur que le maître ne l’entende ou ne lise sur les lèvres.
Septembre est malgré tout le plus beau des mois, les arbres changent d’attitude, ils étonnent par les couleurs improbables, se concentrent sur leur déshabillage hivernal et se parfument. Tout sent le champignon et le décomposé dans les jours qui raccourcissent à allure forcée. C’est à cet instant que se joignent les parfums de la vigne. Des pieds chargés de grappes noires s’étendent entre les fils de fer, retenus par des poteaux saupoudrés de bouillie bordelaise. Une sorte de bleu émeraude teinte le bois en profondeur tandis que le fruit mûrit et parfois se fissure de moisissure, mais les vendanges faites, c’est le marc qui s’échappe dans l’atmosphère. Il suffit d’attendre l’alambic pour faire cuire le saucisson dans le moût et s’enivrer du goutte-à-goutte qui remplit les bouteilles opaques. Cette blanche qui peu à peu accomplit son rite pré-hivernal, c’est l’eau-de-vie que guette dans un coin le garde champêtre, c’est le médicament à tout faire, à aseptiser, à cicatriser, à réchauffer. Le bouilleur de cru mange à la maison le soir venu, et Jean écoute le récit de ses voyages dans la montagne, des histoires de ferme, ses plaisanteries sur les filles qui s’égaient sous le regard des hommes ivres et gaillards, qui s’ouvrent à leur désir irrationnel. Chaque homme raconte un bout de paysage, partout pareil et différent.
Jean habite entre la montagne et la plaine, en réalité en fin de premier tiers d’une ligne idéale qui prend sa source dans la plaine et s’achève sur le sommet le plus proche. Il fait face, en plein sud, à l’immense espace que des villages maillent à leur gré et aux sinuosités de la rivière, soulignée d’arbres. Derrière s’étend une courbure boisée, une sapinière naturelle, à plus de mille mètres d’altitude et qui culmine à un peu moins de treize cents, un lieu sacré pour les Celtes. Le chemin encaillouté passe à quelques encablures de leur maison. Leurs terres occupent avec d’autres un replat, riche d’humus longtemps descendu de la montagne, et qui s’est entassé au gré des millénaires. Exposé à merveille, ce bout du monde semble si bénit que l’histoire vernaculaire l’a baptisé Terre-Dieu.
C’est une ferme comme toutes les autres, sans ostentation, mais construite génération après génération, agrégée souffrance après souffrance. Elle vient du fond des âges. Une famille a grandi là, a fait sienne une parcelle de terre sans doute depuis des siècles et a fait souche par défrichements successifs de la hêtraie originelle. C’est le cas pour celle de Jean. Les archives municipales et les cahiers de la paroisse se souviennent de son nom, d’une issue patrimoniale toujours favorable aux mâles. Au Moyen Âge, la trace antérieure se perd pour tous sauf les seigneurs, la signature s’efface, seuls témoignent des prénoms asservis qui ne se démarquent pas encore. L’identification se fait par des surnoms et des sobriquets qui attendent la lente mouvance du temps pour devenir des patronymes de la terre.
La ferme est en pierre, en granit gris et rugueux avec de gros éclats de mica, jailli des effleurements et des carrières, mal dégrossi, taillé pour les seuls linteaux et pierres d’angle. Le toit de tuiles canal raconte le Midi, la poussée romaine, chaque tuile façonnée dans un moule qui ressemble étrangement à une cuisse d’homme. Le soleil continue la cuisson sur les toits, et même le gel ne parvient pas à les fendre. Dans la plaine, le pisé impose sa présence et, de loin, il est difficile certains jours de savoir où la terre devient verticale, tant les choses sont liées. Le domaine, assez grand si on le compare au voisinage, douze hectares de bonne terre en propriété et treize en location, répond encore à la règle ancestrale de la jachère. On ne fait pas n’importe quoi, il y a un ordre pour les cultures et le repos.
La révolution a commencé il y a à peine quarante ans, même si dans d’autres lieux elle est antérieure. Un bouleversement magistral, la machine s’est autoproclamée et s’est imposée peu à peu. Dans la vallée, des hommes ont arraché des parois à coups de gros marteaux et ont fait exploser des mines, et des années plus tard, le premier train s’est arrêté dans la nouvelle gare. L’ère industrielle avait rejoint les intimes campagnes, avec des outils qui donnaient moins de peine à l’homme. L’arrière-grand-père de Jean, mais c’était dans les années 1880, bêchait certains endroits, il enfonçait avec la force de la cuisse, et parfois des deux, une bêche de bois renforcée en son embout lorsque l’araire ne pénétrait pas suffisamment. Il la soulevait avec ses bras bandés et ses reins durcis. Les hommes devinrent trop nombreux, mais « à croire que les patrons avaient fait une guerre pour cela », pour en éliminer le trop-plein, comme disait son père, Marcel.
Pendant la moisson, Jean aida sans cesse. Il le suivit tandis qu’il labourait le chaume, pour ici ou là retirer les pierres qui remontaient, le tout dans un ballet de bergeronnettes. Ils semèrent les raves blanches au collet violet. Dès la fin de l’automne, ils les ramasseraient, les entasseraient en silo dans la cave. Plante traditionnelle des terres pauvres, elle jouit d’une auréole de bienfaisance auprès des paysans qui la donnent en fourrage et des paysannes qui l’accommodent en bouillon ou encore les cuisent dans la cendre de la cheminée. Jean en raffole.
Le mois de septembre fut exceptionnellement ensoleillé, les vendanges livrèrent leurs quelques hectolitres. Les vignes sont toutes regroupées sur le coteau, face au sud. Presque chaque paysan de la commune possède une parcelle de moins d’un are. Serpette à la main, la foule des familles parcourt les rangées de ceps, charge les paniers qui remplissent à leur tour les barriques entassées sur le tombereau. À la maison, le cuvier est nettoyé et balayé depuis plusieurs jours dans l’attente du remplissage de la cuve d’où s’échappe très vite une odeur de moût qui fermente. Tandis que les grives finissent les vendanges et que jaunissent plus haut les fougères des talus, on goûte le vin nouveau, déjà piquant et entêtant. Les vergers achèvent de mûrir, surtout les poiriers lourds et les pommes à couteau, les reinettes ne tarderont plus à éclater sous le pressoir à cidre.
Les coteaux pentus profitent des chaleurs remontantes. Jean passe de longs moments à contempler l’horizon et les pays dont le nom prononcé ici ou là le poussent à la méditation. Deux chaînes montagneuses se font face et tout les sépare, surtout une riche plaine étouffante de chaleur et à certains endroits des miasmes marécageux, mais elles communient dans la géographie d’un grand massif que les cartes de géographie révèlent comme une entité indéniable, un donjon inexpugnable, protégé des influences faciles des plaines.
Jean aime ce promontoire qui le met à la hauteur des oiseaux, « il est encore à rêver » comme le dit souvent son père, quant à lui toujours à la besogne. Mais Jean, enfant solitaire, qui se mêle peu aux autres gamins de son âge, pourtant assez nombreux dans les fermes avoisinantes, cherche, dans le paysage grand ouvert, des évasions. Son grand-père paternel a combattu sous des cieux moyen-orientaux, et il est mort dans la guerre du Rif, Jean retient ce nom, qui accroche des rêves de sable…
Et puis l’ultime journée, un dimanche avantageux qui repousse d’un jour la traditionnelle rentrée du 1er octobre, passe avec l’apparition malencontreuse, mais symbolique des premières intempéries.
La pluie tape les tuiles et le réveille. Un peu de froid s’infiltre dans les creux de la menuiserie de la fenêtre. Jean, les yeux ouverts, guette le jour. Il fait sombre, pas tout à fait noir. Ses vêtements sont rangés sur la chaise et l’attendent… On ne peut pas dire que cela lui fasse plaisir. L’école, c’est le maître, et cette année, c’est un inconnu qui arrive, les quelques copains qu’il a vus pendant l’été, mais aussi le grand Antoine, son voisin, un peu plus âgé, mais tellement brutal. Jean le craint. Depuis deux ans, l’autre escogriffe lui fait tour sur tour, l’attend dans le chemin, lui fait des grimaces et des pieds de nez, l’imbécile quoi, mais il a presque vingt centimètres de plus, des bras formés… Enfin, des choses qui comptent. La pluie est assourdissante. Il ramasserait bien des noix et des noisettes, comme hier, plutôt que de reprendre le chemin de l’école. Et puis il est si bien chez lui. Son père, sa mère, sa grand-mère et lui. Pas de concurrence.
Le 2 octobre, l’école et la pluie — voilà un mauvais présage… Sa mère, Antonia, ouvre la porte de sa chambre, avec douceur, elle lui caresse les cheveux et l’embrasse. Elle lui parle doucement, et lui fait semblant de dormir, tellement il a besoin d’elle en ce jour. La chicorée grimpe l’escalier et insinue partout son odeur chaude. Il cède et ouvre les yeux sur cette femme aussi belle que sur la photographie de mariage, dans la grande pièce. Le temps de traverser la cour pour se rendre dans les toilettes aux planches disjointes et il se mouille. Il se lave la figure, s’habille. La tartine passe mal, la chicorée au lait chaud l’écœure. Il lutte contre un mal de ventre insidieux, apparu la veille au soir. Il salue son père, qui revient de l’étable, la première traite a rejoint le bidon insoulevable que Marcel manie pourtant avec facilité. Il patiente sous le jet froid de la source dans le bac. Demain, il faudra le descendre à la laiterie du bourg, parce que leur camion de ramassage est en panne. Jean dissimule ses craintes. Il sort en articulant avec émotion un « À ce soir ». Un sentiment de tristesse s’empare de la ferme. Il y a rupture dans l’ordre naturel des choses, même Julius, le percheron, du haut de sa tonne de muscles suit du regard son petit qui s’en va. Émeline, sa grand-mère, pense à ce temps où les enfants ne quittaient jamais la maison. Elle s’en va chercher ses trois chèvres pour les mener à l’enclos. Aujourd’hui, elle n’aura personne pour l’écouter.
Jean commence la lente descente, les brumes basses masquent la plaine et la rivière. Une luminosité mystérieuse gagne peu à peu la campagne et s’accroche aux genêts des talus. On sent que le soleil pousse derrière, qu’il a envie lui aussi de contempler les cerisiers qui conservent quelques longues feuilles rouges, les pruniers déplumés, les peupliers aux chapeaux jaunes, le long du fleuve, et la foule de tous les autres qui oscillent sous le vent dans un camaïeu de verdure fanée.
Quelques terres sont déjà retournées. Presque noires, elles côtoient des prairies qui s’engorgent d’eau. Jean devine dans la buée un héron qui fouille les flaques en recherche d’une grenouille ou assimilée. Une corneille sombre guette sur la plus haute branche du grand noyer, juste avant le virage qui tourne sur une autre histoire. C’est à ce niveau que Jean emprunte un chemin différent. Il ne continue pas la descente logique, inscrite dans la mémoire du paysage, depuis que les hommes ont colonisé le replat, le riche plateau protecteur et chaud. Jean choisit la bifurcation secrète, la sente qui traverse en ligne droite la forêt. Il a des excuses. Le chemin est plus court, il se mouillera moins parce que les ramures forment un vrai toit et il aime les bois. Mais la vraie raison, c’est que le grand Antoine lui a interdit le passage depuis le printemps dernier. Quinze minutes plus tard, Jean aperçoit l’école. Il y a déjà nombre d’enfants et certains ont la chance d’être accompagnés. Ils habitent le bourg. Il sort de sa gibecière un grand mouchoir et s’essuie le visage mouillé. Il secoue sa casquette. Il se demande comment il fera pour passer par la forêt quand les jours seront trop courts.
Le bourg est une manière de capitale. On y trouve l’essentiel, y compris dans la boulangerie de la place un assortiment de bonbons colorés dans des bocaux transparents. Le matin règnent des effluves de pain et de pompe aux pommes. Les enfants salivent alors qu’en bout de place, bien dans la lignée des tilleuls, se dresse imperturbable et solennelle la République, affirmée par le grand bâtiment de la mairie et de l’école. Mais le bourg prolonge la vie champêtre, les moutons paissent dans de petits terrains enclavés, et la basse-cour piaille et crie, surtout les oies de Noël à l’engraissement. Des écuries abritent les lourds traits qui tirent les carrioles. Peu de camions et encore moins d’automobiles rompent le silence. Seule la route centrale, une départementale, est goudronnée. C’est pourtant une commune moderne, presque électrifiée dans son ensemble, avec une gare de triage. Un carrefour de lignes qui nécessite des manœuvres savantes, des aiguillages. Quant aux voyageurs, la micheline s’arrête le matin et repasse le soir. Elle dessert la ville à trois quarts d’heure de là. Jean ne l’a jamais empruntée.
Chaque dimanche matin, les familles se retrouvent, entre messes pour certains, café pour d’autres et marché pour tous. C’est ainsi que tout le monde se connaît, se côtoie. L’étranger, l’anonyme, le nouvel arrivant ne sont pas les bienvenus.
L’école ne peut pas se manquer. Imposant bâtiment avec deux ailes en retour, le rez-de-chaussée est occupé par les classes et les bureaux, l’étage par les appartements. Les fenêtres et les portes sont rehaussées d’un liseré de briques, d’une architecture inconnue ici. D’un côté les filles, de l’autre les garçons. La cour en terre battue abrite un préau ajouré et les toilettes spartiates. Un mur et, en son centre, un grand portail closent l’ensemble, soumis à l’autorisation de la cloche que le directeur est seul habilité à agiter. Un grand marronnier tombe ses feuilles et ses fruits tentateurs pour des lancers plus ou moins fructueux et rejoint peu à peu le camp des squelettiques cerisiers. Une touffe d’asters tremble le long d’un mur. Une école au crépi en grain d’orge orangé avec de hautes baies, et qui sent l’ordre, la morale et l’étude jusque dans le moindre recoin, bien qu’en vérité l’odeur de Javel des planchers livre bataille au parfum d’encaustique des pupitres.
M. Gidel tient là sa première classe, le cours supérieur et la fin d’études primaires, celle des grands. Avec sa blouse grise, ses cheveux noir corbeau, son visage émacié, il inspire le respect, voire le recul. On sent chez cet homme le souci de transmettre, d’apprendre, à ces enfants que la République lui confie, les valeurs intangibles, l’ordre des choses. Il est assis à son bureau, en ce matin, plus d’une heure avant l’arrivée des premiers élèves. De sa chaise, il entrevoit la porte ouverte de la cour de terre battue. Son regard porte aussi sur les lieux d’aisance, ces deux portes bleues ajourées sur le haut et le bas. Instantanément, il sait les logiques et les désordres du lieu secret. Vingt pupitres doubles lui font face, ils brillent de la cire de la sortie d’été. Les hautes fenêtres assurent au jour la plus grande emprise, la classe est par principe lumineuse. Il reconnaît Mme Brousse, l’institutrice, sa collègue de l’autre classe, mais aussi la très jeune épouse du directeur. Elle frappe et, le sourire aux lèvres, lui demande s’il n’est pas trop inquiet, elle le rassure, c’était son cas, il y a deux ans… Il bredouille d’une forte voix. Il a emménagé depuis quelques jours dans le logement libre, à l’étage, celui réservé aux célibataires, deux pièces et les toilettes communs au bout du couloir… Ils l’ont invité à déjeuner dimanche prochain. Il a décliné l’offre du jeudi, jour qu’il consacre à la botanique et la licence universitaire qu’il tente d’achever en suivant les cours théoriques le jeudi après-midi sur plusieurs années…
Il se retourne, pas une trace sur le grand tableau noir, une éponge et des craies, prêtes à l’emploi. Il écrit la date avec application lundi 2 octobre 1950. À leur place, des grands instruments, une équerre, un rapporteur et un compas. Pas très loin, le compendium métrique, cette armoire vitrée qui sert pour les cours de sciences. Elle contient les preuves intangibles aux problèmes impitoyables de mesures et de poids. M. Gidel voue une admiration presque sans bornes à la chaîne d’arpenteur, à la balance Roberval et ses poids en laiton, aux mesures en métal blanc pour les liquides et en bois cerclé pour les grains, et à toutes les formes qui doivent permettre à l’élève de visualiser le parallélépipède, le cylindre, le cône… On l’a prévenu à l’École normale, même si le système métrique est obligatoire en France depuis 1919, chaque province a conservé comme une résurgence ses propres mesures, ses néologismes, son vocabulaire patoisant, ses expressions approximatives, ses résistances à la langue française par endroits… Son rôle, à lui instituteur de la République, est de prolonger l’action de ses prédécesseurs, de faire aboutir au nom de la modernité l’unité du savoir, l’universalité de la culture républicaine.
Il regarde sa montre. Encore une demi-heure. Il contemple de nouveau sa classe pour se persuader qu’il ne manque rien, qu’il n’a rien omis pour le cérémonial de rentrée. La bibliothèque n’est pas très fournie, mais elle suffit pour intéresser les garnements. À côté des sempiternelles, mais efficaces, Fables de La Fontaine, il a rangé par ordre alphabétique les livres campagnards d’Erckmann-Chatrian, les romans rustiques de George Sand, Jules Verne au grand complet et, bien entendu, Robinson Crusoé, ce héros involontaire mais audacieux. Il n’y a pas d’autres livres. Depuis la guerre, seulement cinq années à reconstruire. Des tickets de rationnement, il y a peu encore. Le budget alloué aux livres est anecdotique… surtout dans ces communes de campagne, loin de tout. La plus proche ville est à quarante-cinq kilomètres, mais M. Gidel est chanceux, il y a une gare à moins de cinq minutes, de quoi rentrer chez lui assez souvent et suivre ses cours à la faculté… Il ne se fait guère d’illusions, les gamins ont peu le temps de lire, ils entament une seconde journée en rentrant…
Sur une table, il y a les ardoises et leurs crayons spéciaux, les petites boîtes à éponge, et les cahiers de devoirs mensuels à petits carreaux… Les piles de livres raccommodés attendent une distribution d’autant plus sérieuse que le bien est rare. Ils sont changés lorsqu’ils sont épuisés ou démodés du fait d’un nouveau programme. Les enfants ont de la chance, le dernier date de 1947. Enfin, aux murs, la carte du monde, celle de la France et de ses colonies. Deux lignes de portemanteaux métalliques encadrent la salle. Tout est prêt, même les premières annotations sur son journal de classe. La liste de ses élèves avec leur date de naissance a été établie par son prédécesseur juste avant son départ. On lui a signalé les turbulents, les téméraires, les timides, les éclairés et les simples. Il a composé un ordonnancement qu’il ne s’interdit pas de changer. C’est le premier jour officiel de chauffe et, aujourd’hui, c’est lui qui a allumé le feu dans le fourneau cylindrique. Dans moins d’une heure, il aura dicté le règlement de l’école, énuméré les tâches du ménage que chaque responsable quotidien aura à cœur d’accomplir.
Il attend gaillardement les trente-cinq garçons, inscrits dans la grande classe, les cours moyen deuxième année, les fins d’études de première année et enfin de seconde année, qui passent le certificat dans neuf mois. Très vite, il saura ceux qu’il convient de diriger vers le collège et qu’en conséquence il préparera au concours d’entrée.
M. Gidel n’est pas n’importe qui. Il est une sorte d’homme supérieur, celui qui décide de l’avenir, celui qui sait et a le pouvoir de diriger. En ce sens, il est respecté des parents, qui ne reviennent jamais sur ses décisions. Il devra convaincre certains de laisser leur enfant aller en sixième, et même la promesse d’une bourse n’assouplit pas leur entêtement. Ils n’en voient pas l’utilité ou préfèrent la certitude de la technique, de l’apprentissage. La plupart souhaitent que le fils « reprenne » derrière eux, continue la logique terrienne.
Peu à peu, ils arrivent, les filles d’un côté, les garçons de l’autre, mais la barrière séparatrice n’empêche pas les conversations, les sourires, les haussements d’épaule. M. Gidel rejoint la cour, et Jean l’envisage pour la première fois. Leurs regards se croisent, mais l’instituteur se garde bien de lui sourire. Jean baisse les yeux, change de coin. Cela va être une année dure. Il est dans la même classe qu’Antoine, malgré leur différence d’âge. Le grand escogriffe passe son certificat cette année… Jean retient une larme en observant la ligne de crête forestière, qui effiloche les nuages, mais vient de l’ouest une masse noire qui, dans moins d’une heure, sapera les hauteurs, arasera la moindre possibilité de rêve, d’autant qu’il faudra déjà répondre aux questions du maître.
Quatre classes et quatre rangées d’enfants qui attendent devant les portes, deux pour les filles, la classe de Mme Aumaître pour les plus jeunes et celle de Mme Brousse, et deux pour les garçons, celle du directeur et celle de M. Gidel. Une barrière de bois sépare la cour et deux ailes aggravent la distance. Ils sont venus de toute la commune, certains habitent à proximité et rentreront déjeuner chez eux, d’autres comme Jean ont amené leur gamelle, parce qu’il aurait à peine le temps de manger s’il devait faire l’aller et retour à midi. Il a insisté auprès de ses parents, mais ceux-ci lui ont répondu que c’était une demande stupide et que la fréquentation des autres lui ferait du bien. Il s’est tu. Même là, il lui faudrait supporter Antoine.
Par bonheur, le maître a regroupé les grands sur un côté. Sa voix prend ses marques, les murs s’habituent à elle, et les enfants à ses paroles qu’il répète souvent pour qu’elles soient comprises. Elles s’imposent sans violence mais sans discussion possible. Tous savent qu’il serait inutile de parler sans autorisation, et pourtant certains sont presque des hommes, solides, habitués aux travaux de force et à commander les journaliers. Mais là, ils se taisent avec respect. Sur son estrade M. Gidel paraît immense, sa blouse sombre et sa cravate, son air pas très commode, tout cela concourt à une sévérité visible, à une certitude dissuasive. Sa main écrit la première phrase au tableau, une écriture d’artiste. La craie blanche s’applique à instruire la règle en vigueur, à respecter une géométrie formelle indiscutable. Les enfants comprennent que cette perfection est le résultat d’une pratique qu’il leur faut désormais imiter. Ils la recopieront tout à l’heure. La propreté, condition de la santé. Eau froide, savon, air pur, voilà les meilleurs médecins.
M. Gidel explique que, dès demain, il regardera les ongles et les oreilles, qu’après un travail physique soutenu, il faut se laver le corps, et les mains avant chaque repas, surtout pour ceux qui ont une ferme. Les maladies des animaux peuvent toucher les hommes, la fièvre de Malte par exemple.
Avant la récréation, le maître fait un exercice d’orthographe, des phrases avec des pièges que reconnaît Jean, au moins pour certains. Ce n’est pas le cas de tous. Quelques-uns ont l’air de souffrir et portent le crayon d’ardoise à leur bouche.
Le poêle de fonte, orné au milieu d’une grappe de raisin, pétille par moments, d’autres fois le craquement d’une bûche qui, par son poids, réduit en braises celle du dessous, résonne et attire le regard de celui qui s’ennuie ou qui ne connaît pas la réponse. Quelques esprits inquiets se demandent où est passé le bonnet d’âne qui d’habitude trônait sur le bureau. Ne pas le voir ne signifie pas que son sombre présage soit éteint. M. Gidel doit le conserver dans son tiroir… La cloche libère de ce premier temps un peu bizarre, de cette parenthèse des présentations. Jean reste à l’écart tandis qu’ici et là les conversations naissent et les rapprochements s’opèrent. Les jeux restent incertains en cette première journée.
Désormais, tout est en ordre pour commencer. Dès ce soir, les élèves rentreront avec des devoirs. Le nouveau rythme de la vie s’impose. Chacun abdique et obéit. Telle est la règle. Il commence d’ailleurs par une dictée de circonstance.
De jour en jour la forêt changeait d’aspect. Sur la verdure d’été, l’automne étendait ses badigeons de rouille. Dès les premières nuits froides, les quenouilles des peupliers de la lisière s’étaient dorées. Puis les merisiers, les hêtres et les érables s’étaient allumés comme des torches. Peu à peu, l’incendie gagnait tous les arbres, à l’exception des résineux. Les acacias et les tilleuls devenaient d’un blond pâle ; les chênes secouaient dans le vent aigre de rudes tignasses rousses ; les trembles, les pommiers et les poiriers sauvages charbonnaient comme s’ils avaient été léchés par une flamme. Ernest Pérochon
M. Gidel s’attarde un instant sur les montagnes visibles par la fenêtre de la classe. La forêt se recueille, c’est le ralentissement après les fougues de printemps et les fièvres d’extrême chaleur d’août. La lumière est moins éblouissante, et pourtant des éclats précieux fusent un peu partout. Le repas de midi est triste. Les enfants s’attablent et mangent dans leur gamelle métallique, le plus souvent un quart militaire qu’ils font réchauffer sur le fourneau. Ils accompagnent leur plat d’un fort morceau de pain et d’un verre d’eau. La pomme paraît le dessert commun à tous, ils la pèlent au plus près de la chair et certains la croquent. Jean reste silencieux. Il ne participe pas aux plaisanteries des plus grands. Il attend la cloche en proie à un ennui sans solution.
Lorsqu’il sort pour la récréation, il regarde pardessus la fascine de bois, du côté des filles. Mme Brousse et Mme Aumaître conversent dans le vent humide, avec une nuée de petites filles qui courent les jambes nues. Seules les blouses les différencient vraiment. Les garçons s’activent, certains jouent aux billes dans un coin et d’autres maintiennent la tradition séculaire des toupies, un rond à la craie et la toupie lancée en plein centre doit chasser les autres. Jean, les mains dans les poches, regarde ses camarades, il s’est bien gardé d’apporter quoi que ce soit… Les meilleures sont celles en buis jaune parce qu’incassables. Il conserve celle de son grand-père comme un talisman. Le choc peut facilement fendre les autres.
Jean croise le regard d’une fille isolée, elle lui sourit. Ils sont proches malgré la barrière. Elle lui demande comment il s’appelle. Elle vient d’arriver. Son père est le nouveau chef de gare. M. Gidel et le directeur échangent parfois un mot. Ce dernier considère déjà le nouveau maître comme un rêveur. N’a-t-il pas avoué ces deux passions qui se conjuguent à merveille, la marche et la botanique, il va même proposer à ses élèves de constituer un herbier pendant les activités dirigées. Rêveur mais strict, cela rassure le directeur. M. Gidel s’abstient de parler de ses lectures, les grands voyages de Henry de Monfreid, les ouvrages de Pierre Loti ou encore les récits d’explorateurs.
* * *
Le lendemain matin, parti avec quelques minutes d’avance, Jean marche lentement, il observe le paysage qui le happe comme un précipice. De là, il voit loin. Il englobe les 180 degrés comme un panoramique. Ses yeux ne suffisent pas. Les brumes du matin cachent le cours du fleuve, dont un méandre évite le bourg. La fumée d’un train laisse des traces dans le lointain. L’hiver est déjà là, caché, tapi, mais présent dans tous les esprits. Au bas de la côte, le chemin suit les grandes terres découvertes en amont de la ligne boisée de la berge. Dans le presque silence, Jean tombe sur une dizaine d’oies sauvages qui fouillent les chaumes trempés. Sans bruit, il s’éloigne et rejoint la route goudronnée, la départementale silencieuse à peine perturbée par quelques rares voitures et camions. L’école approche et lui ralentit encore le pas. Il ramasse plusieurs noix qu’il goûte avec plaisir, la saveur amère l’aidant à saliver. La grille ouverte apparaît comme celle d’un casernement. Il regrette de n’être pas passé par la gare. Il est presque le premier, mais il y a déjà le grand Antoine qui demande : « Comment va la poule mouillée ? » Jean serre le poing.
Ce matin, la révision de calcul prend du temps. M. Gidel rappelle à la classe des unités simples et celle des mille. Puis il y a de l’histoire. À midi, Jean s’installe sur la grande table du fond et avale sans appétit son quart réchauffé sur le fourneau. Mauvaise journée, d’autant qu’il a dû composer une rédaction sur sa dernière promenade, pendant que ceux de fin d’études corrigeaient un exercice de grammaire. Et qu’aurait-il à raconter sinon que chaque matin et que chaque soir il traverse un bout de campagne pour venir à l’école. La nature, il la côtoie sans cesse. Elle l’accompagne dans son quotidien, sous le soleil estival, il a travaillé avec son père et parfois traîné en se promenant mais peu. Cet été, le temps de la lumière s’est assombri parce qu’il s’est senti seul. Heureusement, Julius lui a tenu compagnie. Il sait l’atteler, parce que le cheval met du sien en se laissant faire et en baissant la tête lorsqu’il lui passe le lourd collier. D’ailleurs, ils se parlent tous les deux. Chaque soir, lorsque Jean lui prépare son picotin, un grand seau d’orge ou d’avoine concassés, il attend calmement. Mais dès qu’il le quitte, le cheval pousse un hennissement. Il a plutôt envie de raconter ce genre de scène. La promenade solitaire après tout, cela le regarde. Ils ont tous quelque chose à faire à la maison. Son père laboure quelque terre, sa grand-mère garde les bêtes et sa mère s’occupe de tout le reste… Jean, même s’il est moins agile que ses parents, aide chaque jour, surtout à la traite, cela prend tellement de temps que trois personnes assises sur le petit trépied, derrière le cul de douze bonnes vaches, mettent tout de même une heure et demie. Parfois, il s’occupe de la pâtée des cochons, des patates cuites avec du son. La promenade de la rédaction, à décrire le ciel, le temps et le paysage, ça l’embête parce qu’elle ne se passe jamais de cette manière. Alors, Jean décide de raconter l’espace de deux ou trois feuilles ce que lui voit au travers des choses… Il marche dans les champs, s’assoit sur son promontoire et se met à rêver. À quoi, sinon à un départ vers quelque chose qu’il ne connaît pas, mais qui est loin derrière l’horizon… Et qu’il raconte à M. Gidel.
Le mercredi, le soleil rougit l’est de la montagne, une vraie journée d’automne qui sent le champignon dans le moindre souffle de vent. Le peuple le plus civilisé est celui qui utilise le plus de savon. La sentence à la craie présume d’une inspection minutieuse. M. Gidel prévient plusieurs élèves sur un ton de remontrance. Il explique que la société change. « Aujourd’hui, le monde moderne a vaincu la faim, au moins en Europe. Dans les villes, il fallait distribuer des tickets de rationnement il y a encore deux ans. Il n’y a plus vraiment de misère, alors que c’était le cas autrefois dans les campagnes, où la dure nécessité était de survivre et l’hygiène malheureusement passait au second plan. Ce n’est plus le temps des sabots mais celui des souliers. » Chacun écoute avec attention et crainte les propos du maître. « Les grands changements de mode de vie sont dus au machinisme et à ses progrès, à l’arrivée de la bicyclette et de la motocyclette qui ont favorisé les déplacements, et aujourd’hui à celle de l’automobile qui, dans vingt ou trente ans, sera dans tous les foyers. Alors, conclut M. Gidel, on ne vit plus comme des cochons ! »
À la récréation, Jean et Marie, la fille du chef de gare, s’approchent l’un de l’autre avec juste la barrière entre eux. Elle a son âge, elle ne connaît personne, son père est nommé ici depuis le 1er septembre… Elle a pris souvent le train, elle a même accompagné son père à Paris, et le conducteur les a acceptés dans la grande locomotive… « Si tu veux, on se verra souvent », lui dit-elle d’une voix sérieuse. Elle s’échappe au premier coup de cloche. Jean s’enchante des deux nattes brunes, du tablier rose et du sourire complice lorsqu’elle s’est enfuie.
Lorsque M. Gidel rend les copies de la rédaction, et qu’il obtient la meilleure note, cela parachève sa confusion. Jean soutient le regard à la fois narquois et interrogatif d’Antoine… Il sait qu’un déclic secret fait basculer sa vie en ce jour… Ce soir-là, il rentre doucement, il règne une étrangeté dans l’atmosphère, une sensation de roulis. Ses pas cotonneux glissent dans la montée sans s’accrocher au sol. Pendant la traite, son père l’interroge sur ses premières notes. Les mains démesurées pressent les pis qui lâchent de grandes giclées de lait. « Continue, dit-il sans lever la tête. Demain, on fera un peu de cidre. » Jean monte tôt dans sa chambre. Il s’allonge. La lampe à pétrole sur le chevet donne une lumière concentrique qui s’estompe à mesure qu’elle s’éloigne du foyer, et le centre majeur, la focale du monde, c’est ce livre enfin ouvert que M. Gidel lui a confié pour explorer l’ailleurs, un tour du monde en ballon… Jules Verne recueille Jean, fils de générations de paysans sur le piémont d’un grand massif montagneux et sauvage, aux cheminements incertains, aux villages encore clos, et le fait grimper dans un ballon qui se gonfle de gaz et prend peu à peu de l’altitude pour voir le monde autrement que les pieds sur terre, que sur le plancher des vaches… Sa mère ouvre sa porte, s’approche de lui, l’embrasse. « Il est temps d’éteindre. » Jean entend le pas de son père dans l’escalier étroit, les bruits du déshabillage, celui du sommier qui grince sous le poids des corps qui s’allongent, qui cherchent la position de l’abandon musculaire, de la détente physique. Parfois, il perçoit, mais quelque temps après le coucher, d’autres bruits, des mouvements furtifs et retenus. Puis tombe un profond silence sur la ferme, ponctué par des hululements et des feulements qui marquent le règne de la nuit jusqu’au chant du coq.
Jean vient d’avoir onze ans, mais le goût du cidre, il lui semble l’avoir depuis sa naissance. Les odeurs fermières et ménagères accompagnent le moindre geste. Il y a toujours un plat qui mijote, une daube ou un petit salé aux choux, qui rythme la respiration de la maison. D’après sa grand-mère, les paysans d’ici ont toujours fait cette boisson, un jus de pomme, bu jusqu’à ses deux ou trois premiers jours de fermentation, puis recommencé jusqu’à ce que toutes les pommes aient mûri, et que les arbres soient totalement défruités. Tout fruit tombé est ramassé, coupé, amputé si nécessaire et regagne la râpe. Jean essuie les fruits mûrs, il les coupe en quartiers. Son père abaisse la manette de la force dans l’atelier. L’électricité met en branle une longue courroie qui actionne une plaque de bois cloutée qui éclate la pulpe du fruit. Puis Marcel entasse la chair pulvérisée dans le petit pressoir à main. Jean commence à tourner le volant, et ses bras qui forcent donnent naissance à un ruissellement épais. Des gouttes lourdes emplissent la jatte de terre. Marcel prend la suite, serre plus fort. Cinq grandes bouteilles regagnent la souillarde, cette pièce froide, creusée dans le terre-plein, qui abrite les casseroles démesurées, les biches de légumes salés, les bocaux de cerises à l’eau-de-vie, les cuvettes, le stérilisateur et quantité d’ustensiles que Jean apprend à mieux connaître chaque année. Le moût est épandu dans le jardin et les oiseaux s’enivrent aussitôt.
Jean travaille tout le jour, il aligne le bois sous l’auvent de la grange tandis que son père le coupe à la scie circulaire, juste de la taille du foyer, des bûches de trente centimètres de chaleur future, qui proviennent de l’élagage des frênes et des chênes en bordure de champ et de l’abattage au passe-partout de deux fruitiers trop vieux. Jean avait là encore secondé son père, parce que le passe-partout se manie à deux. Ils avaient scié avec application les branches maîtresses pour dégager le tronc. Puis Marcel avait attelé Julius pour tirer les billes en bord de chemin dans l’attente de les mener à la scierie pour de la planche. Ils travaillent pour l’année prochaine, ce bois s’aérera et séchera à l’abri de la pluie. Dans moins d’un mois, ils replanteront un poirier pleine tige et un cerisier Montmorency, l’arbre aux clafoutis, le meilleur, d’après la tradition, avec ses petites cerises aigres.
Après la traite, il se lave le visage, les bras et le torse au gant dans une bassine sur l’évier, avec un énorme morceau de savon de Marseille. Sa mère a fait chauffer une lessiveuse. Il achève de se déshabiller et plonge son corps nu dans un grand baquet, tout contre la cuisinière, et il arrose son crâne presque tondu. C’est une préoccupation pour tous de ne pas ramasser des tiques, des teignes et des poux au cours des multiples travaux des champs et des remuées dans la grange et l’écurie. Tous les quinze jours, Marcel et Jean prêtent leur tête à la tondeuse à main qu’Antonia manie sans les blesser. Le corps nu de Jean ressemble déjà à un petit cep de vigne, à un morceau noueux. Devenu un homme maintenant, sa mère sort avant cette seconde opération.
La classe de cours moyen deuxième année est toujours chargée, qu’elle soit ou non partagée en deux niveaux avec ceux qui préparent le certificat comme le grand Antoine. Deux ans les séparent et vingt centimètres, il se croit toujours le plus fort, mais c’est une affaire de famille. Voisins, ils ne se sont jamais entendus et cela perdure. Des mots aigres, mais la plupart du temps un silence ou le regard qui se détourne, et malheureusement la route qui descend au bourg frôle leur cour… Le travail scolaire ne manque pas et les enfants sollicitent leur mémoire sans cesse pour des règles, des récitations, du calcul mental, des leçons. On leur demande du par cœur. Jean prépare sa lecture, un certain Pierre Loti qui parle de mines d’argent, qui conte des voyages lointains. Jean est promis à l’enseignement agricole, à l’école d’agriculture. Son père parle peu, mais, lorsqu’il le fait, il lui prédit le temps de la technique, du machinisme et de la chimie. Tous les journaux l’affirment.
Le bruit du tisonnier qui fouille le fourneau l’éveille, il déjeune de chicorée au lait et de pain confituré. Jean ne serait jamais parti le matin sans caresser Julius. Dans l’odeur chaude de l’écurie, l’énorme cheval lève toujours la tête vers son petit et vient coller sa grosse joue contre lui. À chaque mouvement, un plissement de muscles ne parvient pas à contenir l’immense tendresse du percheron qui, du bout de ses naseaux, repousse quelques instants plus tard le jeune garçon, comme pour lui signifier l’heure de la séparation.