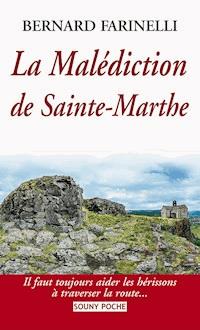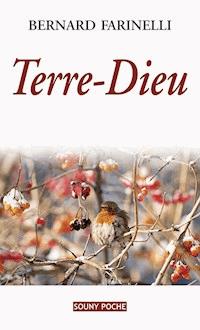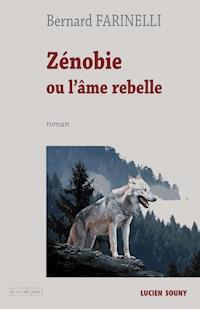
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Suite à la rencontre d'un Gitan en prison, Victor découvre qu'il a des dons bien particuliers...
Suspecté de sabotage pour défendre une cause environnementale, Victor est arrêté. En prison, il rencontre un énigmatique Gitan. Il lui apprend la philosophie, l’autre l’art des signes et du combat. Bénéficiant d’un non-lieu, ce prof de philo décide de tout plaquer et parcourt les montagnes du Massif central. Après une longue errance, il finit par acheter le mas Zénobie. Bien loin de son passé, le destin va pourtant le rattraper, à commencer par le Gitan. Il se retrouve ainsi dans des situations redoutables qu’il va devoir débloquer et apaiser. Attentif à tous les signes, il se rend compte peu à peu qu’il est dépositaire de dons occultes, qu’il peut changer le pire en mieux. Ce qu’il va s’efforcer de faire. Zénobie raconte l’histoire d’un rebelle du XXIe siècle, qui ne se reconnaît ni dans la société ni dans ses valeurs. Il refuse par-dessus tout de laisser aux générations à venir une planète malade et dégradée. Victor, par son charisme et sa volonté inébranlable, entraînera dans son sillage une communauté qui ne demande qu’à relever la tête.
Découvrez ce roman sensible dans lequel le héros, Victor, décide de tout quitter pour rester fidèle à ses valeurs au travers de ses dons occultes.
EXTRAIT
Victor côtoyait une étrange frontière. Il avait la sensation d’être suivi, que quelqu’un l’accrochait par le bras, qu’une mâchoire malintentionnée agrippait son pied. Non pas des fées, des elfes et des lutins, que les légendes et les contes, folklore des anciennes provinces, colportaient. Mais des êtres malins, fluctuants, demi-vivants ! « Pas étonnant que les Anciens aient inventé leur bestiaire fantastique », pensait Victor en cherchant à identifier les ombres. Les scories celtes et la foi du charbonnier avaient fait leur œuvre ! Entre les pierres déifiées et les sculptures romanes représentant l’enfer, les paysans reconnaissaient les démons dans les figures de branchages entremêlés, sous l’ombre déformante d’un morceau de lune glabre. Pour guérir les trop fortes angoisses, les poussées de fièvre, les spirites et les sorciers captaient les récits et les complaintes, repoussaient les sorts. Victor ressentait leur compagnie !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rural dans l’âme et dans l’esprit,
Bernard Farinelli est un défenseur acharné de la vie à la campagne comme en témoignent ses essais (notamment
Le Pari de l’arbre et de la haie, Editions de Terran, 2011 ;
Quitter la ville mode d’emploi,
Sang de la terre, 2002 et nouvelle édition 2008) et ses guides (
Vivre à la campagne, Rustica, 2007). Il écrit des chroniques pour Village Magazine et anime de nombreux débats nationaux sur le thème de la campagne et de l’économie locale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
« Ce qu’on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l’extérieur comme un destin. »
Carl Gustav JUNG
Zénobie ou l’âme rebelle
Victor Arbarossa venait de s’endormir. À six heures du matin, un charivari intense et improbable prit possession de l’immeuble. La guerre s’immisça avec une violence incongrue, pour une rue tranquille d’une ville quelque peu à l’écart des grands flux économiques. Des cris, des hurlements et le vacarme d’une porte enfoncée accompagnèrent les bruits d’une fenêtre pulvérisée. Une dizaine d’individus en noir, cagoulés, armes en main, le cernèrent, le menottèrent. Sur les uniformes matelassés, qui transformaient les hommes et la femme – une queue de cheval blonde dépassait – en robots, blindés et démesurés, un bandeau avertissait : RAID. D’autres policiers en civil entrèrent à leur tour.
— Bouge pas ! Bouge pas !
Victor, maintenu immobile sur le sol, la cage thoracique comprimée par le poids et la forme d’un genou, étouffait. Il s’efforça d’orienter son esprit vers un point quelconque, plutôt que de manifester une résistance, qui, même minime, pourrait donner l’idée aux policiers de l’écraser plus encore. Il distingua les poussières sur le parquet et, sous le lit, un sous-vêtement oublié par sa compagne. Victor avait passé une nuit pénible, dont il savait qu’elle était l’ultime partagée avec Muriel, qui vers minuit s’était levée, habillée à la va-vite, et était partie en murmurant : « Adieu, Victor. » Nu, les mains menottées dans le dos, tenu en joue, il tentait de réguler sa respiration douloureuse. On le retourna, lui enfila un pantalon, ferma un bouton de la braguette.
— Debout !
Il glissa ses pieds dans les chaussures de sport délacées. Une couverture acheva l’habillage succinct. Maintenu par deux policiers, il ne voyait pas où mettre ses pieds. On lui fit baisser la tête pour pénétrer à l’arrière d’une automobile, qui démarra aussitôt en hurlant. Des gens ébahis regardaient leur voisin par leurs fenêtres, professeur de philosophie de son état et délinquant avéré.
Pourquoi l’avait-on arrêté ? Dangereux activiste de l’écologie, écoterroriste, il était passé aux actes. Il remettait en cause la société en légitimant le non-droit par la violence. Des semaines d’interrogatoires, de confrontations, de pressions l’imprégnèrent à la façon d’un répulsif. La police usa des techniques déstabilisatrices habituelles. « Tu es un diesel ancien modèle. Pas d’électronique embarquée ! Comme cela, tu lambines, tu as tout ton temps, tu pollues tranquillement la société et on ne te repère pas ! » L’enquête ne parvenait pas à établir un lien évident entre lui et l’entreprise incendiée d’extraction de granulats. Des journaux publièrent non pas ses aveux puisqu’il n’en fit pas, mais les raisons de son combat. Ainsi disserta-t-il publiquement sur les questions qui brûlaient depuis des années ses jours et ses nuits. Qui pour défendre la nature ? Pour la protéger des pillages, des viols ? Pour être l’avocat de la santé, des humiliés, du sol ? La désobéissance comme légitime défense, et alors ? Qui s’occupait des vrais nuisibles ? Victor récusait les exigences de l’ogre économique et la passivité des consommateurs. Qui d’autre que lui pouvait avoir mis le feu aux engins de l’entreprise qui avait déposé une demande d’agrandissement, englobant une zone protégée, pour cette carrière qu’il combattait ?
La phonétique lui avait valu, à l’école, puis à l’université, le surnom équivoque de Barberousse, et visiblement les policiers en abusaient, ne sachant lequel du pirate ou du Turc était le plus dangereux. « Barberousse », utilisé aussi par les lycéens, avait fuité dans la presse… Ses voyages, notamment plusieurs en Corse, et ses visites dans les camps zadistes plaidaient contre lui. Victor était surveillé depuis deux ans, et son profil correspondait trait pour trait au prototype de l’activiste. Il était d’autant plus dangereux qu’il doublait son action souterraine d’une activité intellectuelle contestataire, pratiquant un copier-coller avec son maître italien, Erri De Luca, qui avait fait de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin son cheval de Troie idéologique en appelant au sabotage. Si lui prenait l’envie de se présenter à un concours de professeur des universités, Arbarossa disposerait de l’autorité scientifique. Même son prénom, Victor, rappelait l’anarchiste Victor Serge, celui-là même qui refusa de dénoncer la bande à Bonnot. Il y a des signes qui ne trompent pas. Comme de rougir, une sorte de délit pour celui qui ne sait mentir.
Pour les enquêteurs, le faisceau d’indices était suffisant. Mais Grégoire Garcia, Gégé pour ses collègues, commandant de police, spécialiste du renseignement, ne parvenait pas à établir de preuve indiscutable contre cet anarchiste dangereux, qui, face aux ventres mous de la démocratie, s’en sortait toujours. À titre personnel, tous ces bobos qui s’adonnaient à la philosophie pour justifier leurs opinions laxistes l’énervaient au plus haut point. À chaque apparition télévisée d’un de ces pseudo-spécialistes de la réflexion, Gégé zappait, sachant que sa haine se focalisait sur ces médiatisés qu’on voyait partout et qui avaient un avis sur tout ! En tant que citoyen, il leur attribuait une part non négligeable de la déliquescence générale. Il avait exposé à sa hiérarchie un moyen d’approche, certes moralement douteux, mais tout à fait légal. Son chef avait répondu : « O. K., mais il faudra qu’elle s’engage ; autrement, cela ne tiendra pas devant le juge ! Et que tu prennes des précautions ; je n’aimerais pas voir une photo dans les journaux ! » Il pensa un instant : « On ne maîtrise jamais l’irrationnel ! » Gégé ne confia pas que les choses étaient déjà engagées…
Gégé alternait les compliments sur l’intelligence et l’opérationnalité de Victor.
— Tu as de l’imagination, tu t’adaptes en permanence. Tu passes au travers… Mais tu ne me la fais pas ! Les Robin des Bois comme toi, il n’y en a pas des masses… Je ne te dis pas que quelquefois, face à un scandale, on n’a pas envie… Chez les zadistes, il n’y a pas que des marginaux ou des imbéciles. À vingt ans, on est idéaliste… Tu connais la chanson… Nous y sommes tous passés. Tu aimes la clandestinité parce que paraître est non conforme à ta stratégie. Tu ne veux surtout pas être remarqué !
Victor objecta que, dans ce cas-là, il n’aurait pas fait de conférences, ni commis quelques écrits ! Mais le policier continua :
— Chez toi, pas d’embrouilles ! Cela ne risque pas, puisque tu nous fais croire que tu agis seul ! Et tu es malin ; on a beau fouiller, personne en vue. Même ta nana n’était pas au courant ! Je dois reconnaître que tu n’es pas mauvais. Jamais ta voiture en ville ; transports en commun, et vélo ! Tu chopes les trottoirs et les sens interdits ; comme ça, tu empêches qu’un véhicule te suive ! Combien de fois as-tu tenté de nous berner ! Un coup, tu traverses la rue et la retraverses aussitôt ! Tu te mets à courir et tu te retournes brusquement ! Mais, mon bonhomme, on est plus costaud que toi, et tout aussi discret ! Tu ne te caches pas. On sait où tu es. La lumière chez toi, tes volets jamais fermés, tes cours au lycée, ton bar avec ta cour de gamins. Plutôt de gamines ! Mais voilà, il arrive des trucs pas clairs et curieusement tu es signalé dans le coin problématique… La lumière reste allumée chez toi et s’éteint comme par magie. Normal, le programmateur, c’est un truc exprès. Tu sais, celui qu’on a trouvé sur la prise de ta lampe de chevet ! On s’intéresse à toi, à ta mentalité, à tes petites et grandes manies depuis près de deux ans… Voilà ce que je pense, tu es un solitaire, un activiste d’autant plus dangereux… Tu crois que c’est le moment de jouer au terroriste, de faire ta Marie-Antoinette ? On n’a pas assez des fous de Dieu ! Les attentats, ça ne te suffit pas !
Victor demanda des preuves. Celles-ci étaient en cours de constitution et exigeaient du temps pour être affinées. Le policier souleva les épaules.
— Mon boulot à moi, c’était de t’arrêter ! La juge va instruire avec les présomptions qu’on lui fournit. Le climat n’est pas bon pour des gens comme toi ! La magistrate se doute que tu ne reconnais pas la justice… Tes écrits, ton ordinateur, les comptes-rendus de policiers dans tes conférences, tout cela va aider… Nous, on va continuer à recouper, à écouter… Et puis on a une déposition… Tu crois que je bluffe… Tu devrais réfléchir… Sans doute, la juge tiendrait compte de tes aveux…
Victor avait décidé, dès le début de l’interrogatoire, de ne pas répondre. Il parlerait devant la juge, pas devant des instructeurs à charge. Ce n’était pas la seule raison de son silence. Il y avait Muriel. Le policier fut obligé de se dévoiler.
— On sait que tu étais à Bergerac. Tu as dit à ton amie que tu donnais une conférence sur l’anarchisme. Mais pas de conférence dans les programmes ! Rien ! Nada. Pourtant, un patron de café t’a reconnu. Il était tard, tu étais son dernier client. Il avait sommeil. Tu ne partais pas. Ton amie a déclaré qu’elle était souvent seule les soirées. Marrant, en comparant les déprédations sur des opérations contestées – et pourquoi pas contestables – et tes absences, cela semble coïncider… Mon boulot, c’est d’établir ces corrélations. Tu ne réponds pas et tu as tort. Cela ne m’emmerde même pas. Un jour ou l’autre, on saura et tu ramasseras. J’en reviens à ta copine ; c’est malheureux des gars comme toi. Vous êtes aveugles.
Victor regarda le policier, qui lâcha avec ironie :
— Elle est jolie, n’est-ce pas, et attachante…
Son ancienne compagne n’avait pas quitté leur domicile, juste avant l’intrusion, par hasard… La déposition qu’avait évoquée le policier était la sienne. Rien de précis, seulement une femme qui relatait les absences de son compagnon…
Gégé laissa échapper un sourire ambigu et reprit :
— Les jerricanes d’essence dans le garage, la grande cisaille à métaux, et deux bidons de chlorate de soude. Pour t’amuser ? Tu gardes ça dans la cave ? Pas la tienne évidemment, celle de la maison de tes parents. Le voisin t’a vu, la veille et le lendemain, entrer et sortir par le garage… Beau score ! Deux chargeuses-pelleteuses, deux dumpers, un scrapeur, plusieurs minipelles, deux tracteurs, trois camions, et la liste n’est pas close. Je te passe les deux 4x4. De la dynamite disparue… Le gars qui a fait ça – en l’occurrence, Victor Arbarossa – a fait fort… Tu as pris des cours en catimini. Je ne sais pas, moi, peut-être en Corse.
Victor esquissa un sourire…
— La bouillabaisse est excellente chez Francis, à la Cala d’Orzo… Depuis le raté des gendarmes, ils ont refait la paillote. Ironie de l’histoire, une plage à deux encablures de celle de Cupabia où le sous-marin Casabianca apportait des armes au maquis corse. Et tes fringues ? Il en manque. On a des photos récentes et des témoignages. Ton pantalon style baroudeur, le genre qu’on trouve pas cher à Decathlon, pour la randonnée. Idem pour le blouson et les godasses. Tu ne sais pas ce qu’elles sont devenues, tes fringues ? Nous, on a une petite idée, même si ta nana est évasive sur ce sujet. Elle ne veut pas te charger. Tu les as brûlées !
La magistrate était une jolie femme d’une cinquantaine d’années. Sobre et calme. Victor répondit à ses questions, même aux plus saugrenues. Son goût pour la Corse ? Une origine grand-parentale, du côté de son père ; une île qui avait survécu par sa quête d’identité, par sa musique retrouvée, par le farniente, par un rapport revendiqué à l’argent facile ! Il fallait payer, l’été, pour voir la belle ; quoi de plus naturel ? Sa présence auprès de zadistes ? Pourquoi renier ses idées ? Ses théories altermondialistes ? Fallait-il faire un slogan du titre du roman de Boris Vian, Et on tuera tous les affreux ? Entendons par là les pauvres et les miséreux ! Bergerac, les simples dires d’un patron de café pressé d’aller se coucher ou de regarder la télé ? Un alibi vérifiable pour cette nuit-là ? La nature diurne !
— Pourquoi ne pas proclamer votre innocence ? L’accusation sans preuve est une technique inquisitoire ! Mais il y a cette forte présomption, ce faisceau d’indices !
— La présomption d’innocence est supérieure !
Victor n’avait en aucun cas été maltraité. Il était mâché, malaxé, trituré par la mâchoire policière et judiciaire. À quoi croyait-il ? À la révolte, et encore par désespoir ! La magistrate fixa son regard sur l’homme dont elle instruisait le procès.
— Monsieur Arbarossa, c’est pour cela que je vous crois dangereux. Vos analyses sont loin d’être simplistes… On veut bien vous écouter, mais pour aller où ? Franchement, vous pensez que l’entreprise dont le matériel a brûlé va stopper son travail ? Non, elle sera remboursée pour partie par les assurances, et quelques paroles équivoques en public sur l’emploi décideront les collectivités à lui octroyer des aides ou des chantiers. Mais ce que j’en dis…
Elle arrêta un long moment son regard sur Victor.
— Vous revendiquez la marge ; ne vous êtes-vous jamais demandé si cela n’arrangeait pas le système que vous combattez ?
— Si, pour vous, je suis un révolutionnaire, alors, banco ! Toute révolte a un sens. Elle prédit l’avenir.
— Les enquêteurs se demandent si vous n’êtes pas un contributeur, évidemment anonyme, de ce Comité Invisible, qui a fait parler de lui dernièrement avec une parution sur l’insurrection. L’éloge du sabotage, la lutte contre l’État, la haine de la police ; les ingrédients ne se retrouvent-ils pas dans vos propos, monsieur Arbarossa ?
— Vous ne pensez pas que la destruction de la planète mérite une insurrection des hommes ? Vous avez des enfants ? Qui sabote quoi ? La lutte contre l’État, dès lors que vous étudiez le mouvement anarchiste, vous en comprenez les arguments. Paul Valéry, grand poète s’il en est, parlait de l’État comme d’un monstre froid ! La haine de la police ; vous m’avez entendu une seule fois m’opposer, insulter, me rebeller ? Par contre, ne me dites pas que la répression au nom de l’ordre public lui confère une image progressiste !
— Monsieur Arbarossa, vous posez la question récurrente de la contestation de la société. Le tribunal jugera si vous êtes un activiste dangereux – je ne retiens pas le mot « terroriste », un temps évoqué à votre égard – ou un poète. En attendant, je ne peux me permettre de vous laisser dans la nature.
Son regard fixait cet homme séduisant qui refusait d’être réduit à l’état d’humain connecté, qui améliore, de lui-même, le grand algorithme pour sa plus grande dépendance. D’être cartographié en permanence. Panurge était un triste archétype. Ce Victor Arbarossa était un héros romantique qui exigeait de relever la tête, de regarder la terre avec des yeux d’humain !
Durant presque un an, Victor connut la prison préventive, jusqu’à son non-lieu du 28 février de l’année suivante. Pendant cette période, il accepta la proposition de publication de ses écrits, de ses articles, de ses prises de position, et il donna les droits d’auteur à une association environnementale. Cette année-là, sa mère mourut et il ne pleura pas – une chute mortelle lui évitait la longue agonie d’un Alzheimer où les fonctions vitales en prennent un coup chaque jour. Son père avait connu le même itinéraire de fin du monde, trois ans auparavant. Muriel, son ancienne compagne, s’installa avec Grégoire Garcia, qui la consola. L’avocat de Victor, commis d’office, pour lequel cette affaire pouvait s’avérer une opportunité heureuse, travaillait sur la faiblesse du dossier et la recherche de témoignages favorables.
Seul son frère, Bruno, le soutint avec fierté. Cadre, sans doute trop âgé, aux méthodes sans doute dépassées, sa hiérarchie l’avait mis au placard. Un déclassement déguisé. Sa direction supprimée, il devait configurer les objectifs de son nouveau poste, pour lesquels cependant il ne recevait jamais de réponse malgré ses notes répétées et ne disposait d’aucun budget ni d’aucune logistique. Attaqué sur sa légitimité, sur ses capacités professionnelles, il avait entamé un processus de chute d’autant plus terrible qu’il ne s’attendait pas à cette déconsidération, lui qui avait fait passer sa famille au second plan. Il gagnait son bureau à l’heure prescrite, s’asseyait devant une table vide. On lui retira l’accès à Internet une quinzaine plus tard. Ses collègues le saluaient, mais ne s’éternisaient pas. Plusieurs suicides avaient émaillé la restructuration de l’entreprise, suicides expliqués par des causes personnelles. Bruno s’arrêta un soir dans une librairie, acheta le bouquin d’un Japonais, exposé en vitrine avec une étiquette « coup de cœur ». Haruki Murakami s’invita dans la vie rangée de Bruno Arbarossa ! Quand il eut achevé la lecture de toute l’œuvre traduite, Bruno craqua. L’imagination ne suffit pas à le protéger. Aucune propolis ne parvenait à boucher les interstices, devenus plaies béantes, de sa déstructuration. Son épouse avait refait sa vie ; ses deux enfants étaient élevés. Bruno se raccrocha à la défense de son frère Victor. Il fut héroïque à de nombreux moments, cachant son propre mal. Il fit tout ce qu’il put, visita Muriel plusieurs fois pour plaider la cause du prisonnier, prit en charge déménagement et paperasserie. Le suicide d’un de ses anciens collaborateurs l’affaiblit un peu plus. Son entreprise, dont l’État était un actionnaire important avec droit de blocage, continuait l’application de son plan de relance. Les vieux n’étaient plus dans le jeu. Mais l’auteur japonais avait sauvé Bruno des grandes profondeurs. Relatant un monde où l’irréel et le réel établissaient des ponts magiques, il avait élevé des pare-feux. Bruno avait besoin de repos, mais il n’était pas détruit. Ses collègues découvraient la force intérieure d’un homme, pourtant lynché… Il avait besoin de calme pour rêver, pour se projeter. L’enfermement psychologique occultait l’issue de secours.
Victor, dès son arrivée à la prison, inaugurée quelque six mois auparavant, fut présenté au directeur.
— Monsieur Arbarossa. Vous êtes là pour un long moment. La préventive a une durée moyenne de neuf mois. Ce peut être plus. Pour moi, vous êtes présumé innocent avant toute décision de justice… Il faut attendre votre procès dans les meilleures conditions ; or les prisons sont surpeuplées, et même dangereuses, malgré les efforts du personnel pénitentiaire… Cette petite présentation pour vous expliquer que vous partagerez la cellule d’un Gitan. À sa demande ! Cela m’a étonné, mais une entrevue avec Gomez – ici, tout le monde l’appelle le Tatoueur ; il vous confiera pourquoi – m’a convaincu. Gomez a entendu parler de vos exploits, mais cela ne l’intéresse pas. Votre curriculum, oui. Vous êtes professeur de philosophie ! Lui n’a fait aucune étude. Il sait lire et écrire, c’est tout. Ne soyez pas surpris, quelques prisonniers passent le bac ou reprennent des études. Nous les encourageons… Je dois vous prévenir, Gomez est un caïd, un chef de tribu. Il n’a rien d’un ange. Si cela ne va pas avec lui, je vous changerai de cellule. À l’inverse, il est irréprochable dans sa conduite. C’est un des hommes les plus craints de l’établissement ; son regard devient vite insoutenable s’il rencontre une opposition. Sa proposition m’arrange, d’un certain côté. Nous avons ici des populations difficiles, des ethnies qui se confrontent…
Le gardien ouvrit la porte.
— Le Tatoueur, je t’amène un colocataire…
Victor avait en face de lui un Homo sapiens d’un autre âge, surgi des romans noirs d’après-guerre. Le visage dur, au regard d’acier, le cheveu ras avec des cicatrices sur le crâne, dont une circulaire qui évoquait la forme d’un tesson de bouteille. À chaque mouvement, les muscles ramassés, nerveux, hésitaient entre le métal et l’élasticité. À cela s’ajoutaient un ton cuivré et un parler de forain. Le Tatoueur avait les yeux gris-bleu, couleur fonte des neiges. Son regard restait sur le qui-vive, mobile, et perçant. L’ardeur de son éclat intimidait. Il signifiait à la personne d’en face qu’il épargnerait les seuls bienveillants. L’interlocuteur se sentait hypnotisé. Le Gitan lui tendit la main en souriant. Le gardien s’esquiva sans bruit, mais stationna un moment derrière la porte.
— Je te remercie d’avoir accepté, et le dirlo aussi… J’ai une proposition à te faire. Tu me mets au parfum pour la philosophie. C’est un truc qui m’a toujours intéressé, mais personne ne m’a appris et je ne sais pas comment m’y prendre. Il faut m’expliquer avec des mots de tous les jours. En échange, je te propose la fonte et le crayon. Je dessine tout le temps. Je réfléchis à une gamme de tatouages pour dehors. Tu sais, en prison, il faut s’occuper, se préparer pour la sortie. Faut pas rester seul avec soi.
— Tu t’en doutes, je ne connais personne. Ça me fera plaisir qu’on échange ! Le seul truc : je n’ai pas envie qu’on m’emmerde. J’ai souvent besoin de silence.
— O. K., Barberousse, ne t’inquiète pas pour les emmerdements. Je peux t’appeler Barberousse, comme dans les journaux ? Ça te va bien ! Toi et moi, on fait la tête et les jambes ! T’as pas connu, c’était un jeu télévisé. Le premier répondait aux questions, l’autre aux défis sportifs ! Tu as négligé le corps ! Moi, le cerveau ! J’ai appris que l’un ne marche pas sans l’autre. Le corps, cela a l’air con. De la viande. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a trois endroits où tu le découvres par nécessité et souvent trop tard. À la plage, où tu passes pour un mal foutu auprès des femmes, qui, quoi qu’elles en disent, ne négligent pas les muscles, la virilité… Avec du bide, tu perds un max de points ! À l’hôpital, tu regrettes tes addictions, tes flemmes. Tu viens pour le curatif, il te fallait penser au préventif ! En prison, c’est une question de survie. Si tu veux te laver tranquille, manger tranquille, dormir tranquille, il te faut une gueule et ce qui va avec ! T’es pas costaud, t’es un faible. T’es un faible, t’es au service ! Ne baisse jamais la tête, autrement, t’es foutu !
Le Gitan avait reniflé à distance un collègue quelque peu différent, une sorte de Zorro intello, et l’avait aussitôt pris en sympathie, le protégeant ainsi des vicissitudes et des promiscuités. Victor fit son temps en toute quiétude, sans se préoccuper une seconde, une fois passée la première nuit, de sa sécurité. Des communautés s’ignoraient, se méfiaient, se toléraient. Dès le lendemain de l’incarcération, ils se mirent au travail.
— Dis-moi, tu peux me parler du gars qui a dit que la propriété c’est le vol…
Victor sourit.
— Proudhon, un des premiers théoriciens de l’anarchie… C’est pour ça que tu t’intéresses à la philo ?
— Oui, franchement oui ! Tu sais pourquoi je suis là ? Parce qu’on me dit que j’ai volé… Moi, je vois pas les choses comme ça.
— Tu dirais quoi si on se servait chez toi ? D’ailleurs, Proudhon, à la fin de sa vie, avait adouci sa position. Il ne militait plus contre la possession limitée, dès lors qu’elle venait du travail…
— Il y a vol et vol ; c’est ça que j’aimerais que tu m’expliques.
— Ça va, on a du temps…
Proudhon, les utopistes, les socialistes furent les premiers invités… Le Tatoueur n’était pas un homme de l’écrit. Lire les textes lui était difficile. Victor fit l’essai. Le Gitan se concentrait, puis reposait l’ouvrage quelques minutes plus tard. « C’est pas pour moi ! » Victor racontait, ponctuait d’une citation, sur laquelle son élève dissertait à voix haute. Après la propriété, Victor aborda la question du travail. Il appliquait les préceptes de la maïeutique, même si Platon n’était pas encore à l’ordre du jour. L’intérêt était de faire parler son ami, de l’aider à construire son raisonnement. Victor lui fit découvrir Paul Lafargue et Bertrand Russell, lesquels plaidaient pour une courte journée de travail, quelques petites heures quotidiennes. Puis les tenants du revenu universel d’existence.
— Le travail, vous, les gadjé, vous avez un problème avec ! Vous faut un emploi régulier, avec la sécurité sociale, les vacances et le compte en banque ! Nous, on exerce notre métier de Gitan. En gros, on se démerde, on s’adapte. On sait faire un tas de trucs. Mon grand-père était dégraisseur de chapeaux et réparateur de parapluies. Ma grand-mère, diseuse de bonne aventure et voleuse de poules ! Du classique. Mes parents chinaient, ramassaient, revendaient. Quand cela ne suffisait pas, ils faisaient les saisons. Tu sais, les trucs que personne ne veut. Ramasser les fruits et les légumes à la journée, par exemple. Nettoyer les chiottes après une fête. On a plein de cordes à notre arc. Sans parler du cirque et des foires. Nous sommes des forains dans l’âme. La réussite sociale n’a pas de sens pour nous… Pour les allocs, tu crois qu’on va cracher dessus ? On nous les donne ! C’est de la chance en plus. Voilà tout ! Nous, on prend le temps de voyager. Vous, c’est à la sauvette. Un avion, et bing ! un week-end avec ta poulette quelque part. Nous, on vit chaque seconde de notre temps. Pour voir la famille, pour les mariages, les naissances, les deuils. On ne laisse jamais les nôtres seuls dans le malheur. On s’occupe de nos enfants, on ne les confie pas à n’importe qui comme vous ! C’est notre tribu. On ne veut donner de leçon à personne ; on vit comme ça ! Continuez à travailler comme vous le faites. C’est votre problème ! Parle-moi des gens qui pensent comme nous depuis longtemps et que vous avez sortis de votre programme. Tu comprends pourquoi j’aime la philo ?
Pour terrible qu’il fût dans la vie, le Gitan était un personnage romanesque. Il s’était pris de passion pour le tatouage et lisait avec boulimie toutes les publications sur le sujet, autodidacte enthousiaste qui, ne sachant trier en amont, ingurgite tout, même l’inutile, même le faux. Son rêve était de visiter les grands salons de tattooing et de causer, avec chaque artiste, de sa technique, de ses motifs, de ses représentations. L’ornementation pure, les courants esthétiques, ne lui disaient rien qui vaille, parce qu’ils étaient creux. À l’image de l’époque ! Comme si l’esthétique avait à voir avec la vraie beauté ! Des millions de gens encrés, avec une fleur sur l’épaule, un papillon dans le dos, voire un serpent qui glissait vers l’entrejambe, c’était du maquillage, de la foutaise. Lui, voulait être maître tatoueur ; ce n’était pas donné au premier manieur d’aiguilles ou de dermographe ! Il ne prendrait pas la peau des gens pour y graver des tags comme sur un mur. Il avait ses bibles. Il privilégiait ce qui touchait aux rites et à l’anthropologie. Le catalogue d’une exposition du musée du quai Branly et un atlas mondial tenaient lieu de textes sacrés et d’annuaires. Le Tatoueur étudiait les représentations lointaines de son peuple, ses symboles, même si sa communauté, pour une bonne partie, avait opté pour l’église évangéliste. Une centaine ou plus de caravanes se concentraient ici et là pour de grands rassemblements. Le Tatoueur les avait fréquentés, autant pour ses affaires que pour voir, mais il restait méfiant. Il préférait la tradition à la religion. Un cahier contenait une quarantaine de signes, semblables, au premier regard, à une succession de pictogrammes orientaux.
— Ce sont des signes de reconnaissance anciens, oubliés aujourd’hui. Ils servaient à éviter des pièges, à donner des informations sur les lieux ou les gens : qui était sympathique dans le coin, où trouver de la volaille… Et bien d’autres choses. Le signe sur un arbre, une pierre, une porte, renseignait ceux qui passaient par là. Ce qui est secret a du sens. Face au mauvais œil qui pouvait nous toucher, le tatouage avait une autre fonction, il nous protégeait. Il était magique. Pour cela, on accompagnait l’opération de prières et de formules. Des petits points géométriques sur le visage, la commissure des lèvres, le menton, les joues. Dans les temps anciens, jamais sur les autres parties du corps ! Bien loin du folklore que les boutiques vendent. Nous ne redoutons que deux choses : la solitude et la maladie !
Son compagnon n’avait jamais exercé son art jusqu’à présent. Il avait causé avec des gars comme lui, dont certains étaient sortis depuis. Ils tenaient à leurs signes corporels. Un prestige qu’ils revendiquaient. Le Tsigane se préparait à devenir un artiste reconnu. L’administration lui avait promis une formation hygiène et salubrité, pour qu’il connaisse les règles professionnelles – une pièce spéciale, l’outillage à usage unique, les désinfections, les stérilisations –, tout un tas de trucs qui l’éloignait du plaisir simple et ancestral de l’aiguille encrée sous la peau, mais qu’il appliquerait pour éviter les déboires dans ce domaine.
La prison ressembla à une usine qui pratiquait les deux-huit. Une année de travail intense mêla, comme l’avait promis le Gitan, la tête et les jambes. Victor enseigna à un étudiant dévoué et travailleur, souleva des tonnes et des tonnes de fonte pour durcir ses muscles, apprit des techniques de combat rapproché et écouta beaucoup. L’intimité du Tatoueur lui permit de découvrir une philosophie du monde d’une grande simplicité. Elle prenait ses racines dans le début des temps. Son ami la résumait ainsi : « Toi et moi, on est des insoumis ! Dans les sociétés primitives, le chef est celui dont on exige tout. Ce n’est pas le gars qui commande pour qu’on fasse ses quatre volontés ! Vous vous êtes laissé avoir par la morale ! Vous condamnez les voleurs, alors que ceux qui vous engagent sont les plus grands voleurs ! Les puissants commandent les banques, vous rackettent, et vous, en échange, vous lavez blanc ! Nous, on est en dehors et on en est fier ! On profite de chaque instant de la vie. Parce que la mort est là. Nous n’oublions jamais la mort ! »
Victor avait besoin d’entrevoir la montagne de la fenêtre de leur cellule. Le Gitan ne le dérangeait pas lors de ces points intimes. Il laissait le marin embarqué régler le sextant au mieux dans sa tête. Barberousse était un mec bien. Il avait besoin d’être seul par moments, et, dans une cellule, c’est compliqué. Cette montagne lointaine n’était rien d’autre qu’une ligne épaisse et dentelée qui fixait l’horizon. Celui-ci obéissait aux lumières changeantes, s’approchait, reculait ou disparaissait. Lorsque la montagne était invisible, du fait du mauvais temps, Victor s’entêtait. Plusieurs fois par heure, il allait à la fenêtre et forçait son regard à creuser la brume. Les barreaux étaient encore plus sinistres ces jours-là. Ils ne laissaient pas d’espoir. Le monde était clos. Il n’existait rien hors les murs. La preuve, il n’y avait rien à voir ! Mais parfois Victor discernait une pointe ou un arrondi fumeux, évanescent, furtif. Il apprécia la compagnie apaisante, exigeante, enrichissante du Gitan, onze mois et quelques jours, le temps du dégonflement du dossier d’accusation.
Lorsque Victor connut la date de son jugement, le Tatoueur prit un air plus sérieux que jamais.
— Barberousse, je sais des choses. Difficile à t’expliquer… Des choses qu’on ne voit pas, qui vivent dans les profondeurs. Tu vas partir, et je ne peux pas rester avec. On ne sait jamais ! Je ne dois pas mourir sans les passer. Je ne te parle pas de mon business. Mais d’une chose qu’on se lègue dans la famille pour ceux qui l’acceptent. Mon fils n’est pas prêt. D’autres proches ne veulent pas s’encombrer la vie. Si tu acceptes, tu en feras ce que tu veux…
Victor accepta, avec une pointe d’humour.
— Et c’est à un type comme moi que tu veux te confier ! J’en suis ému. Tatoueur, tu peux compter sur moi pour les secrets.
— Je sais que tu es prêt, que tu le désires au fond de toi !
Victor avait écouté son ami avec attention. Il n’avait pas tout saisi des propos du Gitan, qui entrecoupait sa révélation de détours plus ou moins ténébreux sur la nécessité de ne pas s’écarter du grand Mythe. L’homme avait chuté ; de là venait le mal. Il fallait se conformer à l’enseignement du Mythe pour être fort. Le Tatoueur ne parlait pas de Dieu. Il usait de métaphores, remerciant Victor de l’avoir éclairé sur le contenu philosophique. Le Mythe expliquait l’armature souterraine de la vie. Des êtres invisibles couraient dans les lieux préservés. La force ne demandait qu’à être perçue, acceptée. Victor trouvait son ami quelque peu mystique, attribuant ce trait de personnalité à la religiosité reconnue des Gitans.
— On ne fait pas n’importe quoi de sa vie. Il y a un sens. Il faut le respecter. Autrement, c’est après que cela n’ira pas. Là-haut, on ne t’embêtera pas parce que tu as emprunté… et le sang répandu pour des raisons nobles est grave, mais pardonnable. Barberousse, on ne fait pas n’importe quoi ! On ne renie pas Dieu et sa famille ! C’est contre nature. Quand tu as quelque chose qui ne va pas, tu cherches un conseiller. C’est ce que je suis ! J’écoute le mal des hommes ! En écoutant, j’agis. Je vais te confier ma force !
Le Gitan était le descendant d’une famille marquée par le don. La plupart des femmes de sa lignée avaient été reconnues dans la communauté. Ce fut son tour, faute d’élues. Le Tatoueur avait un pouvoir particulier, non celui de soumettre à sa volonté le cours des choses, mais celui d’établir des dérivations. Le Gitan avait des accointances mystérieuses. La présence de Victor dans sa cellule pouvait d’ailleurs s’interpréter de la sorte.
Il avait posé sa main sur le front de Victor, l’avait regardé en silence. L’épisode avait duré quelques minutes. Victor se souvenait de peu de choses, des mots marmonnés, des signes, des tremblements de la main, de la sueur… Il était épuisé. Un grand calme l’envahit, et, un moment après, il eut l’impression d’une immense force en lui.
— N’aie plus de pensée négative ou de crainte. Attention, Barberousse, le don est besogneux ! Si tu le laisses à l’abandon, il te travaillera, te rendra malade. Tu vivras dans l’inaccompli !
Le procès donna lieu à de nombreuses manifestations. Une compagnie de CRS protégeait le tribunal. Durant une semaine, des journalistes interrogèrent les sympathisants, rapportèrent les interprétations, les sous-entendus, les colères des parties. La magistrate sourit à Victor.
— Vous êtes libre, monsieur Arbarossa.
Il lui sembla qu’elle aurait aimé en dire plus. Mais la fonction et le lieu s’y opposaient sans doute. Il n’eut pas le temps de la séparation avec le Tatoueur. Une simple poignée de main !
— Que la chance soit avec toi !
Victor répondit avec émotion :
— Gitan, tu es dans mon cœur !
Il retrouva sa liberté, sans préparation. Personne ne l’attendait. Son frère avait rechuté. Un sommeil chimique l’apaisait. Le médecin l’avait retiré de la vie civile un moment. Depuis deux semaines, les visites étaient interdites. Bruno dormait.
Victor craignait ce mois de février qui lui portait souvent malchance ; sans doute une question de conjonction planétaire, lors de la rencontre, dans le ventre de sa mère, d’une petite graine paternelle et d’un ovule. Il disposait de nouveau de ses papiers, d’argent. S’il tentait d’analyser sa situation, ce n’était pas si mal. Avec un non-lieu, il retrouverait de fait son boulot, mais il n’y croyait plus… La justice avait renoncé à le condamner pour faute avérée et se contentait de l’auréole suspicieuse qu’elle lui avait imposée et que rien n’effacerait, pas même un blanchiment officiel.
Victor répondit aux questions des journalistes présents. Il resta sobre, n’exprimant aucun désir revanchard, expliquant qu’il avait besoin désormais d’air et de grands espaces. Il n’envisagea pas de jouer la victime d’une politique nationale ou internationale, d’entrer en guerre ouverte contre les politiciens qui l’avaient mené là. Il avait rayé de son esprit tout espoir de sauvegarde collective et de justice sociale. Il ne croyait qu’en ces actions aléatoires, inespérées, mais moins rares qu’on pouvait le penser, d’individus qui offrent un moment de rééquilibrage. Toutefois, lui ne se sentait plus capable d’un tel geste. L’incarcération l’avait changé. Il se méfiait des mots. Il n’avait pas commandé de taxi. Une journaliste lui offrit une place dans sa voiture. Elle le déposa à proximité de la place centrale.
Victor flânait. La liberté ne signifiait pas encore. Ses pas le guidaient dans la vieille ville. Un rire clair le surprit dans sa marche lente. Il leva la tête. Au deuxième étage de la façade lépreuse, qui donnait sur une placette historique, un jeune couple fumait. Lui, torse nu, musclé, un large tatouage sur la poitrine. Elle, un tee-shirt trop ample qui dénudait ses épaules, les yeux dans l’ailleurs qu’elle venait d’atteindre. Ils prenaient l’air d’une fin de matinée d’un printemps précoce et ensoleillé. Le regard de la jeune fille sentait l’amour, la chair rassasiée. Celui du garçon, la satisfaction d’avoir su bien faire. La poitrine tendue, douloureuse et brûlante, sous le tee-shirt de sa compagne, le certifiait. Ils fumaient un opium en vente libre, celui de l’insouciance, du plaisir. Victor baissa les yeux. Pourquoi les déranger, être le voyeur d’un état qui ne lui appartenait pas ? Il vivait un de ces instants qui ouvrent la porte à la mélancolie, à ce grand combat intime de la défaite annoncée. La fille n’était pas là pour lui. Ce n’était pas de la jalousie. Il ne la connaissait pas. Mais elle était l’archétype de ce qu’il ne vivrait plus, de ce qu’il ne ressentirait plus. Il en avait la certitude. Le type à côté d’elle pouvait être quelqu’un de bien ou un parasite ; il avait permis à ce regard féminin, si lointain et si proche, d’aveugler sa route. Victor se dissimula dans l’encoignure d’un immeuble proche et tenta, en se penchant, de l’apercevoir un instant encore. Elle était comme une fleur ouverte ; la fumée de la cigarette sortait de sa bouche. Elle allait se refermer jusqu’à nouvel ordre, et cette prochaine fois, ce ne serait peut-être plus le garçon d’à côté qui la lui procurerait.
Victor s’éloigna. Il est des jours dont la noirceur pèse de tout son poids sur la vie intérieure, qu’elle soit organique ou psychologique. Il avait mal au ventre. À ces mouvements du corps s’ajoutait la terrible certitude d’une solitude sans fond. Une vieille dame buvait le contenu d’une tasse, seule face au mur de sa cuisine, dans un immeuble de béton prétentieux. L’horreur urbaine le frappa soudain. Presque personne ne s’attardait dans les rues, c’était l’heure du bureau. Les gens répondaient à cette sirène inaudible. Formatés, ils marchaient, tout à leur résignation. Victor se souvenait de cette question récurrente, énoncée comme une interpellation morale, à chaque début de cours, par son prof de philo au lycée, celui-là même qui l’avait déterminé à suivre un chemin identique : « Que dire à ses enfants ? » Il ne s’agissait pas de pédagogie, de religion ou de Platon. Non, son prof se débattait avec l’angoisse de bien exister… Victor traduisait cette interrogation en un pourquoi, esseulé et tragique.
Le rythme contraint de la prison ne le bordait plus. Des tonnes de fonte pour briser les muscles, les empêcher de solliciter l’abandon, l’avachissement ou le projet d’évasion. Beaucoup manipulaient les barres et les poids pour se faire un corps, ajouter une amplitude à leur virilité, une fois dehors. C’était comme un uniforme. Le Tatoueur, c’était pour se conserver, pour garder la forme. Il avait emmené dans son sillage Victor, qui n’aimait pas cette discipline, qui pariait sur la plastique des corps. La fonte laissait place à Platon pour ordonner la pensée ! Le Tatoueur lui vouait une grande dévotion depuis que Victor avait mis au programme le grand rapporteur de mythes.
Logique, donc, que Victor, désormais seul, ne soit pas aussi libre qu’il aurait pu le penser. Il était livré à lui-même. Il n’avait pas respecté d’invisibles paliers de décompression. Malgré sa volonté, malgré sa forme physique, malgré son métier qu’il pourrait désormais reprendre d’une manière ou d’une autre, il déambulait sur les boulevards avec une tête de croque-mort. Tout lui semblait superficiel : les vitrines, les panneaux publicitaires, les adolescents qui marchaient sans rien voir, le téléphone d’une main et les oreillettes qui déversaient à leur cerveau les futilités mutilantes. Par des fenêtres ouvertes, il discernait l’intimité de pièces offertes au regard de la rue.
Un klaxon le fit sursauter. La vitre teintée d’une Mini Cooper rouge au toit blanc s’ouvrit.
— Monsieur Arbarossa, je vous offre un café ? Maintenant que vous êtes redevenu un citoyen ordinaire… Ce matin, ce n’était pas le lieu…
Victor accepta. En fait, il ne trouva aucune raison de refuser.
— Ce n’est pas tout à fait un hasard, monsieur Arbarossa. Je me doutais que vous rejoindriez le domicile de votre frère. Et cette rue passe devant.