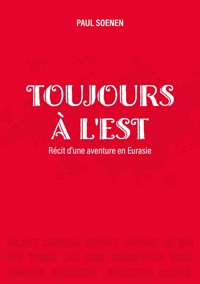
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
« Après avoir enfin mangé, nous nous étions couchés chacun dans notre tente, et j’étais heureux de m’imaginer demain à Copenhague. Je me disais que le voyage avait été facile jusque-là, mais étais aussi bien conscient que ce n’était que le début, que nous étions toujours dans un pays dont le fonctionnement ne nous était pas inconnu, parce qu’Européens, et je concevais encore difficilement que dans quelques mois nous aborderions la frontière turque, puis iranienne… Cela me semblait si surprenant, du domaine de l’impossible même, qu’il devait sans doute survenir un événement malencontreux pour nous en empêcher. Notre départ, et l’impossibilité que je m’imposais de revenir en arrière, avaient rapproché cette échéance dans le champ des possibles, et pourtant la hâte que j’avais de l’atteindre se transformait maintenant en peur qu’elle puisse se dérober à nous. »
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Soenen
Toujours àl’Est
Récit d’une aventure en Eurasie
« La vraie mort c’est la déchéance.
Vieillir c’est tellement plus grave ! Accepter son destin, sa fonction, la niche à chien élevée sur sa vie unique. On ne sait pas ce qu’est la mort quand on est jeune… »
[…]
« Ce qu’ils appellent l’aventure, pensait-il, ce n’est pas une fuite, c’est une chasse : l’ordre du monde ne se détruit pas au bénéfice du hasard, mais de la volonté d’en profiter. »
André Malraux
« La voie royale »
1. Voyageur capricieux
Cette histoire est celle d’un caprice d’adolescent, de ceux que l’on pardonne parce qu’ils sont à la mode et parce qu’on aurait voulu le réaliser soi-même. Au moment où il me prit, je finissais mes études d’ingénieur, en stage dans une grande entreprise de l’aérospatiale qui pour moi aurait dû être un Graal. J’avais longtemps attendu ce stage, sélectionnant scrupuleusement les offres auxquelles je répondais, me concentrant sur les sujets les plus intéressants et susceptibles de déboucher sur une embauche, si bien que je l’avais commencé avec quelques mois de retard sur la masse de mes camarades. Pendant une demi-année, je m’étais plongé dans des calculs numériques de dynamique des fluides, à mailler des tuyères de moteurs-fusées dans un décor de bureaux des années 1980 au cœur d’une forêt normande. Un bel endroit pour finir sa carrière. Pourtant, je ne me sentais pas de la commencer, pris d’un mal commun à beaucoup de jeunes ingénieurs découvrant un métier ne correspondant pas à l’idée qu’ils s’en étaient fait. Malgré des résultats concluants et des appréciations très favorables, je m’apprêtais à refuser le CDI qu’on me proposait.
Je n’avais pas pu, durant mes études, faire un semestre à l’étranger, étant de ces dernières promotions pour lesquelles ça n’avait rien d’obligatoire, encore à la bourre sur l’air du temps qui voulait qu’on se disperse aux quatre vents. Ainsi me trouvais-je comme handicapé social. Un sentiment d’incomplétude me saisissait. Il fallait que je prouve, aux autres et à moi-même, que je n’étais en rien inférieur ou incomplet. Que j’étais moi aussi ouvert sur le monde. Et puis, à cela s’ajoutait un chagrin d’amour, premier d’une vie d’adolescent mal dégrossi, encore naïf et incapable de déceler les illusions du cœur les plus évidentes. Je m’étais humilié pour essayer de la récupérer, en vain. Ses arguments n’étaient pas sans fondement, et plutôt que d’accepter notre incompatibilité flagrante, je m’étais entêté dans des démarches d’un romantisme niais. M’étant à ce point avili, je devais laver mon honneur par un pèlerinage expiatoire. Voilà donc l’origine du caprice.
Je me souviens comme j’étais insouciant en ce temps-là. Je rentrais chez mes parents un week-end sur deux, conduisant leur Renault Espace vieux de plus de vingt ans, approchant des 450 000 km au compteur. Il me fallait près de sept heures pour rejoindre notre village de Charente-Maritime. Je récupérais et déposais sur le chemin de nombreux covoitureurs, à Évreux, Alençon, Le Mans, Angers et Cholet, faisant preuve d’une patience à toute épreuve que j’ai perdue depuis. Pendant un de ces trajets, le câble d’embrayage avait rompu, terminus Angers. C’était déjà un peu l’aventure. Mais cette fois-ci, pour être à la hauteur des enjeux, je ne pouvais me permettre de faire les choses à moitié. Ainsi me décidais-je à entreprendre un voyage au long cours, d’une année à travers le continent eurasiatique. L’idée n’était même pas de moi, je n’avais fait que copier ce qu’une connaissance avait réalisé alors qu’il avait six ans de moins que mes vingt-quatre ans se profilant à l’horizon. M’enfin, je ne cherchais pas à innover. Partir, c’était déjà beaucoup. Je ne pensais pas encore à arriver quelquepart.
Pour finir, je me sentais surtout l’envie de partir vers l’Est, vers cet ensemble de civilisations hétéroclites avec qui nous partagions un continent. Depuis toujours, on sait par chez nous où s’arrête l’Ouest. Mais l’Est, il a fallu bien longtemps avant d’en cerner les limites. Ce fut la voie qu’empruntèrent les grands conquérants, les grands aventuriers, la direction d’où déferlaient les barbares et les maladies mortelles, mais d’où provenaient aussi la soie et les épices. À l’Est, Constantinople, Jérusalem et le Saint Graal ; la Perse et les royaumes grecs des diadoques d’Alexandre. Plus loin encore, des pays qu’on ne s’imaginait pas, où naît le soleil, les rares récits nous étant parvenus nous les décrivant sous des traits fantasmagoriques. Je voulais donc rencontrer cet inconnu et voir de mes yeux ce qu’il pouvait bien s’y dissimuler.
Tout ça n’était que l’acte d’un égoïste, comme le sont tous les aventuriers. Il s’agissait de vivre pour soi-même, sans rien construire de pérenne. J’aurais voulu risquer ma vie pour imiter quelques héros, historiques ou imaginaires, en pensant bêtement que j’en réchapperais, alors que rien n’était encore écrit et qu’aucun scénariste ne pourrait me protéger d’un destin funeste par la simple sympathie qu’il porterait à mon personnage. Et même en y pensant, mieux valait une belle mort dans l’action qu’une longue vie de passivité. Peu importe qu’il faille mourir pour vivre.
Voilà le lot de la jeunesse, et il faut bien que jeunesse se passe. Elle est passée, enfin, je crois…
2. Les deux faces d’une même pièce
Laurent et moi ne nous connaissions pas. Nous nous sommes rencontrés par Internet alors que chacun de nous était à la recherche d’un compagnon pour entamer cette aventure encore floue, mais pour laquelle nous avions tout de même évalué chacun de notre côté un budget et un vague itinéraire.
Il n’avait pas été mon premier interlocuteur. J’avais écumé les petites annonces de la bourse aux équipiers du site du Routard, sur laquelle on trouvait tout pour faire un monde. Idéalistes, adeptes de différents types de spiritualité, touristes, paumés et d’autres qui, se croyant sur un site de rencontre (comment leur donner tort, littéralement, ça l’était), cherchaient un amour à éprouver le temps d’un voyage. Certains composaient avec plusieurs de ces catégories. J’y cherchais pour ma part quelqu’un de mon âge, d’un tempérament aventurier sans être trop allumé. J’étais entré en contact avec quelques personnes, mais aucune ne m’avait semblé suffisamment fiable. Avec aucun d’entre eux, les choses ne s’étaient déroulées aussi simplement qu’avec Laurent. Malgré nos différences évidentes et nos habitudes antagonistes, nous avions été réunis par des caractères accommodants et des objectifs communs. Nous nous préparions à vivre une année comme des vagabonds, ignorants de ce que nous réserverait le jour suivant, parcourant les routes en stop, trimbalant nos sacs sur le dos et couchant à la belle étoile, afin de ne pas dépenser plus que les 10 € par jour et par personne que nous nous étions fixé comme objectif.
À cette époque, je n’avais qu’une expérience réduite de la vie en pleine nature qui se résumait à quelques vacances passées en camping avec mes frères et mes parents et à quelques randonnées pratiquées les rares fois où nous nous étions rendus en montagne. Je connaissais les bases, la théorie, le ciel étoilé de l’hémisphère nord si cela pouvait nous être utile, et un peu l’histoire, romancée, pour vivre le chemin plus intensément et fantasmer cette aventure.
Laurent, lui, était d’une culture plus pratique. Habitué aux longues marches en montagne, au camping sauvage, aux feux de camp, bricoleur à ses heures, je lui dois de m’avoir entraîné dans un mode de vie plus rude que ce qu’aurait été ce voyage avec un autre. Il avait confectionné à partir de vieilles boîtes de conserve, un réchaud à bois qui nous permettrait de cuisiner à peu près en toutes circonstances à partir du moment où nous serions en mesure de trouver quelques brindilles et petites branches à brûler. Nous nous soulagions ainsi du poids et de l’encombrement de bouteilles de gaz à transporter, et du souci de nous en procurer de nouvelles, au bon format, sur notre route. Il emportait aussi avec lui lignes et hameçons pour pouvoir pêcher si l’occasion se présentait.
Moi, l’intello d’humeur souvent casanière porté sur la contemplation et la réflexion, respectueux des normes et des lois ; lui, l’homme des bois partageant son temps entre les festivals de reggae et la montagne, adepte de l’escalade et de l’urbex, fumeur de joints et un peu magouilleur à ses heures ; nous ne nous serions pas trouvés pour autre chose si nous n’avions pas décidé de passer une année ensemble.
Nous nous rencontrâmes seulement une fois avant le jour du départ, le temps d’un week-end à Paris pour faire nos demandes de visas à l’ambassade d’Ouzbékistan, alors seul pays dont la politique d’immigration nous permettait une certaine souplesse sur nos dates d’entrée. Malgré tout ce qui nous séparait, je sentais que nous pourrions nous entendre et que la manière dont nous comptions voyager, loin de nous éloigner, nous rapprocherait, car c’est ainsi que procède l’adversité sur deux esprits volontaires. Nous nous retrouvâmes pour la seconde fois à Besançon, le point de départ de notre voyage, à la mi-mars 2015.
3. La route du Nord Apprentissage et désillusions
Nous venions de traverser l’Allemagne en un seul jour. À ce train-là, nous serions en Norvège plus tôt que prévu ! Depuis Lörrach, au point de convergence des frontières française, suisse et allemande à l’extrême sud-ouest du pays, nous avions dépassé Hambourg et atteint la ville de Lübeck. Notre dernier conducteur nous avait déposés sur une aire d’autoroute à la nuit tombée. C’est confiants dans notre mode de transport que nous avions monté nos tentes dans un bosquet à l’arrière de la station et cuisiné notre premier repas au réchaud àbois.
Ce rituel du dîner allait occuper nombre de nos soirées à venir. Ici, au nord de l’Allemagne, le bois était humide et rendait notre tâche plus complexe. La cuisson nécessitait un soin constant pour rallumer la flamme et l’alimenter. Elle produisait une fumée importante qui piquait les yeux quand il fallait souffler dans la boîte pour raviver le feu et pénétrait nos vêtements de son odeur âcre. Comme nous n’avions de courage que pour une seule fournée, nos portions s’en retrouvaient réduites.
Après avoir enfin mangé, nous nous étions couchés chacun dans notre tente, et j’étais heureux de m’imaginer demain à Copenhague. Je me disais que le voyage avait été facile jusque-là, mais étais aussi bien conscient que ce n’était que le début, que nous étions toujours dans un pays dont le fonctionnement ne nous était pas inconnu, parce qu’Européens, et je concevais encore difficilement que dans quelques mois nous aborderions la frontière turque, puis iranienne… Cela me semblait si surprenant, du domaine de l’impossible même, qu’il devait sans doute survenir un événement malencontreux pour nous en empêcher. Notre départ, et l’impossibilité que je m’imposais de revenir en arrière, avaient rapproché cette échéance dans le champ des possibles, et pourtant la hâte que j’avais de l’atteindre se transformait maintenant en peur qu’elle puisse se dérober ànous.
Au lever du jour, le second du printemps, le temps était couvert et froid, et devait annoncer les déboires qui allaient suivre. Nous repliâmes nos tentes encore humides, les mains gelées faute de pouvoir les manier habilement avec nos gants. Hier encore, nous nous portions bien en manches courtes.
Nous ne tardâmes pas à trouver une voiture pour nous conduire jusqu’à Puttgarden, sur l’île de Fehmarn, d’où nous prîmes le ferry pour rejoindre le Danemark, accostant dans le petit port de Rødby. Le port était à l’écart de la ville, de telle manière qu’on ne s’y rendait pas par hasard ; seulement si l’on avait un bateau à prendre. Ainsi, l’ensemble des conducteurs susceptibles de nous transporter avaient traversé la mer avecnous.
À peine débarqués que nous avions entamé l’auto-stop, nous adressant des pouces aux voitures circulant en un flot ininterrompu régurgité par le navire, passant lentement et au plus près de nous par la seule issue possible de sorte que la tâche devait être aisée. Mais quand le navire eut rendu l’intégralité de son chargement, nous étions encore sur le bord de la route, tentant d’aborder sans désespérer les derniers véhicules de la file, jusqu’à ce qu’ils eussent finalement tous disparu. Une fois battus, mais pas vaincus, nous nous installâmes au débouché d’une petite route de campagne avec l’infime espoir d’être récupérés par quelques habitants d’un village avoisinant – espoir déçu… Une heure plus tard, un second ferry accosta, sans que nous ne soyons plus victorieux. Nous comprîmes bientôt notre erreur. Toutes ces voitures principalement immatriculées au Danemark, et parfois en Suède, étaient remplies de marchandises achetées à moindre coût en Allemagne, de telle manière qu’il était impossible d’y ajouter deux passagers et leurs sacs à dos. Il y eut bien ensuite un homme du coin qui s’arrêta. Pris de pitié, il nous donna 200 couronnes danoises (soit un peu plus de 25 €), révélant au passage, dans sa grande bonté, notre grand amateurisme. Nous avions retiré avant de partir une grosse somme d’argent en euros de manière à ne pas avoir à faire de retraits jusqu’à sortir de Finlande, pensant que le Danemark, la Suède et la Norvège étaient inclus dans la zone monétaire. On nous vantait tellement cette monnaie que je n’avais pas envisagé que des nations européennes développées puissent en utiliser une autre.
Encore une heure plus tard, un troisième bateau accosta, puis un quatrième l’heure suivante. Le temps s’était gâté. Le vent et le crachin s’intensifiant et le froid commençant à pénétrer nos chaussures, nous avions préféré attendre les prochains débarquements à l’abri dans une petite gare attenante au poste de douane. Je ne sais plus à quel moment nous nous décidâmes à prendre le train. Après le cinquième, le sixième débarquement, peut-être plus, peut-être moins, nous avions perdu tout espoir et avions convenu de cesser nos tentatives et de faire crédit sur le budget de quelques jours à venir pour nous permettre de rejoindre Copenhague dans la soirée. C’est soulagé de n’être plus soumis au hasard de l’auto-stop, d’avoir la certitude de notre destination et de notre horaire d’arrivée que je m’étais assis dans ce train et laissé porter.
Nous arrivâmes à Copenhague à la nuit tombée, et il nous restait encore à trouver un endroit où dormir. La ville bourdonnait autour de nous, les rues prises de la joyeuse insouciance du samedi soir. Les monuments de briques rouges, illuminés des feux les plus solennels, se portaient garant de la dignité des lieux, laissant aux hommes le loisir de s’oublier. La gare, grosse dame au visage sévère qu’adoucissait le maquillage de ses lumières dorées, veillait impassiblement. Des groupes de jeunes femmes et d’hommes entraient et sortaient des bars dans des éclats de rires et de voix. Laurent et moi, pressés de poser nos paquetages, arpentions les avenues, insensibles à ces légèretés. Après quelques pérégrinations, nous nous étions enfin couchés dans une de ces auberges pour lesquelles le prix d’une nuit engouffrait plus que notre budget journalier. Ainsi, au second jour de notre voyage, nos dépenses se portaient à la hauteur de ce que nos prévisions assignaient à la fin de la semaine. Nous n’étions encore que de bien piètres aventuriers.
*
Quelques jours plus tard, nous nous réveillâmes dans un cabanon de tôles ondulées que nous avions investi pour la nuit. Un vague sosie de Zlatan Ibrahimovic nous y avait déposés le jour précédent, sur le bord de la route passant juste derrière la haie. Malmö, que nous avions quitté le matin même, n’était encore qu’à une cinquantaine de kilomètres plus au sud. Nous avions tenté de poursuivre l’auto-stop jusqu’à la nuit noire, dans le défilé éblouissant des phares et le balayage de nos silhouettes en ombres chinoises. Puis, las, plutôt que de nous exposer à planter nos tentes, nous avions préféré nous installer dans cet abri, quasiment vide, qui devait servir à l’exploitation du verger. Nous avions pu nous allonger tête-bêche sur un épais tapis de terre poussiéreuse qui se soulevait en volutes dans nos mouvements trop brusques. Un large jour au bas de la cabane laissait s’insinuer un vent glacial qui traversait nos sacs de couchage. La porte qui ne se fermait que de l’extérieur par un fil métallique servant de cadenas restait entrouverte.
Le lendemain avait commencé par ressembler au jour précédent. Un Kosovar nous approcha d’Helsingborg, puis nous attendîmes là longtemps, très longtemps. L’air était gris et froid, et gelait nos mains à travers nos gants. Laurent et moi nous séparâmes pour faire du stop chacun de notre côté, à deux entrées d’autoroute différentes pour augmenter nos chances, revenant sur le fonctionnement qu’avait été le nôtre jusqu’à présent d’alterner nos rôles toutes les demi-heures pour que celui qui ne tende pas le bras puisse le reposer et réchauffer ses mains dans ses poches. Envain.
Dans ces moments de doute, une bête anxiété me prenait. Plus la journée avançait et plus cette inquiétude m’envahissait. Ce fond de peur me rongeait l’estomac. Je sentais de manière insensée que ma survie était en jeu, abandonné, perdu, et bientôt affamé. Manger devenait une obsession, et presque le seul plaisir pour échapper à cette sensation. Petit à petit, les visages derrière les pare-brise devenaient plus haïssables. Puis, le jour disparaissant, les lampadaires s’allumaient et plongeaient le monde dans un insupportable halo orangé. Il n’y avait plus d’hommes à présent, seulement des machines, des orbes éblouissants et le froid de l’acier. Je m’étais aperçu qu’entrer dans une grande surface ou dans une station-service me rassurait. Le temps s’y arrêtait, l’espace s’y dissipait. Partout, du matin au soir, les halogènes plongeaient les rayons dans une ambiance intemporelle, invariable, et calmaient les craintes comme une vision de l’infini soulage la peur de la mort. Misère ! La grande distribution avait le mieux compris les tréfonds de l’homme moderne. Elle seule pourrait unir le genre humain.
Après cinq heures d’attente, nous avions abandonné et pris le bus pour rejoindre Markaryd dans l’espoir d’y trouver de meilleures conditions. En nous éloignant des grandes métropoles, des habitations traditionnelles apparaissaient isolément, arborant des façades de bois peintes en rouge et des encadrements blancs. Peu à peu, nous quittions les plates terres cultivées du sud pour nous enfoncer dans des forêts de plus en plus denses. La journée était déjà bien avancée lorsque nous reprîmes l’auto-stop, et nous craignions alors de la finir de la même manière que la précédente. Le ciel s’était éclairci et laissait entrevoir quelques parcelles de bleu au travers desquelles s’infiltrait une lumière de fin d’après-midi quand s’arrêtaLars.
Ce Suédois bedonnant d’une soixantaine d’années avait lui-même beaucoup voyagé dans sa jeunesse et nous rendait aujourd’hui les services que d’autres lui avaient prêtés quelques décennies plus tôt. Lui avait couru les chemins de traverse jusqu’en France, dormi dans des fossés sans même une couverture et fui la police sous les ponts de Paris. « Vous, vous avez des tentes, des sacs de couchage. Moi, je n’avais rien de cela ! » avait-il ajouté comme pour nous remettre à notre place. Il avait bien évidemment remarqué la forte odeur de fumée qui imprégnait nos vêtements et qui embaumait l’habitacle. Comprenant que nous avions dormi dehors les nuits précédentes, il se proposa donc de nous héberger pour celle-ci.
Lars ne se considérait pas comme un Suédois représentatif du genre, caricaturant ses compatriotes comme timides, introvertis et plutôt peureux – à l’inverse de son caractère expansif – et ce à quoi il attribuait nos déboires d’auto-stoppeurs depuis notre arrivée à Malmö. Il vivait à une quarantaine de kilomètres de Jönköping, dans un hameau de grandes baraques écarlates abritées sous les pins d’une forêt clairsemée et percée de clairières où habitaient des élans, selon ses dires.
À peine installés dans nos appartements, il insista pour que nous commencions par prendre nos douches et lança une machine avec nos vêtements souillés. Cet homme-là, qui n’avait pas peur de dire les choses franchement, n’hésita pas à nous faire comprendre que nous sentions franchement mauvais. Nous le rejoignîmes ensuite dans sa cuisine où il préparait le dîner. Ce grand bavard était intarissable d’anecdotes sur son pays, ses habitants et leurs coutumes, et sur ses nombreuses aventures passées. Je me souviens ne pas avoir réussi à comprendre quel était son véritable métier tant il semblait en avoir fait des différents, de soudeur à professeur de criminologie. Nous bûmes avec modération du rhum ambré qu’il avait sorti d’un bar en forme de globe terrestre, nous mangeâmes copieusement, une omelette « à la française », comme on l’appelait ici, garnie de lard et de saucisses, de tomates et de pommes de terre.
Cette soirée fut pour nous un véritable soulagement. Il semblait qu’en Suède, soit on vous donnait tout, soit on ne vous donnait rien. À moins que ce ne soit le fait de l’auto-stop par lequel les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chaque matin est un recommencement, où tous les acquis sont remis sur la table et rejoués d’un coup de dés. Tant que le soleil n’est pas couché, tout peut encore être gagné, la fortune pouvant basculer en un instant. Un jour à la rue, le suivant au palace.
*
Stockholm, abritée de la mer baltique par de nombreuses îles ciselées comme de la dentelle, n’en respirait pas moins à grandes bouffées les bourrasques que le large lui soufflait. Depuis notre départ, les températures n’avaient cessé de chuter pour passer maintenant dans les négatives. Le vent nous fouettait et nous rougissait la figure. Nous commencions à nous interroger quant à notre course vers le nord, notre but se situant à des latitudes plus septentrionales encore, là où nous pourrions observer des aurores boréales. Tous les jours, nous vérifiions les relevés d’activité solaire pour déterminer si nous pourrions en apercevoir à la nuit tombée. Plus nous nous avancions vers les contrées du nord, plus nous augmentions nos chances de nous situer dans leur zone d’activité, mais plus il faisait froid et plus les nuages obstruaient leciel.
Après un nouvel échec de l’auto-stop, nous avions quitté Stockholm par le train et nous étions arrêtés à Gävle afin de réemprunter la route remontant le long du golfe de Botnie. Cette nuit, l’activité solaire devait connaître un pic et provoquer quelques aurores, mais il nous fallait aller encore un peu plus avant. Au coucher du soleil, nous n’avions toujours pas trouvé de conducteur pour nous emmener et commencions à chercher du regard un endroit surélevé où nous pourrions planter les tentes et duquel nous aurions une vue dégagée vers le nord. Je tendis le bras dans un dernier espoir avant d’abandonner complètement et d’aller installer notre campement. Deux voitures s’arrêtèrent alors. Merci, mais je n’en demandais pas tant !
Encore une fois, ce furent des étrangers qui nous récupérèrent. La description qu’avait donné Lars de ses compatriotes se vérifiait de jour en jour. Les Suédois étaient si peu enclins à l’auto-stop que nous ne pouvions compter sur eux, ou alors fallait-il leur forcer la main. Nous avions dû supplier Yvonne et lui promettre que nous ne voulions ni la tuer ni la voler pour qu’elle accepte de nous conduire. À deux occasions déjà, des Kosovars nous avaient récupérés. Il s’agissait cette fois de Kurdes chrétiens de Turquie qui se rendaient dans la nuit au-delà du cercle polaire pour y revendre une voiture, s’étant établis dans le commerce d’automobile. Ces deux-là avaient des caractères antagonistes, l’un semblant sage et blâmant l’autre pour son attirance pour le jeu qui l’avait conduit à perdre quelques centaines d’euros au casino lors d’un arrêt sur notre route. Je montai avec le sage et Laurent avec le joueur.
La voie coupait à travers une forêt de jeunes bouleaux et de pins. Elle en ressortait pour aborder les rives des nombreux lacs qui constellaient la région. Les dernières clartés du jour, d’un bleu limpide, auréolaient le ciel de l’ouest, et se reflétaient alors sur ces miroirs de glace, toiles lumineuses sur lesquelles se dessinaient en ombres les roches émergées et au travers des zébrures des arbres en bordure de la route. Devant ce spectacle, mon conducteur poussa un soupir d’admiration. Il existe des choses dont la beauté est tout à fait objective et touche de la même manière les hommes de tous horizons.
Je tentais de repérer des aurores par la fenêtre. Le temps jouait contre nous, car la météo se dégradait. Je crus en avoir aperçu une sans pouvoir l’affirmer, les lumières parasites des voitures et de la lune m’empêchant de la distinguer clairement. J’avais d’abord pensé qu’il ne s’agissait que d’un nuage, mais sa légère teinte verte et ses mouvements comme un rideau très lentement soulevé par le vent m’avaient finalement convaincu d’une aurore. Elle était cependant beaucoup moins lumineuse que ce que j’avais imaginé. Avant que j’eusse pu m’assurer plus justement de ce que je voyais, la voiture avait tourné, et les nuages nous avaient recouverts.
De peur que les conditions ne se détériorent plus au nord, nos conducteurs nous assurant que le pays y vivait encore sous deux mètres de neige, nous nous étions arrêtés à la ville d’Umeå, d’où nous pourrions prendre un ferry et passer en Finlande. On nous déposa en centre-ville à 2 h du matin, sans idée d’où dormir, alors que les groupes de fêtards arpentaient les rues en criant leur alcool sur les toits. Nous cherchâmes un endroit isolé et caché des passants pour pouvoir nous reposer.
Tels des vagabonds débutants dormant dans la rue, nous n’étions pas encore assez habitués pour nous exposer, ni assez expérimentés pour reconnaître les meilleures planques. Si nous trouvions un lieu nous semblant propice, mais que quelqu’un venait à passer et nous remarquait, nous partions chercher ailleurs, presque plus par honte que par peur. Nous nous arrêtâmes finalement derrière la gare de bus, nous couchant sur le sol dans un recoin du portail d’entrée, alors fermé. Elle ouvrit à 5 h et l’on put s’y abriter et somnoler sur un banc en cherchant un couchsurfing en urgence pour les jours suivants. Par chance, David nous répondit et nous recueillit chez lui, où nous passâmes quelques jours à préparer notre traversée vers la Finlande. Nous venions d’atteindre le point le plus septentrional de notre voyage. Il arrivait maintenant que des flocons se mettent à tomber. Grâce à notre hôte, nous avions pu profiter de cette ambiance apaisée qui se dégage d’un jour de neige quand on peut s’en abriter et l’observer au chaud par la fenêtre.
4. Finlande Survivre au froid sur une étendue gelée
Nous avions élu domicile sur la petite île de Haukisaari, sur le lac gelé de Konnevesi, que l’on atteignait depuis le village du même nom après une petite dizaine de kilomètres de marche. Nous nous étions installés dans un lavuu, un abri de bois ouvert sur l’un de ses côtés, faisant face à un foyer et couvert par quelques sapins. L’endroit disposait d’une réserve de bois stockée dans une cabane aérée à l’arrière du lavuu. Le lac s’étendait devant nous et on ne pouvait, à ce moment, deviner où il se terminait, un crachin glacé enveloppant dans sa brume l’autre rive jusqu’aux îles les plus proches.
Faire du feu avait occupé le début de notre première soirée, à fendre des bûches et embraser le foyer afin de réchauffer la place et d’assécher les rondins disposés en cercle qui servaient de banc. La journée était déjà bien avancée, mais là, nous pouvions veiller un peu, obnubilés par les ondulations et les crépitements de la flamme, dans sa chaleur rayonnante, sans avoir besoin de nous cacher d’éventuels passants. Le vent continuait de souffler à la nuit tombée, et jouait avec nous, rapprochant ou éloignant la flamme alternativement, jusqu’à nous brûler, nous enfumer ou nous geler. La neige recommençait à tomber. Quand ce jeu eut fini par nous lasser, nous allâmes nous coucher au fond du lavuu, comblant les jours comme nous pouvions, élevant une de nos couvertures de survie pour nous couper un peu de l’extérieur. Laurent s’enveloppa alors dans la seconde, et moi dans mon sursac de couchage.
Ce fut une des nuits les plus froides de notre voyage. Une de ces nuits où il vous faut oublier vos pieds incapables de se réchauffer, pénétrés jusqu’à l’os de ce froid intense malgré trois paires de chaussettes enfilées pour pouvoir trouver le sommeil rien qu’un instant. Étant moins bien équipé que moi, Laurent en souffrit plus encore. Nous avions par la suite trouvé une astuce en intercalant des feuilles de journaux, que nous avions récupérées pour allumer nos feux de bois, entre les différentes couches de chaussettes et en bourrant le fond de nos sacs de couchage de papier chiffonné en boule, ce qui nous permettait de nous isoler un peu plus sans résoudre le problème dans son intégralité. Cela faisait déjà quelques jours que nous y étions confrontés, même en journée, et nous faisait envier un futur nous paraissant encore lointain, où nous voyagerons dans des pays exotiques et chauds. Plus il faisait froid ici, ou plus il faisait chaud là-bas, et plus cela nous semblaitloin.
En attendant, nous marchions pour nous réchauffer. Nous arpentions le lac d’îlot en îlot, pierres perçant la glace sur lesquelles avaient poussé de la mousse et quelques sapins encore jeunes et qui paraissaient comme d’étranges oasis dans ce désert blanc. Parfois, ça n’était que quelques roches à nu émergées formant dans un étang noir une colonie de tortues immobiles, dont seules les carapaces pointaient à la surface, ou les écailles dorsales d’un monstre aquatique. La couverture nuageuse assombrissait l’étendue des eaux que la glace n’avait pas investie et donnait l’impression de profonds abîmes. Quelques ruisseaux d’une noirceur brillante serpentaient sur le blanc immaculé du lac gelé, délimitant un continent glacé d’un autre continent glacé. Quand le temps s’améliorait, ces profondeurs sombres s’égayaient et devenaient des miroirs bleutés, et les îles semblaient s’élever, portées parmi les nuages.
Nous avions creusé un trou dans la glace non loin de notre île pour tenter d’y pêcher et avions constaté qu’une quinzaine de centimètres d’épaisseur seulement suffisaient à nous soutenir hors de l’eau. Laurent posa sa ligne, marqua le trou avec trois bouts de bois montés en pyramide et enroula l’autre extrémité autour d’un long bâton qui ne devait pas passer à travers le trou si un poisson mordait. N’attendant pas de nous nourrir de cette pêche, nous étions retournés au village de Konnevesi pour faire des provisions pour la petite semaine que nous allions passerici.
Comme nous vivions assez rudimentairement, sans payer quoi que ce soit pour dormir ou pour nous déplacer, nous pouvions nous permettre d’allouer une bonne partie de notre budget journalier à la nourriture qui constituait, au moins pour moi, une source de réconfort non négligeable. Usuellement, nous mangions assez peu, dans la limite de ce que pouvait contenir la casserole de Laurent ainsi que notre budget, car il était trop long et fastidieux de faire bouillir de l’eau à l’aide du réchaud à bois pour se permettre une seconde tournée. Pour le petit déjeuner, quelques gâteaux secs ; pour le déjeuner, un sandwich généralement englouti rapidement sur le bord de la route. Chaque jour, si en fin d’après-midi nous n’avions pas trouvé de conducteur pour nous emmener, alors nous goûtions− généralement la même chose qu’au petit déjeuner. Cet instant était devenu un rituel très attendu quand nous fatiguions à force d’attendre. C’était comme une parenthèse qui distrayait nos esprits du froid qui nous piquait et dans laquelle Laurent et moi nous retrouvions dans un même soulagement. Mais là, sur le lac, nous pouvions nous permettre de manger mieux, d’acheter de la confiture à étaler sur nos gâteaux secs, des saucisses à cuire sur le feu, du chocolat pour le jour de Pâques et même du fromage, une denrée rare depuis que nous avions quitté la France.
Pas de poisson cependant. Notre ligne n’en attira jamais un seul. Lors de l’une de nos sorties, nous avions rencontré un autre pêcheur, assis le nez au-dessus de son trou, avec une minuscule canne à pêche qu’il agitait de manière cadencée du bas vers le haut, comme un chef d’orchestre qui s’ennuierait. D’après lui, ce mouvement était nécessaire pour éveiller l’attention du poisson, mais il fallait être très patient. Quatre heures de travail lui étaient généralement nécessaires pour réussir à sortir quelque chose de ces eaux gelées. Nous n’avions clairement pas l’intention d’y passer autant de temps. Notre ligne restait immobile dans son trou, et la glace se reformait et se refermait sur le bouchon. Il avait été agréable de trouver quelqu’un ici, comme le gardien d’un puits dans une zone aride. Ce genre de rencontre inattendue dans un lieu aussi sauvage ressemble d’abord à un mirage.
Lors de nos pérégrinations, nous avions été surpris par un homme à moto qui traçait à travers le lac, et y effectuait des carottages. Lui et sa moto nous avaient grandement aidés à prendre confiance dans la capacité de la couche de glace à nous supporter. Nos premiers pas avaient été hésitants et il avait fallu qu’un Finlandais habitant sur la rive du lac nous rassure avant que nous nous y aventurions. Nous avions commencé à y marcher comme sur des œufs, puis petit à petit avions pris de l’assurance. De temps en temps, la glace émettait un craquement, comme un rappel à l’ordre, mais nous avions fini par nous habituer à ces petits gémissements. Nous n’hésitions plus à sauter de rochers que nous avions escaladés directement sur la glace qui se mettait à trembler, tout en nous méfiant encore aux abords immédiats des surfaces émergées et là où elle se faisait le rivage de l’un de ces ruisseaux noirs. Pourtant, malgré ces dernières précautions, au passage de l’un d’entre eux suffisamment étroit pour que je puisse l’enjamber, la glace craqua sous mes pieds au moment où j’avais cru avoir traversé. Je tombai alors à plat ventre sur la berge qui avait tenu, et sans avoir le temps de réfléchir, je dus m’extraire de l’eau en rampant et en roulant sur moi-même, les chaussures imbibées et le pantalon seulement trempé jusqu’aux genoux. Laurent, refroidi, avait cherché un passage plus sûr. Heureusement pour moi, cette journée avait été plus chaude que les précédentes et l’absence de vent m’avait permis d’éviter que mes jambes ne gèlent sur le chemin du retour. Une fois revenus dans notre abri, nous allumâmes un feu et je mis mes affaires à sécher.
Pour passer le temps, quand nous ne marchions pas ou que nous ne nous réchauffions pas auprès des flammes, nous jouions aux échecs. Laurent avait fabriqué un jeu en rayant une planche de bois avec son couteau et en sciant de petites rondelles à partir d’une branche pour confectionner les pièces, que l’on différenciait par une lettre écrite au stylo sur le dessus. Le dimanche de Pâques avait été la plus belle journée de notre petite semaine sur le lac et nous avions pu jouer au soleil et enlever nos chaussures pour aérer nos pieds jusque-là sans cesse enfermés. Dans la soirée, Laurent avait sorti sa slackline pour la première fois, tendue entre deux sapins, et il balançait sur la sangle en ombre chinoise sur la neige rosée, le soleil bas sur l’horizon en arrière-plan. Les saucisses finlandaises grillaient sur la flamme. Nous mangeâmes et regardâmes le feu s’éteindre avec le ciel, jusqu’à ce que les braises eussent fini par luire plus que les dernières lumières du jour. Se dessinaient dans le fond du foyer des filaments rougeoyants et scintillants, s’entrelaçant et se dissociant, derniers fourmillements d’un feu qui s’endort. Le ciel dégagé laissait paraître ses premières étoiles, présageant que malgré la douce journée, la nuit allait encore être très froide.
5. Traversée de l’Est Périls et perte de repères
Nous avions traversé la mer Baltique depuis Helsinki jusqu’à Tallinn, capitale de l’Estonie, en pensant débarquer dans un nouveau monde, une Europe de l’Est que je fantasmais. J’imaginais le rideau de fer, les blocs de béton soviétiques, la pauvreté débrouillarde et un peu escroc, ainsi qu’un certain désordre, ou plutôt une certaine insouciance, caractéristique des pays en voie de développement. Il est vrai qu’à Tallinn, une vieille vendeuse à moitié manouche usa contre nous d’une ruse pour ne pas rendre la monnaie à Laurent qui venait de lui acheter une paire de chaussettes ; ou qu’au marché central de Riga, le hall des viandes exhalait une odeur désagréable qu’on ne rencontrait plus chez nous ; ou encore que les cultivateurs venus y vendre leur récolte pour un rien portaient sur eux les marques de la rudesse de leur vie campagnarde. Mais ce ne fut cependant pas le sentiment que j’avais attendu qui l’emporta dans un premier temps. Les gens rencontrés sur la route lors de nos pérégrinations d’auto-stoppeurs étaient pour la plupart issus d’une classe sociale plutôt élevée, tout à fait occidentalisés, anglophones, à tel point qu’il ne me semblait pas que la vie soit très différente entre ici et plus à l’ouest. De Tallinn, nous avions rejoint la Lettonie et sa capitale Riga, puis pris la route de la Pologne et de la Hongrie, en passant par Varsovie, Cracovie, puis Budapest. Nous commencions alors à nous lasser de ces grandes villes européennes qui ressemblent tant à d’autres grandes villes européennes, jusqu’à ce que nous arrivions à la frontière de la Roumanie.
Nous démarchions les automobilistes sur une aire d’autoroute à cinquante kilomètres au sud de Budapest quand déboula une caravane de voitures dans des cris de joie. Ce groupe de Roumains convoyait des automobiles depuis l’Allemagne jusque dans leur pays pour les revendre avec bénéfice. Un seul d’entre eux parlait anglais, il paraissait s’affirmer comme le chef de cette petite expédition. Les affaires avaient dû être bonnes à en juger par les démonstrations d’enthousiasme, mais je ne sus pas déterminer leur degré de légalité. Bien qu’ils se montrèrent fort sympathiques, je n’aurais pas été étonné d’apprendre que tout le convoi avait été volé. Pourquoi tant de joie avant de les avoir vendues, si ce n’est parce qu’on est sûr d’y avoir déjà gagné ? Pourquoi refuser d’un air gêné de nous emmener, alors qu’ils conduisaient tant de voitures à vide ? Je gardais mes suspicions pour moi. À défaut de nous avancer, la bande nous offrit le déjeuner.
Notre seconde rencontre fut celle avec un pasteur évangéliste gitan qui proposa de nous emmener jusqu’à Arad, moyennant une participation abusive de 30 € aux frais d’essence pour ce voyage d’une centaine de kilomètres. L’évangélisme gagnait les communautés gitanes et s’accordait bien à l’exubérance de ce peuple. Son rapport décomplexé à l’argent et l’absence de dogme leur rendaient attirant cette espèce de christianisme libéral. Nous n’étions même pas encore entrés en Roumanie que les différences culturelles se faisaient déjà ressentir dès son approche.
Comprenant que nous ne souhaitions pas payer nos déplacements, le pasteur accepta finalement de nous conduire gratuitement. S’il s’était montré légèrement prosélyte au cours du trajet, sa connaissance du pays put éclairer certains de nos questionnements. Nous avions remarqué en arrivant près d’Arad quelques grandes maisons faites pour attirer les regards, sorte de palais excentriques avec colonnades torsadées, multicolores et aux toitures étagées, qui n’étaient pas sans rappeler les formes de certains temples chinois. Le pasteur nous expliqua que ces petits palais étaient les habitations de quelques familles gitanes « travaillant en Europe de l’Ouest ». Je n’avais pourtant jamais rencontré ces travailleurs.
En à peine quelques kilomètres, nous avions changé de monde et étions entrés dans une Europe de l’Est validant nombre des clichés circulant à son sujet. Le jour suivant, sur la route de Deva, nous avions été arrêtés par un accident entre une voiture et un camion qui étaient entrés en collision frontale dans un secteur tortueux. Les gens conduisent ici comme si leur vie ne comptait pas. Cette Europe-là est pleine de tragédies.
On nous déposa à Deva sur le parking d’un supermarché non loin de la gare Centrale. S’il y avait des Tziganes très aisés, d’autres semblaient dans une véritable misère. Circulant entre les voitures garées en bataille, l’une d’entre eux, portant son enfant qui braillait, guettait les clients arrivant et repartant pour quêter.
Nous nous éloignâmes du centre-ville à la recherche d’un endroit à l’abri des regards où nous pourrions dormir la nuit venue et où déposer nos affaires pour ne pas avoir à porter nos sacs le reste de la journée. Nous nous installâmes derrière un bosquet dans un champ de colza où nous pûmes nous délester. Si ce n’était par les hommes, peut-être pouvions-nous être inquiétés par les chiens errants. Ils sont nombreux en Roumanie et certains auraient pu être attirés par les courses que nous venions de faire, cachées dans nos sacs. Nous ne savions pas comment aborder ces meutes. Étaient-elles agressives ? Fallait-il s’en méfier comme de la peste ? J’étais vacciné contre la rage, mais pas Laurent. Ces chiens, ces mendiants, parfois exploités par les leurs, cette sauvagerie quasi féodale qui semble faire loi dans ce pays, donnent à la Roumanie une couleur terriblement unique.
Nous retournâmes ensuite dans le centre pour recharger nos portables, utiliser le Wi-Fi et donner des nouvelles à nos familles dans un Mac Do attenant au même parking où nous avions été déposés. J’observais alors la femme qui mendiait toujours avec son gamin dans les bras. J’avais pitié de cet enfant en pensant à l’avenir qui l’attendait. Alors que l’on traversait quelques jours plus tôt la Slovaquie, notre conducteur nous raconta l’histoire de la région où l’on se trouvait, sinistrée par le chômage, et des familles qui y habitaient. Des générations d’enfants y avaient grandi avec l’exemple d’un père n’ayant jamais travaillé, assis sur une chaise quand ils quittaient la maison en partant à l’école. Ils le retrouvaient au même endroit en rentrant, comme s’il n’avait pas bougé de la journée, paralysé, vidé de sa substance vitale. Je me demandais s’il valait mieux voir ça ou bien sa mère mendier.
Nous rejoignîmes notre champ et nous nous couchâmes, le silence de cette nuit parfois interrompu par des combats de chiens.
*
Nous terminâmes notre voyage roumain à Bucarest, la capitale du pays, où nous nous reposions après les derniers jours passés dans les montagnes. Depuis Deva, nous avions poursuivi notre route vers Brasov et les Carpates, jusqu’au petit village de Bran, place uniquement portée par le tourisme grâce au château du même nom connu comme étant celui où vécut Vlad Tepes, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira cinq siècles plus tard Bram Stoker pour son personnage de Dracula. En vérité, rien n’indiquait que celui-ci ait un jour séjourné ici, mais la légende, elle, s’y était installée. Aujourd’hui, de nombreuses échoppes se sont implantées sur le bord de la route menant au château, plus ou moins en lien avec le thème du lieu. De là, nous randonnâmes jusqu’à Zarnesti, une petite ville de montagne où nous nous arrêtâmes quelques jours, avant de partir pour la capitale. Ces pérégrinations sur d’importants dénivelés avec nos sacs de 20 kg sur le dos m’avaient épuisé, jusqu’à même me faire perdre la sensibilité d’une partie de la cuisse. Un peu inquiet, j’avais tracé au stylo sur ma jambe la forme de la zone affectée afin de pouvoir suivre son évolution et décidé de consulter si jamais cette zone s’étendait. Je ne voulais pas perdre du temps à chercher un médecin pour ce qui ne pouvait être que le froissement d’un nerf, mais cette alerte me rappelait qu’il fallait se préserver afin de ne pas terminer cette aventure trop précipitamment.
Plus tard, alors que nous nous apprêtions à sortir de Bucarest, j’avais frôlé l’hospitalisation. Une envie pressante m’était apparue alors que nous avions quitté l’auberge et attendions le tram. Je cherchai donc un endroit calme et désert, et trouvai à l’arrière d’un bâtiment un jardin mal entretenu cerclé d’une petite bordure enfoncée à un endroit comme s’il était habituel qu’on l’empiète pour s’y introduire. Je l’enjambai et trouvai un arbre à ma convenance, caché le plus possible d’un éventuel public. Alors que j’achevais ma tâche, je vis un homme au rez-de-chaussée s’enfermer derrière une baie vitrée. Je m’étonnai dans un premier temps qu’il ne m’eût pas interpellé, avant que je n’entende un aboiement grave provenir de sa direction. Il venait de lâcher un chien sur moi. Mon sang ne fit qu’un tour, et sans même avoir pu apercevoir la bête, je rebouclai ma ceinture d’un geste sûr, porté par un pic d’adrénaline, courus vers la sortie sans attendre de l’entrevoir et sautai la bordure sans me soucier de ce sur quoi je pourrais retomber de l’autre côté. Une pauvre grand-mère faillit en faire les frais, et sans doute avait-elle été effrayée de me voir surgir devant elle de nulle part comme un coupe-jarret. J’avais échappé au gardien sans savoir s’il était sur mes talons ou encore loin derrière, n’ayant pas même eu l’idée de me retourner.
En arrivant, nous craignions les meutes de chiens errants, mais nous avions appris depuis à nous méfier des chiens attachés à leur maître et à leur territoire. Jamais un chien errant ne s’était montré menaçant envers nous, et si la nuit nous les entendions se battre, c’était seulement pour des histoires de chiens, laissant les hommes hors de leur dimension. Ils avaient plutôt tendance à fuir devant nous, à moins qu’ils n’aient senti l’odeur de la nourriture et ne viennent en réclamer. À voir comme certaines personnes vivent ici, il n’est pas étonnant que les chiens soient encore moins bien lotis.
Même à Zarnesti, ville de montagne en apparence tranquille, il était un quartier que l’on pouvait apercevoir de loin, car il était le seul composé de barres d’immeubles et semblait abriter une grande misère. Je n’avais pas voulu croire, en voyant ces agrégats de blocs bétonnés à nu sur lesquels dégoulinaient des traînées de rouille depuis les bouches d’évacuation, que des gens pouvaient encore y vivre. Sur la façade se dessinait le quadrillage qui délimitait chaque appartement, comme un empilement de conteneurs percés d’une ouverture à chaque extrémité. Certains de ces bâtiments étaient à moitié démolis et les blocs des façades avaient été retirés, laissant paraître le jour de l’autre côté à travers la porte du couloir. Ceux encore habités se repéraient à la multitude d’antennes satellites qui pointaient vers le ciel à chacune des fenêtres. Mais de loin, ce quartier ressemblait à une friche à l’abandon, les toits envahis par les hautes herbes et les arbustes.
Cette pauvreté se retrouvait dans les rayons des supermarchés. Nous avions tout d’abord été surpris et heureux de trouver ici du pâté et du chocolat à des prix défiant toute concurrence. Alors que nous nous rationnions précédemment et que ceux-ci étaient devenus pour nous des mets d’exception, là nous pouvions en acheter sans compter et en avions donc fait de bonnes provisions. Ces provisions, nous dûmes les jeter tant elles étaient immangeables. Le pâté ne contenait que peu de viande, mais beaucoup de gélifiant, le chocolat peu de cacao et beaucoup de je ne sais quoi, les biscuits beaucoup d’arômes chimiques. Et tout ceci pour nourrir les plus pauvres du pays. C’était la première étape de notre voyage où nous étions confrontés à une pauvreté normalisée, et où la loi du plus fort, ou du plus malin, semblait s’appliquer parmi les hommes comme parmi les chiens.
*
Nous prîmes la route de la Bulgarie que nous comptions traverser sans nous arrêter afin de rejoindre la Turquie. Une nouveauté passagère se présentait, l’alphabet cyrillique qu’il nous fallait savoir retranscrire sur nos pancartes d’auto-stoppeurs pour indiquer notre direction aux conducteurs. Nous demandions généralement à des locaux de nous l’écrire ou alors nous recopions au mieux les panneaux directionnels. Certaines lettres étant identiques à notre alphabet latin, cela menait parfois à quelques incompréhensions, la plus notable juste après notre entrée alors que nous voulions rejoindre la ville de Pyce, que nous prononcions « Pisse », mais qui, écrite ainsi en cyrillique, se prononce « Roussé ». Mieux valait ne pas tenter de parler et se contenter de recopier les formes.
Au second jour de traversée, approchant de la frontière turque et alors que nous faisions du stop, une camionnette s’arrêta et en sortit un grand bonhomme au crâne rasé qui nous invita à charger nos sacs à l’arrière et à monter avec lui à l’avant. J’avais remarqué dans son cou un tatouage « SS » en forme de double éclair, comme celui de la Waffen-SS, mais j’avais alors pensé que cela pouvait bien signifier autre chose. Une fois que nous fûmes installés à ses côtés, il avait entamé la conversation en nous demandant si nous aimions le football. Ni Laurent ni moi n’y étions particulièrement sensibles, mais lui était un grand passionné, dans un sens qui m’échappait un peu. Il s’esclaffa : « Moi j’adore le foot, je suis un hooligan, j’adore me battre ! » Et il continua : « J’ai déjà pris un coup de couteau ici et là, et une balle ici ! », dit-il tout en montrant différentes zones sur son torse. Je compris alors que ce tatouage n’avait rien d’anodin et que nous avions affaire là à un vrai néonazi. Il nous demanda si nous n’avions pas un peu d’herbe sur nous, nous raconta la qualité de celle qu’il fumait avec ses amis turcs et nous parla des juifs qu’il mimait comme des vampires en prolongeant ses canines avec ses doigts. C’était un des individus les plus curieux que nous avions rencontrés jusqu’à présent. Certains pourraient facilement s’emporter et émettre un jugement véhément sur sa personne. Je me contenterais de dire que, malgré la doctrine à laquelle il adhérait, cet homme ne m’avait paru n’être qu’un idiot. Pas un monstre, pas une abomination, mais un enfant dans un corps adulte, faisant de la violence un jeu, inconscient et irresponsable. Juste un imbécile, comme le suggérait la lueur débile dans son regard à l’évocation d’une bonne bagarre, étincelle d’une pulsion traversant le vide de son esprit.
Puis il voulut savoir où nous déposer. Laurent sortit une carte pliante qu’un autre conducteur nous avait donnée précédemment et l’étendit devant lui. Je me penchai sur la carte, ainsi que notre conducteur, cherchant la ville de Svilengrad sur la route de la Turquie. C’est alors qu’on entendit un puissant klaxon résonner. Plus personne ne regardait la route. Nous levâmes tous les trois la tête dans le même temps pour constater que nous roulions sur la voie de gauche et qu’un poids lourd nous fonçait dessus. Il redressa son véhicule au dernier moment pour éviter la collision. Moi qui étais assis tout à gauche dans sa conduite à droite, je vis le camion passer très près. Nul doute que si nous n’avions pas esquivé, nous serions morts. Notre aventure se serait achevée dans un stupide accident de la route, sans gloire, sans originalité, comme on peut mourir à deux pas de chez soi. À quoi bon ! S’ensuivit un silence gêné dans la camionnette. Laurent et moi n’avions plus qu’une hâte, descendre. Je pensais à ma mère, elle qui s’inquiète sans arrêt pour un rien. J’imaginais sa souffrance, toutes ses peurs qui se seraient vues justifiées. J’ai imaginé ma famille pleurer un corps absent, mutilé dans un pays étranger. A-t-on le droit de faire ça ? Je n’ai pas envie de mourir loin des miens. Je n’ai pas envie qu’on me pleure…
Il nous déposa à Svilengrad en répétant qu’il nous aimait bien et en nous demandant de faire attention à nous, car il y avait ici des gens dangereux. Sur le moment, je n’avais pas voulu prendre de photo avec lui comme nous l’avions fait avec tous les autres conducteurs jusque-là. Je le regrettais maintenant. Après tout, il s’était arrêté pour nous aider et, malgré ses débordements, il avait mérité sa place dans la fresque de notre aventure.
6. Entrée en Turquie La porte de l’Asie
La Turquie était pour moi chargée d’un fort imaginaire issu de mes cours d’histoire du collège, ainsi que de mes lectures dilettantes. Elle représentait la porte de l’Asie, à la croisée des grandes civilisations, route de conquête de la Grèce par les Perses, puis celle de l’errance des 10 000 mercenaires de Xénophon, chemin victorieux d’Alexandre le Grand vers l’Asie, puis terrain d’affrontement de ses diadoques. C’est cette même terre qui vit l’essor du catholicisme, de l’orthodoxie et de l’islam ; naître la grandeur de Constantinople puis d’Istanbul, siège du pouvoir de l’Empire romain d’Orient, porte d’entrée des pèlerins et croisés partis pour la Terre sainte, puis capitale de l’Empire ottoman. J’avais d’elle de belles idées nourries par ce passé grandiose. Trois mois après notre départ, nous allions enfin y pénétrer.
Nos expériences précédentes nous avaient appris que les conducteurs n’étaient que peu enclins à prendre des auto-stoppeurs à l’approche des frontières, probablement pour ne pas se rendre complice d’un trafic quelconque contre leur volonté. Nous avions donc remonté sur quinze kilomètres les files de camions arrêtés sous un soleil éclatant qui, pour la première fois depuis que nous avions quitté la France, nous brûlait la peau. Les chauffeurs, pour patienter, étaient sortis de leur véhicule. Ils ouvraient une trappe sur le côté et en tiraient un banc et tous les ustensiles pour préparer le thé, qu’ils buvaient en nous regardant passer. Au poste-frontière turc, l’officier nous demanda si nous comptions nous rendre en Syrie. En effet, cette route était aussi celle des djihadistes européens pour l’État islamique. Ne comprenant d’abord pas ce qu’il entendait par « Syria ? », nous échangions des regards circonspects, puis saisissant sa question, nous nous esclaffâmes en répondant par la négative. Peut-être que nos barbes, que nous n’avions pas coupées et qui commençaient à épaissir − surtout celle de Laurent − nous faisaient ressembler à des islamistes. La mienne prenait une allure étrange, clairsemée et pendante sous la mâchoire. Il fallait bien quelques idées extrêmes pour ne pas la couper.
Nous joignîmes la ville la plus proche, Edirne, et mangeâmes un morceau avant de nous rapprocher de l’autoroute pour Istanbul. Nous qui commencions à nous lasser des grandes villes européennes n’étions pas déçus ! Les mosquées qui remplaçaient les églises, les femmes voilées, parfois jeunes et coquettes, les salons de thé occupés par les hommes qui débordaient sur les trottoirs ainsi que les toilettes « à la turque » marquaient une différence claire avec ce que nous avions connu jusqu’à présent. Alors que le soir tombait et que la ville prenait des reflets orangés, nous tentions de la traverser et de nous en éloigner afin de trouver un endroit calme où dormir, non loin de l’autoroute pour Istanbul. Nous zigzaguions sur les trottoirs entre les groupes d’hommes assis à boire le thé et devions décliner à contrecœur nombre d’invitations à les rejoindre, car nous souhaitions nous installer avant la nuit noire.
Peine perdue. Nous devions encore trouver une connexion wi-fi afin de payer nos visas pour l’Iran. L’obtention d’un visa iranien est fastidieuse, nécessitant de s’y prendre au moins un mois à l’avance afin de lancer les démarches auprès d’une agence chargée de vérifier vos identités et activités, qui transmettait ensuite à l’ambassade son avis, favorable ou défavorable, à votre entrée dans le pays. Nous avions commencé les démarches en Roumanie, à Zarnesti, et devions maintenant payer l’agence, par virement bancaire, sans faire figurer que cet argent était destiné à l’Iran pour éviter un blocage de la transaction du fait des sanctions économiques imposées par les États-Unis au titre principal de la lutte contre la prolifération nucléaire. Chose qui n’était pas facile à gérer en récupérant le wi-fi défaillant d’une station-service. Quand nous eûmes fini, la nuit était tombée et nous devions encore trouver un endroit où dormir.
Nous sortîmes de la ville et abordâmes un quartier de friches et de bâtiments en construction. De nombreux lieux auraient pu nous satisfaire, mais les chiens errants y étaient encore plus nombreux qu’en Roumanie, et chaque fois que nous entrions dans un champ ou sur un terrain en travaux, nous étions accueillis par de féroces aboiements, sans que nous ne puissions distinguer ces chiens dans la pénombre, si ce n’était percevoir quelques yeux rouges y briller. Ainsi, nous avions été refoulés encore un peu plus loin, jusqu’à un champ inoccupé où nous nous étions installés derrière un bosquet.
Nous nous trouvions sur une colline qui surplombait la ville dont nous pouvions voir sa partie sud, scène d’un étonnant spectacle. Alors que nous étions prêts à nous coucher, en même temps que la lune rousse se levait à l’est, des lucioles clignotantes voletaient autour de nous. Puis tous les muezzins de la ville se mirent à résonner dans un concert de chants désynchronisés, désaccordés, mais appelant à une même prière. Certains, de leur plus belle voix, vous auraient transportés aux plus grandes heures des sultans ottomans. D’autres y mettaient tant de ferveur qu’ils ne paraissaient plus qu’un cri dans la nuit. D’autres encore, trop vieux peut-être, chantaient d’un air si fatigué qu’on les aurait crus avoir perdu la foi. Et les chiens, comme inspirés par ces vocalises, de gauche et de droite, hurlaient à la mort sous la lune rouge. Puis les minarets s’étaient tus les uns après les autres et les chiens avaient suivi. Un dernier, qui s’était élancé en retard, réveilla les meutes jusqu’à la fin de son appel. Alors un aboiement final, et enfin le silence. Plus que la lune, les lucioles et le sommeil.
Sommeil difficile à trouver parfois. J’avais été réveillé aux alentours de 5 h quand les muezzins résonnèrent de nouveau. De toute manière, nous vivions avec le soleil et celui-ci n’allait pas tarder à se lever. Quand il fit assez clair, nous repliâmes rapidement nos sacs de couchage. Une meute de chiens approchait, qui semblait hostile. Je pense qu’ils appartenaient au paysan, ou berger, propriétaire du champ où nous avions dormi. Nous avions détalé sous les aboiements, à tel point que je ne remarquai même pas une grosse tortue que j’avais dû enjamber, mais qui n’échappa pas à Laurent. Quelle étrange et prometteuse première journée en Turquie !





























