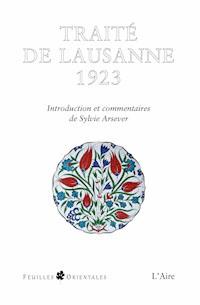
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Aire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les pages d’Histoire qui dessinèrent définitivement les frontières après la première guerre mondiale
La Première Guerre mondiale sonna le glas des empires austro-hongrois, russes et ottomans et déboucha pour chaque nation héritière d’une délimitation de frontières conclue par un traité de paix. Celles de l’Empire ottoman étaient particulièrement difficiles à tracer en raison de sa vaste étendue, de son multiculturalisme et de la spécificité de son histoire. D’abord, il y eut le Traité de Sèvres en 1920, concocté dans la hâte par les forces de l’Entente (Grande-Bretagne, France, Italie dont l’esprit avait des relents de colonialisme). Mais celui-ci s’avéra irréaliste et impraticable et provoqua l’ire de la nouvelle Turquie en gestation. Sous les décombres ottomans surgit un mouvement populaire emmené par Mustafa Kemal le visionnaire qui vainquit les Alliés et les Grecs. Forts de ce succès sur le terrain, les Turcs obtinrent la création d’un nouveau Traité de paix qui eut lieu à Lausanne pendant plusieurs mois et qui fut ratifié par les belligérants le 24 juillet 1923. Comme tout accouchement, celui-ci se fit dans la douleur. Une douleur particulièrement aiguë pour les populations contraintes au déracinement et au retour dans le pays d’origine. Ainsi naquit la nouvelle République de Turquie et furent dessinées définitivement les frontières des pays environnants. Le passé et l’avenir d’une région stratégique du monde étaient définis en quelques dizaines de pages.
Ce livre est agrémenté de cartes géographiques, de photos et d'articles de l'époque
EXTRAIT
Les frontières
C’est évidemment un point déterminant, et le changement majeur par rapport à Sèvres (voir cartes pp. 30-35). Mais seule une petite partie en est discutée à Lausanne, l’essentiel s’était déterminé par la force des armes sur le terrain et concrétisé par des accords bilatéraux avec la France et l’Italie dès 1921, et dans le cadre de l’armistice de Mudanya, signé un mois plus tôt.
La détermination de la frontière gréco-turque en Thrace (art. 2) sert en quelque sorte de round d’échauffement mais, après un baroud d’honneur d’Ismet Pacha pour un plébiscite dans la partie occidentale attribuée à la Grèce, peu de modifications sont apportées au projet allié, si l’on excepte la cession à la Turquie du faubourg de Karagatch, proposée en dernière minute par la Grèce en échange de la renonciation à lui demander des réparations pour les dommages créés par son armée en Anatolie (
art. 59). Les règles précises de la démilitarisation sont réglées dans une convention annexe.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Sylvie Arsever est historienne de formation (Université de Genève) et journaliste en Suisse. Anciennement, vice-présidente du Conseil suisse de la presse, elle gère dorénavant la rubrique « Dossiers » du quotidien suisse
Le Temps et publie des ouvrages sur la politique suisse. Elle est également chargée de cours au Centre romand de formation des journalistes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ouvrage paru dans la collection Feuilles orientales :
Voyage en Arabie heureuse de Carsten Niebuhr. Edition annotée par Alain Chardonnens avec la collaboration de Xochitl Borel.
Remerciements
L’éditeur remercie la Ville de Lausanne et le Centre Atatürk de leur aide précieuse
Documents iconographiques : Archives de la Ville de Lausanne (fonds Würgler), (fonds Hämmerli)
Introduction
Notre mémoire conserve en général plus de noms de batailles célèbres que de souvenirs d’accords fameux. Le traité signé le 24 juillet 1923 à Lausanne entre la Turquie d’une part et les vainqueurs de 1918 de l’autre fait exception. Du moins dans le premier pays, où tous les écoliers savent qu’àLozanont été délimitées les frontières, toujours menacées leur dit-on, de leur pays. Et où toutes les discussions sur les droits des minorités religieuses se mènent en référence à ses stipulations, ou plutôt à l’interprétation restrictive qui en a été rapidement donnée.
Il faut dire que, seul parmi les accords passés au sortir de la Première Guerre mondiale, le traité de Lausanne a survécu aux bouleversements de la Seconde, ainsi qu’au dégel du bloc soviétique, et déploie donc toujours ses effets. Peut-être parce qu’il s’agit déjà d’une révision. La première mais pas la dernière apportée dans l’entre-deux guerres à l’ordre punitif et réparateur dessiné à Paris par les vainqueurs entre 1919 et 1920.
Les écoliers turcs, en effet, apprennent un autre nom encore : Sèvres, la banlieue parisienne où a été signé, en août 1920, un premier traité, beaucoup plus conforme à l’esprit de 1918, qui réduisait le territoire ottoman à une petite enclave anatolienne, soumise au contrôle économique et financier presque total des puissances de l’Entente.
Pour les Turcs, Lausanne venge les injustices de Sèvres. C’est un point de vue opposé qu’on a retenu dans la diaspora arménienne et chez les nationalistes kurdes. Là, le traité négocié sur le rives du Léman à partir de novembre 1922 représente la mémoire brûlante des promesses trahies – celles, formulées à plusieurs reprises par les vainqueurs, de doter les deux peuples d’un foyer national sur les dépouilles de l’Empire ottoman.
Même les passions, dans cette affaire, sont donc toujours vivantes. Mais que dit exactement ce texte ? Le lecteur des pages qui suivent sera peut-être désarçonné par les domaines très disparates qu’il réglemente. A côté des clauses territoriales et de celles qui concernent les échanges de prisonniers et l’entretien des cimetières de guerre, on trouve des stipulations d’ordre économique, administratif, voire judiciaire. Et c’est sur cette dernière catégorie de questions que tout a failli capoter le 4 février 1923, lorsque la délégation turque n’a pas jugé pouvoir accepter le texte qui lui était soumis pour règlement définitif.
C’est qu’il ne s’agit pas simplement de régler les conséquences d’un conflit long et sanglant. Les nouvelles relations instaurées par le traité entre la Turquie et ses voisins occidentaux prennent le relais de plus d’un siècle d’ingérence dans les affaires de l’Empire ottoman – ingérence que le nouveau pouvoir est bien décidé à rejeter, avec une détermination dont les Alliés n’ont peut-être pas pris toute la mesure.
Installée au long du XIXe siècle, l’ingérence est économique, par l’intermédiaire de la Banque impériale ottomane, institut d’émission majoritairement en mains franco-britanniques ; par l’Administration de la dette ottomane, qui s’est fait céder une bonne partie des revenus de l’Empire en garantie d’une créance en croissance exponentielle et par les capitulations, privilèges accordés à partir du XVIe siècle aux partenaires d’un sultan alors au sommet de son pouvoir et devenus avec le déclin un moyen pour les négociants étrangers d’imposer leurs conditions commerciales. Elle est aussi politique : dans la foulée, toujours, des capitulations, les puissances occidentales, Russie en tête, se sont profilées comme protectrices des chrétiens ottomans – un tiers des habitants de l’Empire vers 1850.
Elles soutiennent activement les mouvements d’indépendance qui se répandent dans tous les Balkans à partir de 1820. D’autonomies arrachées en déclarations d’indépendance, l’Empire rétrécit inexorablement. Chaque guerre perdue fait enfler les charges, diminue les terres et donc les revenus, ce qui augmente la dette – et en conséquence l’ingérence étrangère. Et plus on avance vers l’Est – Bulgarie orientale, Macédoine, Bosnie Herzégovine, Thrace –,plus les populations sont mêlées et plus l’équation nationaliste implique des déchirures, des massacres réciproques et des rancœurs durables.
Autant de phénomènes qu’on préfère analyser, à Saint-Pétersbourg, Londres ou Paris, comme la preuve de la cruauté innée des Turcs tandis qu’aux yeux de ces derniers, les chrétiens apparaissent de plus en plus comme la cause de tous les maux. Mieux formés dans les collèges religieux qui se sont multipliés au cours du XIXe siècle, interlocuteurs privilégiés des hommes d’affaires qui font la loi à Constantinople, parcourus d’aspirations autonomistes plus ou moins affirmées qui rappellent cruellement les scénarios balkaniques, ils sont aussi de moins en moins nombreux – un habitant sur cinq en 1914 – mais toujours assez présents pour être ressentis comme une menace, surtout après le déclenchement des hostilités.
Ce sentiment est particulièrement vif chez les Jeunes Turcs, au pouvoir depuis 1908. Issus souvent des milieux turcophones des Balkans, ces officiers formés à l’occidentale dans les écoles dont le Sultan, dans un effort de modernisation, a commencé à doter le pays, sont à la fois intellectuellement européens, attirés par le sécularisme et le positivisme, et profondément nationalistes. Un sentiment qui se concentre au début sur la religion comme marqueur identitaire et englobe tous les musulmans ottomans – turcs, lazes, circassiens ou kurdes – avant de faire une place croissante à la glorification des traits ethniques réels ou supposés des seuls Turcs.
Le génocide commis à partir d’avril 1915 contre les Arméniens ottomans – et les massacres qui visent au même moment les Grecs de la Mer noire et les chrétiens syriaques et chaldéens du Sud-Est – s’inscrivent dans ce contexte, moyen, affirme notamment l’historien Tamer Akçam, d’une politique délibérée visant à homogénéiser la population anatolienne pour garantir les frontières et l’indépendance nationales.
Dans un premier temps, cette forme effroyable d’ingénierie démographique semble devoir jouer à fins contraires. Au lendemain de la victoire de l’Entente, il paraît clair que les frontières de la Turquie seront encore une fois redessinées pour faire place aux revendications nationales des minorités chrétiennes, cette fois enAnatolie même. Le président américain Woodrow Wilson l’a précisé dans le fameux discours par lequel, le 8 janvier 1918, il a énuméré en 14 points les buts de guerre de l’Entente. Le 12e concerne l’Empire ottoman. Il prévoit la libre navigation dans les Détroits, et un partage du territoire entre les populations non-turques – qui doivent pouvoir bénéficier d’un « développement autonome » – et les Turcs, qui pourront conserver « la souveraineté et la sécurité » sur le reste.
Dans le langage de l’époque, ces promesses n’impliquent pas forcément l’indépendance : les peuples trop immatures pour la démocratie, dont font implicitement partie tous les peuples musulmans, ont besoin de tuteurs. Et les candidats ne manquent pas :en 1916 la France et la Grande Bretagne se sont secrètement partagé, par les accords Sykes-Picot, le sud de l’Anatolie et les terres promises aux nationalistes arabes. Un autre morceau a été ensuite attribué à l’Italie, tard venue au club. La Russie, qui devait, principale bénéficiaire du dépècement, gagner Constantinople, est sortie de la course après la Révolution d’octobre avec les accords de Brest-Litovsk (mars 1918).
Le traité de Sèvres, signé en août 1920, tient compte avec plus ou moins de bonheur de l’ensemble de ces facteurs. Les territoires arabes de la Syrie et de l’Irak actuels sont placés, le premier sous contrôle français, le second sous contrôle britannique. La France obtient en sus une zone d’influence au sud de l’Anatolie, en Cilicie, sensée la dédommager pour la perte de la province pétrolière de Mossoul, qui lui était promise mais que les Britanniques ont occupée sitôt l’armistice signé. Une autre zone d’influence est attribuée à l’Italie autour d’Antalya. Smyrne et le territoire environnant sont placés sous juridiction grecque en prévision d’un plébiscite à tenir sur l’avenir de la zone, un système également retenu pour un territoire autonome kurde défini au sud-est. Territoire relativement modeste, la part la plus belle ayant été faite à l’Arménie indépendante qui vient de se créer à Erevan en profitant du démembrement de l’Empire tsariste. Cette dernière hérite des provinces de Van, Bitlis, Erzurum et Trabzon.
Mais déjà, on n’y croit plus beaucoup. Deux années écoulées depuis l’armistice ont largement redistribué les cartes sur le terrain.Dans les capitales européennes, les gouvernements qui avaient ouvert la conférence de Paris dans un esprit encore conquérant ont été remplacés par des hommes plus préoccupés de limiter leurs frais. Aux Etats-Unis, Woodrow Wilson est en difficulté face à la montée du courant isolationniste. Et en Turquie, un débarquement grec encouragé en sous-main par les Britanniques en mai 1919 a fédéré les aspirations à la résistance autour d’un certain général Mustafa Kemal, pas encore Atatürk. Le Sultan dont les émissaires négocient à Sèvres ne contrôle plus l’Anatolie où siège, depuis avril 1920, une Assemblée nationale installée à Ankara.
L’Arménie est la première à tomber – d’autant que ni les Etats-Unis ni aucune des puissances qui se disputaient avec entrain la côte méditerranéenne n’ont voulu assumer de mandat pouvant assurer sa sécurité. Elle doit céder ses provinces ottomanes en octobre 1920 et tombe aussitôt sous contrôle soviétique. Les Italiens et les Français amorcent leur retrait dès le printemps 1921 avant de conclure une paix séparée à l’automne, tandis que les Grecs se lancent dans une tentative d’élargir leur zone d’influence qui se termine en juillet 1922 par une défaite écrasante et un rembarquement sanglant à Smyrne. Quant à la zone autonome du Kurdistan, elle n’a même pas fait l’objet d’un début d’application.
Le 11 octobre 1922, alors que les forces kémalistes marchent sur les Dardanelles, un armistice est conclu à la hâte à Mudanya, sur la mer de Marmara. Un mois plus tard, tout le monde se retrouve sur les bords du Léman. Du côté allié, on retrouve les principaux signataires de Sèvre (la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, la Grèce, le Japon, la Roumanie et le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes). En face d’eux, toutefois, ils n’ont plus un Sultan affaibli régnant dans une capitale occupée mais, en la personne des représentants de la Grande assemblée nationale de Turquie, les agents d’une révolution nationale victorieuse.
Les circonstances, en outre, ont encore changé et Sèvres n’est pas le seul traité de sortie de guerre à vaciller. Au moment où s’ouvre la conférence, les défauts répétés de l’Allemagne dans les livraisons de charbon exigées d’elle à Versailles sèment la discorde entre les Alliés, divisés sur la manière d’y répondre. Cette divergence de vues aura des échos à Lausanne, où les Français, soucieux à la fois depouvoir se concentrer sur la question allemande, qui les touche de plus près, et de capitaliser sur leur reconnaissance précoce du nouveau régime turc, se montreront nettement plus disposés aux concessions que les Britanniques avec lesquels ils mènent, en gros, les négociations, l’Italie se contentant, nonobstant une visite très médiatisée du tout nouveau Duce à l’ouverture des débats, d’un travail technique, souvent de qualité, en commission. La montée de la tension internationale agit aussi sur les nerfs du président de la Conférence, Lord George Curzon. La Grande Bretagne a montré tout l’intérêt qu’elle porte à la question orientale en déléguant son ministre des affaires étrangères à la table des négociations. Mais ce dernier supporte de plus en plus mal l’immobilisation qui lui est ainsi imposée. Et tandis qu’il piaffe à Lausanne devant l’obstination du chef de la délégation turque, Ismet Pacha, les troupes françaises et belges occupent la Ruhr le 11 janvier 1923, créant l’une des crises majeures du premier entre-deux guerres.
Car c’est peu dire qu’Ismet (qui prendra plus tard le nom d’Inönü) à l’idée d’une victoire remportée contre le Grecs en Anatolie, est obstiné. Aidé peut-être par une sérieuse surdité, il transforme l’art de répéter inlassablement la même position en talent diplomatique – il a peu de choix, sa mandataire, la Grande assemblée nationale, étant encore moins disposée aux concessions que lui. Armé également d’une logique sans faille et d’une idée admirablement précise des égards dus à son pays, il ne recule que pouce à pouce – on entendra Curzon se plaindre qu’il est aussi utile d’argumenter avec lui qu’avec la pyramide de Cheops – et obtiendra, à l’usure, beaucoup plus que ce qu’on était prêt à lui concéder.
Il faut dire qu’un autre problème encore complique la position alliée : l’expédition grecque en Anatolie ne s’est pas seulement terminée par un fiasco qui met désormais la Turquie, vaincue de 1918, en position de vainqueur. Elle s’est accompagnée d’atrocités qui, pour n’être pas sans correspondance du côté turc, affaiblissent considérablement, par leur ampleur, la position du négociateur grec, Eleftherios Venizelos, ex-premier ministre resté célèbre pour sagrande idéed’une Grèce déployée sur les deux rives de la Mer Egée. A la conférence de Paris, il avait le soutien sans faille de son homologue britannique Lloyd George. A Lausanne, il s’efforce delimiter les dégâts, toujours avec talent mais avec singulièrement peu de cartes en mains.
Tout, ou presque, est l’occasion de palabres impitoyables. Et comme plusieurs dossiers sont négociés en parallèle, aucun n’avance sûrement vers une conclusion définitive, des concessions croisées restant toujours possibles. Fin janvier 1923, sous l’impulsion de Curzon, qui n’en peut plus, les Alliés, excédés par la résistance d’Ismet à toutes les concessions qu’ils continuent d’attendre de la Turquie, posent sur la table un projet de traité sur lequel ils demandent à la délégation turque de se déterminer rapidement.
C’est un échec et le 4 février, tandis que Curzon part pour ne plus revenir, aucun accord n’a pu être trouvé. Les questions lourdes ont pourtant été réglées : les frontières de la nouvelle Turquie sont dessinées, sous réserve de la souveraineté sur Mossoul qui sera traitée ailleurs ; le sort des Détroits est réglé ; un accord a pu être trouvé, moyennant de substantielles concessions alliées, sur la question de la protection des minorités et la décision la plus lourde humainement, le transfert forcé de 1 300 000 de Grecs ottomans contre un demi million de musulmans de Grèce, a pu être définitivement réglée dès le 30 janvier (voir p. 114). Même sur le sujet plus sensible, car plus près du portefeuille, de la dette ottomane, on est à bout touchant.
Restent quelques points sur lesquels les Alliés estiment pouvoir obtenir des garanties en contrepartie de la perte de la tutelle quasi-totale qu’ils exerçaient jusque-là. Questions dites économiques et relatives à l’avenir des contrats signés par des ressortissants de l’Entente dans l’ancien Empire ottoman, contrôle sanitaire des Détroits, régime judiciaire… Dans chacun de ces dossiers l’obstination turque est ressentie de l’autre côté de la table comme autant des signes d’une susceptibilité mal placée alors qu’elle a une explication finalement très simple : le refus d’être traité comme un partenaire mineur et d’accepter une ingérence ou même une surveillance internationale quelconque.
La rupture ne met pas fin aux contacts bilatéraux – la France avait d’ailleurs fait savoir par avance que le texte déposé restait susceptible de modification – et on se retrouve fin avril sur les bords du Léman pour un nouveau round de discussions à hautcaractère technique où les Turcs marquent encore quelques points significatifs contre des Alliés pressés d’en finir et pas prêts à prendre le risque d’un échec à ce stade des négociations.
Curzon a été remplacé par l’ambassadeur à Constantinople, sir Horace Rumbold, qui signera le traité pour la Grande-Bretagne et un nouveau délégué russe fait son apparition en la personne de Vatslav Vorowsky, le représentant soviétique en Italie. C’est lui qui, à son détriment, offre à cette deuxième phase des négociations son moment médiatique fort. Le 10 mai, un émigré blanc, Moritz Conradi, l’abat à coups de revolver alors qu’il dîne avec des collègues dans la salle à manger de l’hôtel Cecil. Au terme d’un procès qui s’est transformé en mise en accusation du régime soviétique, Conradi sera acquitté le 16 novembre avec son complice Arcadius Polounine. Son avocat Théodore Aubert deviendra un héraut de la cause antibolchévique à travers l’Entente internationale contre la IIIe internationale qu’il crée dans la foulée.
La signature du traité, le 24 juillet est fêtée par des illuminations et des feux d’artifice – après tout, la paix peut vraiment commencer en Orient et surtout le risque d’une reprise, même ponctuelle, des hostilités est écarté. Les commentateurs soulignent la victoire turque, qu’ils attribuent à la division de l’Entente et certains considèrent qu’elle sera éphémère : une fois l’ivresse du succès dissipée, la Turquie devra faire face aux rapports de force réels entre elle et les puissances occidentales et ceux-là, basés sur le développement plus avancé de l’Europe, n’ont pas changé.
Ils se trompent, au moins sur le second point. Au prix d’une fermeture économique certes coûteuse, la République turque proclamée le 29 octobre de la même année évitera de retomber dans la dépendance des capitaux européens et américains. Effectuant vers la modernité à l’occidentale une marche forcée dont on peut penser qu’elle n’est, aujourd’hui encore, pas entièrement digérée, elle inaugurera en quelque sorte la troisième voie entre Occident et monde soviétique que s’efforceront plus tard de suivre un Jawaharlal Nehru ou un Gamal Abdel Nasser, pour acquérir aujourd’hui un statut non discuté de puissance régionale avec laquelle il faut compter.
La connaissance de cet avenir nous permet de regarder d’un oeilcritique la condescendance avec laquelle Curzon ou le négociateur français Maurice Bompard accueillent en 1923 les digressions d’Ismet sur la volonté de son pays de respecter entièrement et de façon autonome les règles du jeu international ou, dans un registre moins heureux, sur l’hégémonie de la race turque. Les jours du sentiment évident de supériorité qu’ils manifestent, même dans leurs amabilités, sont comptés. Les temps sont en train de changer et celui qui le sait, c’est Ismet pacha.
Reste la face noire. Moins que la disparition des projets arménien et kurde morts-nés à Sèvres, c’est l’élimination, par un échange massif de populations, de presque toute trace de la présence chrétienne en Anatolie qui constitue le prix le plus lourd payé pour l’émergence à Lausanne d’une Turquie nouvelle capable de défendre sa place dans le concert des Nations. L’Arménie de Sèvres était vue par les victimes de 1915 comme un lieu d’accueil pour les réfugiés et une forme de dédommagement pour les souffrances infligées. Mais, projetée sur un territoire où les Arméniens n’étaient pas majoritaires même en 1914, elle aurait nécessité pour exister un volontarisme que les puissances étaient très loin de manifester. Et plus qu’en renonçant à un projet dont on voit mal quel sort il aurait réservé aux populations musulmanes détachées du territoire turc, c’est en acceptant de poursuivre, avec la bénédiction internationale, le nettoyage ethnique commencé en 1914 que les Alliés ont le plus nettement cautionné ce dernier, de même que l’idée, qu’ils n’étaient pas loin de partager, que des peuple différents ne peuvent en aucun cas partager la même terre.
Peut-être au lendemain des exactions réciproques de deux guerres, cette idée n’était-elle pas si éloignée de la réalité. La pratique, en tout cas, était promise à un bel avenir avec 4,5 millions d’Allemands expulsés officiellement à partir de 1945 en conséquence du traité de Postdam, sans compter près du double de réfugiés fuyant l’Armée rouge et les représailles ainsi que, en 1947, les quelque 12 millions de personnes jetées sur les routes à la suite de la partition entre l’Inde et le Pakistan. En Turquie en tout cas, la mémoire occultée de ces événements continue de sourdre entre les lacunes du discours officiel, porteuse d’interrogations que de nombreux intellectuels jugent devoir être résolues prioritairement àtoute démocratisation réelle de la société. Et c’est un rôle plus aigu encore que joue la question kurde, toujours présente, envenimée par plusieurs années de guerre civile avec le PKK et, depuis quelques années, régulièrement à deux doigts d’être résolue – ou d’embraser la région.
Sylvie Arsever
Le Traité pas à pas
Partie I
Clauses politiques
Les frontières
C’est évidemment un point déterminant, et le changement majeur par rapport à Sèvres (voir cartes pp. 30-35). Mais seule une petite partie en est discutée à Lausanne, l’essentiel s’était déterminé par la force des armes sur le terrain et concrétisé par des accords bilatéraux avec la France et l’Italie dès 1921, et dans le cadre de l’armistice de Mudanya, signé un mois plus tôt.
La détermination de la frontière gréco-turque en Thrace (art. 2) sert en quelque sorte de round d’échauffement mais, après un baroud d’honneur d’Ismet Pacha pour un plébiscite dans la partie occidentale attribuée à la Grèce, peu de modifications sont apportées au projet allié, si l’on excepte la cession à la Turquie du faubourg de Karagatch, proposée en dernière minute par la Grèce en échange de la renonciation à lui demander des réparations pour les dommages créés par son armée en Anatolie (art. 59). Les règles précises de la démilitarisation sont réglées dans une convention annexe.
Plus délicate est la question des Détroits (art. 23 et 24). Les Alliés, soutenus par une vigoureuse intervention du représentant américain Richard Washburn Child, souhaitent accéder librement à la Mer Noire, en temps de guerre comme en temps de paix, un accès garanti par une démilitarisation des Dardanelles et du Bosphore. Dans un premier temps, la délégation turque s’abstient pour laisser le représentant russe, le Commissaire du peuple aux affaires étrangères Gueorgui Tchitchérine, monter seul au créneau en faveur d’une fermeture en cas de guerre. Tout en précisant que telle est aussi sa position, Ismet admet finalement d’entrer en matière sur la solution alliée en en négociant pas à pas les conditions : garanties apportées à la Turquie, ampleur de la démilitarisation, tonnages admis et, surtout, contrôle, fixées dans une convention annexe (voir p. 115).
Le sort des îles de la mer Egée et de la mer de Marmara est réglé en parallèle (art. 12 à 15), la Turquie ne manifestant pas d’appétits très poussés dans ce domaine sous réserve d’un combat resté vain pour le retour de Samothrace, perdue en 1912, dans son giron.
Au Sud





























