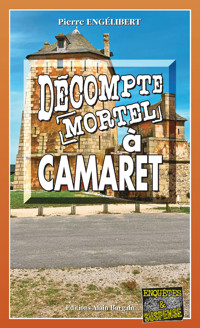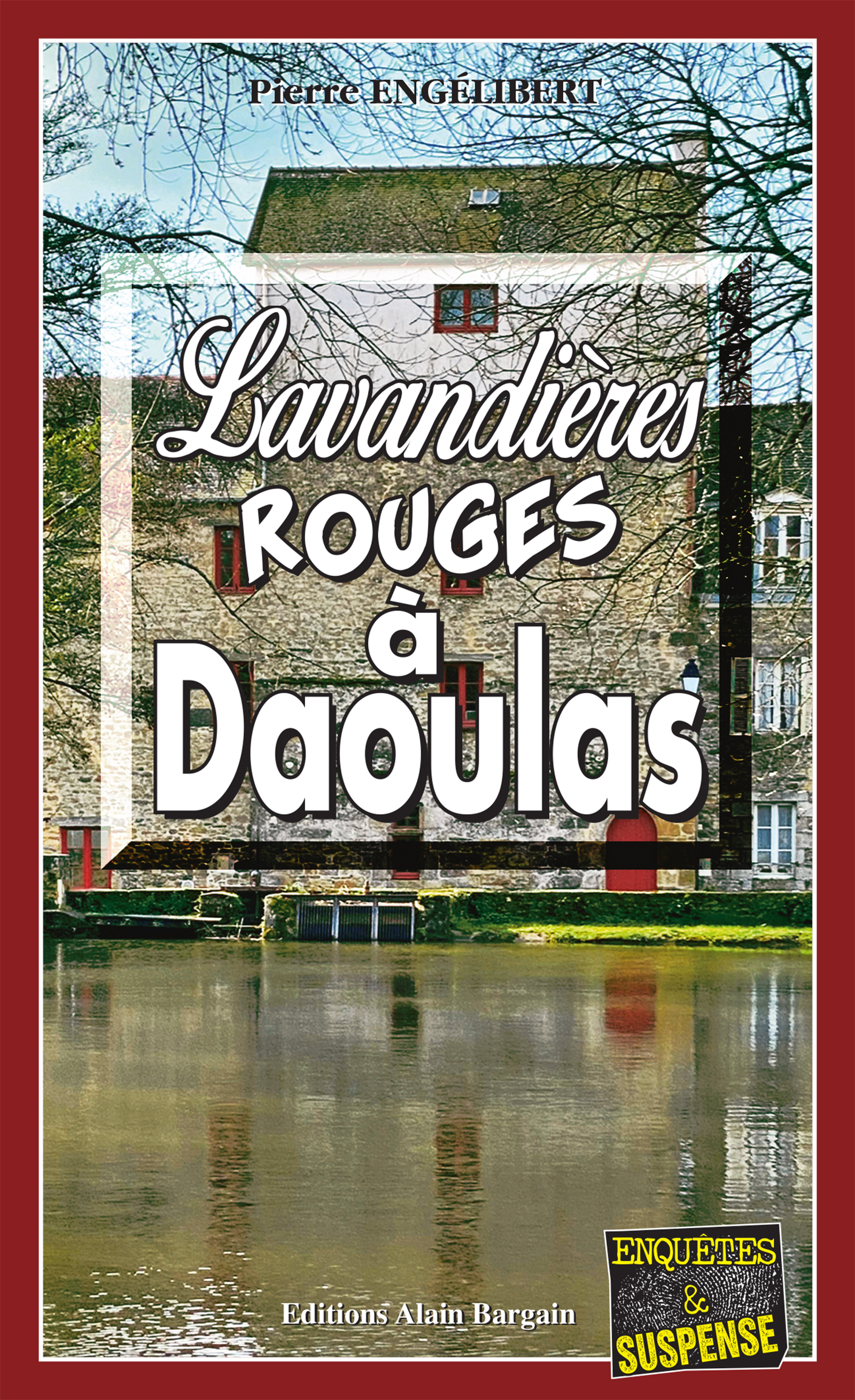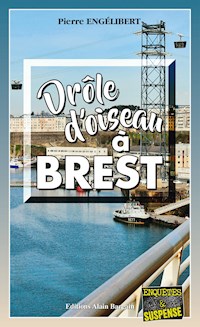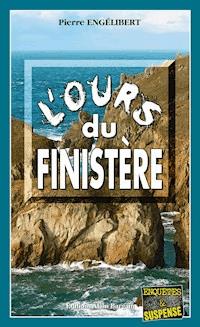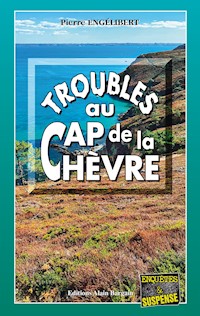
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Enor Berigman
- Sprache: Französisch
Un couple de retraités brestois est retrouvé assassiné dans sa résidence secondaire de Lostmarc'h au cap de la Chèvre à Crozon. Le commissaire Berigman comprend très vite que l'homme, ancien responsable fondateur d'un cabinet d'audit international, devait avoir beaucoup d'ennemis sur tous les continents en raison de soupçons de corruption qui pèsent sur des rapports falsifiés...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Professeur des écoles pendant plus de trente ans au Faou, maire honoraire de la ville,
Pierre Engélibert a profité de son départ à la retraite pour se remettre à l’écriture de nouvelles, de contes et de poèmes.
L’Ours du Finistère est son premier roman policier. Grand lecteur et passionné de voyages, père de deux enfants, il vit toujours au Faou.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes sœurs Anne-Marie et Marie-Noëlle,
À mon frère Pascal,
Qui ont tous trois renoué avec les Causses du Quercy, des terres calcaires où les eaux sont souvent souterraines.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
PROLOGUE
Péninsule de la Guajira, extrême nord-est de la Colombie
Estercilia, ma petite fille, a été inhumée ce matin. Les clans d’Ipuana, le clan du faucon, et d’Arpushaina, celui du vautour noir, sont de nouveau en deuil. Elle venait d’avoir six ans et n’aura guère eu le bonheur, elle non plus, de connaître la vie insouciante des enfants de cet âge-là ailleurs. Victime de la mine et de la mort noire le long du Rio Rancheria. Une de plus. Comme des centaines d’autres enfants et beaucoup de nos anciens en quelques années. Les plus fragiles. Ce n’était pas une fatalité, tout le monde le sait puisque la mine est responsable. Ce qui reste du fleuve est empoisonné, les poussières de soufre et de méthane se sont infiltrées partout. Le bétail ne s’y abreuve plus et les troupeaux dépérissent. Trente ans plus tôt nous nous y baignions encore. Aujourd’hui c’est impossible. Des dizaines de milliers d’hectares ont été déboisés. Les sols, autrefois si fertiles, sont devenus arides. Il ne pleut presque plus. Pour nous le changement climatique provoqué par l’homme est brutalement devenu une réalité en quelques décennies. Où sont passés les oiseaux ? Les poissons ? La nourriture pour nos chèvres et nos brebis ? Notre Terre-Mère a été blessée à mort.
Nous, les Wayuu, qui n’avons jamais été conquis par les Espagnols, sommes aujourd’hui dépossédés de nos terres ancestrales sous l’effet conjugué de la prédation des multinationales propriétaires de la mine de Cerrejón et des paramilitaires narcotrafiquants qui se partagent notre eau, qu’ils ont privatisée presque en totalité. Les tueurs ont construit un barrage en amont, sur le plateau, pour y développer des rizicultures et des palmeraies. Endiguement, détournement, le peu qui nous reste d’eau est pollué. La faim, la soif et les maladies sont devenues nos compagnes funèbres.
L’arrière-grand-père d’Estercilia, Tanko Simanca, le « Pütchipü’üi » de notre communauté, celui qui résout les problèmes, est désarmé face à ces hommes puissants. Aucune aide ne viendra non plus des autorités locales, elles sont corrompues, mais pas seulement elles car les enjeux financiers sont trop importants pour que l’État, qui fait semblant de compatir par de cyniques mesures “humanitaires”, se penche sérieusement sur notre sort. Que pesons-nous à côté de ces démons ? Même Juya, le dieu de la pluie, ne peut plus rien pour nous.
La mine à ciel ouvert fait plus de quatre cents kilomètres carrés ; au moins dix mille employés y travaillent. Le consortium possède sa propre ligne de chemin de fer, sur cent cinquante kilomètres. Deux trains de plus de cent vingt wagons font la navette vingt-quatre heures sur vingt-quatre vers le port d’embarquement du minerai entièrement dédié à cette activité, laissant le vent répandre de la poussière tout le long de la ligne.
Anglo-American, Glencore/Xstrata, BHP Billiton, voici les noms de ces prédateurs. On ne sait même plus si ces entreprises sont australiennes, anglaises, suisses ou même colombiennes tant leurs capitaux sont entremêlés ! Leurs profits n’ont pas de patrie et d’ailleurs on retrouve ces compagnies sur tous les continents, défigurant sans scrupule la nature et détruisant partout la biodiversité. Et malheur à ceux qui leur résistent, comme au Congo. Quelle amère et tardive consolation de savoir, selon Noshua Padilla, Maria Josayu et ma chère sœur Juya Simanca, les avocats de la “Wayuu Taya Foundation”, que le monde entier commence à s’intéresser aux spoliations dont sont victimes les peuples autochtones. Pour preuve, selon eux, le prix Pinocchio du climat attribué en 2015 à l’Anglo-American par une association écologique française pour les mensonges sur leurs pratiques sociales et environnementales prétendues “vertueuses” dont ils abreuvent les médias. Derrière leurs discours, la réalité est noire et meurtrière : loin du développement, ce sont leurs destructions qui sont durables.
2015 ! C’est l’année où, grâce au comité civique de défense de la Guajira et du Rio Rancheria, nous avons déposé une plainte auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains pour violation de nos droits fondamentaux et attaque contre la vie. Sans trop d’illusions. La démarche aura permis de rencontrer d’autres peuples et d’éprouver ce que nous savions déjà. Les multinationales, parfois les mêmes, ont partout les mêmes pratiques : spoliations, expropriations, destruction de la nature, déforestation et privatisation de l’eau, violence de leurs milices privées contre ceux qui résistent, assassinats ciblés, incendies des villages.
Quelques mois après le dépôt de plainte, en novembre, comme pour nous donner raison, le barrage de la mine de fer de Bento Rodrigues, dans le Minas Gerais, au Brésil, s’effondrait, faisant des dizaines de morts et disparus et déversant des milliers et des milliers de tonnes de boues toxiques sur des centaines de kilomètres jusqu’à l’océan. Le Rio Doce, source de vie et d’eau pour toute une population, est devenu le Rio Morto. C’est le Fukushima brésilien, il faudra des décennies avant que ne disparaissent les traces de cette agression contre la nature. Qui exploitait la mine ? Vale et encore BHP Billiton ! Vale, qui se moque de la sécurité, responsable en 2019 de la rupture du barrage de Brumadinho, toujours au Brésil. Un problème de drainage, ont-ils osé dire. Au moins deux cent soixante-dix morts.
Neuf ans après le Forum alternatif mondial de l’eau de Mexico en 2006 où nos représentantes avaient rencontré des délégués de nombreux conseils nationaux indigènes de toutes les Amériques, les échanges ont abouti à la création du Comité de liaison des peuples autochtones et premiers, de l’Alaska à la Terre de Feu en cette année 2015. La confrontation de nos expériences avait été rapide : nous avions tous les mêmes problèmes et les mêmes adversaires. Les Wichis d’Argentine, âprement défendus par Isabel Zamora et Lecko Cobos, se battent difficilement contre les compagnies d’agrobusiness qui organisent la déforestation de centaines de milliers d’hectares et provoquent la contamination de l’eau et l’infiltration de produits toxiques au prix de l’expulsion des populations ; les Guaranis du Brésil sont déplacés pour que Bunge puisse vendre toujours plus de sucre à Coca-Cola, les paysans d’Équateur ont perdu la bataille contre le pétrolier Chevron, qui a pourtant commis un crime écologique dans leur pays, et ceux du Pérou assistent, impuissants, à la destruction de leur territoire par Newmont, qui exploite les mines d’or et de cuivre de Yanacocha.
Tous nos pays sont concernés, la Bolivie, le Venezuela, d’autres encore, mais partout les mobilisations sont de plus en plus nombreuses. Malgré tout, les bonnes nouvelles rares.
En Équateur, le droit humain à l’eau a été déclaré patrimoine national stratégique d’usage public, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et essentiel à la vie, et est inscrit dans la constitution depuis 2008. Au Mexique, les femmes Mazahuas, menées par Yadira Ortega, ont créé un front zapatiste pour la défense de l’eau alors que les Indiens Yaquis s’opposent au milliardaire Carlos Slim, qui a détourné leur rivière pour réaliser des complexes touristiques et favoriser l’industrie agroalimentaire.
L’accès libre à l’eau ! Tout commence par là !
D’ailleurs Nestlé, Danone, Coca-Cola ou Pepsi, tous ceux qui font commerce d’eau minérale dans des bouteilles en plastique ou de soda n’ont jamais fait autant d’affaires qu’en miroir inversé de la destruction de nos ressources naturelles en eau là où les réseaux d’eau potable n’existent pas. Dans les territoires des autochtones et dans les vastes quartiers pauvres de nos pays.
Il est vital de retrouver nos droits territoriaux et de reprendre le contrôle de l’eau comme bien commun et public de l’humanité.
Mais parmi tous nos adversaires, une catégorie passe entre les mailles du filet. Victimes directes, nos amis brésiliens nous l’ont désignée les premiers et, du Mexique à l’Argentine jusqu’à notre péninsule, nous nous sommes aperçus que le même nom revenait fréquemment. Lui aussi a des milliers de morts sur la conscience, il ne peut pas l’ignorer si ce que l’on soupçonne est vrai. Il est temps d’aller chercher la vérité.
Selon nos avocats, en ce qui nous concerne, nous les Wayuu et les familles des victimes au Minas Gerais, au Brésil, cette quête mène jusqu’en France, dans une région qui s’appelle Bretagne. C’est pourquoi ils ont contacté quelqu’un là-bas en notre nom.
En attendant Estercilia Epiayu a rejoint la terre. Comme d’habitude, il était inutile de demander une autopsie, il n’y aurait eu personne pour la faire. Car cela permet au gouvernement de ne pas prendre le risque d’avoir à rendre compte publiquement des causes criminelles de la mort de nos enfants et de nos anciens. Il faudrait alors rechercher des responsables. Et leurs complices sont nombreux et puissants.
I
Samedi 9 avril 2022, 2 h 30 du matin, Crozon, cap de la Chèvre, village de Lostmarc’h
Le Jumpy Citroën gris quitte l’agglomération de Crozon par la rue de Dinan puis évite la direction de la pointe de Dinan en tournant sur la gauche par Menez Kerlouantec. Quelques centaines de mètres plus loin, le conducteur prend à droite sur Kernaleguen, puis c’est Runcadic qui mène enfin dans la lande au village de Lostmarc’h. Plus loin, juste avant la falaise, l’oppidum, les dolmens et le grand menhir dominent la pointe volcanique spectaculaire, haut lieu du mégalithisme. Plus bas, c’est la magnifique plage, rendez-vous des surfeurs toute l’année par presque tous les temps, ce qui de plus en plus ne va pas sans protestations des riverains du village, exaspérés de subir le tumulte de norias de camping-cars ou de voitures avec remorque dont les propriétaires ne coupent même pas les moteurs pendant qu’ils évaluent l’importance de la houle depuis le haut de la falaise afin de voir s’ils vont rejoindre le parking du bas pour s’adonner à leur passion. Et cela malgré le sens interdit destiné aux non-riverains à l’entrée de la toute petite agglomération. Il est vrai que le panneau est régulièrement barbouillé de peinture par d’anonymes pratiquants mécontents. En été, cette côte est un lieu de fréquentation d’une part de Français, d’autre part de nombreux touristes allemands, belges ou néerlandais dont beaucoup y pratiquent un naturisme toléré sur cette plage qui s’étale langoureusement jusqu’à la pointe de Kerdra, qui la sépare à marée haute de la plage adjacente de La Palue, dont les habitants du village ont les mêmes soucis que leurs voisins d’à côté. Les habitants locaux savent que ce site paradisiaque, porte de l’océan, n’est pas sans danger. Ce n’est pas pour rien que des panneaux indiquent que la baignade y est interdite en raison de la formation de baïnes, ces pièges à baigneurs. La puissance des vagues, leur effet d’aspiration et les violents courants latéraux ont vite fait d’entraîner les imprudents vers le large. Ce n’est pas une plage pour les enfants.
Mais les deux occupants du véhicule ne se préoccupent guère de savoir tout cela, ni même que la coupe régulière des prunelliers préserve, dans ce site naturel d’intérêt communautaire européen, la fragile fétuque de la lande où viennent se nourrir les très rares craves à bec rouge. Ils ne sont pas là pour admirer les lieux. En particulier à cette heure-là par cette nuit un peu sombre et tempétueuse qu’ils n’ont pas choisie par hasard.
Alexis et Vincent se connaissent depuis l’école maternelle. Le fait qu’à l’école élémentaire tous les deux se soient retrouvés orphelins de père à un an d’intervalle les a rapprochés. Ils ont grandi dans le même quartier de Brest, à Saint-Martin, et ne se sont jamais perdus de vue, faisant toujours les quatre cents coups ensemble. À l’adolescence ce fut plutôt le même coup unique, le vol sans violence, partout où ils se trouvaient : commerces, vestiaires, voitures laissées ouvertes. Puis, le permis de conduire acquis, ils ont pu élargir leur zone de chasse et s’attaquer à plus sérieux, apprenant en même temps à connaître les bons réseaux de receleurs. Dorénavant, l’essentiel de leurs rapines consiste à pénétrer dans les résidences secondaires inoccupées ou les maisons principales désertées par leurs propriétaires pendant les vacances au cours d’une petite visite “d’appropriation” selon Alexis, de “réquisition” selon Vincent, cette querelle sémantique étant devenue entre eux un jeu qui les fait toujours rire. Mais ainsi, ils n’usent jamais de violences physiques envers les personnes pas plus qu’ils n’exercent de dégradations à l’intérieur des habitations. Pas forcément pour des raisons morales ou de respect, mais parce qu’ils espèrent que si un jour ils se font prendre, la peine encourue sera moins lourde. Et ils n’ignorent pas non plus qu’ils ne sont pas assez courageux ou motivés pour affronter quelqu’un et encore moins le malmener. Ce n’est pas leur truc. C’est pourquoi ils “travaillent” généralement sur la foi d’un renseignement extérieur sûr. Leur comparse Marvin passe son temps libre à dénicher de bonnes cibles, de celles dont il paraît certain que le produit de la visite sera fructueux. Ils auraient pourtant été bien surpris d’entendre que se glisser chez autrui et le voler était aussi une forme de violence, certes psychologique, mais de celles qui laissent parfois des traces indélébiles. Car de violation de propriété à viol de l’intimité ou viol tout court, le ressenti de la victime franchit souvent le pas, même quand la perte est plus sentimentale que pécuniaire. Ou peut-être justement à cause de cela. Mais sans doute n’auraient-ils pas compris ce jugement.
Le Jumpy s’engage dans le village. Ils distinguent à peine la grande maison neuve en pierre en contrebas sur la gauche, puis ils passent le petit parking où se trouvent les conteneurs semi-enterrés et le sens interdit juste avant les premières habitations sur la droite. La route étroite finit en impasse par un minuscule rond-point au-delà duquel commence le chemin de la falaise. Ils roulent lentement le long des pentys, ces petites maisons basses en pierre qui épousent le relief, que l’on trouve en Bretagne en bord de mer, souvent à l’écart des villages. Les toits pentus recouverts d’ardoises et leurs petites ouvertures ainsi que leur exposition les protègent efficacement du vent et des tempêtes.
Tout au bout, après les deux dernières maisons à droite, des locations de vacances, un chemin empierré d’une dizaine de mètres les amène sur un tout petit parking de quelques places, lui aussi devenu réservé aux riverains. Alexis se gare et coupe le moteur. Tous les deux descendent, chacun ayant un grand sac à la main. Ils sont vêtus d’habits très sombres qui les rendent pratiquement invisibles dans l’obscurité. Comme d’habitude, ils restent totalement immobiles et silencieux plusieurs minutes à l’affût du moindre bruit. C’est le prix de la sécurité. Ils savent que le village est presque désert, les résidents allemands ou belges ne sont pas encore arrivés, ni même les Brestois ou les Parisiens qui ont acheté ici une petite habitation de vacances pour l’été ou les week-ends de la belle saison pour les plus proches. Mais c’est l’une des dernières nuits possibles pour opérer, les vacances de printemps ont commencé ce vendredi soir en Bretagne et même si dimanche le premier tour de l’élection présidentielle devrait retenir les résidents français dans leur habitation principale, les étrangers n’ont que faire de l’événement. De fait il reste très peu d’habitants permanents à Lostmarc’h ; ils se comptent sûrement sur les doigts des deux mains, ou presque, et ils sont plutôt situés dans les premières maisons du petit bourg. Mais les deux jeunes hommes ne veulent pas prendre le risque que l’un d’entre eux, assez courageux et intrigué par le bruit du moteur, ne vienne jeter un œil pour voir ce qui se passe. À moins qu’il n’appelle la gendarmerie, mais c’est peu probable tant qu’il n’a pas la certitude que quelque chose de louche se trame. Quoique, à cette heure-là, personne ne voudra sortir sous ces conditions météo exécrables. De toute façon, dans le cas de l’arrivée surprise d’un riverain, ils n’insisteront pas et repartiront. Ne jamais tenter le diable, c’est leur règle, celle à laquelle ils doivent certainement de ne jamais avoir été pris. Elle nécessite de la discipline et une bonne entente, mais ils sont maintenant suffisamment aguerris pour s’y tenir sans effort ni regret. Bref le froid et la pluie ininterrompus ajoutés au vent soutenu les préservent à coup sûr d’une apparition soudaine. Et c’est tant mieux car, au bout d’une impasse, ils ne sont pas dans la meilleure position stratégique.
Leur objectif est la deuxième maison sur la droite, à une vingtaine de mètres, juste après l’enfilade de quelques résidences en contrebas dont on devine à peine l’ombre des toits d’ardoises, en reprenant la route en sens inverse. L’entrée côté route est en réalité un premier étage car, à cause de la pente, le rez-de-chaussée donne sur le jardinet de l’autre côté de la maison. Comme d’habitude, ils ignorent comment Marvin a repéré cette cible, moins ils en savent, mieux c’est, mais leur complice ne les a jamais déçus.
Rassurés par le calme des lieux malgré le souffle du vent, les deux garçons avancent sans bruit jusqu’à la barrière en bois qui permet le passage d’une voiture sur le côté. Ils la franchissent sans difficulté, descendent dans le noir le long du passage qui mène à un garage ouvert de deux places et à la terrasse qui borde toute la façade du bâtiment. Ils n’ont pas le temps d’envier les heureux propriétaires qui, par beau temps, doivent prendre à cet endroit leur petit-déjeuner face à la mer et aux falaises du cap à condition qu’il n’y ait pas trop de vent, car ils s’arrêtent subitement. Ils aperçoivent une masse sombre dans la partie gauche du local. Il ne peut s’agir que d’une voiture !
— Mais il ne devait y avoir personne ! chuchote Alexis.
— Ben non, Marvin était sûr de lui. Normalement ils sont chez eux à Brest, répond Vincent.
— Bon alors, qu’est-ce qu’on fait ?
— Attends, je réfléchis.
Ils se taisent quelques instants, ne laissant plus que le bruit des vagues au loin sur la plage entailler le calme qui règne. Alexis laisse Vincent à ses réflexions. Des deux, c’est toujours ce dernier qui prend les décisions importantes et il ne discute jamais. Quelques secondes suffisent à Vincent.
— Écoute, ces gens doivent posséder plusieurs voitures, il est probable que celle-ci en soit une qu’ils laissent ici à disposition de leurs amis de passage.
— Mais c’est ravitaillé par les corbeaux, ici ! Ces amis viendraient déjà en voiture ! Et puis, justement, ce sont peut-être des amis qui sont là ! s’étonne Alexis.
Vincent fait une grimace que son compère ne peut apercevoir dans l’obscurité.
— Parle plus bas, les sons peuvent porter loin la nuit, même avec le bruit du vent. Je n’en sais pas plus que toi mais je fais confiance à Marvin, il ne s’est jamais trompé. Et puis tu as remarqué que le garage a deux emplacements. Je pense que la maison est bien vide. Allez, on y va, mais prudemment !
Marvin, le troisième partenaire de leur trio, est leur éclaireur ; son unique mission est de repérer les coups à faire. La mère de Marvin, Valentina, est espagnole, de Cadaqués, en Catalogne, ce qui fait qu’il comprend et parle parfaitement la langue. C’est pourquoi ils l’avaient accompagné une année chez ses grands-parents jusque là-bas. Un super souvenir avec Éléonore, la grande sœur de Marvin. Les garçons se sont rencontrés cinq ans auparavant, lorsque Vincent, pourtant plus jeune d’un an, est sorti avec elle. Leur aventure a duré presque trois ans puis ils se sont séparés sans drame, en restant bons amis. D’ailleurs Éléonore n’ignore rien de leurs activités et ils la croisent parfois avec Marvin sans aucun problème. Car les liens avec ce dernier, eux, n’ont jamais été rompus tant leur entente était devenue solide. Il est vrai que le jeune homme a toutes les qualités requises pour faire un excellent acolyte ; il est prudent et sait se rendre quasiment invisible avec son physique de jeune premier souriant. Toujours bien habillé sans être m’as-tu-vu, il passe facilement inaperçu et il ne suscite aucune méfiance. Et surtout il ne laisse aucun souvenir dans l’esprit des gens. Grâce à lui, avant de commettre leurs forfaits, Alexis et Vincent ne se rendent jamais sur les lieux, échappant à tout témoignage que les voisins pourraient donner à la police. Mais rien n’est laissé au hasard, ils se préparent sur des photos, des plans, des cartes routières afin d’identifier les accès et les zones de repli pour fuir par un autre trajet de retour et ils ont appris à assimiler toutes les informations complémentaires que leur fournit Marvin qui, quant à lui, au moment du coup, s’arrange pour être loin de là, en compagnie de nombreux témoins si c’est possible, pour le cas où il aurait quand même été remarqué. Mais, signe que ce système semble quasi infaillible, il n’a jamais été inquiété. C’est pourquoi ensuite le partage se fait toujours à trois parts égales.
Le fait que la porte à petits carreaux vitrés dans sa partie haute ne soit pas fermée à clé ne les étonne qu’à moitié, ils ont souvent constaté la négligence des propriétaires dans la protection de leurs biens. C’est très bien ainsi, il n’y aura même pas d’effraction.
Ils allument leurs lampes en entrant dans une grande pièce de vie qui occupe presque la totalité de ce rez-de-jardin, hormis un WC et une petite salle d’eau derrière l’escalier à gauche. Les pièces de nuit sont donc à l’étage où le palier doit avoir une sortie directe sur la rue. Les deux jeunes se séparent et explorent la pièce dans une chorégraphie éprouvée, les rayons de lumière balayant les murs blancs, puis chaque meuble, tables basses, buffets et vaisselier. Plusieurs photos encadrées, certaines en noir et blanc, représentent un jeune couple, sans doute les propriétaires bien longtemps auparavant, entouré de jeunes Asiatiques, d’autres, moins anciennes, des portraits de vacances heureuses dans des paysages tropicaux. Le décor indique clairement que les premières ont été prises quelque part en Extrême-Orient. Les motifs de plusieurs tableaux accrochés sont d’ailleurs clairement de ce continent.
Très vite, une large armoire à deux battants, entièrement vitrée, attire l’attention de Vincent. Les étagères de verre sont décorées de toutes sortes d’objets, vases, vaisselle, statuettes ou miniatures, qui sont également à l’évidence tous d’origine asiatique. Parmi les plus petits, il reconnaît des Netsuke japonais, ces petites sculptures en bois ou en ivoire qui servent à maintenir les petites boîtes qui remplacent les poches absentes dans les kimonos japonais, car il en a déjà “emprunté” plusieurs fois et il sait que certains valent une petite fortune chez les collectionneurs. L’avantage est que cela ne prend pas de place. Au vu de ces merveilles, le garçon n’imagine pas un seul instant que les autres objets puissent être sans intérêt. Bien qu’il n’y connaisse rien, il sent qu’il n’a pas affaire à de pâles copies industrielles.
Ne comprenant toujours pas comment on peut être aussi imprudent, il ouvre les portes qui ne sont pas verrouillées alors qu’un dispositif existe. Il est vrai qu’il serait facile de briser le verre des parois. Il sélectionne avec précaution le maximum d’objets qu’il enfourne méthodiquement dans son sac. Il entend qu’Alexis fait de même de son côté.
Dix minutes plus tard les deux cambrioleurs font le point. Ils savent que le butin est inespéré, ils n’ont pas fait le déplacement pour rien.
— Qu’est-ce qu’on fait ? On monte voir à l’étage ? demande Alexis.
— Oui, vu ce qu’on a trouvé, ce serait bête de passer à côté d’une pièce encore plus exceptionnelle. Allons-y, on se donne cinq minutes puis on se barre.
Ils posent leurs sacs près de la sortie et montent l’escalier. Le palier donne sur un étroit couloir côté rue, qui distribue sans doute les chambres et peut-être une salle de bains.
Toutes ces pièces offrent certainement une vue exceptionnelle sur la mer. Malgré l’élégance de son ambiance, la première chambre, prolongée d’une salle d’eau spacieuse, les déçoit : la décoration y est maritime, dans les tons blanc et bleu, plutôt sobre. Les statuettes d’oiseaux de mer, les objets d’intérieur de voilier en bois ou en laiton, ainsi que les cadres marins sentent plus la boutique de touristes de Camaret ou de Crozon que l’artisanat de qualité, même si certaines pièces, comme un très beau baromètre, peuvent être intéressantes. Inutile d’insister.
La pièce suivante est un bureau dont ils admirent d’un œil distrait les bibliothèques vitrées ouvertes emplies de livres dont certains doivent être très anciens s’ils en croient les reliures. Mais ils n’y connaissent rien en livres, pas toujours faciles à négocier dans leur milieu.
Sans voir le petit coffre béant au fond d’une étagère à l’extrême droite, Alexis s’empare juste sur le bureau d’un coupe-papier magnifique, probablement chinois, dont le manche en ivoire sculpté en relief représente en miniature un paysan au pied d’un arbre au bord d’un champ. On aperçoit deux bœufs à l’arrêt tirant un soc de charrue en deuxième plan et une maison au loin. Un monogramme qui doit être une signature enroule la base du manche. Une pièce extraordinaire à n’en pas douter !
Mais les deux cambrioleurs n’allaient jamais oublier la deuxième chambre de toute leur vie. Ce n’est pas le bardage bois sur chaque mur et au plafond ni même les étagères croulant sous des dizaines de livres qui les impressionnent, encore moins la luxueuse salle de bains attenante qu’ils distinguent dans la continuité de la porte ouverte, c’est le lit. Plus précisément les deux corps allongés et ils pressentent immédiatement qu’une tragédie s’est produite dans cette pièce. Les taches de sang coagulé qui ont inondé les draps ne leur permettent aucun doute.
Ils réalisent en même temps, livides, que ce couple qui paraît avoir bien plus de quatre-vingts ans n’est pas mort de causes naturelles, c’est impossible. Ils ont été assassinés.
Les pensées se bousculent à toute vitesse dans l’esprit de Vincent car la richesse de leur butin et l’ordre qui régnait dans la maison prouvent que ce ne sont certainement pas d’autres cambrioleurs qui sont à l’origine de ces meurtres. Il ne cède pas à la panique de son ami, qui lui dit avec sagesse et terreur qu’il faut fiche le camp en vitesse, et s’approche pour toucher une main de la femme du dos de la sienne après avoir ôté son gant droit. La peau est froide, la mort n’est pas récente. Cela le rassure un peu, l’assassin est loin à l’heure qu’il est. Mais Alexis a raison, il ne faut pas qu’ils traînent. C’est alors qu’il remarque l’épais dossier dont le titre est en français mais dont beaucoup de pages intérieures sont en espagnol. Un registre non moins compact l’accompagne ; les deux documents sont posés en évidence sur les cuisses de l’homme. Peut-être Marvin saura-t-il de quoi il s’agit ? Dans un geste réflexe, il s’en saisit tout en murmurant d’une voix qui se veut plus calme qu’il ne l’est :
— Allez, viens, on s’arrache en silence et surtout sans courir.
Leur idée initiale était d’aller se planquer jusqu’à 6 heures du matin sur le parking du bas dont le chemin mène à la plage à travers la lande. Il est disposé en petites unités protégées par des talus et des haies, entourées d’arbres et de marais qui rendent tout véhicule invisible depuis la route qui rejoint La Palue. Ils n’imaginent pas une seconde que des gendarmes perdraient leur temps à venir patrouiller dans ce bout du monde désert.
Aussi, malgré leur découverte macabre, ils décident de s’en tenir à leur plan, faisant preuve d’un vrai sang-froid car bien des gens dans la même situation auraient choisi de mettre la plus grande distance possible entre les cadavres et eux. D’autant qu’une solution de repli existe pas trop loin, à Saint-Nic, où habite Éléonore. Mais là, le risque de tomber sur une ronde des gendarmes est bien plus grand.
II
Lundi 11 avril 2022, 11 h 15, Brest, antenne du SRPJ de Rennes
L’air de Bourée, de Jethro Tull, qui annonce un appel sur son portable, tire sans regret le commissaire Enor Berigman de l’étude du dossier posé devant lui. Il s’agit d’un document statistique comparatif déjà dépassé sur les crimes et délits dans le Finistère entre 2012 et 2019 aussi bien en zone police qu’en zone gendarmerie. Sans surprise, ce sont les escroqueries et les abus de confiance qui viennent en tête, talonnés par les destructions ou dégradations de véhicules ou de biens privés, les cambriolages, les vols et les coups et blessures. Le trafic de stupéfiants arrive bien après même s’il n’est pas négligeable, les réseaux se reconstituant aussi vite qu’ils sont démantelés ou presque. Il ne fait d’ailleurs guère de doute qu’il a augmenté ces toutes dernières années. Le nombre d’arrestations aussi. L’ensemble montre une relative stabilité, avec des baisses ou des hausses dans chaque catégorie selon les moments. Rien de nouveau sous le soleil, qui est plutôt présent ce matin. En ce qui le concerne, il est heureux, malgré les affaires exceptionnelles auxquelles il s’est mesuré, que les assassinats soient rares dans le département.
L’appel vient du brigadier-chef Thierry Pouliquen.
— Oui, Thierry, je t’écoute.
— Bonjour, Commissaire, je vous appelle pour un homicide, et un élément me fait craindre que ce ne soit une affaire plus difficile qu’elle n’aurait pu paraître au premier abord. Le légiste et les services forensiques sont en route, ils devraient être là d’une minute à l’autre.
Le commissaire ne perd pas de temps à demander sur quoi repose l’opinion de son subordonné, il lui fait confiance pour ce type d’expertise. Il est donc nécessaire qu’il se rende sans tarder sur les lieux.
— L’adresse ? demande-t-il en prenant un papier et un stylo.
— 69 rue de Kergoniam, c’est dans le quartier Saint-Marc, près de la rue de Verdun.
— Bien, on arrive.
Inutile également d’insister sur la préservation de la scène de crime, Thierry connaît son métier et le secteur doit déjà être bouclé. De toute façon, si Claude Guitton, le chef des techniciens, arrive avec son équipe, même une mouche aura du mal à polluer les lieux.
Enor se lève, enfile sa veste en cuir, se dirige vers la salle des adjoints, à quelques mètres. Tout le groupe est présent, Françoise, Aela, Denis et Ronan, chacun occupé à diverses tâches passionnantes du type rapports à rédiger ou dossiers à clore et à transmettre à un juge ou à la procureure. Sortir va leur faire le plus grand bien à tous.
Il lance à la cantonade :
— Quelqu’un connaît la rue de Kergoniam ?
Des hochements de tête négatifs lui répondent, ce qui ne l’étonne pas car la rue ne doit pas être un axe de communication entre plusieurs quartiers. Le genre d’endroit où l’on ne passe que si on y a à faire ou qu’on s’est perdu.
— C’est à Saint-Marc, rendez-vous au numéro 69. Thierry nous y attend avec un cadavre qui semble lui poser un problème. On s’y rend séparément, Françoise avec moi, les autres allez-y ensemble et on se retrouve là-bas.
D’un pas pressé, alors que tous les policiers se préparent, Enor, suivi du commandant Ridel, descend l’escalier et rejoint le parking.
C’est à dessein qu’il a prié Françoise de se joindre à lui afin d’avoir un petit moment pour discuter un peu de son moral. Le début d’année 2022 a été difficile pour elle, son épouse Dominique, professeur d’anglais, bien que vaccinée, a contracté le Covid en février et a dû s’isoler quelque temps. Heureusement, tout ne s’est finalement pas trop mal passé en dépit d’une courte période alarmante où elle avait ressenti une grande fatigue accompagnée d’une forte fièvre et de divers maux associés. L’essentiel fut d’avoir évité l’hospitalisation, au contraire de Kirstin, la mère de sa conjointe Mariannig, qui avait passé près d’un mois au Raigmore Hospital d’Inverness en avril 2021 avant de reprendre lentement le dessus. Après cette alerte, Kirstin et Guy se sont promis de venir les voir en Bretagne dès que la pandémie aura été neutralisée par les campagnes de vaccination et que les déplacements internationaux seront de nouveau aisés. On est maintenant tout proche d’y être parvenu. Ils projettent de venir sans doute fin juillet. De son côté, Françoise, cas contact testée négative, est restée éloignée du travail plusieurs jours, affrontant seule ses angoisses sur l’état de santé de Dominique. Enor l’avait appelée quotidiennement pour la tenir informée des affaires en cours et lui maintenir le moral. Les autres collègues avaient fait de même, par roulement, afin qu’elle ne soit pas obligée de devoir se répéter en donnant des nouvelles.
Mais pour Françoise et Dominique, le souci principal, une fois rassurées, avait rapidement été ailleurs, entraînant un court épisode de déprime de la policière, comme un contrecoup de la période éprouvante qu’elle venait de vivre : à cause de la pandémie le projet d’adoption enclenché en 2019 par le couple n’avait pas progressé depuis l’agrément accordé par les services du département en janvier 2020. Elles avaient dû, comme les textes les y obligeaient annuellement, envoyer à chaque début d’année un courrier de confirmation de leur intention d’adopter. C’était obligatoire pour maintenir l’agrément, lui-même valable cinq ans à cette condition. Les derniers mois avaient donc été un peu difficiles psychologiquement pour Françoise, entre la maladie de son épouse et la paralysie du dossier dans ces circonstances exceptionnelles malgré les nombreux coups de fil passés à la Direction de l’enfance et de la famille du conseil départemental. C’est pourquoi Enor n’avait pas encore tout à fait retrouvé la collègue vive et volontaire qu’il connaissait. Aussi était-ce avec beaucoup de satisfaction qu’il avait constaté depuis peu des progrès dans l’humeur de son adjointe, moins distraite, moins soucieuse, plus présente en quelque sorte. Il était persuadé que, tous les horizons sanitaires s’éclaircissant, ce n’était plus qu’une affaire de quelques jours avant qu’elle ne se soit ressaisie totalement. Surtout si une nouvelle affaire difficile leur tombe dessus ! Il aura alors besoin de ses exceptionnelles capacités de raisonnement et de son entière implication.
Sur le chemin, il tâte le terrain, même s’il est sûr des réponses :
— Tu te sens prête pour une nouvelle enquête ?
— Oui, ne t’inquiète pas, tout va bien maintenant. Dominique n’aura eu finalement aucune séquelle et elle est en pleine forme.
— Et pour votre démarche d’adoption, vous avez du nouveau depuis la dernière fois ?
Elle esquisse une petite moue d’hésitation.
— Je les ai encore eus au téléphone en fin de semaine dernière, ils répètent que tout est relancé et qu’on devrait avoir rapidement des nouvelles. Mais tu sais comment ça se passe, les administrations n’ont pas toujours le même sens du calendrier que leurs administrés.
— Peut-être mais c’est quand même un progrès ! Et puis je vous fais confiance pour les pousser un peu ! ajoute-t-il en souriant.
— Oh, c’est une arme à manier avec précaution, il ne faut pas les harceler non plus ! D’autant que je crois sincèrement qu’ils font de leur mieux dans des conditions très particulières en ce moment et, je crois, en effectifs réduits.
— Allez, un peu d’optimisme ne peut pas nuire, je suis sûr que tout va s’accélérer maintenant que les perspectives sont meilleures.
— Oui, tu as raison, je le sais bien, mais ça ne diminue pas mon impatience et ne soulage pas non plus mon nœud à l’estomac. J’ai toujours peur de voir toutes les procédures se figer brutalement de nouveau.
— Non, je n’y crois pas, tu le dis toi-même, tout redémarre et aucun nuage n’apparaît plus à l’horizon.
— En fait j’espère que nous aboutirons avant l’hiver prochain, je crains une nouvelle vague épidémique.
— Mais nous ne serons pas du tout dans la même situation d’impréparation que les années précédentes, d’autres vaccins seront disponibles et adaptés aux nouveaux variants !
— Puisses-tu dire vrai !
Enor ne fait aucun commentaire, il est satisfait de cette clarification de l’état d’esprit de sa collègue.
Il leur faut une vingtaine de minutes, aidés du GPS, pour arriver à destination, une rue calme de quartier, comme le commissaire le pensait. La maison se trouve peu avant un virage sur la droite après lequel la rue semble soudain redescendre vers le port de commerce. Le secteur est neutralisé par les bleus, aussi n’a-t-il aucune difficulté à trouver une place pour se garer. La maison, à peine visible, est protégée tout du long du trottoir par une haie arbustive de plus de deux mètres de haut qui aurait bien besoin d’être taillée.
Les deux policiers descendent de voiture, saluent l’agent de garde et franchissent un portillon en bois foncé laissé ouvert. Le crépi ocre soutenu des murs de la maison, jurant un peu au goût d’Enor avec la porte d’entrée et les fenêtres bleues en aluminium, semble avoir été refait tout récemment. Ils entrent directement dans une grande pièce à vivre où ils aperçoivent plusieurs collègues affairés dans la partie salon au fond de la salle. Il ne leur faut que quelques secondes pour enfiler les tenues de protection qu’on leur tend tandis que Thierry Pouliquen s’avance vers eux.
— Ah, vous voilà, Commissaire.
— Oui, le reste de l’équipe suit. Mais fais-nous déjà un résumé de ce que tu sais.
— La victime s’appelle Jean Ferré, 57 ans, célibataire. Elle a été découverte ce matin à dix heures et quart par sa secrétaire, Sylviane Jamet, qui est venue jusqu’ici, inquiète de ne pas le voir à son bureau en arrivant alors qu’ils avaient rendez-vous. Elle était surtout étonnée qu’il ne réponde pas à ses appels, ce qui ne se produit jamais dans ces circonstances d’après elle. Il l’aurait avertie de son retard ou serait resté joignable. Elle a d’abord sonné avec insistance et comme personne ne venait ouvrir et que la porte n’était pas verrouillée elle est entrée et a appelé à peu près de l’endroit où nous nous trouvons. C’est en s’avançant un peu qu’elle a aperçu le corps allongé au fond du salon. Après avoir vérifié s’il était encore en vie, elle nous a appelés à 10 h 26 exactement.
— Où est-elle maintenant ?
— Nous l’avons installée dans le bureau, en compagnie d’un agent.
— Bien, j’espère qu’elle n’aura touché à rien.
— D’après elle, non. À part le cadavre. Elle affirme être sortie immédiatement pour nous attendre. Ah si ! Elle est allée constater que la voiture de son patron était bien dans le garage en passant par la porte intérieure.
— Ah ?
Enor lance un regard autour de lui. L’impulsion de la secrétaire l’intrigue un peu. A-t-elle cru à un cambriolage et à un vol de voiture qui aurait mal tourné ? Aucun désordre qui pourrait y faire penser ne règne dans la pièce.
— Quelle voiture possédait la victime ?
— En fait elle en a deux, mais l’une d’entre elles est une Porsche récente. Elles sont toujours là, répond Thierry, qui a suivi le cheminement de la pensée du commissaire.
— La secrétaire, comment est-elle ?
— Eh bien, choquée, bien sûr, mais plutôt calme. Je crois qu’elle a fait preuve d’un certain sang-froid, ce qui n’est peut-être pas étonnant étant donné l’activité professionnelle de Jean Ferré.
— Ah oui, c’est vrai que tu as fait allusion à une difficulté au téléphone. Que faisait-il ?
— C’est pour cela que je vous ai dit que l’affaire risquait d’être un peu difficile, il était détective privé.
Alors qu’Enor est un peu abasourdi, sentant poindre les ennuis, c’est Françoise qui réagit la première :
— Eh bien, voilà qui n’annonce rien de bon ! À moins qu’avec de la chance la solution ne s’impose d’elle-même.
— N’y comptons pas trop, soupire Enor. Allons voir si Yves a déjà des choses à nous dire sur les causes de la mort avant de parler à la secrétaire.
Soudain Enor songe à un détail.
— Thierry, peux-tu demander à une équipe d’aller se mettre en faction devant l’agence de notre victime et de ne laisser entrer ou sortir personne des locaux jusqu’à ce qu’on arrive. Tu as l’adresse ?
— Non, mais je m’en occupe tout de suite auprès d’elle, répond-il en s’éloignant.
— Bien, rejoignons Yves.
Yves Cardic, le légiste, est encore agenouillé près du corps tandis qu’à deux mètres Claude Guitton laisse le photographe de la police prendre des clichés d’un objet au sol qu’Enor ne distingue pas bien derrière le fauteuil en cuir dans lequel la victime était peut-être assise lorsqu’elle a été tuée. Il aperçoit un mètre disposé de façon à apprécier les dimensions de l’objet en question et une plaque de numérotation. Il fait un signe aux deux hommes avant de s’adresser au légiste :
— Salut, Yves, tu as déjà quelque chose pour nous ?
Cardic tourne la tête et se redresse.
— Ah, vous voilà ! Je crois qu’en ce qui me concerne l’affaire est assez simple. La victime a été frappée plusieurs fois au crâne avec l’objet qui est au sol derrière. Elle a reçu au moins trois coups par-derrière dont deux ont totalement enfoncé la boîte crânienne, cela ne lui laissait aucune chance.
— Tu penses qu’elle a été surprise alors qu’elle était assise ?
Cardic fait une grimace.
— Difficile à dire, mais l’absence de livre ou de journal au sol m’incite à penser que, si l’homme était assis, il devait être en train de discuter avec son assassin. Celui-ci sera passé derrière lui à un moment donné et en aura profité pour le frapper avec la tête en pierre qui est au sol. Mais cela reste une hypothèse du déroulement des faits en attendant l’autopsie.
Enor fait deux pas de côté et aperçoit alors l’arme du crime : une statuette d’environ vingt centimètres de hauteur représentant un curieux visage grimaçant évoquant une origine probablement sud-américaine. Si cet objet appartenait à Ferré, ce qui est probable quand on voyait l’inspiration nettement amérindienne des autres objets et tableaux qui ornent la pièce, alors la question d’un meurtre improvisé sous le coup de la colère se posait. Une dispute ? Trop tôt encore pour s’engager dans cette voie.
Il fait un signe de tête à la procureure, Guylaine Essart, qui arrive, mais revient au légiste :
— Tu as une idée de l’heure du décès ?
— Au vu des premiers éléments d’examen, je dirais hier en fin d’après-midi ou en début de soirée, entre dix-neuf et vingt-deux environ, à une heure près.
— Dimanche, donc ! Cela devrait faciliter la recherche de témoins parmi les voisins.
— Pas si sûr ! C’était le résultat des élections à cette heure-là, tout le monde était sûrement scotché devant la télé et il ne devait pas y avoir un chat dans la rue non plus dans ce quartier. Peut-être s’agit-il d’une dispute électorale qui a mal tourné, après tout, ajoute-t-il avec un grand sourire qui montre qu’il n’y croit pas lui-même.
— Sait-on jamais ? On a déjà vu pire, répond Enor, qui feint de ne pas remarquer l’habituelle mimique exaspérée de la procureure devant les habituelles saillies du légiste.
— S’il y avait eu deux verres et une bouteille d’alcool vide, on pourrait admettre un meurtre impulsif de ce type sous l’effet de la boisson, mais il n’y a rien sur la table basse ni même de traces, observe Françoise. L’évier de la cuisine et le lave-vaisselle sont vides.
— Vérifie les placards pour voir si des verres ont été lavés récemment. Rien d’autre, Yves ?
— Non, sinon que la victime était athlétique, semblait en bonne santé et capable de se défendre. Je ferai l’autopsie en fin d’après-midi, on en saura plus après – il regarde sa montre –, bon, j’en ai fini ici, à plus tard.
— D’accord, n’oublie pas de nous confirmer l’heure exacte.
Pendant qu’Yves s’éloigne et qu’on s’apprête à évacuer le corps, Enor balaie la pièce du regard : quelques bibelots, trois ou quatre poteries, des statuettes et des toiles de toutes tailles accrochées au mur. Le tropisme centre ou sud-américain de l’habitant des lieux est manifeste et, bien que n’étant pas connaisseur, Enor aurait juré que l’ensemble était de l’authentique artisanat. Un vrai petit musée. Pas un seul objet de décoration qui ne se rapporte au monde amérindien, même le tapis, très coloré, au sol. Un tableau attire son attention car, en dehors de son aspect, il est extrêmement protégé par un solide cadre épais en bois exotique. Il s’agit d’un portrait, très solennel, d’un chef indien en grande tenue, dont l’artiste a su capter un regard perçant qui impose le respect. En dessous du tableau un court texte précise : « Cadeau de mes amis Wankas, Pérou, 2013. Peinture à l’argile. » La voix de la procureure tire soudain Enor de ses rêveries.
— Commissaire, si nous sortions faire un premier point pendant que les techniciens s’affairent encore ! Je crois que votre équipe au complet est arrivée.
Le ton est plus amusé qu’irrité. Enor la suit et tous se retrouvent en bout de terrasse, au pied d’un mimosa qui aurait sans nul doute besoin d’être taillé.
Le commissaire expose le peu qu’il sait aux policiers puis enchaîne :
— Bien ! Commençons par la routine. En attendant les résultats des techniciens et leur feu vert pour fouiller la maison, vous commencez l’enquête de voisinage. Notez bien les absents pour repasser les solliciter ce soir. Françoise, tu restes avec moi pour interroger la secrétaire, Sylviane Jamet. Des questions ?
— Oui, Patron. D’après ce que nous a décrit Thierry, la maison semble contenir plusieurs objets de valeur ; on peut donc supposer que le vol n’est pas le mobile du crime, analyse Denis.
— En tout cas pas le vol de ces objets-là, mais n’allons pas trop vite dans les conclusions, on manque encore trop de renseignements. Peut-être la secrétaire nous en dira-t-elle plus. La profession de notre victime étant particulière, il faut établir le plus vite possible si notre homme avait reçu récemment des menaces. Thierry, tu as eu l’adresse de son agence de détective ?
— Oui, c’est à Recouvrance, rue Bouillon, une rue perpendiculaire à la place de la Porte.
— Bien, je vois où c’est, nous irons dès que nous aurons fini ici, la secrétaire doit avoir les clés. Demande à Claude d’envoyer déjà quelques hommes sur place, cela nous fera gagner du temps pour l’inspection des lieux.
Pendant que Thierry s’éloigne, Enor se tourne vers son groupe :
— Si vous ne voyez rien d’autre, occupez-vous des voisins dès maintenant, en binôme avec un bleu. On se retrouve à la boîte à 19 heures. Madame la procureure, quelque chose de particulier ?
Sur un signe de tête négatif de cette dernière qui confirme également que cet horaire lui convient, Aela, Denis et Ronan se dispersent pour effectuer un exercice qui n’a jamais été le plus passionnant du métier de policier même si chacun espère toujours tomber sur l’information vitale qui conduira l’enquête sur la piste de l’assassin. Et, pourquoi pas, sur son identification. Mais cela ne se passe pratiquement jamais ainsi et d’ailleurs Enor ne se souvient pas que le témoignage d’un voisin l’ait déjà aidé de façon décisive dans la résolution d’une affaire. Mais c’est l’indispensable routine qui commande cette démarche et il suffirait d’une fois…
III
Lundi 11 avril 2022, 13 heures
Après le départ de la procureure, en attendant un premier rapport oral de Claude Guitton, Enor et Françoise se dirigent vers le bureau où se trouve Sylviane Jamet, la secrétaire. Thierry Pouliquen, de son côté, est parti rejoindre ses collègues après avoir remis les clés de la rue Bouillon au chef des techniciens qui charge Bernard Jagu, technicien principal, d’aller examiner les lieux avec une petite équipe.
Sylviane Jamet, assise dans un fauteuil en cuir marron devant une table basse en verre, est une grande brune aux yeux bleus d’une cinquantaine d’années ou à peine plus. Une bouteille d’eau est posée près d’elle ainsi qu’un paquet de mouchoirs en papier presque vide dont elle a jeté les usagés dans une corbeille à papier toute proche. Elle porte un chemisier blanc sous son blazer bleu foncé ouvert. Un pantalon de même couleur aux plis impeccables descend jusqu’aux chevilles, qui reposent sur des chaussures noires à talons hauts. Le chignon étudié sur la tête et les deux anneaux dorés aux oreilles viennent parfaire le caractère strict de l’ensemble de la tenue et du port général qui annonce comme un cliché la secrétaire efficace et organisée. Si ce ne sont les yeux rouges et les larmes qui coulent le long de ses joues.
Enor se dit qu’elle pourrait bien faire un bon témoin, malgré le choc qu’elle éprouve encore. Après avoir fait signe à l’agent de les laisser, le commissaire se présente ainsi que Françoise. Puis il commence :
— Madame, vous sentez-vous capable de répondre à quelques questions ?
Elle fait un bref signe de tête.
— Oui, faites votre travail, je sais bien que chaque heure compte.
La voix est claire et agréable, légèrement voilée par l’émotion.
— Je vous remercie, alors clarifions le premier point. Pour quelle raison vous êtes-vous déplacée ce matin ?
Sylviane Jamet redresse la tête et le regarde droit dans les yeux.
— Parce que je n’arrivais pas à joindre Jean au téléphone. Son portable me renvoyait sur la messagerie. C’était très inhabituel dans ces circonstances car il était attendu au tribunal à 11 heures. Son témoignage était requis dans une affaire d’escroquerie et il devait passer au bureau récupérer les papiers et documents afin de les relire attentivement une dernière fois à cause de points comptables un peu ardus. Je l’attendais vers 8 heures et j’avais préparé le dossier, même s’il avait tout en tête comme d’habitude. Mais il était perfectionniste, vous savez, d’ailleurs c’était un ancien collègue à vous.
— Ah bon ?
— Oui, il a fini sa carrière avec le grade de commandant à Troyes avant d’ouvrir son agence ici, à Brest.
Le bref coup d’œil de Françoise indique à Enor qu’ils ont eu la même pensée : il allait falloir se renseigner sur la carrière de Jean Ferré dans la police et sur les motifs de sa reconversion. Même s’il n’était pas rare de trouver beaucoup d’anciens policiers dans les officines de sécurité ou d’enquêtes privées. Voire chez les cadres ou à la direction de polices municipales de grandes villes. Mais ils préfèrent souvent rester dans les parages de leurs anciens lieux d’exercice où ils bénéficient de réseaux d’information solidement établis.
— Donc, n’ayant pas de nouvelles, vous décidez de venir chez lui ? Mais il aurait pu être simplement retardé en ville et arrivé pendant que vous étiez en route ?