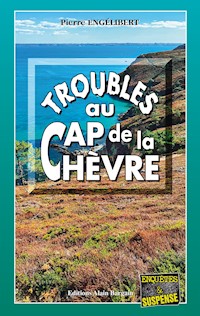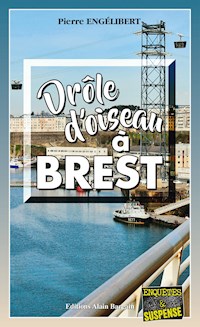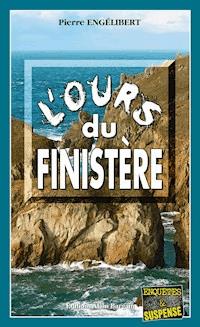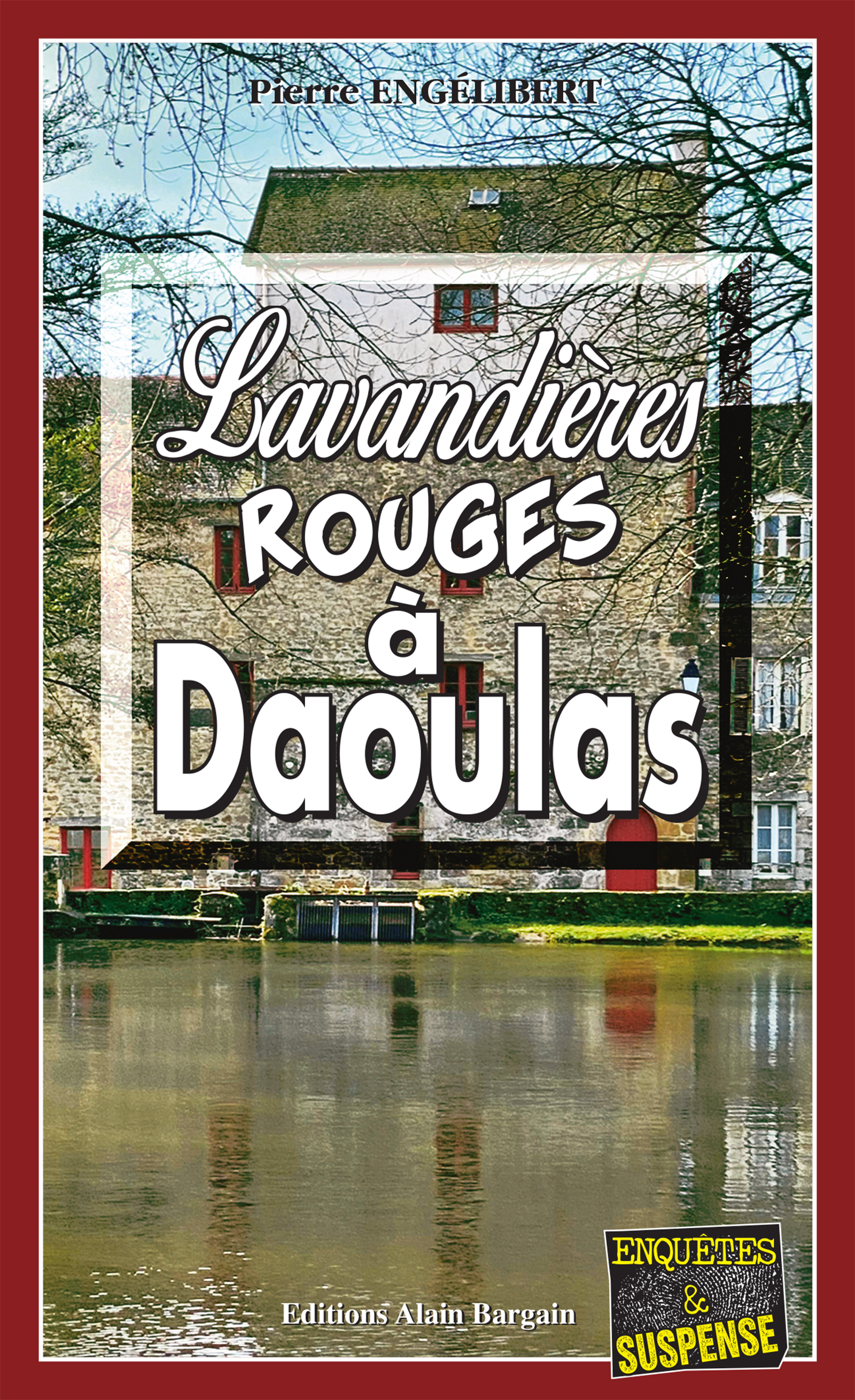
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Enor Berigman
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Le commissaire Enor Berigman fonce tout droit vers les dangers tandis qu'il enquête sur les mystérieuses Lavandières rouges et sur les meurtres qui se succèdent...
Un homme est retrouvé noyé, enfermé dans un tonneau, au fond du port de commerce de Brest. Une lettre de revendication du meurtre, signée de mystérieuses « Lavandières de la nuit », est rapidement adressée à une revue féministe, Azenor. Trois jours plus tard, un pharmacien de la ville est assassiné dans son officine. Sur place, la police écarte très vite la thèse d’un crime crapuleux. Le modus operandi du meurtre et la suite immédiate des évènements sont la marque d’un professionnel. Au fil des découvertes, alors que les morts se succèdent, de Daoulas à Dirinon en passant par Logonna-Daoulas, les deux enquêtes enchevêtrent légendes bretonnes et scandale international, et se fondent soudainement en un crescendo d’horreurs. Il n’en faut pas plus pour que le commissaire Enor Berigman se retrouve sur la sellette alors que la tension monte de plus en plus dans un Brest en ébullition et que le danger se referme sur son équipe…
Retrouvez le commissaire et son équipe dans ce polar breton à glacer le sang.
EXTRAIT
22 novembre 1988 – Cimetière de Landerneau
La vague de froid qui sévit dans le sud et l’est de la France n’atteint pas la Bretagne. Elle n’en a pas besoin, la froidure intérieure qui a envahi mon esprit va bien au-delà, elle est de l’ordre de celle du vide dans l’espace intersidéral. Ma fille a été tuée. Elle avait 36 ans. Une issue prévisible, contre laquelle toutes les actions se sont heurtées à un mur, celui de l’inertie et de l’impuissance. Pourtant, cinq ans après, elle commençait à surmonter le drame du “poste Drakkar” à Beyrouth, quand son frère, sergent au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, a succombé après une agonie de plusieurs jours, comme des dizaines de ses camarades. Sa présence a sans doute cruellement manqué pour qu’elle puisse s’échapper de son enfer. Il n’y a pas de remède à ces deux disparitions, aucune douleur n’est comparable. Celui qui l’a martyrisée est en détention préventive, en attente de son procès. Je ne veux même plus prononcer son nom, il m’a volé la chair de ma chair. Son jugement est ma dernière attente dans cette vie, attente de justice, pas de compréhension. Il ne me reste que les centaines de souvenirs qui resurgissent à la vue d’une photo, d’un objet, d’un lieu ou d’une odeur. Certains restent flous ou fugaces, ils réapparaissent parfois sans prévenir, d’autres sont bien vivaces et je sais que je n’oublierai jamais les moments les plus heureux, pas plus que les périodes les plus douloureuses. Ses premières coupes de tennis, la mort de son père et tant d’autres images encore.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Professeur des écoles pendant plus de trente ans au Faou, maire honoraire de la ville,
Pierre Engélibert a profité de son départ à la retraite pour se remettre à l’écriture. Il est membre du collectif d’auteurs “L’Assassin Habite Dans Le 29 ”.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
À Danielle, mon épouse depuis plus de quarante ans, qui m’a suggéré un jour de construire une histoire autour de légendes bretonnes et sans qui celle-ci n’aurait pas vu le jour.
I
22 novembre 1988 – Cimetière de Landerneau
La vague de froid qui sévit dans le sud et l’est de la France n’atteint pas la Bretagne. Elle n’en a pas besoin, la froidure intérieure qui a envahi mon esprit va bien au-delà, elle est de l’ordre de celle du vide dans l’espace intersidéral. Ma fille a été tuée. Elle avait 36 ans. Une issue prévisible, contre laquelle toutes les actions se sont heurtées à un mur, celui de l’inertie et de l’impuissance. Pourtant, cinq ans après, elle commençait à surmonter le drame du “poste Drakkar” à Beyrouth, quand son frère, sergent au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, a succombé après une agonie de plusieurs jours, comme des dizaines de ses camarades. Sa présence a sans doute cruellement manqué pour qu’elle puisse s’échapper de son enfer. Il n’y a pas de remède à ces deux disparitions, aucune douleur n’est comparable. Celui qui l’a martyrisée est en détention préventive, en attente de son procès. Je ne veux même plus prononcer son nom, il m’a volé la chair de ma chair. Son jugement est ma dernière attente dans cette vie, attente de justice, pas de compréhension. Il ne me reste que les centaines de souvenirs qui resurgissent à la vue d’une photo, d’un objet, d’un lieu ou d’une odeur. Certains restent flous ou fugaces, ils réapparaissent parfois sans prévenir, d’autres sont bien vivaces et je sais que je n’oublierai jamais les moments les plus heureux, pas plus que les périodes les plus douloureuses. Ses premières coupes de tennis, la mort de son père et tant d’autres images encore.
Le cimetière est pratiquement désert en cette fin de matinée d’automne. Une dame âgée arrose des pots deux rangées plus loin, je distingue plusieurs noms sur la pierre tombale qu’elle nettoyait quelques minutes plus tôt en frottant avec application la pierre ternie avec une éponge humide qu’elle rinçait doucement dans un seau d’eau près d’elle. Un peu plus loin à droite un jeune couple d’une trentaine d’années dépose un bouquet de roses jaunes dans un vase en métal près d’un cadre contenant deux photos. C’est tout. Le silence est total, à peine troublé par des bruits intermittents de voitures du côté de l’allée verte où je me suis garée et où j’avais été accueillie par quelques gloussements de poules au fond d’un jardin. Mais ici même les choucas respectent la tranquillité des lieux, guère inquiets de la présence du chat de gouttière qui fait sa toilette à quelques mètres d’eux en plein milieu de l’allée centrale. L’endroit est reposant, hors du monde, il fige une courte période de pause entre deux désordres de ma vie. Elle suspend le dernier et annonce le suivant. Les musiciens disent que les silences aussi appartiennent de plein effet à la partition, car il est une musique pour qui sait l’entendre, il est le souffle contenu de la mélodie. Mais pour moi aujourd’hui il ne prélude à rien, il clôt. Le soupir est devenu éternel, la note noire qu’il remplace est devenue ma couleur d’avenir.
Je regarde tous ces visages défaits autour de moi. Beaucoup me sont familiers, d’autres me sont inconnus. Qu’expriment-ils ? L’effroi ? Le désarroi ? La colère ? La tristesse ? Un peu de tout cela, mais plusieurs d’entre eux laissent poindre derrière leur dureté des marques de culpabilité et de honte par une ride trop accentuée ou un regard vers elle trop fuyant mais qui ne peut s’en détacher. Elle est là et ne comprend pas. Pourquoi n’ont-ils rien fait ? m’ont demandé ces yeux tous ces derniers soirs, quand elle se couchait puis pleurait silencieusement dans la pénombre. Tandis qu’elle était agenouillée, mes mains s’emparaient des siennes. Je ne sais que répondre, car c’est vrai, s’ils avaient agi tout de suite cela l’aurait sûrement sauvée. Eux tous, les proches, les amis, les policiers, les médecins et les services sociaux. Et moi-même, si absente. J’étais trop loin, à Truro, de l’autre côté de la mer, pour estimer suffisamment correctement la situation malgré mes alarmes et mes interventions. Je me suis même déplacée plus d’une fois, sans entrevoir le pire. En vain. Je suis rentrée chaque fois en pensant que le relais était assuré, que la surveillance suffirait à empêcher la fatalité de se produire. Comment un tel aveuglement est-il possible ? Comme si l’on pouvait endiguer le mal ! Grave erreur dont nous ne sommes pas les uniques responsables. Car même si seule l’infirmière des urgences a essayé de l’orienter vers une association de secours, même si celle-ci est allée avec insistance jusqu’à la contacter chez elle, ma fille n’était pas encore prête à couper les ponts, toujours persuadée que les choses allaient s’arranger, toujours sous son emprise. Elle n’a pas vu l’entreprise de destruction à l’œuvre, n’a pas saisi la montée en gravité de la spirale des troubles émotionnels et cognitifs qui ont engendré sa dépression ni déchiffré les atteintes psychosomatiques, les troubles de la digestion, les céphalées chroniques ou les oppressions respiratoires. Sans parler des altérations du sommeil, des pertes de mémoire ou d’attention. Comment pouvait-elle encore parler d’incidents isolés, comme pour se rassurer, comme si son agresseur était encore son partenaire, alors que devant l’aggravation des symptômes tout hurlait en elle que c’était faux. Elle n’aurait pu survivre que si elle avait d’abord admis qu’elle n’était coupable de rien. Mais comment aurait-ce été possible dans l’amenuisement progressif de ses activités sociales et en l’absence d’appuis extérieurs ? Pas même celui de son médecin, qui semble être passé à côté de l’horreur. Sans doute a-t-elle fait le choix de la protection de son enfant par peur de représailles, craignant pour la petite si elle se défendait. Elle se croyait piégée. Peut-être l’était-elle, après tout, quand on mesure l’impuissance qui fut la mienne malgré mes tentatives. Policiers et médecins furent sidérés, quand ce fut trop tard, par l’ampleur des cicatrices sur son corps. Des traces les plus anciennes aux plus récentes, la souffrance s’est inscrite en chaque blessure, chaque contusion, chaque hématome, mémoires d’un jeu de piste morbide. Les marques de strangulation et de brûlures toutes fraîches ont reculé les bornes de la sauvagerie qu’elle a subie dans l’enfer des menaces de mort. Jusqu’au jour où l’irréparable du geste final est arrivé.
Les coups ont commencé dès le début de sa grossesse, en mars 1978. Comme s’il ne l’avait pas acceptée, comme si elle était un danger pour son pouvoir, je devrais penser ses abus de pouvoir. Son narcissisme ne pouvait lui faire admettre qu’il n’ait peut-être plus toujours le dernier mot, qu’il devrait s’effacer devant le bébé. Brutalement sa jalousie pathologique envers ce bébé à naître s’est greffée sur celle, tout aussi maladive, envers les autres hommes. Les soupçons injustifiés s’alourdirent de fausses accusations d’adultère après la naissance. Les humiliations verbales, les reproches futiles, déjà répétitifs, sont devenus des violences physiques. Cela a duré toutes ces années, empreintes de manipulations qui ont semé le doute et la perte de confiance dans son esprit. Une perverse mise en œuvre de disqualification. On aurait dû le mettre hors d’état de nuire et la même question me hantera jusqu’à ma mort prochaine : qu’aurais-je dû faire de plus ? Et aujourd’hui, comment affronter le regard accusateur de ma petite-fille et comment ranimer mon âme dévastée ? D’ailleurs pourquoi le faire, ce malheur sans retour a éteint tout souffle vital en moi.
II
Vendredi 3 mai 2019 – Shwe Hla Min Restaurant, quartier sud de Taunggyi, capitale de l’État Shan au Myanmar en Birmanie
Prudent à son habitude, assis dos à un mur, le colonel Sai Aung Tun, en civil, ne s’était pas levé à mon arrivée. J’ai dû attendre quelques secondes qu’il m’invite de la main à m’asseoir en même temps qu’il faisait un discret signe de tête à la serveuse qui semblait guetter son ordre. Je repérai, deux tables plus loin, ses deux gardes du corps, aux yeux très mobiles, dégustant silencieusement leur soupe, et dont l’indifférence feinte ne pouvait tromper que les clients trop occupés à parler de tout et de rien, presque tous facilement reconnaissables : des étudiants de l’université toute proche, des clients du centre commercial d’à côté, des abonnés du golf club et quelques touristes sans doute de retour d’une visite de pagode, de monastère ou d’une excursion au lac Inle. J’aurais pu leur dire que les soupes, surtout la mohinga, étaient nettement meilleures au “Cherry May” à quelques centaines de mètres d’ici pour quelques kyats de plus, mais je n’étais pas là pour ça. Pourtant le choix du colonel m’étonnait un peu, ce n’était vraiment pas l’endroit idéal pour parler de choses sérieuses ou peut-être était-ce le meilleur, dans le brouhaha ambiant où personne ne faisait attention à nous. Quoique avec les étudiants, on ne sait jamais.
J’observai avec application mon vis-à-vis pendant qu’il passait commande d’un buffet birman accompagné de jus d’avocat. Cela faisait un an que je ne l’avais pas vu, il restait encore très svelte, tout en muscles, témoignage d’années d’entraînement continu. Ses yeux lumineux gouvernaient toujours son visage anguleux et carré sans une ride, dégageant encore, derrière son apparence aristocratique, une intense force intérieure. Quel âge pouvait-il bien avoir ? Sans doute bien plus de quarante-cinq ans. Son expression sereine, aimable, en avait trompé plus d’un. Car c’était un redoutable stratège et combattant, qui l’avait encore prouvé l’an passé lors de l’attaque du QG des rebelles de l’armée du nord de l’État Shan avec ses forces spéciales à Wan Hai, non loin de la frontière chinoise. Un des plus brillants officiers de la Tatmadaw, notre armée, qui finira général, cela ne fait pas de doute, s’il se maintient dans les bons clans. Bien qu’à moitié d’origine shan lui-même par sa mère, il détestait ceux qui voulaient transformer le pays en État fédéral intégral depuis des décennies. Comme moi, qui suis pourtant karen. Maintenant que l’insurrection communiste était liquidée, le danger des minorités ethniques et religieuses revenait au premier plan. Cela ne l’empêche pas de haïr toujours autant les Chinois.
Mais ce n’était pas pour cela que le colonel m’avait fait venir, il s’adressait toujours à moi pour la même raison : régler un différend délicat et sensible. J’intervenais en ultime recours, quand le destin était écrit, alors même que les cibles croyaient avoir encore des cartes en main. Elles ignorent notre code de loi. Ici, en affaires, on traite avec tout le monde, même avec ses ennemis, car la chaîne logistique requiert de nombreux acteurs unis par la même communauté d’intérêts commerciaux et financiers. Il suffit de trouver les bons intermédiaires, les garants en qui les parties concernées ont confiance, et le bon territoire qui deviendra la zone de trêve. Dans ces lieux sécurisés, la guerre est alors reléguée provisoirement au second plan. La réussite tient à la pérennité des interlocuteurs et à leur professionnalisme, mais elle est toujours au rendez-vous car le trafic de pierres précieuses ou de teck est extrêmement lucratif pour tous. Ainsi que celui qui est la raison pour laquelle le colonel a besoin de mes services, si j’ai bien compris. Ma présence ici est le signe que des téméraires ne respectent plus la règle, ou veulent la changer. Ces insensés ne savent pas, comme on dit chez nous, que « plus le coq hérisse ses plumes, plus il est facile de le plumer ».
Pendant le repas nous discutons de la situation militaire dans l’État Rakhine, où l’armée et les Arakanais “traitent” la question des Rohingyas. Le colonel est satisfait de l’attitude de la conseillère d’État, dont la maîtrise politique l’étonne, heureux que son prix Nobel ne l’ait pas orientée vers de mauvais choix. J’abonde dans son sens, tout en finissant mon curry et mon ngapi. Décidément le curry indien n’arrivera jamais à la hauteur du nôtre.
Lorsque la table est débarrassée, hormis le thé birman, le colonel sort de sa serviette au sol une grande enveloppe qu’il pose devant moi :
— Vous le savez, nous devons un service à nos amis de Delhi. Ils nous ont sollicités pour une affaire qui indirectement nous concerne aussi. Aussi nous sommes convenus d’envoyer quelqu’un de chez nous plutôt que de chez eux. Vous serez moins repérable, moins en lien évident pour Interpol, étant donné la nature de l’opération – il tapote de la main l’enveloppe – Comme d’habitude vous trouverez tous les renseignements là-dedans. Votre passeport est américain, vous partez lundi de Yangon pour Londres, en passant par Doha, par le vol de Qatar Airways. Vous y trouverez aussi les billets, vos cartes bancaires et toutes les adresses utiles. Vous aurez une épouse qui vous attendra à l’arrivée à Heathrow, elle vient de New York, donc pas de problème, c’est une Américaine authentique. Le reste du ravitaillement vous attendra à Paris.
Je savais ce qu’il voulait dire par là, il connaissait mes préférences.
— Bien, colonel, rien d’autre ?
— Non, sinon que je suis certain que vous formerez un beau couple.
Je prends l’enveloppe sans l’ouvrir, le laissant à son sourire. Alors que je me lève, il ajoute soudainement :
— Ah, si ! Comme il est noté, ne revenez pas sans la liste.
III
Vendredi 31 mai 2019, 8 h 45 – Port de commerce de Brest
Le brigadier Thierry Pouliquen ne regrette pas d’être de permanence en ce week-end de l’Ascension. Ces périodes de pont offrent toujours au commissariat et en ville une ambiance particulière, comme en suspens, qu’il apprécie, même si le calme trompeur et nonchalant des rues et des commerces la journée est habituellement déchiré en fin de soirée ou au petit matin par des drames familiaux ou de turbulentes sorties de bar ou de boîtes de nuit, la plupart du temps sous l’emprise de l’alcool, mais pas seulement. C’est à ces heures rituelles que les incidents et les nuisances faits d’agressions, de violences, de rackets et parfois d’homicides, tapis pendant la lumière policée du jour, émergent soudain bruyamment dans le clair-obscur des étoiles. Ces moments sont bien sûr les plus dangereux car on ne sait jamais sur quoi ou sur qui l’on va tomber lors d’un appel d’urgence. Il peut se cacher n’importe quoi derrière l’appellation “tapage nocturne”. Mais il se trouve que la nuit dernière a été tranquille, les rares appels n’ont concerné que des cas faciles à résoudre, le plus étonnant étant cet homme saoul qui, s’étant trompé d’étage, s’était affalé tout habillé sur le lit de la locataire du dessous qui, invitée par sa voisine de palier, avait commis l’imprudence de ne pas fermer sa porte à clé. Fatiguée, elle s’était déshabillée aussitôt dans la salle de bains en rentrant et l’avait trouvé dans la chambre, comprenant que le bruit qu’il lui avait semblé entendre n’était que ses ronflements, sans que le chat, confortablement installé dans son panier, en paraisse dérangé. Elle les avait aussitôt appelés et il avait fallu s’y mettre à trois pour lui faire réintégrer son appartement à l’étage au-dessus. Heureusement l’escalier était large. Ennuyée, la locataire avait décidé de ne pas porter plainte.
L’entrée du deuxième éperon du port de commerce, derrière l’immeuble du Grand Large, est barrée. Plusieurs véhicules de police et de gendarmerie maritime empêchent les accès à l’entrée. Seuls le camion technique de la brigade nautique de la gendarmerie venue de Roscoff et son propre véhicule de police sont garés à l’est de l’éperon, près du bord. L’endroit n’est guère fréquenté de jour, hormis par quelques professionnels, mais de nuit il doit être totalement désert. Suffisamment loin du quai de la douane, peu éclairé et sans aucun restaurant ni la moindre boutique dans cette zone de travail, on ne risque pas d’être dérangé. Le bateau pneumatique de la brigade de surveillance du littoral, un Sillinger, quadrille la zone, en quête d’un corps éventuel. La vedette côtière de surveillance maritime fait de même, un peu plus au large, tandis que les plongeurs de la brigade nautique sont à l’œuvre. L’adjudant-chef Patrice Cariou, qui dirige la brigade, est en contact régulier avec son chef d’escadron. Mais pour l’instant la recherche est vaine. Personne n’est sûr qu’il y ait un corps à trouver, le seul indice est la découverte du chien, très tôt ce matin, flottant à la surface de l’eau, une laisse attachée à son collier. L’étrangeté de ce fait avait justifié l’appel à la brigade plutôt qu’aux plongeurs des pompiers. L’animal s’est sans doute noyé, aucune trace de coup n’est visible et les goélands n’ont pas eu le temps de commencer leur besogne. Tout le monde attend, cela ne fait que trois quarts d’heure que les équipes sont opérationnelles.
Dans l’expectative, Pouliquen craint le pire. Il ne voit guère pour quelle raison un chien serait mort noyé à cet endroit. On a pu l’y jeter bien sûr, mais la présence de la laisse l’intrigue et ne cadre évidemment pas avec un chien errant que des inconnus peut-être avinés auraient voulu jeter à l’eau par jeu. Surtout dans cette zone abandonnée des fêtards. Mais il a déjà vu tant de choses ! Alors rien n’est impossible.
Les minutes défilent et Thierry, qui regarde tristement un peu plus loin le cadavre du chien que des policiers emportent, laisse ses pensées vagabonder. Il n’aimerait pas trouver ainsi Zéphir, son adorable corniaud, âgé de neuf ans mais toujours aussi joueur avec sa fille Éléonore qui à cinq ans est devenue sa plus grande amie, parfois au grand agacement de son épouse Coralie devant les désordres que ces deux-là sont capables de mettre en quelques minutes dans la chambre de la petite.
L’un des plongeurs qui vient de remonter signale par geste qu’ils n’ont encore rien trouvé, avant de disparaître de nouveau. Il est vrai que la visibilité doit être pratiquement nulle au fond et que la zone est relativement étendue. Il est heureux qu’elle soit isolée, les curieux sont refoulés au loin, du côté du quai. Ce plongeur est une plongeuse, la maréchale des logis-chef Karine Piriou, célèbre dans toute la Bretagne pour ses performances sportives exceptionnelles dans son domaine et qui a remporté de nombreuses coupes en compétition, nationales et internationales. S’il y a une chose suspecte au fond, cadavre ou autre, son équipe et elle la dénicheront. Le grade de Karine lui rappelle que lui-même va passer l’unité de valeur 1, celle qui a trait à la manipulation des armes et aux techniques professionnelles, en vue d’être promu brigadier-chef. À condition qu’il réussisse ensuite l’unité 2, sur la gestion et le commandement. Il ne peut s’empêcher comme ses collègues de râler une fois de plus en pensée contre le fait que les sous-officiers doivent passer des examens pour progresser dans leur carrière tandis que les officiers évoluent à l’ancienneté, cherchez l’erreur !
Soudain une bouée parachute surgit à la surface à une quinzaine de mètres au large, un peu à gauche. Ils ont trouvé quelque chose. De nouveau un plongeur apparaît. Il ôte son masque et crie d’une voix forte :
— On a repéré un tonneau suspect au fond, on va l’ouvrir !
Puis il se rééquipe, prend les outils qu’on lui tend et replonge. Dix minutes plus tard il refait surface et hèle les hommes sur le quai :
— Il y a un corps dans le tonneau ! Homicide !
Ces plongeurs sont des plongeurs-enquêteurs de la gendarmerie, officiers de police judiciaire, techniciens en identification subaquatique formés au centre national d’Antibes, l’équivalent des personnels de la police technique et scientifique pour les terriens. Pouliquen sait qu’ils sont maintenant occupés à baliser les lieux avec des cônes numérotés, à tracer un dessin de la scène et à filmer et prendre des photos du moindre indice en même temps que des mesures de distance sont saisies et des prélèvements effectués. Un travail de routine, mais dans un milieu spécial, qui débouche de la même façon sur des éléments de constatation et des pièces de procédure contrôlées par le responsable, indispensables pour la bonne suite de l’enquête s’il doit y avoir un procès un jour afin qu’un avocat ne démolisse pas le dossier d’accusation sur un vice de forme. Ils ont bien fait de faire appel à eux. Ne doutant pas de leur diagnostic, il appelle le commandant Françoise Ridel, officier de permanence ce week-end à l’antenne de Brest du SRPJ.
IV
Samedi 1er juin 2019, 17 h 30 – Île de Bréhat
Dans le bac qui le ramène en quelques minutes à l’embarcadère de la pointe de l’Arcouest avec sa compagne Mariannig, le commissaire Enor Berigman repense une dernière fois aux trois jours qu’ils viennent de passer sur l’île à l’invitation de Corinne Delourme, collègue d’université de Mariannig, professeur de philosophie comme elle mais sur le site de Rennes 1. Elles se sont connues quelques années auparavant au cours d’un détachement à l’université de Liège et sont rapidement devenues très amies. Corinne est une spécialiste de Michel Foucault et Mariannig de Sartre. Bizarrement, faisant partie de la même université et travaillant dans des domaines de philosophie contemporaine très proches et aux multiples connexions, elles ne s’étaient jamais rencontrées. Tout au plus avaient-elles eu quelques contacts par Internet.
Corinne possède, avec ses sœurs et son frère, une maison de famille dans la partie nord de l’île. Son mari, Paul Delourme, originaire de Paimpol, est avocat spécialisé en droit social, droit immobilier, droit des victimes et contentieux à Rennes. Malgré les appréhensions d’Enor, les avocats n’étant pas toujours les meilleurs amis des policiers, les trois jours furent très agréables et leurs hôtes se montrèrent aux petits soins pour leur faire visiter non seulement l’île qu’ils ne connaissaient pas et dont ils découvrirent la grande variété des paysages et du patrimoine, mais, grâce à un petit canot à moteur, quelques îlots alentour. Le charme n’avait pas été rompu lors de la découverte des ruines de l’île Lavrec, ruines d’un ancien monastère qui aurait été fondé au Ve ou VIe siècle par saint Budoc, arrivé là selon la légende dans une auge en pierre depuis l’Irlande. Un “curragh” irlandais, peut-être ? ajoutent les passionnés d’histoire locale. Paul lui avait expliqué qu’étant jeune, lui-même avait sillonné tous ces lieux avec son père en périssoire, un petit canot monoplace traditionnel de trois à quatre mètres, anguleux, à fond plat étroit et instable. Mais quand il se rendit compte de la dangerosité des récifs et de la violence des courants entre tous ces îlots, courageux mais pas téméraire, Enor avait été heureux d’être en canot à moteur. À l’invitation de Mariannig, ils avaient passé la dernière soirée au restaurant de l’hôtel Belle Vue, sur le port, autour d’un plateau de fruits de mer géant, permettant une longue parenthèse dans les discussions philosophiques et universitaires des deux femmes. Dans le silence nocturne de l’après-dîner, car il n’y a pas de voitures sur l’île, la promenade de retour vers la villa, digestive, n’avait pas été superflue. Dans la journée ils avaient aussi fait un tour à la verrerie aujourd’hui mondialement connue qui s’est installée dans les murs de la vieille citadelle du Second Empire depuis une vingtaine d’années et ils purent notamment y admirer leurs célèbres boules d’escalier qui équipent bien des palaces. Leur choix, bien plus modeste, s’était porté sur une boule à fond plat emprisonnant une méduse à l’ombrelle bleue et aux tentacules jaunes. Bref les deux couples avaient sympathisé durant cette escapade reposante et c’est sur la promesse de nouvelles rencontres qu’ils se quittèrent, Mariannig et lui ayant refusé toutefois que leurs hôtes les raccompagnent sur le continent en canot puisqu’ils avaient leur billet retour par le bac.
Maintenant, la tête agréablement caressée par le vent, il songe à la nouvelle enquête qui l’attend. Françoise l’a appelé la veille en fin d’après-midi pour lui annoncer la découverte d’un corps au fond de l’eau au port de commerce. S’il arrive parfois de retrouver des noyés dans les ports de France ou d’ailleurs, il s’agit presque toujours de noyades accidentelles, parfois de suicides, mais dans le cas présent les circonstances du décès étaient extraordinaires, dans le sens fort de ce mot, ôtant tout doute sur la nature criminelle des faits. Il n’a encore jamais vu ça ! L’homme, dont l’identité reste à établir, gisait au fond de l’eau enfermé dans un tonneau percé intentionnellement en plusieurs endroits pour qu’il coule rapidement. Il y a une heure, Yves Cardic, le légiste, lui a confirmé au téléphone la mort par noyade dans la nuit de jeudi à vendredi mais aussi la présence d’un traumatisme crânien dû à un violent coup porté à la tête. L’homme n’était pas mort quand il fut enfermé. Qu’il ait été agressé dans la nuit n’était pas une surprise car il aurait été impossible d’agir en plein jour à cet endroit-là. Selon toute vraisemblance, le tonneau a bien dû être jeté à l’eau au bout de l’éperon, son positionnement lors de sa découverte étant compatible avec les courants de marée, et l’importance des trous a dû l’envoyer très rapidement par le fond. Selon Yves, des analyses bactériennes confirmeront certainement cette observation car, Enor l’ignorait, on ne trouve pas les mêmes bactéries au fond de la mer selon les lieux et les sols. Françoise, qui avait assisté à l’autopsie, lui avait précisé que la tenue de l’homme, ou plutôt du jeune homme car il ne semblait pas avoir plus de trente ans, était faite de vêtements bon marché usés, et même déchirés. Son aspect physique était en résonance avec cette constatation : barbe et cheveux en mèches folles, corps peu entretenu pour ne pas dire plus, petites lésions multiples non soignées, denture gâtée, le tableau, renforcé par les examens du légiste sur l’état des organes internes révélé par l’autopsie qui avait eu lieu presque dans la foulée, était peu reluisant et dénotait un mode de vie précaire. Bref, tout indiquait l’un des nombreux squatters ou sans domicile fixe qui hantent les rues de Brest. La présence du chien, compatible avec cette hypothèse, suggère que le lieu de l’agression doit être assez proche de là, quelque part sur le port. Car l’animal avait dû suivre en courant le véhicule du tueur. Si c’était le cas, cela n’allait pas arranger pour autant les recherches, la piste sera difficile à remonter et la quête de témoins très aléatoire. Mais Enor se rassure un peu en espérant qu’il ne s’agisse pas d’une victime choisie au hasard et qu’un lien l’unisse à ses assassins. Les assassinats, c’est-à-dire les meurtres avec préméditation, sont plutôt rares voire inexistants dans les milieux marginaux. La mort survient parfois au cours d’une bagarre, par surprise, les protagonistes étant toujours sous influence de l’alcool, mais sûrement pas en utilisant un tonneau comme arme du crime. À moins d’y voir un symbole, ou une punition. Mais il n’imagine franchement pas un ou plusieurs SDF agir ainsi, car il se pose aussi la question d’une action collective, ou à tout le moins d’au minimum deux personnes. Un tonneau de cinq cents litres, même vide, ne se déplace pas comme ça ! Sortir du coffre d’une camionnette plusieurs dizaines de kilos augmentés du poids d’un homme n’est pas si simple même si ensuite on peut faire rouler le tonneau. Mais pourquoi donc se donner tant de mal ? ne peut-il s’empêcher de se demander. Quel est le message, si tant est qu’il y en ait un ? Françoise et les collègues devaient passer la journée à ratisser le port à la recherche de témoins et surtout des compagnons de galère de la victime pendant que les services techniques récoltaient tous les indices éventuels au bout de l’éperon. Un long travail de patience commençait. D’ailleurs c’est déjà la fin de la journée et il n’a aucune nouvelle, signe que l’enquête n’a pas progressé.
Mariannig le tire de ses rêveries pour lui montrer un oiseau qui disparaît déjà au loin, vers le large. Elle a cru reconnaître un macareux, ce qui est étonnant mais possible en cette saison dans ce secteur situé non loin de la Réserve des sept îles et plus particulièrement de l’île Rouzic, où niche une colonie de ces oiseaux, la dernière de France mais hélas menacée et en baisse depuis quelques années. Ils arrivent à l’embarcadère et rejoignent leur voiture au parking longue durée, puis ils prennent le chemin du retour, vers Toulbroc’h, à l’ouest de Brest, où les attend un autre paysage maritime, ouvert sur la rade.
V
Dimanche 2 juin 2019
Avant de rejoindre en milieu de matinée au SRPJ les membres de son équipe qui sont de service afin de faire le point, Enor fait un crochet par le port de commerce pour voir les lieux du crime, accompagné par la musique des Black Irish Band qui chantent, loin du banjo de Paul Clayton, une version très irlandaise de The banks of Sacramento. Il se gare sur le parking devant l’immeuble du Grand Large puis il longe l’éperon en marchant jusqu’à la pointe, endroit supposé d’où le tonneau a dû être jeté à l’eau. Il constate que même en matinée, il n’a croisé personne. Il est vrai que c’est dimanche et que les employés de l’immeuble, presque toutes des femmes, qui font souvent une pause cigarette au bas de l’escalier de secours extérieur sont absents. Il se dit qu’en pleine nuit en effet, il est certain qu’il n’y a aucun risque d’être dérangé, sauf coup de malchance comme le passage d’une patrouille de police plus loin sur le quai. Et encore ! C’est pourquoi trouver un témoin sera presque mission impossible. L’idée lui revient d’un meurtre collectif, deux personnes pour s’occuper du tonneau et peut-être une pour faire le guet au niveau du quai. Mais cette idée le tracasse quant à sa signification : meurtre prémédité ou équipée sauvage à la recherche d’une victime choisie au hasard ? Ce dernier point ne colle pas avec l’utilisation d’un tonneau comme arme du crime. Mais alors pourquoi un groupe inconnu s’en prendrait-il précisément à un jeune zonard comme il y en a des dizaines dans les villes de France ? Il comprend qu’à ce stade il est arrivé au bout de toute spéculation raisonnable. « Les faits, rien que les faits », lui dirait son mentor le commissaire à la retraite Le Rouzic, « tenez-vous-en à ça » et il ajoutait souvent la formule sibylline « la vache broute lentement, mais la terre est patiente ». Le sens du proverbe lui restait obscur, mais il croyait comprendre que la vache symbolisait l’enquêteur, était-ce un trait d’humour sur le rapport entre flic et vache, et la terre le substrat de l’enquête. En rejoignant le SRPJ, Enor pense au brigadier Pouliquen qui sera présent également. Le commissaire avait aimé travailler avec lui lors d’une précédente affaire car non seulement il avait su s’intégrer parfaitement au groupe tout en n’en faisant statutairement pas partie mais il avait fait preuve d’initiative et de rigueur, qualités indispensables pour tout enquêteur. À son arrivée, il trouve Françoise, le commandant Françoise Ridel, devant la toute nouvelle machine à café installée depuis quelques jours après des années de demandes répétées. C’est une belle brune d’une cinquantaine d’années, d’origine dieppoise, qui seconde efficacement Enor. Seconder n’est pas forcément le terme adéquat car Enor ne s’embarrasse pas de hiérarchie dans l’équipe, mais plutôt de responsabilité, la sienne étant d’orienter, de diriger, de distribuer les tâches et de trancher en cas de nécessité, mais avant d’en arriver là, la parole est libre et égale d’où qu’elle vienne car il a pleinement confiance en chacun des policiers de son groupe. Que personne ne soit bridé dans son expression, sans être jugé, est pour lui un gage d’efficacité et l’assurance d’une vitalité solidaire des membres. De fait, aucun conflit ni aucune compétition ne vient troubler le bon fonctionnement du service ni le déroulement technique des enquêtes. D’ailleurs il ne l’admettrait pas, mais le secret était tout simplement de ne jamais laisser poindre la moindre discordance. Prévenir et non guérir, selon le vieil adage.
Après quelques échanges anodins sur l’île de Bréhat, ils se dirigent tous deux vers la salle Magdelain, leur salle de réunion, où sont déjà installés Pouliquen et le lieutenant Denis Bauzin. Ce dernier, un grand blond aux cheveux courts, véliplanchiste accompli, devrait passer capitaine dans l’année. Enor commence, aussitôt les salutations faites :
— Alors, où en est-on ?
— Je laisse commencer Thierry puisqu’il était le premier sur les lieux, dit Françoise, puis je compléterai si c’est nécessaire. Je précise juste que la procureure a immédiatement ouvert une enquête préliminaire en lien avec le divisionnaire et moi-même.
Pouliquen fait ensuite un rapide résumé de la découverte du corps, durant lequel Enor n’apprend que deux faits nouveaux pour lui : l’homme qui a appelé le commissariat était un pêcheur et l’appel fut enregistré à 8 h 13.
Le brigadier précise ensuite :
— Le témoin s’appelle Matthieu Rannou, 66 ans, retraité de la marine, marié, deux grands enfants qui ne vivent plus en Bretagne. Il est connu dans le secteur, il vient pêcher là depuis des années, l’endroit est calme et n’est pas mauvais apparemment. Il habite cité d’Antin, côté rue Voltaire, un appartement au deuxième étage. Nous n’avons rien sur lui, il n’a jamais fait parler de lui. Je crois qu’il n’a rien à voir avec le mort et qu’on peut le laisser de côté.
Enor a un léger hochement de tête :
— Peut-être mais vous lui avez demandé s’il avait déjà vu des sans-abri dans son secteur de pêche ? S’il est un habitué des lieux il a pu voir quelque chose, une dispute dans un groupe par exemple.
— Oui, nous l’avons interrogé à ce propos mais la réponse est négative. Il vient surtout le matin, il y retrouve d’ailleurs souvent d’autres passionnés de la canne à pêche. Il arrive parfois qu’ils aillent ensuite prendre en fin de matinée un apéro dans un des bars du secteur, généralement le “Bar des Mouettes”, un bar-tabac sur le quai, où ils ont leurs habitudes. C’est près des viviers. À son avis les sans-abri sont plutôt un peu plus haut, du côté de la gare ou alors en bas de Siam, ce que je confirme, mais alors on n’est plus sur le port.
Françoise et Enor approuvent. Ils connaissent ces lieux de fréquentation, qui ne sont d’ailleurs pas les seuls à Brest. Les districts de Jaurès, de Guérin ou de quelques squares sont également des points de ralliement parmi d’autres. Pouliquen continue :
— Mais bon, comme il le dit, il n’est jamais sur le port en soirée alors il est possible qu’il traîne quand même un groupe ou deux avec leurs chiens par endroits. Certains se déplacent, même s’ils restent fidèles à une zone, notamment pour passer la nuit. Ils ont leurs territoires, je suppose. Personnellement je n’ai pas souvenir de groupes particuliers par là.
— Vérifiez cela auprès des restaurateurs du quartier, d’accord ? demande Enor.
— Oui, on va s’y mettre. Enfin voilà, la suite vous la connaissez ! Mais j’aurais tendance à penser que l’individu était isolé de son groupe au moment de l’agression, ce qui paraît logique.
Françoise reprend alors la parole :
— Oui c’est possible et cela ne fait que renforcer l’idée de la préméditation.
— Tu veux dire qu’on l’aurait attiré dans un piège plutôt que choisi au hasard ? lui demande Denis avec un froncement de sourcils.
— Oui, exactement, tout l’indique car pour un meurtre gratuit le tonneau ne s’imposait pas. Nous avons deux problèmes. Le premier, le plus urgent, c’est de découvrir l’identité de la victime.
— Et le deuxième ? interroge Pouliquen.
— Essayer de comprendre la symbolique du tonneau, glisse-t-elle dans un sourire.
— Ah oui, bien sûr, s’il y en a une… – il réfléchit une seconde et poursuit –, il faut que je vérifie quelque chose au commissariat à propos des SDF, il me semble que j’ai vu passer une note il y a quelques jours.
Enor ne réagit pas à cette dernière remarque mais revient sur le propos de Françoise, dont il partage le sens :
— Oui, je crois qu’il y en a une, mais je ne vois pas laquelle – il fait une grimace –, pourtant cette histoire de tonneau me rappelle quelque chose, mais je n’arrive pas à retrouver quoi.
— Cela te reviendra sans y penser, assure-t-elle. Il n’y a pas grand-chose à ajouter quant aux faits. Aucune trace de véhicule n’a été retrouvée sur les lieux mais il semble, sans que ce soit certain, qu’une légère marque au sol, une entaille, pourrait provenir du cerclage du tonneau. Les services techniques doivent le contrôler dès demain quand ils auront fini leurs prélèvements. Ils s’occupent également de déterminer les origines et la fonction du tonneau.
— D’accord, et les alentours ? demande Enor.
Françoise hoche la tête négativement :
— Rien. Tout ce qui pouvait être ramassé a été embarqué pour analyse mais il y a peu d’espoir d’avoir un indice important. La plupart des objets trouvés, mégots, papiers ou autres étaient certainement là depuis des jours. Et ça ne représente pas une grande quantité. Assez étonnamment, le lieu, bien qu’isolé, était plutôt propre. Je crois bien qu’il ne faut pas trop compter non plus sur des éléments sous-marins. Les plongeurs de la gendarmerie n’ont a priori rien trouvé mais les analyses sont en cours.
Enor soupire :
— Dommage ! Résumons : pas d’indices, pas de témoins, pas d’identité de la victime ! Il est rare de commencer une enquête aussi démunis. Ah si ! Il nous reste le tonneau !
— Et le chien ! complète Denis. Ne l’oublions pas !
— Oui, tu as raison, le chien. C’est peut-être grâce à lui qu’on pourra mettre un nom sur notre noyé. Alors voici le programme : Aela, Ronan et toi, avec Thierry et ses hommes, dès demain matin vous prospecterez tous les commerces de ce secteur du port. Procure-toi des photos de la victime et du chien et vous interrogez tout le monde, on peut espérer un témoignage. À certains moments de la journée, ces groupes de jeunes sans-abri ne sont pas toujours discrets et ils ont pu se faire remarquer. Le but est d’en retrouver au moins un, alors soyez attentifs à la moindre originalité qui pourra nous aider à lui mettre la main dessus.
— Mais demain, c’est lundi, il y aura certainement pas mal de commerces fermés, observe Denis.
— Oui, c’est possible mais sans doute pas les restaurants – Enor se tourne vers Françoise –, peux-tu rechercher si on trouve trace de crimes similaires dans la région ? Ou dans tout le pays si tu ne trouves rien ? N’hésite pas non plus à remonter dans le passé, enfin tu connais la musique. Quant à moi je vais essayer d’avoir des éclaircissements sur l’usage des tonneaux dans la région et leur origine de fabrication.
— Oui, commente Denis, par ici, à part le cidre et la bière, il faut sans doute courir jusqu’à la région nantaise pour le vin.
Mais Françoise émet une moue sceptique :
— Il est surtout probable qu’il s’agisse d’un tonneau acheté d’occasion, ce qui ne simplifie pas les recherches.
— En effet, c’est l’hypothèse la plus vraisemblable, admet Enor, mais nous ne devons rien négliger. Quelqu’un s’est donné du mal pour accomplir ce meurtre dans ces conditions et j’aimerais bien qu’on comprenne vite pourquoi.
Enor se dit qu’ils ont fait le tour des premières tâches à accomplir et s’apprête à lever la séance lorsqu’il pense à quelque chose :
— Denis, je vais contacter le divisionnaire et la procureure pour les informer mais je vais surtout leur suggérer d’envoyer une photo de la victime à la presse dès demain après-midi si on n’a rien de nouveau. Alors fais un nombre suffisant de tirages de son portrait, d’accord ?
— Oui, Patron.
— Bien, je crois que ça suffit pour le moment. On se retrouve donc demain à quatorze heures ici même.
Quelques minutes plus tard, après les deux coups de fil passés à Guylaine Essart, la procureure, et à Peyret, le divisionnaire, Enor remonte tranquillement en voiture la rue de la Porte puis il rattrape la route de la Corniche par la rue Saint-Exupéry, au son de The wanderer, interprété par Dion and the Belmonts. Comme dans la version de Richard Anthony, Le Vagabond, il sourit en pensant aux paroles qui soulèveraient aujourd’hui, non sans justes arguments, un tollé féministe sur les réseaux sociaux. Son vagabond à lui gisait au fond de l’eau et il avait été frappé par la différence d’approche de ses deux interlocuteurs : là où Guylaine Essart réagissait comme pour tout assassinat indépendamment de la personnalité de la victime, Peyret n’y avait vu que le décès d’un SDF anonyme dont la mort n’allait sûrement pas troubler ses nuits ni l’enquête perturber sa carrière. Quoique, à bien y réfléchir, s’était repris le divisionnaire, les conditions “particulières” de cette mort allaient attirer toute la presse en quête de sensationnel. Il valait mieux, “finalement”, et ce dernier mot trahissait toute la sécheresse de Peyret, trouver le coupable au plus vite. Il n’y avait rien qu’il ne craignait plus que la presse.
Lorsqu’il arrive à sa maison de Toulbroc’h, Enor se dit qu’il va bien profiter de cet après-midi avec Mariannig et sa grande fille Alexine. Car il ne sait pas quand sera son prochain temps libre ; un mauvais pressentiment l’assaille depuis la veille.
VI
Lundi 3 juin 2019, 8 h 30
C’est un Enor ragaillardi par la soirée de la veille qui arrive dans les bureaux du SRPJ. La conversation entre Alexine, Mariannig et lui l’avait ramené des années en arrière, lorsqu’il avait parcouru l’Angleterre et l’Écosse en stop. Il venait d’avoir dix-huit ans à peine, c’étaient les dernières années où l’on voyait encore beaucoup de stoppeurs et les rencontres amicales, parfois étonnantes, étaient encore la règle. Il se souvenait de la facilité immédiate des rapports avec toutes sortes de routards, comme ces soldats américains basés en Allemagne qui visitaient l’Europe ainsi. Mais 2019 n’est pas 1988, les routes sont plus dangereuses, les automobilistes eux-mêmes plus méfiants et les auto-stoppeurs de longue distance se sont raréfiés. Aussi fut-il rassuré qu’Alexine parle plutôt d’un voyage en voiture en juillet avec son copain Erik – Erik avec un “k” lui avait précisé Alexine quelques mois plus tôt car son père était suédois –, sa grande amie Aliona et le copain de celle-ci, Alan. Les deux garçons avaient leur permis, les deux filles envisageaient de le passer après les vacances dans la ville où se poursuivraient leurs études après les classes préparatoires. Alexine espérait qu’en ce qui la concernait ce serait à Lille si elle était admise en troisième année de licence à l’académie de préparation au concours de l’École supérieure de journalisme. Elle s’était inscrite dès l’ouverture du site en février. Pour les vacances, le choix de l’Écosse était entre autres motivé par l’envie de voir ses grands-parents à Inverness et de faire découvrir le pays à ses amis, mais aussi, pensait-il peu charitablement, par la possibilité d’avoir un point de chute de quelques jours qui ne leur coûterait pratiquement rien. Il comprenait ça ! D’ailleurs les parents de Mariannig, Kirstin et Guy, étaient venus à Toulbroc’h l’été précédent, ce n’était pas comme si elle ne les avait pas vus depuis des années ! Mais ils seraient évidemment très heureux de les recevoir et Mariannig et lui-même avaient aussi l’intention d’y retourner en août. Affaire à suivre…
Sitôt installé dans son bureau, il commence les recherches sur les tonneaux. Beaucoup de sites internet lui en proposent des neufs, en majorité des fabricants de Bourgogne, ce qui lui semble logique. Mais très vite, entre sites de vente pour du neuf et sites d’occasion, il se demande s’il ne fait pas fausse route ou s’il ne se disperse pas trop alors qu’il n’a encore rien reçu des services techniques sur la nature et la destination de l’objet. Il comprend vite qu’il est prématuré de faire cette recherche, il ne sait même pas s’il y a un logo d’origine sur ce tonneau qui pourrait en retracer l’origine, ce qui éviterait pourtant une grande perte de temps. Mais il n’est pas naïf : il est impossible que le problème soit si simple, leur assassin ne peut avoir commis une telle erreur qui permettrait peut-être de remonter jusqu’à lui. De ce côté-là, les premiers résultats ne viendront sûrement pas avant la fin de matinée. Il décide de laisser tomber provisoirement, s’égarant quelques secondes sur l’invraisemblable performance pour la première fois d’une dénommée Anna Edson Taylor qui, le 24 octobre 1901, jour de son anniversaire, s’était lancée enfermée dans un tonneau dans les chutes du Niagara et en était ressortie vivante. Elle avait pris la précaution un peu douteuse aux yeux du policier d’essayer avec son chat deux jours avant ! Heureusement il avait survécu.
La sonnerie du téléphone le tire de sa rêverie :
— Oui ?
C’est le standard :
— Commissaire, je vous passe le sous-brigadier Mercier.
Enor ne le connaît pas, l’homme vient juste d’être muté à Brest.
Après un léger grésillement, il entend une voix décidée :
— Commissaire Berigman ?
— Moi-même.
— Mes respects, Monsieur le commissaire. Ici le sous-brigadier Pascal Mercier. Je vous appelle de la pharmacie de la Poudre, rue du Moulin à Poudre, presque à l’angle de la rue Auguste-Kervern, vous voyez le secteur ?
— Oui, tout à fait. Que se passe-t-il ?
— Eh bien, normalement la pharmacie est fermée le lundi matin. Mais un habitant de la rue qui allait prendre le bus un peu plus bas s’est étonné que la porte soit entrebâillée, sans voir le moindre éclairage électrique, alors il a ouvert en demandant s’il y avait quelqu’un mais en même temps, comme son champ de vision s’était agrandi, il a aperçu deux jambes qui dépassaient au sol derrière un présentoir. Il s’est approché et a reconnu, il est client de l’officine, le pharmacien dans une mare de sang. Il nous a appelés aussitôt, peu avant huit heures, et nous sommes arrivés le plus vite possible. Mais il était inutile d’insister, l’homme était mort depuis un certain temps. Nous avons juste fait le tour des lieux pour nous assurer que l’assassin n’était plus là car il me semble que le meurtre ne fait aucun doute.
Enor soupire :
— Vous n’avez touché à rien ?
— Non, on a fait attention à ne rien brouiller, on connaît la musique. J’ai quand même vérifié que la victime était bien décédée, c’est tout. Bref, je peux juste ajouter que le local n’a pas été dévasté, tout est nickel.
— OK, j’arrive tout de suite. Restez sur place et surtout retenez le témoin.
— On l’a prévenu qu’il devrait attendre, Commissaire, à tout de suite.
Enor raccroche et appelle aussitôt Yves Cardic, le légiste, puis Guylaine Essart, la procureure, en leur donnant rendez-vous sur les lieux. Au moment où il sort de son bureau, le capitaine Le Dévéhat débouche du fond du couloir, l’air un peu perdu :
— Ah, Aela, tu tombes bien, tu vas venir avec moi, on a un autre meurtre sur les bras. Tu ne devais pas être sur les quais pour la recherche de témoignages à propos de notre inconnu au tonneau ?
Tout en se dirigeant vers la sortie d’un pas rapide, elle répond :
— Si, mais je croyais que le rendez-vous était ici, j’ai mal compris.
— Bon, de toute façon, ils sont assez nombreux.
Ils montent dans une voiture de service banalisée et se dirigent rapidement vers la rue du Moulin à Poudre. Quelques minutes à peine suffisent pour arriver et se garer devant la pharmacie. Plusieurs gardiens de la paix tiennent les curieux à distance. Les deux policiers, après les avoir salués, s’engouffrent dans l’officine dont la façade vieillotte est au diapason de la vétusté de l’intérieur. Ils revêtent aussitôt une tenue de protection tendue par un technicien déjà sur les lieux. Près de la porte d’entrée, Enor remarque un homme assis sur une chaise. Le légiste n’étant pas encore arrivé, c’est le sous-brigadier, un homme à l’aspect athlétique mais sans signe particulier, qui les accueille et leur désigne le corps, effectivement partiellement caché, un peu plus loin au sol. Enor ne s’en approche qu’à peine pour ne pas contaminer la scène de crime, il distingue malgré tout des cheveux bruns courts et un visage de profil qui semble indiquer un individu d’une cinquantaine d’années environ, mais la blessure par balle à la nuque et les meurtrissures sur la joue ne facilitent pas l’estimation. Il note également des lésions importantes au genou droit, sans doute elles aussi le résultat d’une balle, ce qui l’intrigue beaucoup. En jetant un coup d’œil général autour de lui, il constate en effet que tout semble parfaitement en ordre. Rien ne suggère un cambriolage. Il entend soudain une voix qu’il reconnaît derrière lui et qui l’apostrophe :
— Alors, comme ça, comme tu étais absent à la découverte du dernier cadavre vendredi, tu t’es débrouillé pour en avoir un autre dès ton retour de week-end ?
Enor se retourne, aperçoit la grimace amusée d’Aela un peu plus loin, et rétorque à Yves Cardic :
— Qu’est-ce que tu veux, on ne se refait pas ! Mais je me serais bien passé de celui-là. Le mort du tonneau suffisait à mon malheur.
Cardic s’approche du corps, murmurant comme pour lui-même :
— Oui, mais je parierais que celui-ci va devenir très prioritaire. Entre un probable SDF et un pharmacien, si j’ai bien compris, les autorités auront à cœur de privilégier ce dernier, ça ne fait pas un pli.
Mais Enor secoue la tête :
— Pas si sûr. N’oublie pas les circonstances exceptionnelles du premier mort, on ne voit pas un tonneau tous les jours. Quant à lui, poursuit-il en désignant le cadavre au sol de la tête, il se peut qu’il ne s’agisse que d’une simple agression, une tentative de vol qui aura mal tourné. Quoique…
Comme Enor semble pensif, c’est Aela qui complète sa pensée tandis que le légiste se penche déjà vers le corps quelques mètres plus loin alors que les techniciens, tous présents maintenant, s’activent et examinent chaque recoin :
— Si c’était une agression de drogués, l’arme du crime aurait plutôt été un couteau, non ? Et puis il semble avoir été frappé, comme si l’assassin cherchait à obtenir quelque chose de lui.
— Oui, c’est exactement cela. Et la blessure au genou ne me plaît pas non plus. Une balle dans le genou avait un sens précis en Irlande à l’époque de l’IRA, et même jusqu’à la période des accords de paix en 1998, voire encore après.
— Lequel ?
— Briser les genoux était réservé aux mouchards avant leur exécution, puis aux dealers. C’était un signe de punition, et un message envoyé aux suivants. C’était d’ailleurs pratiqué dans les deux communautés. Les républicains réglaient leurs comptes entre eux, y compris dans le domaine de la délinquance car ils ne reconnaissaient pas la police d’Ulster qui était constituée en quasi-totalité d’unionistes protestants. Du moins c’était leur justification.
Alors qu’il aperçoit le sous-brigadier qui apparaît avec l’homme de la chaise, dont il suppose que c’est celui qui a découvert le corps, et qu’Aela et lui s’approchent, le chef des services techniques, Claude Guitton, surgit du fond de la pharmacie et l’interpelle :
— Enor !
Il fait signe à Pascal Mercier d’attendre et les deux policiers rejoignent Claude, contournant le photographe de la police :
— Salut, Claude. Alors, tu as trouvé quelque chose ?
— Oui et non. Rien pour le moment du côté des indices matériels, mais il ne fait guère de doute que quelqu’un a fouillé les bureaux. Tout a été déplacé, on le remarque bien à l’absence de poussière par endroits et à celle qui est sous certains dossiers. Même chose sur les étagères de la bibliothèque. De plus certaines boîtes ont été renversées et leur contenu mélangé dans les tiroirs. Je suis affirmatif, quelqu’un cherchait quelque chose, sans doute d’assez petit.
— De l’argent ?
Guitton hausse les épaules :
— Peut-être, ça pourrait correspondre mais par expérience je dirais qu’il reste trop d’ordre pour ça. À moins que l’assassin ne l’ait trouvé. À toi de voir.
Enor reste perplexe :
— Tout cela nous éloigne du cambriolage qui aurait dérapé. Bien, merci, Claude, je te laisse à la suite de ton travail. Puis il s’adresse à Aela : Allons voir notre témoin.
Ils se dirigent vers l’entrée où l’homme, un petit moustachu au visage encore un peu pâle et qui semble déjà porter sa quarantaine d’années comme un fardeau, est toujours assis. Peut-être sont-ce les circonstances, quelqu’un de normal ne découvre pas un cadavre sans réaction, se dit Enor qui se présente et demande aussitôt au témoin de lui raconter précisément ses gestes du matin. Mais ce dernier, qui se lève péniblement, n’a dans le fond pas grand-chose à dire et ne peut que répéter son premier témoignage : il n’a rien vu, rien entendu, et a juste été interloqué par la porte de la pharmacie entrouverte, une porte à l’ancienne et non une double porte d’entrée coulissante. D’ailleurs il était étrange que le rideau métallique ne soit pas baissé, peut-être était-ce cela qui l’avait inconsciemment amené à être plus attentif lors de son passage. Il n’a rien remarqué non plus dans la rue, personne ne courait sur le trottoir. L’heure de la mort n’est pas encore déterminée, mais Enor est convaincu qu’elle remonte à la nuit et non au matin. Les dix minutes suivantes passées à poser des questions associant différentes approches pour tenter de faire revenir un détail oublié n’amènent aucun élément nouveau. La seule information est que la victime avait une employée, une préparatrice d’une trentaine d’années dont le témoin ignorait le nom.