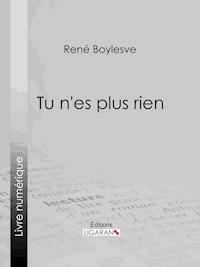
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "De l'évanouissement causé par une commotion si douloureuse et si brusque, son âme, seule, s'évada comme l'esprit échappe au cauchemar. On se félicite d'abord que le malaise soit terminé; l'impression de sécurité vous réconforte; et l'on se laisse alors replonger presque volontiers dans une demi-somnolence..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335095364
©Ligaran 2015
À LA MÉMOIRE
DE
MON FRÈRE
LE CAPITAINE PIERRE TARDIVEAU
TUÉ À L’ENNEMI DEVANT VERDUN
LE 7 JUILLET 1916
De l’évanouissement causé par une commotion si douloureuse et si brusque, son âme, seule, s’évada comme l’esprit échappe au cauchemar. On se félicite d’abord que le malaise soit terminé ; l’impression de sécurité vous réconforte ; et l’on se laisse alors replonger presque volontiers dans une demi-somnolence. On recommencerait l’épreuve, car on ne croit plus qu’elle corresponde à rien de réel.
Dormait-elle encore ? Était-ce sa mémoire, était-ce son imagination qui déroulait devant ses yeux des images déjà anciennes, que la songerie n’avait jamais évoquées jusqu’alors et qui soudain s’offraient avec une netteté irritante. Des chuchotements, un murmure de voix dans la pièce voisine, oui, elle les constatait, et, cependant, à ces colloques insolites, elle n’accordait pas son attention ; la pression douce et obstinée d’une main invisible refoulait sa pensée vers des jours écoulés.
Un pas feutré sur le tapis, un doigt qui lui interrogea le pouls, ne la troublèrent pas plus que la mélopée coutumière de la marchande des quatre-saisons. Elle ne se dit pas : « Comment ! je suis malade ?… on s’inquiète de moi ?… Et me voilà alitée, en plein jour, moi jeune et si étrangère à toutes les maladies !… » Mais elle se remémorait une certaine saison, de certains jours, presque lointains, des circonstances passées, une période de sa vie qui semblait être jouée sous ses yeux, comme un acte.
Un mois d’été de l’une des précédentes années. Elle revoyait la dernière journée dans leur pavillon, aux environs de Paris, devant le jardin en pente et la trouée dans les feuillages sur les lointains coteaux vaporeux et splendides… Chacun s’apprêtait à partir en vacances et quelques-uns de ces messieurs à accomplir une période d’instruction. Quels bavardages ! Quelles discussions avec les amis convoqués à la campagne pour cette après-midi d’adieux ! Ils formaient tous un monde jeune, alerte, ami des plaisirs et de toutes les beautés, aventureux, insouciant et charmant. Le plus âgé des hommes était M. de la Villaumer, dont les cheveux grisonnaient, mais qui ne se plaisait qu’au milieu des figures gracieuses. Plusieurs étaient artistes, musiciens ou peintres, fis aimaient le décor de la vie et la vie spirituelle, aisée, qui s’arrange en décor. L’amour régnait dans ces sociétés ; il y était plus facile que passionné ; on en avait à peu près supprimé les ravages. Les ménages excellents n’y étaient d’ailleurs pas rares. Odette Jacquelin et son mari étaient cités comme le couple le plus épris. Auprès d’eux, Clotilde et Georges Avvogade, qui roucoulaient comme des colombes, ne faisaient que des amoureux « pour lever de rideau », disait-on. Rose Misson, appelée la bonne Rose, Simone de Prans, Germaine Le Gault étaient toutes des femmes adorant leur mari, ne souhaitant pas d’autre bonheur et ne concevant pas autre chose que le bonheur.
Pourquoi Jean Jacquelin, se demandait-on, était-il officier de réserve ? À quoi rimait cette mascarade, tous les deux ans, d’un garçon qui n’avait de militaire ni la tradition, ni l’éducation, ni la foi ? Le vieux père y avait tenu, parce qu’il gardait de son temps des préjugés indéracinables. Quant à Jean, lui, il s’en moquait ; c’était un garçon parfaitement lancé pour gagner beaucoup d’argent, et offrir à Odette le luxe considéré, dans leur milieu, non comme un superflu, mais comme l’indispensable. Il ne concevait pas qu’un autre souci pût préoccuper sérieusement un esprit. Sans entrer dans les mille et une considérations de quelques-uns de ses amis, plus cultivés, qui raisonnaient, théorisaient, lui, il trouvait que l’uniforme de sous-lieutenant d’infanterie lui allait bien et que, lorsqu’il l’endossait, c’était une occasion pour lui de se dégourdir ; les fatigues physiques ne lui faisaient pas de mal ; il eût jugé volontiers les grandes manœuvres un exercice suranné ; il en souriait même ; il se plaisait à énumérer les bévues commises par tel ou tel chef ; mais qu’est-ce donc qui l’empêchait toujours de plaisanter la chose elle-même ? D’ailleurs, être officier de réserve, c’était peut-être une des innombrables bizarreries de la vie de société, mais c’était ce qu’on appelle une convenance ; dans un certain monde, cela se faisait. Il laissait là-dessus dire et pérorer ; il n’opposait pas un argument ; il demeurait officier de réserve, accomplissant, quand il était convoqué, sa période d’instruction.
Sa jeune femme l’avait accompagné, cette fois-là, jusqu’à Tours, pour être quelques heures de plus avec lui et pour avoir plus tôt ses dépêches les jours suivants. Que le temps lui paraissait long, toute seule, à l’Hôtel de l’Univers, dans une jolie chambre pourtant ! Elle s’amusait à piquer la curiosité, rue Nationale, avec son petit trotteur de la dernière coupe, son canotier si simple, tout à fait « Parisienne en vacances », et l’élégance à la fois originale et discrète qu’elle avait en toutes ses façons. Il était généralement convenu qu’elle était jolie. Dans la salle de restaurant, à l’hôtel, qui n’intriguait-elle pas ? Elle s’égayait à voir les voyageurs en famille inventer des prétextes pour changer de place, à leur petite table, les uns afin d’être assis en face d’elle, les autres afin que leur grand fils ne le fût pas. Et on la reluquait ! Arrivait un télégramme du sous-lieutenant : « Sois demain, chérie, à Port-de-Piles », ou bien : « Ligueil, tel jour pour déjeuner », ou bien : « À Loches, Hôtel de France, après la dislocation ». Et elle courait à ces rendez-vous, en auto de louage ou par le train. Et elle attendait longtemps parfois dans les auberges ou au bord des routes poussiéreuses.
Des conversations de table d’hôte lui revenaient. Chacun parlait des manœuvres. On discutait sur les noms des généraux, sur les communes occupées. La présence du Président de la République était un évènement dans le pays. Il y avait des vieillards qui ne consentaient pas à s’entretenir d’autre chose que de 70 ; quelques-uns, moins âgés, rappelaient l’état magnifique de l’armée reconstituée, à l’époque de la mort de Gambetta, par exemple, ou lors de l’affaire Schnœblé, où l’on avait été si près de la voir à l’œuvre. Alors, un politicien de l’endroit, – pas plus sot, après tout, que la plupart de ses contemporains, – rubicond, l’œil injecté à la fin des repas, vous prenait tout à coup ces souvenirs, ces regrets et cette apparente émotion belliqueuse et vous les faisait sauter en les renversant comme les œufs dans la poêle. La guerre, selon lui, était un fléau des anciens âges. La France, nation de progrès, consentait encore, pour ménager les transitions nécessaires, à en exécuter le simulacre, mais c’était un jeu protocolaire, une dernière courbette au passé. La guerre était destructive ; les sociétés modernes ne s’appliquaient qu’à la production ; croire à la guerre, c’était s’imaginer qu’on remonte le courant de l’histoire. D’ailleurs, pour tout esprit averti, les moyens scientifiques de destruction étaient tels que la lutte fratricide était rendue totalement impossible, im-pos-si-ble. Il fallait être niais pour ne pas s’apercevoir qu’en un clin d’œil tout serait réduit en poussière. Les manœuvres !… ah ! on le faisait bien rire avec les manœuvres. Les manœuvres ne ressemblaient pas plus à la guerre, telle qu’elle pourrait être, qu’un pistolet de bazar à un mortier allemand. La guerre, si elle éclatait jamais, ne durerait seulement pas le temps de vos concentrations de corps d’armée : le premier des deux adversaires qui serait en avance d’une demi-journée réduirait l’autre à merci. – « Eh ! dites donc, interrompait quelqu’un, il ne serait alors peut-être pas mauvais de tout faire pour obtenir cette avance ?… » – « Inutile ! Comptez votre population, considérez vos aspirations, pensez aussi aux finances !… Les finances ? pas un pays de grand armement qui puisse soutenir la guerre six semaines… ni qui puisse soutenir la seule préparation à la guerre encore pendant trois ans… Consultez les grandes banques, qui mènent le monde, entendez-vous ? qui mènent le monde, les Empereurs, les Rois, comme les peuples, ne nous le dissimulons pas : la guerre est impossible, im-pos-si-ble !… Nous assistons, avec vos manœuvres ; aux derniers gestes d’un âge préhistorique… Tournez vos yeux vers l’avenir, et, Messieurs, toute cette horde chamarrée et tonitruante vous apparaîtra comme enfantine !… » – « Mais l’Allemagne ? le parti militaire ?… Les Pangermanistes ?… » – « L’Allemagne est un peuple pacifique, industriel et commerçant, qui se sert de ses canons comme moyen de réclame… Ce que nous n’avons pas suffisamment, le savez-vous ? C’est le sens des affaires…, parfaitement. Et ce sens, l’Allemand le possède… Le parti militaire ? une goutte d’eau dans le lac… Les Pangermanistes ? des hommes-affiches à la solde de l’industrie nationale !… D’abord l’Empereur, comme l’affirme quiconque l’a vu de près, est un secret ami de la France… et j’ajouterai : le plus républicain de nous tous… Le socialisme, voilà son ennemi… L’armée qu’il nous faut, ce n’est pas un ramassis de soldats, c’est un groupement d’hommes décidés à maintenir la paix… L’humanité est en marche, on ne saurait trop le redire, vers un avenir de liberté, d’égalité, de fraternité… Ah ! il faut tenir compte de la concurrence économique : c’est la loi de la vie… » – « Mais, précisément !… »
Une réminiscence, accentuée sans doute par l’état de fièvre, apportait à la jeune femme, avec une précision d’une minutie extraordinaire, jusqu’à la moindre de ces paroles entendues à sa petite table solitaire. Il est vrai qu’elle s’était amusée à les répéter au sous-lieutenant, son mari ; elle se souvenait même à quel moment : quand il pataugeait en se savonnant dans son bain, au retour des manœuvres. Il en avait ri de tout son cœur ; car, lorsque Jean revenait des manœuvres, il était un autre homme que lorsqu’il s’y rendait. Quelques jours seulement de présence au corps, au milieu de ses camarades militaires, ou le transformaient, ou plus exactement le restituaient à son état normal, en tout cas le faisaient triompher de la paresse qu’il avait d’ordinaire à donner la réplique à ses amis les beaux parleurs de Paris.
Odette n’attachait, elle, aucune importance à toutes ces idées, que ce fussent les unes ou les autres. Élevée dans l’unique religion du bonheur, elle tenait le bonheur par l’amour pour la seule fin enviable de toute destinée. À quoi bon discuter ? Pourquoi penser aux calamités ? Certains de ses amis, des plus réputés par leur intelligence, ne soutenaient-ils pas que c’était l’honneur de l’homme civilisé que de ne pas même songer à des actes de barbarie ? que l’homme se haussait en dignité en négligeant de se préparer à manier les armes ?… Elle se rappelait aussi, parmi tant d’autres, l’opinion assez âpre de M. de la Villaumer, souvent répétée : « Nous ne sommes pas en état de faire la guerre. Nous ne savons pas à quel point nous ne sommes pas en état, ne sachant pas du tout ce que c’est que la guerre. Si on nous la fait, comme c’est à craindre, autant vaudrait le déluge… »
Cependant ce jour-là, au sortir de la baignoire, Jean s’était tellement échauffé en parlant de l’armée, qu’il avait inspiré presque peur à sa femme. Elle l’avait enserré de ses bras, pendant qu’il s’enveloppait dans son peignoir, en lui disant :
– Tais-toi, Jean !… Oh ! songe donc, si jamais tu étais seulement défiguré par un vilain coup ! Tes beaux yeux, mon chéri !… tes belles dents !… Non, mais ce serait fou !…
Et, parce qu’il avait ri, de ses belles dents, jusqu’à fermer complètement ses beaux yeux, elle avait aussitôt pensé à autre chose.
Sans consentir jamais à examiner d’un peu près cet ordre de questions, elle conservait une grande crédulité optimiste, non pas quant à la guerre qui ne l’intéressait aucunement, mais quant à son Jean, qui, seul, importait, et qu’elle ne croyait pas, en sa qualité d’officier « de réserve », tenu de participer à une campagne. Ceci était, chez elle, idée innocente, déposée en son esprit par l’abondance de toutes ses satisfactions, et que, pour rien, elle n’eût voulu approfondir, de peur que le résultat ne fût défavorable. C’est la même paresse d’esprit, voluptueuse, qui la retenait, par exemple, de se demander le sens de ces mots entendus de la bouche de son mari : « Me voilà affecté désormais aux troupes de couverture. Nous n’irons plus en Touraine… » Eh ! bien, on n’irait plus en Touraine ; on irait ailleurs.
Et sa rêverie la reportait au début de la saison dernière, au bord de la mer. Il faisait si beau ! Jean avait eu la chance d’obtenir congé, à sa maison de commerce, dès le 15 juillet ; on était parti pour Surville ; l’affluence était déjà grande à l’Hôtel de Normandie ; le Casino était bondé ; les jeux ronflaient ; le petit Théâtre exhibait des vedettes parisiennes ; une rangée d’autos empestait la terrasse où l’on allait boire l’après-midi au son de l’orchestre des tziganes, en se faisant rôtir au soleil ; d’élégants jeunes gens arboraient des costumes kaki, à martingale, avec des chapeaux à larges bords. Le soir, dans le hall, on dansait le tango.
La grande agitation des villes d’eaux, composée à une quantité d’actions nulles ou d’un fastidieux va-et-vient, de bars en bars, de casinos en casinos, de goûters en goûters, commençait.
– Ah ! ça, viendras-tu ? voyons, Jean ! Es-tu assommant avec tes lectures de dépêches ! On dirait que tu attends quelque chose… Qu’est-ce que ça te fiche cette affaire ?…
Chaque soir, en pénétrant dans le grand hall du Casino par la galerie donnant sur la mer, soit pour aller au théâtre, ou au music-hall, ou simplement s’asseoir en prenant son café ou sa camomille, on voyait une agglomération de messieurs en smoking devant le cadre, à droite de la porte, qui contenait les dépêches de Paris et la clôture de la Bourse. Odette s’entendait encore prononçant les paroles de reproches adressées à son mari qui revenait toujours de là avec une figure inaccoutumée.
– Eh ! bien, l’affaire ?… demandait-elle.
Jean citait quelques-unes des dépositions sensationnelles. Il ajouta, un soir :
– Il y a un ultimatum à la Serbie…
– Et après ?…
On n’en reparla plus. Mais Jean se leva deux fois pour aviser des personnes qu’il connaissait. Il discutait avec elles, un moment, dans le couloir, puis revenait auprès de sa femme.
– Oh ! ce ne sera encore rien, disait-il.
Pendant quelques jours, le même manège se renouvela. Il fallut entrer dans des explications. Alors Odette elle-même s’agita ; elle accompagnait son mari aux dépêches : elle y courait, seule, dans le jour. Mais le nombre des lecteurs de dépêches augmentait ; il fallait parfois attendre cinq minutes, et le silence ou les quelques mots échappés du groupe l’impressionnaient : elle allait relire les mêmes dépêches sur la plage, au kiosque du Figaro. Des menaces de guerre ?… de guerre européenne ?… La guerre ?… Non, ça, par exemple, n’était pas vraisemblable… C’est une idée qui ne pénétrait qu’avec d’extrêmes difficultés sous tous les fronts. Les dépêches se succédaient, deux fois par jour, tantôt rassurantes, tantôt mauvaises ; mais lorsqu’elles contenaient un sujet d’alarme, c’en était un plus fondé que celui de la veille.
Odette en vint à demander à son mari :
– Enfin, s’il y avait la guerre, par hasard, est-ce que ça t’atteindrait, toi ?
– Ne te presse pas, ma chérie, la guerre n’est pas encore déclarée…
– Enfin, enfin, si elle l’était ?
– Eh ! bien, si elle l’était : je suis officier de réserve.
– La réserve, qu’est-ce que c’est ? c’est pour quand il n’y a plus d’active ?
Il l’avait embrassée en riant. Un parent d’un des plus puissants banquiers de Paris venait de déclarer à la table voisine que « tout était arrangé ».
Mais le lendemain le bruit se répandait au Casino que les nouvelles étaient si fâcheuses qu’on ne les avait pas affichées. Jean alla aux renseignements. Le bruit se trouva confirmé. Alors, il dit à sa femme :
– Il faut prendre ses précautions. Écoute, mon adorée : je vais partir pour Paris ce soir. Je mettrai ordre à mes affaires ; je verrai La Villaumer, qui sait tout ; Avvogade qui déjeune avec le Président du Conseil ; je saurai ce qu’on peut savoir et je tâcherai d’être de retour pour la nuit…
Elle réentendait toutes les paroles ; elle revoyait les moindres gestes ; elle imaginait La Villaumer, si clairvoyant, si sage, et Clotilde Avvogade au milieu de ses fleurs, dans son appartement presque trop délicieux, et faisant la grimace en entendant son mari parler de choses désagréables… Elle revoyait aussi la triste nuit qu’elle avait passée seule, sans dormir, et la chauve-souris qui était entrée dans sa chambre comme un diablotin ; et les figures, le lendemain, au restaurant, au Casino, à la plage, partout ! Et les départs : l’hôtel presque vide dès le soir qu’elle attendait son mari, le soir qu’il ne revint pas !…
Il n’était pas revenu parce qu’il avait trouvé à Paris un ordre de « rejoindre immédiatement pour accomplir une période d’instruction ». Il lui avait télégraphié : « Ne bouge pas : tout ira bien ; t’écrirai. »
« Une période d’instruction » ? si soudainement décidée ? qu’est-ce que cela signifiait ? Était-ce la guerre ? Elle interrogea autour d’elle. Les uns étaient stupéfaits de ce qu’elle annonçait ; les autres disaient : « Une période d’instruction, rien de plus ordinaire. » « En somme, faisait un autre, on mobilise déjà. » Un monsieur lui dit : « Mais non. Madame : la mobilisation ne peut être que générale. Il peut se faire que certains officiers soient appelés individuellement, mais c’est par mesure de précaution, étant donné que la situation, évidemment, est tendue… »
– Mais pourquoi lui appelé et pas d’autres ?… Il n’est qu’officier de réserve !…
– Cela tient au lieu de son Dépôt sans doute. Connaissez-vous le lieu de son Dépôt ?
– Je sais qu’il appartenait autrefois au IXe corps, mais je crois qu’il est passé à Nancy…
– Troupes de couverture, ah ! ah !
– C’est cela, précisément, Monsieur : il a été affecté aux troupes de couverture…
– Ah ! très bien. Oh ! très bien.
Elle trouva une autre femme dans son cas ou à peu près. Mais le mari de celle-ci, appelé aussi individuellement, était capitaine de l’active, lui, et en garnison à Pont-à-Mousson…
– Celui-là, se dit Odette, il est frit.
Et la comparaison lui étant un peu avantageuse, son moral en fut remonté. Jean n’était que sous-lieutenant, il n’appartenait qu’à la réserve… Elle fut occupée par la compassion que lui inspira l’autre femme, d’un tout, autre caractère qu’elle, cependant ; fortement préparée à la guerre et prête à sacrifier tout : « Je regrette, disait celle-ci, que mes garçons ne soient pas grands, cela ferait des défenseurs de plus au pays… »
Odette était aussi mal adaptée que possible à un pareil langage. Tout la surprenait. Elle ne comprenait rien.
Une dame arriva de Paris ; c’était la femme d’un député : elle dit à qui voulut l’entendre :
– Je peux bien vous le confier : la mobilisation sera affichée demain.
Il faisait un temps idéalement beau, bien que des orages eussent sévi, même dans l’Ouest. Les enfants jouaient sur la plage. La mer, sous un ciel sans nuage, était d’un calme engourdissant. On voyait Le Havre étalé au soleil comme un long lévrier haletant de chaleur ; de beaux bateaux de transport, au loin ; et de petites voiles en apparence immobiles. Jamais le ciel, la mer, la terre n’avaient paru tant désirer la paix ; jamais le bonheur d’exister n’avait peut-être été plus sensible. Quels que fussent les sujets d’alarme, tout vous criait qu’il était impossible de croire au malheur.
Le lendemain, samedi 1er août, Odette, troublée par les conversations entendues, mais dénuée de renseignements particuliers, allait jeter à la poste une lettre adressée à son cher Jean, à Paris, puisqu’elle ne savait où l’atteindre. Il était environ quatre heures. Elle vit devant la mairie un rassemblement se former, et le tambour de ville arriver, entouré d’une ribambelle de gamins. Ce tambour était un grand garçon jeune, sec et blême ; il manifestait un sérieux qu’un tambour n’a pas pour annoncer qu’il a été perdu une petite chienne gris-feu à longs poils. La foule aussitôt l’entoura avec une avidité frénétique. Il exécuta son roulement : prit dans sa poche un papier qu’il déplia et lut à haute voix, sans que son masque fût en rien modifié : « La mobilisation générale est déclarée. Le premier jour de la mobilisation est pour le dimanche août. Aucun homme ne devra partir avant d’avoir consulté l’affiche qui sera apposée incessamment. » Un ban.
La foule, composée en majorité d’hommes jeunes, d’un mouvement unanime et comme réglé, leva son chapeau en criant : « Vive la France ! » Un seul garçon prononça : « Vive la guerre ! » Et le tambour blême s’éloigna, pour recommencer son avertissement, vers un autre carrefour.
Cela avait l’air d’un fait tout simple, presque ordinaire, au croisement de ces quatre rues de petite ville. Le fait accompli : piétinement, dispersion, silence. Et cet acte modeste, par centaine de milliers de fois répété à la même heure, était le plus tragique cri d’alarme de l’histoire des hommes, et qui retentissait, au même point du temps, sur tout le globe terrestre. Peu de bruit ; presque pas de paroles ; et tous ces hommes levant leur chapeau pour prononcer un mot qui tout à coup devenait sacré, venaient de faire le sacrifice de leur vie. L’imagination se perdait à imaginer en quelle multitude de points du monde, pareil don de soi venait d’être fait, car si l’homme qui « part » espère être épargné, celui qui apprend qu’il est appelé se livre un instant corps et âme.
Presque aussitôt les cloches sonnèrent le tocsin comme si la ville brûlait. Toutes les églises ; puis, sur le coteau, dans la campagne, le même signal de détresse, comme une épidémie, gagnait. C’était trop nouveau pour être tout à fait effrayant. Beaucoup entendaient et ne pensaient pas. Personne ne se représentait la tragédie à laquelle ces humbles petites cloches désolées vous convoquaient. Ce qui sauve les hommes est de borner toujours leurs pensées à ce qu’ils ont à faire de plus immédiat. L’idée d’une paire de chaussures, celle du lieu où est serré un livret ou celle d’aller dire adieu à tel ou tel, arrêtent le vertige que l’énormité d’un tel évènement est apte à produire.
Odette fut suffoquée, d’abord, et pleura, comme une enfant nerveuse qui assiste à une alerte. Elle ne voyait pas, au travers de ses larmes, la boîte aux lettres où elle jetait pour son Jean une lettre qui ne signifiait déjà plus rien et qui, sans doute, ne joindrait pas son destinataire. Et, tout autour d’elle, aux portes, dans les rues, à l’hôtel, sur la plage, des femmes pleuraient.
Odette monta chez elle. Elle dit à sa femme de chambre :
– Et vous, Amélie ?
– Moi, le mien rejoint le deuxième jour… Je voulais demander à Madame de prendre le train de Paris ce soir – demain il n’y aura plus de place pour les civils –. Comme ça, je pourrais encore l’embrasser…
– Allez, Amélie.
Elle s’assit à la fenêtre donnant sur le parterre, sur les tennis désertés, et la mer. Elle était seule ; elle n’avait rien à faire qu’à songer et à attendre.
Tout était comme stupéfié, cristallisé. Il semblait qu’il n’y eût plus personne nulle part. La fumée de trois grands transatlantiques, en rade du Havre, seul mouvement perceptible, montait tout droit dans l’air immobile. Quelques nuages de beau temps, à l’horizon, moutonnaient en rosissant. Une ou deux barques de pêche, toutes voiles dehors, flânaient comme sur un lac. En temps ordinaire, on eut dit : « Quel coucher de soleil nous allons avoir ! » Odette pensa : « Les hommes qui sont dans ces barques, à l’heure présente, ne savent pas !… »
Et aussitôt une opération involontaire se produisit dans son esprit. Elle se transportait en un temps pareil à celui qui régnait encore sur les barques, en un temps où « l’on ne savait pas ». Il n’y avait dans le monde rien d’extraordinaire ; la vie, souriante, chantait ; l’espérance d’une vie plus belle berçait la pensée… Ce temps qui semblait être déjà lointain, il datait d’une heure. Et tout était changé, mais changé comme rien n’avait changé jamais. Habitait-on la même planète qu’en ce temps-là ? Qui donc se faisait la moindre idée de ce qui allait se passer à présent ? Elle essaya d’entrevoir le jour de demain. Mais elle ne se figura rien ;… rien. La phrase de La Villaumer, seule, lui revenait : « Nous ne sommes pas en état… Autant le déluge… »
Et avec cela, au fond, très profond d’elle-même, elle ne croyait pas du tout au malheur.
Elle demeura là, assise, jusqu’à l’heure du dîner, à sa fenêtre. Elle reconstruisait toute sa vie passée avec Jean. Elle frissonnait à ses premières caresses. Elle n’avait jamais aimé que lui, avant son mariage ; depuis son mariage, que lui. Ce n’était plus la guerre qu’elle croyait inimaginable, mais la puissance de l’amour qu’elle éprouvait pour Jean. Et au lieu de concevoir le chaos, c’étaient les images les plus agréables, que son penchant naturel l’incitait à faire ressurgir. Elle souriait, son corps s’alanguissait ; ses doigts avaient des frémissements comme si une étreinte possible était proche ; et ses lèvres, dans le vide, dessinaient le mouvement du baiser.
Une voix d’homme provenant du balcon contigu à celui de sa chambre, prononça :
– Il est bien absurde de penser que la nature puisse se mêler de nos affaires ; mais, par curiosité, regardez-moi ce ciel… Je n’en ai jamais vu de pareil.
Les mots s’adressaient à une personne placée à l’intérieur, qui s’approcha de la fenêtre ; et l’on entendit une exclamation de femme, plainte ou invocation désespérée, comme on n’avait pas non plus coutume d’en entendre.
Odette se leva, et, elle aussi, regarda. Elle n’était pas superstitieuse ; elle n’était pas surtout inclinée vers les interprétations lugubres. Elle avait toujours été heureuse ; sa vie s’était écoulée, pour ainsi dire, comme une longue fête continue. Étant seule dans sa chambre, elle ne dit pas un mot. Mais toute sa chair se hérissa.
Il se peut que de pareils phénomènes se produisent parfois et que nous ne leur accordions aucune attention : cependant, ce jour-là, à trois personnes occupant des chambres d’hôtel voisines, à d’autres aussi, qui en parlèrent le soir, au dîner, le coucher du soleil apparut tout à fait insolite et capable de donner raison à toutes les croyances de bonnes femmes touchant les relations de la terre avec les choses merveilleuses par leur caractère colossal, qui s’accomplissent à la voûte du ciel. Tout l’horizon, au-dessus de la mer tranquille, n’était qu’un brasier, une fournaise d’une intense ardeur, sur laquelle s’étiraient, comme des lambeaux de viandes déchiquetées, quelques longs nuages d’un rouge violacé, livide. Peu après, le feu trop féroce s’atténua, s’éteignit presque, comme si toute la matière combustible eut été consumée par la furie des flammes. Puis le disque du soleil laissa voir son contour ; et il était pareil à une ampoule géante emplie de sang, à un réceptacle de cristal tellement gorgé que, par quelque fissure, le liquide visqueux s’échappait, répandait, et de droite et de gauche, un marécage, un lac, une mer de sérum humain, roulant de part et d’autre, vers des fleuves aux rives contractées, qui soulevaient un double mascaret formidable. L’ampoule sinistre éclata elle-même, tout à coup, et fut pulvérisée dans cet amas de matières en fusion ou d’eaux épaisses, pesantes et immondes ; puis de minces ruisseaux s’écoulèrent comme aux alentours des abattoirs…
Non, en vérité, aucun vertige de l’imagination, aucune vision hallucinée, aucune romantique complaisance : une image réelle, d’aspect symbolique, et qui devançait, comme une vignette, encore un peu mignarde, les pages incendiées du grand livre de l’Histoire qui venait de s’ouvrir.
Pour l’âme d’Odette cela joua le rôle d’un décor qui s’abaisse sur un acte nouveau : dès le lever du rideau, on est fixé : adieu la comédie légère, les aimables fantaisies, les ballets ! C’est le tragique qui commence.
Alors sa mémoire maladive lui faisait parcourir, d’un bond, plusieurs mois de guerre.
On passe dans une atmosphère embrasée. C’est dur, mais on y est passé. L’Alsace, une bouffée d’espoir fou, avant-dernière minute de la vieille France ; la Belgique : enthousiasme d’abord, horreur ensuite : les Alliances : pronostics dits assurés sur le « résultat final » : l’invasion : marche à l’échafaud où le condamné conserve l’espoir de l’invraisemblable ; la Marne : l’invraisemblable réalisé à quoi l’on n’ose pas croire ; l’ennemi refoulé et accroché ; la chute d’Anvers dont tant de gens, que l’on retrouvera par la suite, affirment que « ça n’a aucune importance ».
Odette recevait des nouvelles de Jean. Comment Jean pouvait-il se trouver dans une pareille fournaise ? et comment, elle, en pouvait-elle soutenir l’idée ? Mais bien des choses crues impossibles commençaient à être reconnues faisables. Jean supportait les fatigues, et tout en lui était modifié. Elle le trouvait non pas tel qu’il était au retour des manœuvres, mais un homme surélevé, oui, qui semblait dépasser sa taille, et quoi qu’il fît pour paraître simplement ordinaire et charmant. On devinait ses souffrances et on le sentait heureux. Odette alla même jusqu’à penser : « Comme il se passe de moi !… » Elle était revenue à Paris afin d’avoir de ses nouvelles plus vite. Mais il ne semblait pas, lui, conserver aucune notion du temps. C’est que, du temps il n’était plus maître. Odette lui écrivait toujours comme à un être isolé et disposant de sa personne. Sans le faire exprès, il lui répondait comme un homme qui n’a pas d’existence propre, comme un homme emporté par quelque chose de plus grand que lui, et qui, seul, compte. Elle ne comprenait pas encore, et elle reprochait doucement à Jean de se négliger.





























