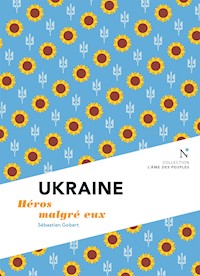
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Comment parler aujourd’hui de l’Ukraine ? Comment rédiger ce petit livre qui prétend fouiller l’âme ukrainienne comme le font tous les ouvrages de notre collection ? Ces deux questions ne nous ont pas quitté avant de publier ce récit d’un soulèvement, d’une histoire et d’une redécouverte. Car l’Ukraine est aujourd’hui tout cela. Ce berceau de la culture slave et de la religion orthodoxe n’est plus que le fantôme de ce pays dynamique, porté par une société civile d’une incroyable vitalité, qui avait éclos au fil des années 2000. Ce livre est logiquement une lettre d’amour à l’Ukraine, écrite par un ancien correspondant basé à Kiev. « Génération Volodymyr », oui. Parce que ce prénom présidentiel, aujourd’hui, symbolise ce que l’âme d’un peuple est d’abord : le refus forcené de disparaître.
Un grand récit suivi d’entretiens avec Tetiana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko (journaliste et philosophe), Bohdana Neborak (écrivaine) et Bohdan Lohvinenko (écrivain).
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sébastien Gobert est journaliste à
La Libre Belgique après avoir été correspondant à Kiev durant de nombreuses années.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Carte
AVANT-PROPOSPourquoi l’Ukraine ?
« L’Ukraine n’est pas encore morte. » Le premier vers de l’hymne national nous interpelle. L’Ukraine, victime d’une agression d’un autre âge, ne veut pas mourir. Elle résiste pour exister. Elle résiste pour que ses enfants existent à l’avenir. Elle résiste pour que cet avenir soit libre. Elle résiste pour exister aussi sur notre carte mentale.
L’Ukraine se bat pour être plus qu’un simple résidu d’empire. « Ou-kraina », son nom hérité du vieux slave, nous incite à penser à l’Ukraine selon sa traduction littérale : un territoire aux confins, aux marges, aux limites. Pourtant, jadis, des géographes autrichiens ont identifié un point qui en ferait le centre géographique de l’Europe. On connaît la valeur scientifique de ce genre de mesures pour un continent dont les délimitations sont floues. Reste que les Ukrainiens ne se perçoivent pas comme un peuple des confins, aux contours indéfinis. Ils s’efforcent bel et bien de former un ensemble cohérent. Un corps uni malgré ses différences et son instabilité. Ou plutôt, grâce à elles.
Si l’Ukraine est une frontier, c’est plutôt pour l’Union européenne, l’OTAN et l’Occident en général. À Bruxelles, Paris ou Washington, on s’interroge, on tergiverse, on hésite quant à l’appartenance de l’Ukraine. À Kiev1, on ne s’embarrasse plus de ces questions. On a exprimé des choix clairs sur les barricades et dans les tranchées. On les a payés du prix du sang. Les Ukrainiens savent dans quel monde ils veulent vivre. Ils sont d’ailleurs en train de le protéger de leurs corps, ce monde. La frontière – et non la frontier – qu’ils défendent, c’est celle de la liberté.
Un combat à replacer dans le temps long. Déjà aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, les voyageurs européens mettaient en avant les différences entre des Russes monarchiques, des Polonais aristocratiques et des Ukrainiens épris de liberté, voire démocratiques. « L’Ukraine a toujours aspiré à être libre » écrivait Voltaire. Une aspiration contrariée par la géographie et l’histoire, la politique et l’idéologie.
Le lancement de l’insurrection cosaque de Bohdan Khmelnitskiy2 contre la République des Deux Nations3, en 1648, coïncide avec la signature des traités de Westphalie, mettant fin à la guerre de Trente Ans. Alors que l’Europe de l’Ouest se conforte dans la reconnaissance immuable du concept de souveraineté nationale qui garantit la survie de l’État, l’Est du continent s’engage dans une course ravageuse dans laquelle tous les coups semblent permis, y compris la négation d’identités particulières.
La quête de liberté et d’indépendance des Ukrainiens n’est donc ni une marche triomphale ni un poème romantique. C’est une complainte. « La liberté ou la mort ! » scandait l’anarchiste Nestor Makhno4 dans le chaos suivant la Première Guerre mondiale. Une devise toujours d’actualité.
Dans cette longue lutte, les trois dernières décennies sont un pivot. L’indépendance de 1991 a offert un cadre pour panser les plaies des siècles passés, consolider une idée nationale et assouvir sa soif de liberté5. Cela grâce à une forte mobilisation citoyenne autour d’un projet de révolution permanente. Mais aussi à travers la jouissance d’un vaste pays d’opportunités insoupçonnées. L’Ukraine est une terre de potentiel, répète-t-on à l’envi jusqu’à en faire une plaisanterie. Mais qu’il soit assouvi rapidement ou non, ce potentiel promet un avenir. Le changement, ici, est brouillon, chaotique et dysfonctionnel. Mais il est réel.
Ce processus de changement fédère des communautés que l’on imaginerait très différentes, au premier abord. Ukrainophones et russophones, Hongrois, Tatars de Crimée, Coréens, Juifs, Grecs ou encore Roumains se rejoignent dans la définition d’un nouveau vivre-ensemble qui dépasse le simple socle ethnoculturel. Un projet civique se structure en commun, pas à pas. C’est-à-dire, deux pas en avant, un pas en arrière. Mais le mouvement est là. L’Ukraine change. L’Ukraine est plus ukrainienne que jamais dans son histoire. L’Ukraine a un avenir. Et les Ukrainiens voient leur avenir en Ukraine.
Les raisons ne manquent pas pour eux de résister, envers et contre tout. Et pour nous, amis lecteurs, de partir à leur découverte.
1 L’auteur est bien conscient de la forme ukrainienne du nom de la capitale, Kyiv, et des questions qui en découlent. C’est par respect des conventions que l’appellation Kiev est utilisée dans cet ouvrage
2 Hetman (chef militaire élu par ses pairs) des cosaques zaporogues (1595-1657). Il lança une vaste insurrection contre la noblesse polonaise en 1648 avant de se rapprocher de la Moscovie en 1654.
3 État formé en 1569 par l’union du Royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie. Il fut un temps l’État le plus vaste d’Europe.
4 Communiste libertaire (1888-1934) d’origine cosaque zaporogue, fondateur de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne qui combattit à la fois les « Armées blanches » tsaristes contre-révolutionnaires et l’Armée rouge bolchevique. Il meurt en exil en France.
5 Indépendance acquise le 24 août 1991 dans le cadre de la dissolution de l’Union soviétique.
Héros malgré eux
Sur les ruines de l’amitié entre les peuples
Un premier aperçu nécessite une prise de hauteur. Pas facile dans un pays aussi plat que l’Ukraine. Mais les collines de Kiev sont faites pour cela. D’une large terrasse ouverte sur le levant, on embrasse une vue imprenable sur le fleuve, le Dnipro. Une force tranquille qui se fraie un chemin dans les méandres marécageux du nord, serpente à travers les plaines jusqu’à la mer Noire au sud. À l’ouest, les campagnes verdoyantes qui s’élèvent lentement jusqu’aux contreforts des Carpates. À l’est, la steppe aride et ouverte sur l’horizon. Au centre, les terres fertiles irriguées par le Dnipro. C’est là que tout commence, le long de cette ligne de vie. On se plaît à croire qu’il suffit de planter un bâton dans le tchernozem, la fameuse terre noire, et d’attendre qu’il se transforme en arbre fruitier. Fantasme ou réalité ? Libre à chacun d’essayer… Ce qui est sûr, c’est que l’on ne pourrait pas même en rêver si le Dnipro ne coulait pas.
Tout dans l’histoire ramène à ce fleuve, qu’il soit vécu comme une colonne vertébrale, une ligne de front ou une frontière. C’est lui qui a fait naître Kiev, aux alentours du cinquième siècle, en l’imposant comme un comptoir commercial. Lui qui a conduit les Varègues depuis leur lointaine Scandinavie, à un moment du neuvième siècle, le long de l’isthme de la Baltique à la mer Noire que leur avait laissé Charlemagne. Lui qui a fait prospérer le port jusqu’à en faire le cœur d’une des plus puissantes principautés de l’Europe médiévale.
De la terrasse, on peut contempler les coupoles dorées de la ville haute qu’a dû quitter la princesse Anna Yaroslavna pour partir épouser le roi de France Henri Ier, en 1051. On raconte qu’elle ne fut guère charmée par la rudesse et le manque d’hygiène de la cour des Capétiens. Un commentaire que les Ukrainiens ne se lassent pas de répéter aux Français de passage et qui ne manquerait pas de flatter la fierté de l’aïeul d’Anna, Volodymyr le Grand.
Lui, on devine sa statue, entre les arbres, qui ne cesse de bénir le fleuve en contrebas. C’est le Dnipro qui a fait remonter les idées chrétiennes depuis la Crimée hellénisée. Avant de christianiser la Rous de Kiev1 en 988, le grand prince aurait tout de même longtemps hésité avec l’islam. Cette nouvelle religion, alors en pleine expansion, l’autorisait en effet à prendre plusieurs épouses. Elle lui interdisait toutefois de consommer de l’alcool. Et c’est donc derrière Constantinople la chrétienne que s’est rangé Volodymyr. De cette anecdote de comptoir, les Ukrainiens veulent voir l’une des origines de leur sens de l’humour légendaire.
Par extension, beaucoup sont tentés de tirer une droite ligne entre la Rous de Kiev et l’Ukraine contemporaine. Pour contrecarrer les relectures agressives de l’histoire par le Kremlin, certainement. Mais aussi pour que la jeune république s’enorgueillisse d’un prestige millénaire. La tentation est grande. Mais après le sac de Kiev par les Mongols en 1240 et les invasions tous azimuts qui ont marqué les siècles suivants, les Ukrainiens – a fortiori les Russes et les Bélarusses – sont-ils plus proches des Roussiens que les Français, les Belges ou les Suisses ne le sont des Gaulois ? Dans les manuels scolaires, les explications sont vagues. Dans les reconstitutions historiques, les discours sont grandiloquents. Pour retracer des origines à partir de détails disparus dans les incendies de l’histoire, l’amalgame est la règle.
En survolant du regard le quartier de Podil, c’est bien une sensation d’agrégat qui s’impose, entre les immeubles tsaristes et les tours futuristes, les usines et les centres commerciaux, les silos à grain et les chantiers désaffectés, les parcs fraîchement rénovés et les rues étroites. Les ruines du port de commerce varègue, c’est dans les entrailles de la place de la Poste qu’il faut aller les chercher. Là, des pilotis, des poutres, des pièces de monnaie, des vases sont sortis de terre au pied d’un mur de soutènement, en bordure de la voie rapide. Des trésors d’archéologie enfouis sous des couches de boue qu’une poignée de militants se démène pour préserver. Sans moyens techniques. Malgré l’indifférence de la municipalité. Face au projet de construction d’un énième centre commercial.
L’engagement est amateur, la protestation naïve et les chances de succès réduites. Mais l’engouement est sincère. Il faut écrire le futur. Les Soviétiques ne sont plus là pour imposer un avenir radieux qui serait inscrit dans le cours naturel de l’histoire. Ne restent que des Ukrainiens sans illusions, pragmatiques et déterminés. Ils ne cherchent pas à revenir à l’état idyllique d’une situation révolue puisque le passé a trahi. Ils cherchent encore moins à préserver les acquis d’une situation existante puisque le présent est frustrant. S’ils se mobilisent, c’est pour inventer le futur le plus rapidement possible, à bout de bras.
Cette soif de changement est visible depuis notre terrasse. À gauche, une passerelle en verre s’élance vers la colline voisine. En face, une arche élégante enjambe le Dnipro. Le changement se matérialise dans des ponts. Les Ukrainiens en ont eu assez de murs, de cloisons et d’obstacles. Bien sûr, le mouvement est brouillon. Le verre de la passerelle s’est fissuré dès le jour de son inauguration. Le chantier de l’arche est presque aussi vieux que l’indépendance. On déplore de l’incompétence. On crie à la corruption. On suspend le projet. On débat. On argumente. On hurle. On entame une révolution. On la gagne. Et on relance les projets avec l’espoir d’avancer, un petit peu plus loin encore.
Entre-temps, on s’amuse. La fête foraine étalée sur la terrasse ne paie pas de mine. Le câble de la tyrolienne reliant l’île Troukhaniv n’inspire qu’une confiance timorée. Mais l’Ukraine est un pays de relativisme. Il faut croire que tout va bien se passer. Il faut profiter. Ici, on ne sait jamais ce qu’il adviendra demain. Dans la moindre décision frivole pèse le poids d’une conscience collective de souffrances historiques.





























