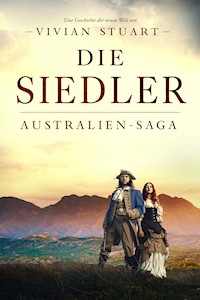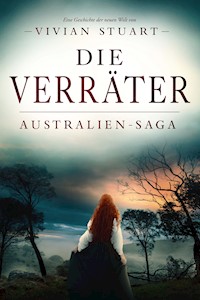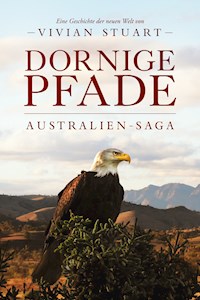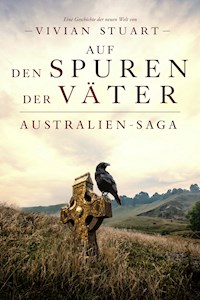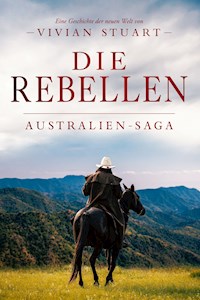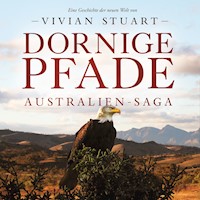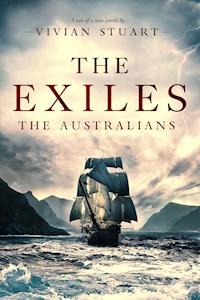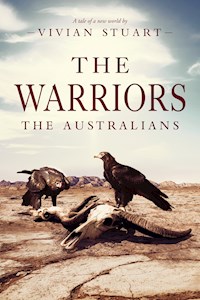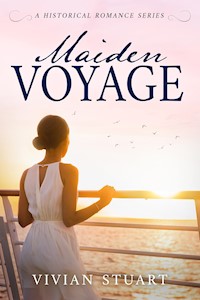Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance historique
- Sprache: Französisch
Thorquil, qui vient d'hériter du titre de boron et du domaine d' Ardlair en Ecosse, voudrait bien épouser Jennifer Oakroyd qui apporterait dans la corbeille de noces assez d'argent pour rendre au domaine son lustre d'autrefois. Le père de Jennifer estime que cette union ne peut être que profitable aux uns et aux autres. Le baron, ruiné, redeviendra riche et, lui, devenu beau-père d'un noble, aura planté un jalon important pour son élévation à la pairie. Et Jennifer? Personne ne semble se préoccuper d'elle. « Elle n'a rien à dire, estime son père, je la monœuvre à ma guise. » Mais ce qui paraissait incroyable se produit. A l'injonction paternelle qu'elle devra « manœuvrer » pour se faire épouser par Thorquil, Jennifer répond catégoriquement : « Non. »
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un Château dans la brume
Un Château dans la brume
Castle in the Mist
© Vivian Stuart, 1959
© eBook: Jentas ehf. 2022
ISBN: 978-9979-64-609-9
This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition, including this condition, being imposed on the subsequent purchase.
All contracts and agreements regarding the work, editing, and layout are owned by Jentas ehf.
CHAPITRE PREMIER
Une écharpe mouvante de brume, suspendue comme un voile sombre au-dessus du loch, estompe à l’horizon les collines entre lesquelles, scintillante, la voie ferrée se glisse en serpentant. Le Night Higlander vient de s’immobiliser, crachant sa vapeur au visage de la petite gare déserte et somnolente.
Depuis plus d’une heure, Somerled Sinclair ne cessait de guetter à travers la glace du sleeping l’approche de la station. A peine franchie la rivière, il s’était avancé le long du couloir, ses deux grosses valises au bout des bras, pour être le premier à voir surgir du brouillard matinal l’humble station où il reprendra, enfin, contact avec la bonne terre d’Ecosse.
Le long convoi s’est arrêté dans un grincement de freins et aussitôt une voix désincarnée, jaillie du tréfonds d’une gorge usée, a dominé pour un instant le bruit de la vapeur qui fuse. « Loch Rhua Hait ! Correspondance pour Loss, Kinlochalder et Arlait. Loch Rhua Hait ! »
Somerled sourit. Il y a cinq ans qu’il ne l’a plus entendue, la voix rocailleuse et cassée du vieux Rory McLean, mais il la reconnaît aussitôt. Elle fait partie du décor qu’il revoyait en rêve ; il la retrouve avec bonheur, cette voix qui, la première, accueille l’enfant prodigue, comme la main d’un ami tendue par-dessus les années et fait, en un instant, surgir les souvenirs. C’est, avec elle, le pays natal qu’il retrouve et le passé qu’elle vient d’évoquer entoure le voyageur, amical et familier.
Pour entrevoir le vieux Rory, Somerled saute sur le quai. Il est là, tel qu’il s’attendait à le voir, longue et maigre silhouette, à peine voûtée, dans l’uniforme sombre aux galons d’argent, un drapeau dans une main, un fanal dans l’autre, et il répète : « Loch Rhua Hait ! » en criant le nom de cette station insignifiante du ton dont il annoncerait : « Buckingham » ou « Balmoral ».
Le voyageur s’approche rapidement du chef de gare et lui lance :
— Bonjour, Rory !
— Les yeux d’un bleu délavé qui regardent Somerled n’expriment, d’abord, rien d’autre que la surprise. Surprise d’entendre un inconnu l’aborder ainsi. Puis ils se ferment. Le vieillard fouille dans ses souvenirs, tandis que le voyageur, déçu, presque peiné, s’apprête à dire son nom. Mais un sourire éclaire la face ridée.
— Mais... c’est Mr Somerled ! lance la voix rocailleuse qui, semble-t-il, ne sait que crier, par la force d’une trop longue habitude. Par le Ciel, je ne m’attendais pas à vous voir descendre du Night Higlander ! Et sans bagages, encore !
— Je ne rentre pas les mains vides, j’ai deux valises... et elles vont filer au bout de l’Ecosse, si je ne m’en soucie pas, déclare le voyageur, qui s’empresse d’aller chercher ses bagages dans le couloir où il les a laissés. Quand il saute sur le quai, Rory a déjà déployé le drapeau qui donnera le départ au Night Higlander. Son bras se lève et le nuage de vapeur qui enveloppe aussitôt l’énorme locomotive se mêle pour un instant à la brume déchiquetée. Le long train défile lentement devant les deux hommes, assourdis par le vacarme, puis il prend de la vitesse tandis que la lanterne du wagon de queue s’estompe dans le lointain. Le chef de gare se tourne alors vers le voyageur qui a déposé les lourdes valises sur l’asphalte du quai. Il semble se rendre compte que Somerled est déçu de ne pas avoir été reconnu au premier coup d’œil et, comme en s’excusant, il soupire :
— Mes pauvres yeux ne sont plus, hélas ! ce qu’ils étaient quand vous nous avez quittés ! Et puis, avec cette brume que le loch nous envoie, on ne distingue pas très bien les choses. Voulezvous entrer dans mon bureau ? Nous boirons une tasse de thé, en attendant le départ du bus.
— Le voyageur sursaute. Il semble à la fois indigné et incrédule. Il demande, d’un ton qui appelle le démenti :
— La voiture n’est donc pas encore arrivée ?
— Non... Je l’aurais vue, ou entendue. Il n’y a que l’auto des postes. Vous n’aurez pas longtemps à attendre.
Somerled, en quelques pas rapides, gagne la cour. Il n’y voit que la grande voiture rouge, assez délabrée, portant l’écusson des postes de Sa Majesté, et il retient avec peine une exclamation de dépit. C’est ainsi qu’on le reçoit, après cinq ans d’absence ? On n’a pas même pris la peine de venir le chercher en voiture ! On sait fort bien, pourtant, qu’il arrive par ce train, et que le bus, lent et incommode, est peu digne de conduire un Sinclair d’Ardlair au château de ses ancêtres. Pas de voiture. Pas même un mot, pour expliquer la raison de cette absence. « Ne serais-je pas le bienvenu à la maison ? » se demande-t-il, pour la première fois.
Certes, à présent, c’est le domaine de Thorquil. Lui n’est que le cadet. Pour sa mère, il le fut toujours, pour elle dont toute la vie fut consacrée au fils aîné. Pour son père, Somerled comptait beaucoup, mais il est mort, à présent, et Thorquil a chaussé ses bottes. Ardlair et ce qu’il reste de la fortune appartiennent à son frère. Certes, il reste l’héritier légitime mais, il en est convaincu, pas pour longtemps : seulement jusqu’à ce que Thorquil se soit marié et qu’un fils lui soit né, pour lui succéder.
Il se mariera et il aura un fils, parce que c’est son devoir. Il doit cela à la famille, au nom, au château. Jamais Thorquil ne tentera de se dérober à un devoir. Somerled sait que son frère préférerait demeurer célibataire, mais qu’il fera taire ses aspirations profondes. Il prendra femme, pour avoir des enfants. Et femme riche, pour avoir de l’argent, pour maintenir le rang de la famille et redorer le blason. Ce sont deux devoirs auquel l’aîné des Sinclair est astreint.
« Thorquil épousera une femme riche ». Durant toute leur enfance les deux frères ont entendu cette phrase dans la bouche de leur mère. Ils en riaient, alors. Somerled surtout, puisque, au fond, cela ne le concernait pas. Mais Thorquil en a été marqué jusqu’aux moelles. Jamais il n’a osé imaginer qu’il pourrait ne pas se marier, ou ne pas épouser une dot.
Certes, Ardlair exige de l’argent. Beaucoup d’argent, et le Seigneur du lieu ne peut, sans déroger, s’en procurer qu’en s’alliant à une fille bien nantie des biens de ce monde et prête à troquer l’or plébéien contre le titre impécunieux. Il s’en est toujours trouvé, dans le commerce et la finance, disposées à ce marché où l’amour ne trouve guère son compte.
« Thorquil épousera une femme riche. » Il ne l’oubliera pas. S’il faisait mine de ne pas s’en souvenir, sa mère saurait bien le lui rappeler.
Somerled retourne dans sa tête ces pensées découragées, tandis qu’il revient à longues enjambées vers le bureau de Rory. Puisqu’il faut attendre le départ du bus, autant que ce soit en compagnie du vieillard amical, et en parlant du pays, qui pour l’heure grimace plus qu’il ne sourit au fils retrouvé.
— Je suis heureux de vous servir la première tasse de thé que vous boirez sur notre bonne terre d’Ecosse, déclare le chef de gare. Peut-être aurions-nous dû fêter cela avec un verre d’alcool du cru, mais la Compagnie ne permet pas à ses agents de boire pendant leur service et je suis de service, bien que le prochain train ne doive passer que dans deux heures !
— De toute façon, il serait bien tôt pour boire du whisky, répond Somerled. Votre thé me fait plaisir. Je ne voudrais pas vous inciter à violer les règlements.
— Vous n’y parviendrez pas... Je n’ai jamais mérité le moindre blâme depuis que je suis sous l’uniforme et je ne commencerais pas à mon âge. Voici quarante ans que je suis chef de cette station. Je vous ai vu bébé, dans les bras de la chère Elspeth.
— J’espère qu’elle se porte bien. Je serai heureux de la revoir.
Sur le visage du vieillard passe un nuage. Il dit, comme à regret, en pesant chaque mot, soucieux sans doute de ne pas laisser supposer, fûtce par l’intonation, qu’il se permettrait de juger, ou peut-être de blamer :
— Si vous voulez revoir Elspeth, sir, il faudra aller à Edimbourg. Elle n’est plus au château depuis des années. Elle ne fait plus partie du personnel.
— Elspeth est partie ? Ce n’est pas possible... Elspeth !
Il avait sur la langue une question, mais il la retint. On n’interroge pas un étranger sur les raisons qui ont motivé le départ d’un domestique de la famille. Il baissa la tête, sans parvenir à cacher son désarroi. Rory reprit, après un instant :
— Il y a eu beaucoup de changements, dans le personnel. Vous ne retrouverez guère de visages familiers.
— Fergus est encore là, au moins ? lança-t-il d’un ton inquiet.
— Non... Il est parti, lui aussi.
— Elspeth ! Fergus ! C’est incroyable ! Tous ceux que j’ai connus sont partis.
Il ne formula pas la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi ? » Il se sentait perdre pied. Il n’avait imaginé rien de tel. Aucune des rares lettres de son frère ne laissait même supposer un pareil bouleversement dans la demeure familiale. Parce qu’il ne pouvait pas comprendre et que ses idées se brouillaient dans sa tête, il demanda, plaintivement :
— Les règlements ferroviaires vous interdisentils absolument d’avoir, en réserve, un peu d’alcool ? Pour les cas urgents ? Il me faut quelque chose de plus fort que du thé, pour supporter ce choc.
— J’ai bien un flacon de whisky, dans la pharmacie. Pour les cas urgents, comme vous dites. Je crains qu’il ne soit pas fameux, mais c’est tout de même du whisky d’Ecosse.
Il se leva et alla ouvrir une armoire. Somerled lui fut reconnaissant de ne poser aucune question, de ne faire aucun commentaire. Il comprenait, naturellement, et sans doute savait-il bien des choses que Somerled ignorait encore, mais il refusait de profiter des circonstances pour s’immiscer dans la vie privée des gens du château. Sans plus rien dire, il déposa un grand verre sur le bureau, y versa une généreuse ration d’alcool. Somerled en vida en quelques gorgées la plus grande partie, ne fit aucun commentaire et se replongea dans ses pensées.
Des pensées bizarres, et mélancoliques. Fergus parti ! Elspeth partie ! Pourquoi ? Est-il possible que l’argent manque à ce point ? Beaucoup de changements, a dit Rory. Certes, les droits de succession représentent une énorme part d’un héritage et quand celui-ci se compose surtout de terres et de bâtiments qui ne rapportent presque aucun loyer, il est difficile de satisfaire aux exigences du fisc. Mais Elspeth ? Mais Fergus ? Si Thorquil avait été incapable de régler leurs gages, ils seraient, sans se plaindre, restés au château sans toucher de salaire.
Une pensée, soudain, se fait jour dans l’esprit de Somerled, mais une pensée tellement absurde qu’il la repousse avec dédain. Il ne s’est pas moins demandé si c’est faute de quelqu’un pour conduire la voiture, ou même, faute de voiture, qu’on n’est pas venu le prendre à la station. Il sourit, d’un sourire désabusé et affirme : « Il est impossible que mon frère en soit là ! »
Il a laissé ces paroles échapper à ses lèvres tendues, mais Rory semble ne pas avoir entendu. En tout cas, il ne questionne pas, Somerled ne veut pas l’interroger et le silence s’établit entre les murs du petit bureau.
La sonnerie du téléphone fait sursauter les deux hommes. Rory décroche le récepteur, écoute, demande : « Voulez-vous lui parler ? »
On ne le désire pas, sans doute. Le chef de gare annonce à Somerled :
— C’était miss Graham. Elle n’arrivera pas avant vingt minutes. La voiture est tombée en panne...
— Qui est miss Graham ? demande-t-il, sans intérêt.
— C’est une jeune personne qui travaille chez votre frère. Une sorte de dame de compagnie, je crois. Elle aide Sa Seigneurie à faire marcher la maison.
Une dame de compagnie ? Qui aide sa mère à diriger la maison ? Vraiment, Somerled ne comprend plus. Sa mère n’a jamais eu besoin qu’on l’aide ! Elle fut toujours merveilleusement capable de faire marcher la maisonnée, et jalouse de le faire seule. En quoi cette jeune personne lui est-elle utile ? À moins qu’elle ne soit là pour Thorquil ? Peut-être est-ce la femme richement dotée, qu’il épousera bientôt, et qui, par avance, se familiarise avec l’existence qui sera la sienne. Rory le sait, sans doute, mais Somerled n’ose pas le questionner.Il dit simplement :
— Vous devrez donc supporter ma présence pendant vingt minutes encore. Je tâcherai de ne pas vous gêner.
— Vous ne me gênerez pas du tout. Je n’ai rien à faire avant le passage du train de 8 h. 15. Il n’y a généralement aucun voyageur pour Loch Rhua Hait et je n’espère pas vendre un seul billet. Les affaires ne marchent jamais bien fort, à cette gare. S’il en était de même partout sur le réseau, la Compagnie pourrait déposer son bilan.
— Somerled est reconnaissant au vieillard d’amorcer une discussion qui ne touche en rien au château, à la famille, aux changements que Thorquil a fait subir à l’ordre ancien. Ils se mettent à parler de la situation des chemins de fer, sujet capable d’alimenter la conversation jusqu’à l’arrivée de cette miss Graham qui se fait attendre. Un quart d’heure passe ainsi, puis vingt minutes. Et, par la petite fenêtre Somerled voit passer une immense voiture, qui reluit dans le soleil levant de tous ses chromes astiqués avec soin et de sa peinture sans une tache. Une jeune femme est au volant. A côté d’elle, un chauffeur en livrée se tient raide et immobile comme à la parade.
— A qui est cette Rolls ? demanda Somerled, incrédule. Pas à mon frère, pourtant ? Et cette jeune fille n’est pas miss Graham, je suppose.
— C’est la voiture de Mr Jonathan Oakroyd, et c’est miss Jennifer Oakroyd qui conduit, répond Rory. Mr Oakroyd est un financier qui vient d’acheter Loss House. Il voulait Ardlair aussi, mais votre frère a refusé de vendre.
Il ne donne pas d’autres détails. Il n’ajoute pas : « naturellement ! » L’idée que le baron d’Ardlair pourrait vendre le château de ses ancêtres ne lui est même pas venue. Il ne précise pas non plus « Mr Oakroyd est riche... » Cela va de soi. Qui, s’il n’est millionnaire, envisagerait d’acheter deux propriétés qui ne rapportent rien ? D’ailleurs, l’énorme Rolls, le chauffeur en livrée, proclament l’opulence. On sent la fortune, la situation sociale assurée, un peu ostentatoire même.
Pourtant miss Jennifer Oakroyd, une fois qu’elle est descendue de la somptueuse limousine, semble bien quelconque. Modeste ? Effacée, plutôt. On ne se retournerait certes pas pour lui accorder un second regard. Sauf, bien sûr, quand on sait qu’elle est la fille d’un roi de la finance.
Rory se précipite au guichet. Contrairement à ce qu’il supposait, il va vendre un billet, ce matin. Somerled quitte le bureau et fait quelques pas dans la cour de la gare. Il ne peut s’empêcher d’admirer la voiture, tandis qu’il n’a jeté qu’un coup d’œil rapide et indifférent à la conductrice. Il a seulement remarqué qu’elle est de petite taille, mince, et que ses vêtements, quoique bien coupés et certainement fort coûteux, dénotent bien peu de recherche. Visiblement, elle ne se soucie pas le moins du monde d’être élégante. On dirait, même, qu’elle s’efforce de bannir de sa tenue comme de sa toilette tout ce qui pourrait attirer l’attention. Une fille insignifiante. Etrange pour une fille si riche !
Somerled sait bien que, par la force des choses, il fera sa connaissance. Son père est, à présent, le plus proche voisin de Thorquil. Il a acheté Loss House ; il désirait acquérir aussi le château. Un beau parti, pour le baron ruiné, que cette Jennifer. Thorquil, forcément, y a pensé. De lui même, ou parce que sa mère le lui a dit. « Peutêtre sont-ils déjà fiancés, pense-t-il. Rory ne m’en a rien dit, mais il doit savoir. »
Il ne va pourtant pas interroger le vieillard. Au château, il apprendra bien vite quelle est exactement la situation. « Si j’y arrive un jour, grommelle-t-il, avec cette miss Graham qui semble avoir oublié qu’elle est chargée de venir me chercher : « Je pense qu’au lieu de l’attendre jusqu’à ce soir, je serais sage de téléphoner à Cameron de m’envoyer un taxi. »
Il se remet à marcher de long en large dans la petite cour. Soudain, on l’appelle. Il se retourne et voit en face de lui miss Jennifer elle-même, qui le regarde, en rougissant un peu. Etrange. De nos jours, les jeunes filles ne rougissent pas si facilement. Les filles de millionnaires, surtout.
« Elle a dit : « Excusez-moi, sir. » Somerled retire son chapeau et attend.
Vue de près, elle est beaucoup mieux qu’il ne l’avait cru. Ses yeux bruns pétillent d’intelligence. De grands yeux, très beaux, qui regardent en face, mais sans aucune arrogance. Elle dit d’une voix douce, cultivée : « Rory McLean m’a fait part du contretemps qui s’est produit, avec votre voiture. Peut-être accepterez-vous que mon chauffeur vous conduise chez vous ? Ce ne serait qu’un très petit détour, nous sommes voisins. Je suis Jennifer Oakroyd. Mon père habite Loss House. »
Somerled s’incline. Il est surpris. Perplexe, même. Ah ! s’il savait où en sont les choses, entre les nouveaux venus et la famille Sinclair, il lui serait facile de répondre, mais il craint de commettre un impair. Et il y a, aussi, cette miss Graham, qui doit venir le chercher mais semble incroyablement insoucieuse de l’heure. Cette miss Graham qu’il ne sait où situer, chez son frère. Est-elle une domestique ? Une « dame de compagnie », comme le suggère le vieux Rory ? Ou... quoi ?
Il se décide à décliner l’offre de la jeune millionnaire et il explique :
— Je ne suis pas en détresse ! Pas vraiment ! J’ignore ce qu’à pu vous raconter ce brave Rory, mais il ne s’est rien produit de plus gravé qu’un incident mécanique, qui a retardé miss Graham. Elle va certainement arriver d’un instant à l’autre.
— Sur le visage de Jennifer, une ombre a passé, fugitive. Pendant une seconde peut-être, l’éclat des yeux bruns s’est voilé. Cela suffit à Somerled pour conclure : « Elle ne l’aime pas ! » Il n’a pas le temps de se demander si la jeune fille a interrogé le chef de gare ou s’il lui a spontanément fait part de l’embarras dans lequel le retard de la voiture a mis le jeune homme. Jennifer enchaîne, d’un ton qui exprime, imperceptiblement, une compréhension un peu apitoyée :
— Naturellement, si miss Graham a pris la peine d’accomplir ce long trajet pour venir vous chercher, il serait discourtois de la laisser rentrer seule à Ardlair. Je ne savais pas que ce serait Allison qui viendrait. McLean m’a simplement dit que votre voiture n’arrivait pas, et j’ai cru pouvoir vous offrir la mienne.
— C’était vraiment très aimable de votre part, miss Oakroyd.
— Mais non... C’était tout naturel, entre voisins.
Un coup de sifflet strident déchire le calme de la petite station. Jennifer se hâte de prendre congé, en disant encore :
— Johnson est à votre disposition, si quelque chose retenait miss Graham. A bientôt, sans doute.
Elle s’éloigne d’un pas rapide. Somerled la suit des yeux. Il la voit monter dans le wagon, où le chauffeur a déposé une valise. Une seule, et Jennifer a dit : « A bientôt ! » Elle habite donc à Loss House et va simplement passer quelques jours dans la capitale. Elle reviendra avant que Somerled soit parti...
« Elle peut bien aller à Londres, ou ailleurs, et y rester ! se gourmande le jeune homme, fâché d’avoir laissé ses pensées s’attacher à cette étrangère. En quoi cela doit-il m’importer, qu’elle soit en Ecosse ou à Londres ? Ce qui m’importe, pour l’instant, c’est plutôt de savoir ce que peut bien faire cette miss Graham, cette autre inconnue que miss Oakroyd, qui ne l’aime pas, appelle simplement : Allison. »
Le train quitte la station ; le chauffeur regagne sa voiture, s’assied derrière le volant, mais ne part pas. Jennifer a, évidemment, ordonné à Johnson de se tenir à la disposition du jeune homme. Très aimable, vraiment. Mais pourquoi y verrait-il davantage qu’un geste de courtoisie, normal entre voisins ? Cela ne veut pas dire qu’il existe d’autres raisons ; ni d’autres liens entre les habitants de Loss House et ceux d’Ardlair. Pourquoi y en aurait-il ? Les Oakroyd sont anglais, donc, pour les Ecossais, un peu des étrangers, pour ne pas dire des intrus. Et des plébéiens ! Ils ont acheté un domaine, c’est vrai. Mais cela ne suffit pas.
Surgie du tréfonds de son esprit, une pensée vient assaillir Somerled : « Ils sont millionnaires. Cela suffit, peut-être. Thorquil doit épouser une dot ! »
Il n’a pas le temps de s’attarder à ce que suggère cette réflexion. Toussotante, crachotante, avançant par saccades, une voiture vient d’entrer dans la cour. Une voiture ancienne, qu’on n’oserait comparer à l’éclatante Rolls de Jennifer. Une voiture que Somerled reconnaît aussitôt. Elle est conduite par une jeune personne qu’il n’a jamais vue, mais qui ne peut être que miss Graham.
L’auto s’immobilise. Parce qu’on a coupé le contact, ou parce que le moteur est vraiment à bout de souffle. Somerled s’avance. En guise de salut, la conductrice lui lance :
— Cette damnée voiture n’a pas cessé de me jouer des tours, depuis Ardlair. C’est miracle que j’aie pu arriver jusqu’ici. Et ce sera un plus grand miracle encore que je puisse la faire repartir ! Il faut appeler un garagiste et prier pour qu’il la répare tout de suite.
— Elle ne s’est pas présentée. Elle ne s’est pas excusée pour avoir fait attendre si longtemps le frère de son patron. Etrange, si elle n’est vraiment qu’une employée... Somerled décide d’imiter cette désinvolture. Il dit simplement :
— Ou bien vous n’avez plus d’essence, ou bien le filtre est bouché. Il n’y a pas besoin d’un mécanicien pour arranger ça !
Il soulève le capot. Allison lance, d’un ton un peu méprisant :
— Vous y connaissez donc quelque chose, dans les moteurs ?
— Assez pour déboucher un tuyau, en tout cas, ou pour remplir un réservoir. Que dit la jauge ?
— Trois quarts. Je ne connais peut-être pas grand-chose aux moteurs, mais je sais quand même qu’ils brûlent de l’essence...
Somerled ne répond pas. Il lui a suffi de jeter un coup d’œil sur le filtre pour voir que la cuve est pleine de sédiment. Il desserre l’écrou, vide le verre, l’essuie soigneusement, le replace sans dire un mot, tandis que miss Graham attend, l’air ennuyé.
— Voulez-vous mettre le contact, sans lancer le moteur, dit-il bientôt.
La pompe fait entendre son claquement, la cuve se remplit. Le mal est réparé. Somerled se prépare à rabaisser le capot, mais Allison lui crie, railleuse :
— Attendez donc une minute ! Il faut beaucoup d’optimisme pour croire que vous avez pu remettre le moteur en ordre en si peu de temps. Moi, je n’y crois pas.
Il la regarde, sans sourire, rabat le couvercle, s’essuie ostensiblement les mains et dit froidement :
— Il vous suffira d’appuyer sur le bouton pour être convaincue.
— Le moteur part immédiatement. Allison, incrédule, donne quelques vigoureux coups d’accélérateur. Manifestement, elle s’attend à un nouvel arrêt, mais le ronronnement devient un grondement, qui s’amplifie, docile, et continue, rassurant. Somerled ouvre la portière s’assied à côté de la conductrice, qui hausse les épaules et déclare :
— Ne triomphez pas trop tôt. C’est la même chose, chaque fois que le moteur s’est reposé. Il repart normalement, mais il s’arrête après quelques minutes.
— Il ne s’arrêtera plus, désormais. Vous pouvez aller...
— Si vous le dites ! riposte Allison, sarcastique. J’espère que vous avez une douzaine ou deux de mouchoirs, pour vous essuyer les doigts chaque fois qu’il faudra recommencer cette comédie.
Elle embraye, passe les vitesses, surprise de sentir que le moteur tourne rond, sort de la cour et s’engage sur la grand-route. Prudemment, d’abord. Puis elle force l’allure. A côté d’elle, Somerled, les yeux fermés, montre qu’il se désintéresse et de la voiture et de la conductrice ; manifestement, cette désinvolture irrite la jeune fille. Après quelques milles, elle dit soudain :
— Ou bien le Ciel vous est venu en aide, ou bien vous connaissez vraiment quelque chose aux moteurs.
— Oh ! ce n’était rien du tout. Un filtre obstrué, l’essence qui n’arrivait pas suffisamment au carburateur. On s’en rendait compte tout de suite. Donc, ne me tressez pas de couronnes. C’était aussi simple à découvrir que facile à réparer.
Cette fois, elle tourne la tête, glisse à son voisin un regard réprobateur, et riposte, sèchement :
— Vous y connaissez peut-être quelque chose, dans la façon de déboucher un tuyau encrassé, mais vous êtes très ignorant en psychologie. Croyez-vous que ça me fasse plaisir de vous entendre dire que, si je n’avais pas été une sotte, j’aurais fort bien pu remédier à cette panne, au lieu de perdre deux heures à rouler comme un escargot ? D’ailleurs, votre modestie, si c’est de la modestie, vous dessert. Je ne vous admire plus du tout, depuis que vous avez avoué que n’importe qui pouvait faire ce que vous avez fait.
Somerled s’irrite de plus en plus. Cette jeune personne arrogante prétend-elle lui donner des leçons ? Elle ? La dame de compagnie de sa mère ! De quel ton lui parle-t-elle ? Il prend sa voix la plus distante pour demander :
— Ne pouvez-vous pas imaginer qu’un homme puisse ne pas souhaiter votre admiration ?
C’est presque une déclaration de guerre, mais, pense-t-il, cette pécore l’a bien cherchée. Il tourne la tête et regarde défiler les arbres, le long de la route. Elle ne dit rien. Simplement, son pied appuie plus fort sur l’accélérateur. Cela ne contrarie pas du tout Somerled, qui ne désire pas voir se prolonger le tête-à-tête. Miss Graham aurait pu lui donner des renseignements sur les changements intervenus au château. Bah ! Il attendra, et son frère lui dira ce qu’il doit savoir. Bientôt, il saura exactement quelle est la place de cette miss Graham à Ardlair.
Ils roulent en silence, dans la lumière du matin. Il y a vingt milles, entre la gare et le château, mais la route ne semble pas longue. A chaque tournant, Somerled s’émeut et s’émerveille de retrouver les points de vue familiers, tellement pareils à ses souvenirs qu’il se demande s’il a bien été absent cinq longues années.
Son père est mort. Sa mère se fait aider par une dame de compagnie. Thorquil est devenu baron et le maître d’Ardlair. De grands changements sont intervenus, dans le personnel. Mais le pays est demeuré le même. Il sourit pour accueillir l’enfant prodigue. Somerled se sent heureux de retrouver la terre natale.
Mais les gens — sa famille — se réjouit-elle de revoir l’exilé ?
Il n’en est plus tout à fait sûr, à présent.
CHAPITRE II
Lorsqu’elle eut achevé de déjeuner, seule à une des petites tables du wagon restaurant, Jennifer regagna lentement son compartiment.
Elle a fait traîner le repas autant qu’elle a pu. C’est que le trajet est long, du comté de Ross jusqu’à Londres, et le temps passe bien lentement quand on est seule.
Elle n’a aucune bonne raison de se rendre dans la capitale. Elle se plaît mieux à Loss House qu’en ville, mais elle a obéi à son père. Elle obéit toujours. Presque toujours à contrecœur : elle se soumet pour ne pas multiplier les causes de conflits, déjà si nombreuses.
Elle s’est assise dans son coin, a attiré à elle la demi-douzaine de magazines destinés à meubler les longues heures du voyage, les a feuilletés distraitement en s’efforçant de s’intéresser aux photos et aux dessins, puis, bientôt, les a repoussés sur la banquette. Elle préfère rêver.
Non pas que ses pensées soient joyeuses et qu’elle les retrouve avec plaisir. Elle a, bien au contraire, de fortes raisons de s’estimer très malheureuse. A cause de son père, de son habitude de décider, sans la consulter, de ce que sa fille doit faire, ne pas faire, penser ou ne pas penser. Jennifer sait bien qu’elle a déçu les espérances du financier, qu’elle n’est pas, qu’elle ne sera jamais, ce qu’il ambitionnait. Mais ses exigences ne sont-elles pas démesurées ? Elle soupire, une fois de plus, voudrait prendre quelqu’un à témoin de l’injustice qu’on lui fait, mais se borne à murmurer pour elle seule :
« Est-ce ma faute, à moi, si je n’ai pas beaucoup de volonté ni d’ambition ? Mes capacités sont limitées et je ne suis qu’une femme ! Je ne puis remplacer le fils qu’il aurait voulu avoir, un fils tout pareil à lui, digne de lui succéder ! Moi, je ressemble à ma mère : douce, passive, affectueuse et romanesque. »
Sa mère ? Elle n’en a gardé aucun souvenir, elle n’en sait rien d’autre que ce que lui dit parfois son père, quand il lui reproche, précisément, d’être comme elle, non comme lui. Mais, pourtant, il l’a épousée ; il ne lui a sans doute pas demandé d’être une femme d’affaires, mais seulement d’être une femme. Sa femme. Il a bien dû l’aimer. Donc, à un certain moment de sa vie, l’amour, même pour lui, était une réalité.
Aujourd’hui, hélas ! il en va tout autrement ; Jonathan Oakroyd est un homme dur, cynique, ambitieux, pour qui les sentiments ne comptent pas. Sa surprenante réussite matérielle l’a confirmé dans sa conviction que, pour parvenir, il faut être ainsi et il est devenu tout à fait incapable de comprendre que sa fille puisse être d’un avis différent. Fille unique d’un important financier, il est convaincu qu’elle ne doit, comme lui, penser à rien d’autre qu’à gravir quelques degrés de plus qu’il ne l’a fait lui-même du long escalier qui conduit les forts jusqu’au sommet. Les forts ! Ceux qui ne s’embarrassent pas de bêtises telles que l’amour ! Ceux qui ne se laissent pas arrêter par les sentiments.