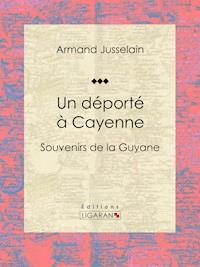
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au mois de février 1854, la Cérès, mouillée en rade de Toulon, attendait les derniers ordres pour prendre la mer. Ce bâtiment est un des deux transports-mixtes qui, encore aujourd'hui, font chaque année le tour de nos possessions d'Amérique. Ils ont pour mission de rapatrier les employés du Gouvernement et les militaires, dont la santé est compromise par le climat des Colonies et auxquels un plus long séjour dans ces pays pourrait devenir fatal..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076424
©Ligaran 2015
Au mois de février 1854, la Cérès, mouillée en rade de Toulon, attendait les derniers ordres pour prendre la mer.
Ce bâtiment est un des deux transports-mixtes qui, encore aujourd’hui, font chaque année le tour de nos possessions d’Amérique. Ils ont pour mission de rapatrier les employés du Gouvernement et les militaires, dont la santé est compromise par le climat des Colonies et auxquels un plus long séjour dans ces pays pourrait devenir fatal. Cette destination toute spéciale leur a fait donner le nom de frégate-hôpital.
Ne vous attendez pas à mener sur ces navires la vie agréable que promettent, trop facilement du reste, aux voyageurs les peintres de la mer. Au départ, on quitte la France pour de longues années ; quelquefois pour toujours. Au retour, la joie de revoir la patrie est tempérée souvent par vos propres souffrances, ou la vue des visages pâles et maladifs de la plupart des passagers. Il n’est pas rare alors que la traversée soit attristée par quelque funèbre cérémonie.
Appelé à tenir garnison à la Guyane, j’étais au nombre de ceux que la Cérès devait débarquer à Cayenne. Ce départ pour une colonie lointaine, dont je ne pouvais revenir que quatre années après, ne me souriait pas, surtout en ce moment. On parlait dans nos ports de mer, de guerre avec les Russes, et les officiers que leur tour de service désignait pour les Colonies, enviaient le sort de leurs camarades qui, plus heureux, ne quittaient pas la France.
Aussi tentai-je quelques démarches pour obtenir une permutation. Mais ma demande ne fut pas favorablement accueillie : force me fut donc de me résigner à prendre le chemin de la Guyane.
Mes notions sur ce pays étaient alors assez vagues. J’avais pu me renseigner cependant auprès de personnes qui y avaient résidé. Mais on ne vit jamais, sur un même sujet, d’opinions plus contradictoires. Après des raisons fort spécieuses à l’appui de leur dire : « C’est un enfer, concluaient les uns. C’est un paradis, affirmaient les autres. » Suspendu ainsi entre le ciel et l’enfer, un malheureux désire savoir au plus tôt de quel côté il tombera. Rien ne pèse comme l’incertitude. Pour en sortir, je fis, pendant le peu de jours qu’avant mon départ je passai à Paris, d’assez fréquentes stations à la bibliothèque impériale. J’espérais y trouver quelques données certaines sur les avantages et les inconvénients de ce pays trop décrié, pensais-je, par les uns, trop vanté, peut-être, par les autres.
Hélas ! Les quelques livres que je lus à la hâte ne firent qu’accroître mon embarras.
Dans quelques-uns, écrits par des hommes qui avaient fait un long séjour à la Guyane, je voyais que, « le pays est très sain, même pour les Européens ; qu’il jouit d’une fertilité extraordinaire, etc., etc… »
Parmi ces narrateurs optimistes, j’en distinguai un tout particulièrement. C’était un vétéran blanchi sous le harnais, le général d’artillerie Bernard, qui, après une carrière honorablement remplie, s’était retiré dans celle Thébaïde. Débutant alors dans le métier des armes et animé de la foi des néophytes, j’étais, certes, disposé à tenir pour bon le témoignage de ce vieux guerrier.
Venaient ensuite des écrivains, qui, renchérissant sur les premiers, soutenaient que « la Guyane pourrait être, si le Gouvernement y portait ses soins, une source inépuisable de richesse pour la mère-patrie. » Ceux-ci, j’aurais souhaité, on le croira sans peine, voir la raison de leur côté.
Mais voici que d’autres, parmi lesquels des administrateurs remarquables, comme Malouet, et quelques victimes de nos dissensions politiques, dont les récits sont empreints d’un accent de résignation philosophique de nature à dissiper toute défiance, représentaient, au contraire, la Guyane comme une terre inhabitable pour la race blanche.
Barbé-Marbois, dans son Journal d’un Déporté non jugé, dit en propres termes : « La Guyane est pour notre race une vaste infirmerie, où tout l’art du médecin consiste à retarder la mort du malade. »
Qui croire ?… De guerre lasse, je pris le parti de ne m’en rapporter qu’à moi-même, et d’attendre pour démêler le vrai du faux que je fusse arrivé dans le pays.
Au milieu de ces divergences d’opinions, une chose me consolait heureusement, c’est que tous ces écrivains s’accordaient sur ce point, que la Guyane est une contrée presque inconnue, et qu’on y trouve une nature toute différente de la nôtre et fort curieuse à observer.
Un décret du 8 décembre 1851 avait désigné cette colonie comme lieu de transportation pour les repris de justice en rupture de banc, et les affiliés aux sociétés secrètes. Les déportés devaient être employés à la colonisation du pays. Donnant un plus grand développement à ce système, le Gouvernement l’avait étendu ensuite aux hommes condamnés aux travaux forcés dans la métropole, et aux individus d’origine africaine et asiatique, condamnés à la même peine et à la réclusion par les tribunaux de nos quatre grandes colonies.
L’œuvre nouvelle qui s’élaborait à la Guyane devait, je l’espérais du moins, appeler tous ceux qui voudraient y travailler, à parcourir le pays dans tous les sens, pour en étudier la configuration, le climat et les ressources. Il y avait, pour un officier jeune et animé du désir de bien faire, quelque chance d’y trouver un emploi plus utile et plus varié de son temps que dans nos monotones garnisons des Antilles.
Ma foi, pensai-je, puisque le sort contraire me force de quitter la France en ce moment, colonie pour colonie, autant être déporté à Cayenne qu’ailleurs.
Dès mon arrivée à Toulon, j’appris que la Cérès transportait à la Guyane un convoi de cinq-cents condamnés. La présence à bord de ces passagers tant soit peu exceptionnels pouvait nous valoir une traversée pittoresque. C’était, cette fois, une bonne fortune.
Le jour de l’appareillage, je ne manquai pas d’assister à l’embarquement de nos compagnons de route.
Un fort piquet de troupes d’infanterie de Marine gardait les principales issues du port et surveillait l’opération. Chaque condamné répondait à la porte du bagne à l’appel de son nom. Là, on lui retirait sa chaîne. Il ne gardait que le cercle de fer, la manille, qui lui entourait la cheville du pied. Cet anneau, signe d’alliance entre le bagne et l’homme, il ne devait le quitter qu’au jour du divorce ; c’est-à-dire, lors qu’il toucherait le sol de la Guyane.
Ces malheureux s’acheminaient tous gaiement, entre deux haies de soldats, vers les chaloupes qui les transportaient à bord de la Cérès. À leur arrivée sur le pont, on en faisait de nouveau l’appel. On les fouillait pour s’assurer qu’ils ne possédaient ni armes, ni matières combustibles. Ils descendaient ensuite, par le grand panneau, dans le faux-pont, qu’on avait disposé pour les recevoir.
À bâbord et à tribord, de fortes grilles le divisaient en deux longues salles, assez semblables à celles où l’on enferme, au Jardin des Plantes, les animaux féroces. Un couloir avait été ménagé entre elles, pour la surveillance et le service. Armées de sabres d’abordage, des sentinelles s’y promenaient déjà à notre arrivée. On avait placé, de distance en distance, de grands fanaux qui, contrairement aux usages établis sur les navires de guerre, devaient éclairer la scène a giorno, pendant toute la traversée.
En approchant de la frégate, nous avions remarqué encore que les sabords en avaient été garnis de solides barres de fer. Ce navire ressemblait ainsi à une prison flottante… Prison au départ, hôpital au retour : il devait être difficile d’y rêver au ciel bleu et aux brises parfumées des Tropiques.
À peine le dernier forçat embarqué, le 20 février, à dix heures du matin, la Cérès se hâta de lever l’ancre.
Les personnes qui avaient accompagné des officiers de la frégate ou quelque passager, furent invitées à regagner la terre. On se serrait les mains ; on s’embrassait, en disant : Au revoir ! Quelques-uns détournaient la tête pour essuyer une larme.
Les canots, qui n’appartenaient pas au navire, s’éloignèrent bientôt un à un. L’hélice commença à faire trembler le pont, et la Cérès se mit en mouvement.
Sur la dunette de la frégate, tous les yeux étaient tournés vers le rivage.
Qui a quitté, ne fût ce qu’une fois, la France n’oubliera jamais l’émotion qu’on éprouve, en voyant disparaître d’abord les amis, qui de la plage vous envoient un dernier adieu, puis les maisons, parmi lesquelles chacun cherche du regard celle où il laisse une partie de lui-même, au moins par le souvenir ; enfin, la terre, qui ne paraît plus bientôt que comme un nuage à l’horizon !… La vapeur a cela de bon, qu’en vous éloignant rapidement, elle abrège ces cruels moments…
Les premières heures qui suivent le départ sont tristes. Personne ne parle ; chacun s’isole dans sa douleur et ses regrets. Quelques vieux renards endurcis, plus rompus aux habitudes du bord, et qui savent que, là surtout, est vrai le proverbe : « Comme on fait son lit on se couche, » s’occupent seuls des petits travaux d’installation, destinés à leur assurer un gîte convenable pour le reste de la traversée.
Mais bientôt une émotion nouvelle s’empare de vous, qui absorbe toutes les autres : c’est celle du mal de mer. De quelque peu de coquetterie qu’on soit doué, on éprouve alors le besoin de se retirer dans sa cabine. Deux ou trois jours après, on en sort, le visage légèrement pâli. Sur le pont, on ne voit que gens consolés qui causent gaiement, on soupire une dernière fois, et l’on s’efforce d’oublier !…
Nous quittâmes la France par un temps splendide, qui nous favorisa jusqu’à notre arrivée à la Guyane. L’air de la Méditerranée est déjà tiède à la fin de février. Nous passâmes donc, sans une trop brusque transition, comme cela arrive, quand on part pendant l’hiver de Brest ou de Cherbourg, de nos latitudes froides à la zone intertropicale.
Au bout de quelques jours, la mer, calme comme un lac, était à peine ridée par les vents alises. On put ouvrir les sabords ; la batterie qu’occupaient les transportés se trouva dès lors continuellement aérée. Aussi quoique ces cinq-cents hommes fussent enfermés dans un espace relativement restreint, il y eut peu de malades, et nous eûmes la chance de ne jeter aucun cadavre à la mer pendant la traversée…
Il faut dire qu’on traitait ces condamnés avec beaucoup d’humanité. S’il était défendu aux soldats et aux matelots de leur adresser la parole sans nécessité, il leur était ordonné aussi, quand une circonstance quelconque exigeait qu’ils leur parlassent, de le faire sans brutalité. Pour la nourriture, ils recevaient, sauf le vin et l’eau-de-vie, la même ration que l’équipage. De plus, on n’eut pas recours une seule fois aux peines corporelles, naguère encore en usage dans la marine, et que les règlements autorisaient à appliquer ici. Il en résulta que pas la moindre tentative de révolte, pas la plus petite scène tragique ne vint rompre la monotonie de la traversée. J’en suis fâché pour le pittoresque qu’y eût gagné mon récit, tout se passa aussi paisiblement que si nous avions eu pour voisins les gens les plus vertueux du monde. Même, le dimanche, c’étaient deux d’entre eux qui servaient la messe, dite par l’aumônier de la frégate, tandis qu’une dizaine d’autres, sous la direction d’un des leurs, improvisé maître-de-chapelle, chantaient les louanges du Seigneur.
En voyant ces forçats si doucement traités, on pensait involontairement à d’autres exilés qui avaient suivi autrefois la même route, pour aborder aux mêmes rivages.
Ceux-là, c’étaient des hommes qui avaient occupé dans leur patrie les plus hautes positions sociales ; quelques-uns y avaient rendu d’illustres services.
Quelle différence pourtant, à soixante ans à peine d’intervalle, entre le sort des uns et celui des autres !
Lisez les mémoires de Barbé-Morbois, et vous verrez à quelles tortures ses compagnons d’infortune et lui étaient soumis. La plupart du temps, ils n’avaient pour nourriture que des vivres avariés. Souvent, ils souffraient cruellement de la faim.
Il y a dans ces mémoires une scène vulgaire, mais qui devient singulièrement émouvante, quand on considère quels en étaient les acteurs ; c’est celle où l’on voit des officiers du bord, touchés de leur misère, donner clandestinement à ces exilés, par une ouverture pratiquée dans la cloison, un « gigot » et quelques provisions.
Un autre déporté, le général Ramel, a peint aussi les souffrances de ces malheureuses victimes de nos discordes politiques : « Lorsqu’au huitième jour de notre traversée, dit-il, dans son Journal publié à Londres en 1799, on voulut bien nous laisser respirer pendant une heure chaque jour, trois seulement d’entre nous, Tronçon-Ducoudray, Pichegru et Lavilleheurnois, furent en état de profiter de cette permission. Tous les autres n’avaient plus assez de force pour sortir de l’entre-pont. Je fus moi-même vingt-huit jours sans pouvoir sortir de la fosse aux lions. »
Telles étaient, dès les premiers jours, les misères de ces infortunés, que Barbé-Marbois adressa au capitaine une lettre dans laquelle il demandait qu’avant de quitter la côte d’Espagne, on envoyât à terre un canot pour faire, aux frais des déportés, les provisions qui leur étaient indispensables.
« Il n’est pas possible, écrivait-il au commandant Delaporte, que vous ayez l’ordre de nous faire mourir de faim et nous devons croire que les barbaries que vous exercez contre nous sont un abus de votre autorité. Songez que vous pourrez vous en repentir un jour, que notre sang pèsera sur votre tête et que c’est peut-être à la France entière, mais certainement à nos familles, à nos pères et à nos fils que vous aurez à rendre compte de l’existence des hommes que le sort a mis entre vos mains. »
Le capitaine répondit : « Je n’ai point de vengeance à redouter. Je n’enverrai pas à terre ; je ne changerai rien aux ordres que j’ai donnés et je ferai sangler des coups de garcette au premier qui m’ennuiera par ses représentations. »
« Depuis que les maux violents causés par le mouvement des vagues avaient cessé, continue Ramel, la cruelle faim produisait parmi nous des effets différents… Le plus grand nombre étaient affaiblis, presque éteints, surtout Tronçon-Ducoudray, Laffon-Ladebat et Barthélemy, au contraire Barbé-Marbois, Willot et Dossonville avaient des accès de rage, et les aliments grossiers qu’ils prenaient en petite quantité ne faisaient qu’augmenter leur appétit dévorant.
Je me souviens dans ce moment d’un trait plus remarquable, un seul mot, un cri qui fit frémir notre féroce capitaine. Marbois se promenait sur le pont et souffrait de la faim, jusqu’à ne pouvoir plus se contenir. Le capitaine passa tout près de lui : « J’ai faim ! j’ai faim ! lui cria Marbois d’une voix forte, quoiqu’altérée » et le regardant avec des yeux étincelants : « J’ai faim ; donne-moi à manger, ou fais-moi jeter à la mer ! »
Après de pareilles tortures, ces exilés arrivaient à Cayenne dans le plus déplorable état.
Sur quatre-vingt-treize déportés qui se trouvaient sur la Charente, cinquante-cinq furent, pour cause de maladie, débarqués d’urgence à leur arrivée, et la seule corvette la Bayonnaise jetait huit cadavres à la mer pendant la traversée.
Il faut espérer que notre pays ne reverra jamais ces mauvais jours, que, conduit sagement par une main puissante à la liberté la plus complète, il en goûtera les bienfaits, sans en connaître désormais les tristes égarements. Ce que je puis assurer, dès à présent, c’est qu’on ne trouverait pas aujourd’hui, dans le corps de la marine, un seul officier pour exécuter ses instructions avec une telle barbarie.
La comparaison des traitements appliqués aux forçats en 1854 à ceux que subissaient, en 1797, des députés et des généraux ne vous semble-t-elle pas, ami lecteur, sans vouloir faire notre temps meilleur qu’il n’est, un assez éloquent plaidoyer en sa faveur ?
Les passagers, placés dans des situations moins exceptionnelles, trouveront d’autres changements à bord des bâtiments qui font, de nos jours, ces longues traversées.
Sur quelques rares navires du commerce, dont les capitaines sont de vieux loups de mer qui ont conservé les anciennes traditions, on cache encore soigneusement aux profanes la carte routière, sur laquelle est tracé chaque jour le chemin parcouru. La cabine où se calcule le point devient alors un sanctuaire. Le capitaine y va consulter le génie familier du navire… Le sextant, la boussole sont des instruments magiques ; la carte de Mercator, un parchemin cabalistique.
Il y a tantôt vingt-cinq ans, – j’étais alors un enfant, – je fis un voyage sur un navire marchand, où les choses ne se passaient pas autrement.
Tout ce mystère ne déplaisait pas à certaines imaginations. Il avait, pour le capitaine, cet inappréciable avantage de faire de lui une sorte de demi-dieu pour la plupart de ses passagers, et de soustraire à leur contrôle les erreurs auxquelles il était exposé. Moins le capitaine était rompu à la pratique de l’observation et aux calculs de la trigonométrie, plus il s’enveloppait ainsi d’un nuage aux yeux de tous. Ce n’était pas sans terreur qu’on consultait l’oracle, aux jours de tempête, sur les aspects du ciel et les variations du baromètre ! Et, comme cela arrive trop souvent en ce monde, plus il était ignorant, plus il était écouté.
Aujourd’hui qu’on exige des examens sérieux pour commander au long-cours, toutes ces petites manœuvres, fort innocentes au fond, ont disparu. Sur certains bâtiments, à bord des admirables steamers français, entre autres, qui font les voyages de New-York et des Antilles un bon exemple a même été donné : on affiche, chaque jour, dans le carré des passagers, en chiffres connus, la longitude, la latitude, le nombre de lieues parcourues, depuis le départ, et le nombre de celles qui restent à faire jusqu’à l’arrivée. C’est un usage qui devrait être imposé, soit dit en passant, à tous les navires qui prennent des passagers. Mais quel que soit celui sur lequel vous serez embarqué, si vous désirez connaître la situation du flot qui vous porte, interrogez poliment un des officiers, et je parie que la plupart du temps il s’empressera de vous satisfaire. Sur les bâtiments à vapeur, qui ne sont pas soumis comme les navires à voiles aux caprices du vent, vous pourrez savoir ainsi, à quelques heures près, le moment où vous poserez le pied sur le plancher des vaches, comme disent les matelots.
Le 26 mars, le commandant de la Cérès nous annonçait de lui-même que nous verrions le lendemain la terre des Guyanes. En effet, à la pointe du jour, la vigie, placée en tête du grand mat, cria : Terre !
À ce cri chacun quitta sa cabine avec un battement de cœur et se hâta de monter sur le pont. Plus d’une belle, dans son empressement, oublia, ce matin-là, les petits soins de coquetterie, dont elle ne s’était pas départie un seul instant depuis le premier jour de la traversée. Quelques-unes se montrèrent même dans des toilettes qui auraient provoqué le sourire en toute autre circonstance… Mais tous les yeux étaient fixés sur le même point. L’émotion avait gagné jusques aux transportés, qu’on voyait s’agiter derrière leurs grilles, comme des rats, pris dans une souricière.
La côte nous apparut d’abord comme une légère brume à l’horizon.
Vers six heures, la Cérès passa à quelque distance d’un rocher nu et assez élevé. On nous dit que c’était le Grand Connétable.
Quelques oiseaux de mer, qui y ont élu domicile, vinrent, en poussant des cris aigus, voltiger autour de la frégate.
Un peu plus loin, nous aperçûmes un autre rocher moins gros que le premier. C’est le Petit Connétable.
À neuf heures, nous laissions à notre gauche deux grands îlots couverts de végétation. Le premier nous parut en partie cultivé, et semé de groupes de constructions qui, examinées à la longue vue, nous parurent d’aspect assez gai. On l’appelle l’Îlet-la-Mère.
On y avait, en 1852, interné les déportés, dits politiques. À l’époque de notre arrivée, ils avaient été remplacés par les repris de justice, éloignés de France en vertu du décret de 1851, et les condamnés qui avaient fini leur peine depuis leur transportation à la Guyane.
La seconde île, l’Îlet-le-Père, n’a jamais été occupée par les transportés. On dut plus tard y interner les femmes, qu’on allait envoyer à la Guyane, quand l’invasion de la fièvre jaune vint s’opposer à ce projet. Cette île nous sembla moins étendue et beaucoup plus boisée que l’Îlet-la-Mère. Une seule case, habitée, nous dit-on, par un pilote, apparaît, comme une sentinelle, sur son sommet le plus élevé.
Auprès de ces îles, émergent de l’eau, semblables à des hémisphères d’égale grosseur, deux rochers, appelés les Mamelles, ou les Deux-Filles.
Les îles le Père, la Mère et les Deux-Filles forment, avec un petit rocher isolé, le Malingre, le groupe des îles de Rémire.
Malgré le spectacle divertissant que nous donnait ce petit archipel, qui semblait ainsi défiler sous nos yeux, nous avions hâte d’arriver aux Îles-du-Salut, où nous devions passer la nuit, avant de nous acheminer sur Cayenne. Mais la Cérès, qui n’avait rallumé que le matin ses feux, éteints depuis que nous avions franchi le détroit de Gibraltar, naviguait sous une faible pression, ne filant guère que six nœuds à l’heure.
Notre vieux commandant, dont on ne manqua pas de critiquer la prudence, avait donné l’ordre de n’avancer que la sonde à la main. « On ne doit naviguer dans ces parages, disait-il, en son langage de marin, qu’en ouvrant l’œil aux bossoirs. » La côte n’est formée généralement que de bancs de vase, sur lesquels poussent, noyées en partie à la marée haute, des plantes grasses, au maigre feuillage, appelées palétuviers. À part quelques collines peu élevées qui se montrent de loin en loin, la terre des Guyanes n’est dessinée à l’horizon que par cette ligne de chétifs arbrisseaux.
Les nombreux cours d’eau qui sillonnent le versant nord de l’Amérique méridionale déposent à leur embouchure un limon abondant. La mer qui baigne ces rivages, jaunâtre et bourbeuse, dissimule le fond à quelques pieds de la surface.
Rien n’annonce au voyageur qu’il a devant lui un grand continent. Quelle différence entre cet aspect misérable et le panorama saisissant qui frappe le navigateur, quand il aborde une de nos Antilles, et qu’il voit ces grands pitons dont les cimes boisées se perdent dans les nuages, et ces immenses champs de cannes déroulant jusqu’à la mer leurs riches tapis de verdure !
Là, tout révèle l’activité et la vie. Des bourgs se montrent de distance en distance. Les cheminées d’usine fument de toutes parts. Des canots de pêcheurs, avec leurs voiles blanches et leurs matelots noirs, sillonnent les eaux vives de la côte.
Ici, rien de tout cela, partout le silence et la solitude. Cette terre doit être telle aujourd’hui, plus déserte seulement, qu’elle apparut aux premiers Européens qui y abordèrent, il y a bientôt quatre siècles. Décidément, la première impression n’était pas favorable à la Guyane.
Vers deux heures de l’après-midi, nous aperçûmes enfin à l’horizon le groupe des Îles-du-Salut.
Les navires d’un fort tirant d’eau ne peuvent aller jusqu’à Cayenne ; c’est auprès de ces îles, éloignées de quatre lieues de la côte la plus voisine, celle de Kourou, qu’ils vont chercher un mouillage. Confondues d’abord en une seule, à cause de la faible distance qui les sépare, vers cinq heures, elles nous apparurent plus distinctement. Elles sont au nombre de trois. On les appelait autrefois Îles-du-Diable. Elles ne changèrent de nom qu’en 1763, à une époque qui jouit d’une triste célébrité dans l’histoire de la Guyane.
En cette année 1763, sous le ministère du duc de Choiseul, on ramassa sur le pavé de Paris et dans les départements de l’Est, douze ou treize mille malheureux qui, égarés par des prospectus mensongers, consentirent à partir pour Cayenne. Il paraîtrait qu’il s’agissait, par quelque brillant programme de colonisation, de faire diversion dans l’esprit public à la perte récente du Canada.
L’aspect que présenta la plage de Kourou a l’arrivée des immigrants, suffira pour donner une idée de l’inconcevable folie avec laquelle fut conduite cette expédition. Voici la description qu’en a faite un témoin oculaire :
« J’ai vu ces déserts aussi fréquentés que le Palais-Royal. Des dames en robes traînantes, des messieurs à plumet marchaient d’un pas léger jusqu’à l’anse, et Kourou offrit pendant un mois le coup d’œil le plus galant et le plus magnifique.
On y avait amené jusqu’à des filles de joie ; mais comme on avait été pris au dépourvu, les carbets n’étaient pas assez vastes, et trois ou quatre cents personnes logeaient ensemble. La peste commença ses ravages, les fièvres du pays s’y joignirent et la mort frappa indistinctement. Au bout de quelques mois, dix mille personnes périrent. »
Pendant qu’une aussi épouvantable catastrophe s’accomplissait à douze lieues de Cayenne, les deux chefs de l’expédition, MM. de Turgot et Chanvallon y étaient occupés de misérables querelles. Cependant cinq-cents malheureux, échappés à ce grand naufrage, obtinrent de se retirer aux Îles-du-Diable. Ils les appelèrent, dans leur reconnaissance, Îles-du-Salut.
À la plus grande, ils donnèrent le nom d’Île-Royale. (Elle a dû sans doute à son exiguïté, et à son éloignement du théâtre de nos dissensions politiques de n’avoir pas été débaptisée depuis cette époque).
Séparée de l’Île-Royale par un petit bras de mer, se voit à côté l’Île Saint-Joseph.
Ces deux îles sont très rocailleuses, et très élevées eu égard à leur peu d’étendue. Elles étaient autrefois couvertes d’arbres qu’on a abattus, depuis qu’on y a installé un établissement pénitentiaire. Le peu qui en reste suffit cependant pour leur donner un aspect qui nous parut plein de grâce et de fraîcheur. Il faut n’avoir vu pendant de longs jours que le ciel et l’eau, pour savoir avec quel plaisir, je dirai presque avec quelle émotion, l’œil se repose sur le moindre brin de verdure ! À une demi-lieue au large de ces deux îles, on distingue à peine, au ras de l’eau, sans la plus petite trace de végétation, un grand banc de sable, battu par tous les vents de la mer.
C’est l’Île-du-Diable, la seule du groupe qui ait conservé son nom.
Elle resta inhabitée pendant les premiers temps de la transportation. Puis, on y exila les hommes incorrigibles : « Ce qui joint à son singulier nom, disait plaisamment un aumônier des Îles-du-Salut, peut faire supposer que ce n’est pas là précisément un paradis terrestre. »
Quelque temps avant notre arrivée, on y avait transféré le peu de déportés politiques qui restaient encore à la Guyane. Il leur avait été délivré des outils et des matériaux pour construire leurs maisons. Un canot leur apportait des vivres deux fois par semaine.
« Voici une occasion unique, leur avait dit ironiquement le commandant des Îles-du-Salut, pour mettre en pratique les différents systèmes qui doivent assurer le bonheur de l’humanité, et vous installer tout à l’aise en république démocratique et sociale, voire même en phalanstère, si les idées de Fourier vous sourient ! davantage. »
Plaisanterie de mauvais goût, que nous traiterions sévèrement, s’il y avait eu quelques individus dignes d’inspirer la pitié parmi ces prétendus martyrs de leur foi politique. Mais de tous les déportés, c’étaient généralement les plus arrogants et les plus indisciplinés, et la plupart avaient subi, avant leur translation à la Guyane, une ou plusieurs condamnations infamantes.
Qu’un homme honorable se trouvât égaré parmi eux, le gouverneur l’autorisait à résider à Cayenne. Il y vivait parfaitement libre. Voulait-il même s’évader ? On ne prenait pas de bien grandes précautions pour s’opposer à son projet.
On en jugera par le fait suivant, que je tiens de la propre bouche d’un gouverneur de la Guyane : On vint l’avertir, un jour, qu’un des notables négociants de la colonie devait remettre à un membre du conseil municipal de la ville de B…, déporté en 1852, et interné à Cayenne, une somme assez considérable. Cet argent lui était envoyé par sa famille pour faciliter son évasion. Le gouverneur ferma les yeux. L’évasion s’opéra sans obstacle. Mais l’infortuné conseiller municipal avait eu la malencontreuse idée de s’associer, parmi ses compagnons, deux de ceux qu’il jugeait les plus dignes de partager avec lui la liberté. La barque qui les portait à Surinam chavira en route.
Que le hasard est grand ! Des trois évadés, un seul se noya. Ce fut le malheureux habitant de B…
Vers six heures du soir, seulement nous pûmes jeter l’ancre entre l’île Royale et l’île Saint-Joseph.
À quatre degrés de l’Équateur, le crépuscule ne dure guère et la nuit vient vite. On eut cependant le temps de mettre à terre nos cinq-cents transportés. Les officiers et les passagers pouvaient débarquer aussi, mais persuadés qu’en pareil cas, le mieux est souvent, comme on dit, l’ennemi du bien, ils ne voulurent pas essayer d’une installation faite à la hâte, et préférèrent coucher, cette nuit-là encore, à bord de la Cérès.
Dans la soirée, le commandant et les officiers de l’île Royale vinrent nous visiter. C’étaient des exilés, avides de nouvelles de la patrie.
Dans nos ports militaires, les officiers de toutes armes, les employés de tous rangs forment une sorte de colonie. Toutes les personnes d’un certain monde se connaissent. On est donc sûr, quand on quitte un de ces ports, pour aller habiter nos possessions d’outre-mer, que les fonctionnaires qui arrivent de France pourront tous vous parler de vos parents et de vos amis. Aussi étions-nous littéralement accablés de questions.
Celui-ci s’informait d’un camarade qui lui était cher. « Quelle campagne devait-il faire ? Sur quel vaisseau était-il embarqué ? »
Celui-là s’intéressait à une famille dont il avait reçu, à Toulon, un accueil gracieux. Il y avait alors dans la maison deux charmantes jeunes filles. « Étaient-elles toujours aussi jolies qu’autrefois ?… Avaient-elles droit encore à la fleur d’oranger ? » Sous cette forme banale, se cachait peut-être, comme une larme sous un sourire, quelque regret du passé, ou quelqu’espérance pour l’avenir ?
Un autre demandait avec inquiétude des nouvelles d’une femme tendrement aimée. Elle lui avait juré qu’elle ne survivrait pas à son départ. Nous lui apprenions, en riant, que l’infidèle était depuis longtemps consolée.
Ainsi se passa notre première soirée à la Guyane. Tout le monde causait et riait. Mais derrière cette gaieté on sentait, ravivé par tous les souvenirs évoqués, le regret de la patrie absente. Quand on apprit que la guerre allait éclater, (elle fut déclarée le 27 mars, le jour même de notre arrivée à la Guyane), quel chagrin de n’y pouvoir assister ! quels vœux pour cette chère France !… Ceux-là seuls savent combien ils l’aiment, qui en sont séparés ainsi pendant de longues années !
Cependant, vers minuit, heure bien avancée pour ces contrées, où l’on ne veille guère, les officiers de l’île avaient regagné la terre ; ceux de la frégate et les passagers s’étaient retirés dans leurs cabines. Sur le pont de la Cérès deux hommes restaient seuls. Ils causaient en fumant un dernier cigare. C’étaient votre serviteur et un vieux camarade du régiment qu’il avait retrouvé aux Îles-du-Salut.
La chaleur avait été accablante toute la journée. Mais la brise du soir permettait enfin de respirer. Je n’avais, pour ma part, nulle envie de descendre dans ma cabine, où régnait une température à faire éclore des vers à soie.
Un spectacle, dont je n’étais pas encore rassasié, me retenait d’ailleurs sur le pont, c’était la vue de ce beau ciel étincelant, de cette mer phosphorescente des Tropiques, qui, cette nuit-là, semblait une immense nappe de feu. Quelques embarcations attardées s’éloignaient de la frégate, laissant derrière elles une longue traînée lumineuse. On pouvait suivre, dans l’obscurité, le mouvement cadencé des rames qui plongeaient comme dans un métal en fusion, et se relevaient chargées de stalactites d’or. Plus près de nous, autour des flancs du navire, d’énormes masses brillantes circulaient à quelques pieds sous l’eau. Ce phénomène attira mon attention.
– Voilà qui est étrange ! pensai-je tout haut.
Et comme, pour mieux voir, je me penchais par-dessus le bastingage.
– Prends garde, me dit mon compagnon. Ce sont des requins.
Je m’éloignai vivement du bord.
– Ils sont très nombreux autour de l’île, continua mon camarade. Toutes les immondices qu’on jette à la mer les y attirent. Les mortalités, assez nombreuses depuis quelque temps, peuvent aussi être pour quelque chose dans leurs visites. Le sol de l’île est trop rocailleux et trop restreint pour qu’on y enterre les morts. On les jette donc à l’eau comme à bord d’un navire en pleine mer.
Croirais-tu, ajouta-t-il en riant, qu’il y a des gens qui disent qu’il est désagréable d’être inhumé de la sorte ? Pour mon compte, une fois rendu là, terre ou eau, la chose m’importera peu. Toujours est-il que lorsque le canot qui fait ici l’office de corbillard va au large avec son funèbre chargement, les requins le suivent à la piste, comme une bande de loups affamés. Tu comprends pourquoi.
– Mais alors, quelle que soit la chaleur, il vous est donc interdit de prendre jamais un bain de mer ? demandai-je.
– La consigne, me répondit mon ami, défend expressément de se baigner ailleurs que dans l’enceinte préparée pour cet usage.
Mais vois donc, dit-il, en me montrant du doigt les masses lumineuses. Ne dirait-on pas des chiens qui cherchent une piste ? Ils ont faim sans doute ? Personne n’est mort ici depuis deux ou trois jours, et le jeûne leur paraît un peu long. Il ne ferait pas bon, je crois, leur tomber sous la dent en ce moment.
Tu me demandais tout à l’heure si l’on pouvait se baigner à la mer. Je t’ai répondu que la consigne le défendait. Tu vas juger si on la viole impunément.
Il y a quelques jours, un transporté, nouvellement arrivé, s’éloigna de l’île à la nage. On prétend que se fiant à son habileté, il avait formé le projet de gagner ainsi la côte de Kourou, et de s’enfoncer dans l’intérieur du pays.
À peine était-il à une centaine de mètres au large qu’on l’entendit pousser des cris perçants. Les requins lui donnaient la chasse.
Excellent nageur, il essaya, en faisant des efforts désespérés, de regagner le rivage.
Il allait prendre pied, quand un des requins l’atteignit, et, d’un seul coup de sa formidable gueule, lui ouvrit le ventre. Mais effrayé sans doute par les convulsions et les cris du blessé, il lâcha sa proie.
L’homme n’était qu’à quelques mètres de la plage. Il eut encore la force d’y arriver, traînant après lui, comme un cheval éventré dans un cirque, ses entrailles sanglantes.
On accourut… on le croyait sauvé. Il venait d’expirer sur le sable.
Eh bien ! mon cher ; tout est ici à l’avenant. Dans l’eau salée, les requins ; dans l’eau douce, les torpilles et les gymnotes ; dans l’eau saumâtre, les caïmans ; sur terre, les serpents, les scorpions, les mille-pattes ; dans l’air, les vampires, les maringouins, les moustiques, et quelquefois la peste qu’on appelle ici vomito negro.
Ah ! mon ami, le délicieux pays ! ajouta-t-il en forme de péroraison.
Je trouvai que mon compagnon devenait lugubre, et bien décidé à ne pas subir, dès mon arrivée, l’influence de ceux qui voient tout en noir, je pris le parti de regagner ma cabine. Rendu là, je fis cette réflexion que je devais être, dans ma couchette, à la même profondeur sous l’eau que les requins. Le corps de l’un d’eux n’était peut-être séparé du mien que par l’épaisseur de la membrure. Cette idée me fit frissonner un peu ; mais, Dieu merci, l’obstacle était solide, et je ne tardai pas à m’endormir profondément…
La nuit fut d’un calme inaccoutumé. Tous ceux qui ont navigué savent qu’un vaisseau, (man of war, disent les Anglais), est un être vivant qui s’endort au coucher du soleil, et se réveille dès l’aube, comme la plupart des animaux de la création. Si le voyageur enfermé, comme Jonas, dans l’obscurité de ses flancs a entendu au-dessus de sa tête des pas précipités, des bruits alarmants, des sifflements sinistres, c’est que le monstre a eu une nuit d’insomnie.
D’habitude, son sommeil est paisible, surtout sous ces latitudes. On n’entend alors, pendant de longues heures, que le léger crépitement de l’eau sillonnée par les flancs du navire, et les craquements des mâts gémissant sous les efforts de la brise.
Mais le matin, dès l’aurore, le monstre ne dort plus. Il reprend alors toute l’agitation de la vie. Il a même le réveil assez bruyant. C’est que c’est le moment de la toilette, disent les marins, du pansage, dirait un officier de cavalerie.





























