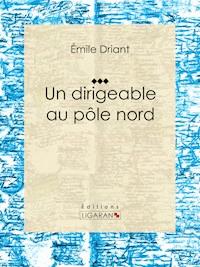
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le dirigeable militaire Patrie N°2 est venu de Verdun à Anderannes, petit village d'Argonne, pour y étudier l'installation d'un hangar naturel au fond d'un ravin profond et y trouver abri en cas d'atterrissage imprévu. Pendant que son commandant et le général gouverneur du camp retranché sont au château d'Andevannes, propriété d'un ancien officier, M. de Soignes, et s'y attardent à luncher après avoir décidé de ne rentrer à Verdun qu'à la nuit, Christine de…"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335068702
©Ligaran 2015
Le capitaine Danrit a écrit cet ouvrage pour essayer de convaincre quelque Mécène français de la possibilité d’atteindre le pôle en dirigeable et d’y planter avant toute autre puissance le drapeau tricolore.
Depuis qu’il a assisté aux essais du République, vu les plans de l’ingénieur Julliot pour la construction d’un aérostat de 100 mètres de long, constaté la résistance au vent de ce long fuseau effilé et remarquablement maniable, l’auteur de la Guerre de demain, de Guerre fatale, d’Invasion jaune, d’Ordre du Tzar et de dix autres ouvrages aimés de la jeunesse, est lui-même convaincu que la réalisation de cette hypothèse est sortie du domaine de l’utopie, et comme rien ne vaut le roman pour incruster une idée dans l’opinion, il a écrit le roman le plus captivant qui soit pour démontrer victorieusement la valeur de sa thèse. Robinsons de l’air est le digne pendant de Robinsons sous-marins qu’a couronné dès son apparition l’Académie française.
L’ÉDITEUR.
Le dirigeable militaire Patrie N° 2 est venu de Verdun à Andevannes, petit village d’Argonne, pour y étudier l’installation d’un hangar naturel au fond d’un ravin profond et y trouver abri en cas d’atterrissage imprévu.
Pendant que son commandant et le général gouverneur du camp retranché sont au château d’Andevannes, propriété d’un ancien officier, M. de Soignes, et s’y attardent à luncher après avoir décidé de ne rentrer à Verdun qu’à la nuit, Christiane de Soignes, la fille unique du comte, délicieuse jeune fille de 19 ans, habituée à tous les sports et fervente d’automobilisme et d’aérostation, demande et obtient de ses parents l’autorisation d’aller voir de près le merveilleux engin retenu par des cordages spéciaux ancrés dans le sol. Le commandant du Patrie charge le lieutenant Durtal, son adjoint, de l’y accompagner et la jeune fille, curieuse de sensations nouvelles devant ce monstre qui se balance, obtient non sans peine du jeune officier d’aérostiers qu’il lui soit permis de s’asseoir dans la nacelle.
Il l’y précède et commence à lui donner quelques explications lorsqu’une automobile surgit et arrive en trombe près de la nacelle, quatre officiers en descendent. Le lieutenant d’infanterie commandant le poste de garde, trompé par des papiers qu’ils exhibent et la qualité de délégués du commandant de l’établissement d’aérostation du Chalais qu’ils prennent, les laisse sans défiance approcher de l’aérostat. Sous prétexte de vérifier la solidité des cordes d’amarrage, ils se portent aux quatre amarres, les coupent à un signal donné, et profitent de la confusion produite par le traînage du ballon pour remonter dans leur voiture et disparaître.
C’est un attentat anarchiste.
Malgré les grappes des soldats qui s’accrochent à ses câbles, le Patrie N° 2 est entraîné par un vent qui croît rapidement, et quand le lâchez-tout retentit, il s’enfonce, la nuit venue, dans les profondeurs du ciel.
Seule dans la nacelle avec cet officier qu’elle ne connaissait point, Christiane de Soignes s’abandonne à un désespoir qui tourne vite à l’affolement. Que va-t-il arriver ? que dira-t-on si jamais elle en revient ? quelle atroce inquiétude au château !
Son affolement redouble lorsque le lieutenant lui déclare qu’il n’est pas maître de l’aérostat, la corde de commande du gouvernail étant immobilisée quelque part à l’extrémité du long fuseau de soie.
La nuit se passe dans une angoisse inexprimable et quand le jour arrive Georges Durtal constate avec stupeur que le Patrie est au-dessus de la mer du Nord et file droit au nord à la vitesse de cent kilomètres à l’heure.
Il tente de grimper dans les cordages pour libérer la corde qui maîtrise le gouvernail, risque de tomber, recommence sa périlleuse gymnastique en constatant que le Patrie va se perdre dans les solitudes de l’Océan glacial et finit par atteindre le gouvernail, après une série d’efforts audacieux qui arrachent à sa compagne des cris d’admiration et de terreur. Le jeune homme a conquis l’enthousiaste jeune fille par son courage tranquille et quand, maître de l’aérostat, il le dirige vers les falaises norvégiennes qui bordent l’horizon, et aborde dans un fjord aux parois abruptes où il échappe à l’étreinte du vent, elle est sous le charme, sa terreur a disparu et elle compare au fond d’elle-même le vaillant que le hasard a mis sur sa route à ces oisifs et à ces snobs qui se disputent à Andevannes sa main et sa dot.
Un superbe yacht, l’Étoile polaire, est à l’ancre dans le fjord voisin du cap Nord où vient d’aborder le Patrie, et ses matelots aident les naufragés de l’air à atterrir. Ce yacht appartient à un milliardaire américain, Sir James Elliot, qui, accompagné de sa femme et du docteur Petersen, tente de gagner un pari d’un million de dollars engagé avec Sir Astorg, roi du Cuivre. Sir Elliot est le roi de l’automobile et il a parié de monter plus haut vers le nord que le lieutenant Peary qui a atteint 87° 6. Toutes ses tentatives depuis dix-huit mois pour franchir la banquise ont échoué ; il n’a plus que quatre mois devant lui pour remplir les conditions de son pari et il en désespère presque entièrement, lorsque l’arrivée du Patrie N° 2 lui inspire un projet bien digne d’une cervelle américaine.
Pourquoi le lieutenant Durtal ne lui louerait-il pas son ballon pour une semaine ? il ne faut que 30 heures à la vitesse normale du Patrie, 75 kilomètres à l’heure, pour atteindre le Pôle, soit moins de huit jours pour aller et revenir. Le milliardaire ne regardera pas au prix.
L’officier refuse énergiquement. Il est responsable de cet aérostat vis-à-vis de ses chefs, vis-à-vis du gouvernement français et n’a pas le droit de le louer ; il doit le ramener à son hangar de Verdun. « Ne comptez pas sur moi pour cela », lui notifie alors l’Américain ; et au même moment on apprend que Bob Midy, un nègre aux allures de singe qui court partout et se hisse partout, a occasionné une déperdition d’hydrogène en faisant jouer la soupape du dirigeable pour s’amuser. C’est le Patrie cloué sur cette grève déserte. Et la discussion entre les deux hommes tourne à l’aigre.
Mais l’Américain, qui voit à quelle nature chevaleresque il a affaire, s’excuse d’avoir voulu peser par un chantage sur la détermination du jeune officier ; il lui fournira l’hydrogène perdu, l’aidera au rapatriement de l’aérostat, mais une dernière fois il le conjure de réfléchir à sa proposition : le pôle Nord est accessible en ballon : le Patrie peut l’atteindre, et il convie ses hôtes à le suivre dans la cabine voisine.
Nous entrons ici dans le vif du récit.
C’était le carré des officiers. Des instruments, des publications étaient épars sur les tables et une vaste bibliothèque y occupait tout un panneau.
En face d’elle s’étalait une immense carte à grande échelle des régions boréales.
Deux cercles, représentant, l’un, le 70e, l’autre, le 80e degré de latitude nord, y étaient tracés en rouge, et entre eux s’étalaient les rivages d’Asie et d’Amérique, le Groenland, le Spitzberg, la Nouvelle-Zemble, la Terre de François-Joseph et les îles de la Nouvelle-Sibérie.
Du 80° au 90° degré, les latitudes étaient figurées par des cercles moins épais, tracés de degré en degré et entourant le point fatidique :
NORTH-POLE
dont l’inscription attirait invinciblement le regard, car, autour de lui, dans les parties restées blanches, jusqu’au 87° degré, c’était l’inconnu…
Les itinéraires de ceux qui avaient tenté de franchir la barrière glacée étaient marqués par des lignes pointillées de différentes formes, et c’était un enchevêtrement de tracés et d’inscriptions rappelant des noms et des dates, précisant les latitudes atteintes et montrant, mieux que de longs discours, la persistance de l’idée poursuivie par tant d’explorateurs, depuis 350 ans.
– Tenez, lisez tous ces noms, fit le milliardaire, noms de héros que je mets au-dessus des plus fameux conquérants… ou plutôt laissez-moi vous les énumérer, je vous dirai pourquoi tout, l’heure. Et vous, mademoiselle, accordez-moi toute votre indulgence pour cette leçon de géographie… Songez que, depuis quinze mois, mon cerveau est imprégné de tout cela, mes nerfs tendus vers ce point, ma volonté concentrée là…
– Dites, monsieur, fit la jeune fille d’une voix grave. Vous n’imaginez pas, au contraire, combien je vous comprends.
– Le premier en date, commença le milliardaire, c’est Willoughby, à qui la Compagnie moscovite des marchands de Londres avait confié trois vaisseaux ; il découvrit la Nouvelle-Zemble en 1553 : premier pionnier du passage nord-est, il mourut de froid sur la côte laponne avec tout son équipage. Et comme il avait ouvert la route, les explorations se multiplient : c’est Piet et Jackmann qui, au seizième siècle, atteignent la mer de Kara ; John Davis qui explore le Groenland jusqu’au 72e degré ; Hudson, qui monte au 80e degré et meurt, trahi par son équipage, sur un bateau entrouvert ; William Baffin qui, en 1616, sur un bâtiment de 35 tonnes, le Discovery, parcourt dans tous les sens la mer à laquelle il donne son nom ; William Barentz enfin, qui vient du Texel, découvre le Spitzberg et y meurt.
« Deux cent trente ans s’écoulent ensuite sans une exploration marquante, fit l’Américain après un silence. Il semble que l’homme ait renoncé à franchir ces seuils glacés.
Mais au dix-neuvième siècle, la fièvre des découvertes boréales reprend de plus belle. En 1827, Parry se lance à nouveau à la conquête du Pôle. Il cherche à l’atteindre sur des barques montées sur roues et traînées par des chiens ; il atteint la latitude 82° 45’ sur un glaçon flottant ; en 1831, James Ross découvre en Boothie, par 75° de latitude, le Pôle Magnétique ; puis c’est Franklin qui meurt en trouvant le passage nord-ouest ; Hall, dont le vaisseau, par le détroit de Smith, atteint 82° 16’ ; Markham, Lookwood, Payer, qui dépassent le 83° degré ; Wrangel, qui croit avoir vu, au-delà de la terre qui porte son nom, la fameuse Polynia ou mer libre, chantée dans les légendes des baleiniers Scandinaves ; Cook, Moore, Collinson, Mac Clure et le grand Nordenskjold.
Et pour compléter le martyrologe de ceux qui, après leur mort, servirent encore la science, c’est de Long, dont le vaisseau la Jeannette sombre près des îles de la Nouvelle-Sibérie et envoie, trois ans après, des débris de sa carcasse sur les côtes du Groenland, donnant ainsi l’idée à l’immortel Nansen de se confier à la banquise dérivante pour atteindre le Pôle.
C’est Nansen enfin, – et celui-là, je le salue bien bas, – Nansen, le Suédois, qui abandonnant son navire, dont la dérive ne passe pas assez haut, se lance, avec un seul compagnon et quelques chiens, sur les champs glacés, d’où il est obligé de revenir à la Terre François-Joseph, ayant atteint 86° 13’.
C’est Cagni, le second du duc des Abruzzes, qui, de la baie de Teplitz, où hivernait en 1900 la Stella Polare, sur la côte orientale de l’île du Prince-Rodolphe, exécute une marche audacieuse le conduisant à 86° 31, soit vingt minutes plus haut que Nansen.
Et, plus à l’ouest encore, c’est enfin notre compatriote Peary – car c’est un Américain qui détient ce record – c’est Peary, dont le navire le Roosevelt avait pris ses quartiers d’hiver sur la Terre de Grant, qui parvient, le 21 avril 1906, jusqu’au 87° 6’, c’est-à-dire à 220 kilomètres du Pôle !
Eh bien ! monsieur le lieutenant, si je vous ai fait cette nomenclature, peut-être aride et à coup sûr trop longue, devinez-vous pourquoi ?
Comment sonnent à vos oreilles tous ces noms que j’ai passés en revue ? Ils sonnent comme des noms étrangers, n’est-il pas vrai ?
Parmi tous ces explorateurs, il n’y a que des Anglais, des Américains, des Hollandais, des Suédois, des Norvégiens, des Russes et même des Italiens… Pas un nom français… pas un, entendez-vous ? Ne voulez-vous pas en mettre un ?
Le vôtre ! »
Le milliardaire se tut. Il avait parlé avec une chaleur entraînante et on sentait que cette question lui tenait à cœur par-dessus toutes les autres et qu’il donnerait ses millions pour voir son nom à lui gravé à côté de celui d’un Peary ou d’un Nansen.
Silencieux, Georges Durtal regardait le point sur lequel sir James Elliot venait de poser le doigt.
Lui aussi se sentait transporté vers un idéal nouveau.
Il ne disait plus : « C’est fou », il ne disait pas non plus : « c’est impossible ! car il connaissait son dirigeable et ce qu’il en pouvait attendre.
Il se répétait :
Trente heures !
Il suffit de trente heures pour atteindre ce point mystérieux vers lequel ont convergé tant d’héroïsmes et de sacrifices.
Un oui, et trente heures après, c’est un nom français qui s’inscrira ici, triomphalement, en tête de tous ces noms…
Pour ne pas répondre ce « oui » aux pressantes instances de sir Elliot, il avait besoin de se répéter, comme un leitmotive :
Je n’ai pas le droit de disposer du Patrie, je n’ai pas le droit de risquer sa perte dans une expédition que l’État français n’aurait jamais songé à me confier. »
Et, partagé entre toutes ces pensées contradictoires, il ne répondait pas.
– Un dernier mot, monsieur le lieutenant : veuillez excuser, et vous aussi, mademoiselle, le pitoyable marchandage par lequel j’avais commencé. C’est un peu notre habitude, à nous autres Américains, de traiter toutes les questions comme nous traitons les affaires ; mais cette manière, je n’hésite pas à le reconnaître, est indigne de vous. Si donc vous ne croyez pas devoir accéder à ma proposition, je vous donnerai néanmoins l’hydrogène nécessaire pour vous mettre en état de repartir où vous voudrez.
Il appuya sur ce dernier mot, puis gravement :
« Veuillez seulement considérer, acheva-t-il, qu’en partant seul, vous risquez la perte du ballon que vous voulez conserver à votre pays.
Et veuillez surtout réfléchir que, si vous refusez d’aller au Pôle en ayant le moyen, jamais homme n’aura passé aussi près que vous de l’immortalité… une immortalité qui rejaillirait sur votre pays, monsieur l’officier français ! »
Un silence impressionnant suivit cette éloquente adjuration. Ce fut Christiane qui le rompit :
– Madame, fit-elle d’un air décidé, voulez-vous permettre qu’on nous laisse seuls un instant ? M. Durtal portera sa réponse définitive à sir James tout à l’heure.
Les explorateurs du pôle. – Pas un nom français ! L’intervention de Christiane. – La voix des aïeux. – L’élu. – Six passagers. – Fabrication de l’hydrogène. – Installation de la nacelle. – Vêtements polaires. – Le souvenir d’Andrée. – Traîneau automobile. – Le soleil de minuit.
La porte s’était refermée. Christiane se rapprocha de l’officier, plongea ses yeux dans les siens et, avec un accent de décision qu’il ne soupçonnait pas chez elle :
– Monsieur Durtal, lui dit-elle à mi-voix, comme pour mettre plus d’intimité dans cette grave explication, il faut accepter la proposition de cet homme, il faut essayer d’aller au Pôle !…
– Mais, mademoiselle…
– Écoutez-moi, je vous en prie. Il y a des choses que les femmes sentent mieux qu’elles ne les démontrent, et celle-là en est une. Et puis, comment vous expliquer que la Christiane qui vous parle n’est plus celle qui sombrait au départ dans une terreur instinctive, qu’elle n’est même plus la Christiane d’il y a une heure ! Tout ce que cet homme vient de dire m’a retournée. Songez-y ! Un acte de volonté, et c’est vous, c’est la France, qui prend la tête de tous ces explorateurs dont il vient de citer les noms. Oh ! monsieur Durtal. Je voudrais faire passer en vous la conviction qui vient de naître en moi, de s’imposer à moi irrésistiblement… Croyez-moi, cet Américain a le sentiment du grand et du beau. Il dit vrai : jamais occasion comme celle-là n’a été offerte à un homme, à une nation…
Elle mit le doigt sur le Pôle et, étendant le bras, d’un geste large :
– Voyez-vous le retentissement qu’aurait partout cette surprenante, cette étourdissante nouvelle, tombant en France, en Europe, au moment où l’on y pense le moins : « Le drapeau français a été planté au Pôle par un officier français ! » ? Voyez-vous ces lourdes plaisanteries, qui n’ont pas dû manquer à l’étranger au lendemain de notre accident, les sots commentaires de toute sorte provoqués par la perte d’un second Patrie, tout cela s’effondrant dans une rumeur d’apothéose : « Le Patrie est au Pôle ! »?
« Ah ! monsieur, si vous sentiez cela comme moi !… »
Et les yeux dans le lointain de son rêve, Christiane de Soignes joignit les mains.
– Je ressens tout cela comme vous, mademoiselle, fit-il, à mi-voix, lui aussi, et tout à l’heure, quand cet homme nous montrait le cercle d’inconnu se resserrant autour de l’axe du monde par la tenace volonté de navigateurs étrangers, quand il disait surtout : « Pas un nom français parmi tous ces noms de chercheurs et de héros ! » j’avais presque honte de cette constatation et je me disais : « Pourquoi pas nous ? »
– Eh bien ! vous traduisez exactement ce que je pensais au même moment. Alors, concluez comme moi : essayons ! partons !
– Mademoiselle, je le voudrais, mais tout en moi proteste. Laissez-moi vous le redire, avant tout je suis soldat ; je n’ai pas le droit – et il articula lentement cette phrase en appuyant sur le dernier mot – je n’ai pas le droit de disposer du Patrie. Devant cet argument unique, impérieux, capital, tombent tous mes enthousiasmes. J’en suis responsable vis-à-vis de mes chefs, de ce ballon, responsable, entendez-vous ? Le hasard m’en a fait le maître. Mais, dans ce coin perdu des rivages arctiques, je représente à moi seul toute la hiérarchie militaire. Je dois agir ici comme si j’étais en communication constante avec les chefs de l’armée. Or, il n’est pas douteux que, si ceux-ci pouvaient m’envoyer un ordre, ce serait celui-ci : « Ramenez le Patrie à son hangar, où il a son utilité comme engin de guerre, où il peut être indispensable demain ». Là est le devoir.
Christiane de Soignes secoua la tête.
– Non, monsieur, il n’est pas là. Vous raisonnez en officier, vous ne raisonnez pas en français, fit-elle avec une vivacité qui se reflétait dans son regard plein de clartés… Écoutez : je ne sais si c’est la voix d’aïeux très lointains qui, en ce moment, bourdonne dans mon cerveau et me souffle des pensées qui étaient si loin de moi, il y a quelques heures… C’est possible. Je crois à la transmission de la volonté des morts, parce qu’en infusant leur sang à leurs descendants, ils leur ont passé leurs plus pures aspirations et comme des parcelles d’idéal qui n’attendent qu’une occasion pour entrer en vibration… Eh bien, à cette heure, tout vibre en moi, et je me sens remué au plus profond de moi-même.
Elle se tut, et, lentement, comme si elle écoutait des voix mystérieuses :
– Tenez, fit-elle, j’ai entendu souvent raconter par mes parents qu’un des nôtres fut, aux Indes, un compagnon d’armes de Dupleix et de sa femme Jeanne de Castro, la Begum des légendes hindoues. Avec ce grand Français, il lutta contre les rajahs et les Anglais et fut tué au siège de Pondichéry. C’était une âme aventureuse et ses cendres reposent quelque part, sur un lointain rivage. Il ne se serait pas embarrassé d’une consigne étroite, lui. Il aurait vu, au-dessus d’elle, le renom de la France et du roi. Eh bien, qui sait si ce n’est pas lui, cet aïeul mort pour une noble cause, qui réveille en moi des sentiments que je ne me connaissais pas ? Qui sait si ce n’est pas lui qui vous dit par ma voix : « L’heure sonne de faire une grande chose pour la France, ne la laissez pas passer ! » ?
Elle se tut de nouveau, ses yeux dans ceux de l’officier, et elle ne parlait plus, que Georges Durtal, profondément remué par cette voix chaude et prenante, l’écoutait encore, remplissant son regard de son idéale beauté, car Christiane était comme transfigurée. La légitime fierté de sa race se reflétait sur son beau visage et, dans sa distinction native, elle apparaissait au jeune officier comme une de ces grandes dames de la « Guerre en dentelles », qui souriaient à leurs chevaliers, en leur montrant, d’un geste gracieux, la direction du champ de bataille.
Il se sentait rapetissé à côté d’elle. Il eût voulu baiser le bas de sa robe, lui dire son admiration et tout ce qui montait en lui de chaude sympathie, de tendresse et de respect. Il eût voulu surtout céder à ses objurgations. Il en comprenait la force, la justesse, mais il se sentait comme tiré en arrière par les mots de « devoir militaire » et de « consigne », qu’on lui avait appris à respecter avant tous les autres.
La jeune fille semblait suivre sur ses traits la lutte intérieure qui le rendait silencieux. Mélancoliquement, elle reprit :
– Plus d’une fois déjà, j’ai regretté d’être femme. J’ai envié ceux qui combattent, ceux qui vont au loin, ceux qui meurent. Je me suis grisée de sport pour me donner l’illusion de l’action, mais je ne suis arrivée qu’à lasser mon corps sans rassasier mon âme. Puis, j’ai rêvé d’être l’inspiratrice d’un acte héroïque, et voilà que l’acte se précise, voilà que l’homme ayant en mains les moyens de l’accomplir est là… Et j’éprouve une émotion indéfinissable en lui disant : « Pourquoi ne voulez-vous pas être l’élu ? »
Sa jeune poitrine battait avec force.
Il se rapprocha, les yeux troubles, lui prit la main qu’elle abandonnait.
– Mademoiselle Christiane, fit-il, très bas, comment me permettez-vous de comprendre ce mot ?…
– Ne le définissons pas maintenant, dit-elle, mais laissez-vous convaincre : tant de raisons devraient vous décider ! Que sera notre retour au milieu des sourires et des sous-entendus des uns, des reproches et des critiques des autres ? Encore, vous n’en souffrirez guère, vous : on est indulgent pour l’homme. Mais moi ?… On n’a le droit de partir comme nous l’avons fait que si on n’en revient pas… ou, si on en revient, avec une étoile au front. Cette étoile, il faut l’aller chercher là-bas.
Et pour la seconde fois, d’un geste impérieux, que tempérait un sourire plein de promesses, elle remit son doigt sur le mot North Pole.
Alors il ne résista plus.
– J’irai, fit-il simplement.
– C’est bien, dit-elle, d’une voix pénétrée ; mais ne dites pas « j’irai », dites : « nous irons ». Car Dieu nous a fait une destinée commune, je ne vous quitte pas. Vous avez renoncé aux objections que vous suggérait votre conscience de soldat, je suis sûre que vous m’éviterez de même toute récrimination, si nous ne réussissons pas. Si nous devons rester dans les profondeurs glacées où je vous entraîne, nous y resterons ensemble !… Mais si nous en revenons… ce sera la main dans la main…
Le voulez-vous ?
– Ô Christiane ! fit-il, à voix basse.
– Georges ! murmura-t-elle.
Et leurs mains se joignirent silencieusement.
Quand les deux jeunes gens rentrèrent dans la salle à manger, tous les regards étaient fixés sur eux. Sir James Elliot, les lèvres serrées, avait laissé éteindre son cigare, et le savant lui-même semblait gagné à l’émotion de l’attente générale.
– Monsieur, dit Georges Durtal, nous partirons quand vous voudrez.
– Pour le nord ?
– Oui, monsieur, pour le nord.
– Et Mlle de Soignes ?…
– Mlle de Soignes part avec nous.
– Hurrah ! jeta l’Américain, et d’un coup de poing formidable, il ébranla un guéridon et fit sauter verres et bouteilles.
Vous venez avec nous, miss ! combien je suis heureuse de cette résolution ! fit l’Américaine, dont les petits yeux gris brillaient par-dessus les lunettes.
Et cherchant aussitôt dans sa poche la Bible qui ne la quittait jamais, elle se mit à la feuilleter avec vivacité, pour y trouver les actions de grâces adéquates à la situation.
– Je pars avec mon fiancé, madame, fit délibérément Christiane, et si nous revenons du Pôle, Mme Durtal de la dépêche, ce sera moi.
– Ah ! chère miss, quelle heureuse surprise, mais aussi quelle erreur déplorable j’avais faite ce matin !
– Je ne vous en veux pas du tout, madame, au contraire, fit la jeune fille en souriant ; sans vous, les choses n’eussent peut-être pas pris la tournure qu’elles viennent de prendre.
– Vous, miss, déclara l’Américain transporté, vous allez être l’ange gardien de l’expédition. À vous dire vrai, je ne partais qu’à contrecœur avec mon bateau du côté des îles de la Nouvelle-Sibérie, je n’espérais guère y trouver la mer libre de Wrangel ; mais c’était ma dernière carte, je la jouais. En dirigeable, au contraire, j’ai la conviction du succès. Vous serez la petite fée qui nous guidera et nous ramènera. Je suis un peu superstitieux, vous savez, comme tous les hommes qui sacrifient à Plutus, dieu de l’argent. Eh bien ! je crois à la chance avec vous et je baptise à l’avance du nom de Terre Christiane le glacier sur lequel nous planterons notre drapeau.
– Quel drapeau ? demanda malicieusement la jeune fille.
Interloqué, le Yankee ne répondit point.
Ce fut mistress Elliot qui déclara :
– Si Dieu nous accorde cette grâce sans précédent d’atteindre le Pôle, le drapeau américain et le drapeau français devront y flotter côte à côte, au même titre. N’est-ce pas votre avis, miss ?
– Pourtant, fit Christiane, le monde entier saura que le Patrie est un ballon français !
– Laissons cela, clama l’Américain, et qu’on apporte deux bouteilles d’extra-dry pour fêter cette nouvelle entende cordiale. À partir d’aujourd’hui, monsieur l’Officier, vous êtes le commandant de l’expédition et je ne vous donne plus d’autre titre. Entendons-nous : quand nous serons dans les airs, vous serez le maître, mais quand, pour une raison ou une autre, nous serons ramenés à terre ou sur mer, je reprendrai le commandement de l’expédition. Est-ce convenu ?
Si bizarre que fût la convention, Georges Durtal acquiesça en riant. Tout son bonheur à lui était ailleurs, et à cette heure, il se demandait s’il ne rêvait point et si c’était bien à lui que l’adorable jeune fille avait dit, le ciel dans les yeux : « Voulez-vous être l’élu ? »
Quelques instants après, une animation extraordinaire secouait tout le personnel de l’Étoile-Polaire.
Sir James Elliot exigeait qu’on ne perdît plus une minute. Le baromètre était à 758 millimètres. C’était, d’après le savant, la certitude d’une accalmie assez longue, consécutive à l’ouragan qui était venu s’éteindre la veille aux environs du Cap Nord. Il fallait en profiter, ce succès pouvant dépendre de quelques heures gagnées ou perdues, et, armé de son autorité de chef de l’expédition, puisqu’elle n’avait pas encore quitté le sol, sir Elliot décréta qu’on partirait la nuit suivante, à minuit, si possible.
Tout le monde allait s’employer à mettre le Patrie et ses passagers en état d’affronter le mystérieux et passionnant voyage.
Ces passagers, quels étaient-ils ?
Puisque le dirigeable pouvait porter douze personnes en pleine charge, ce n’était pas trop de lui en imposer six. Cinq étaient tout naturellement désignées, mistress Elliot étant inséparable de son mari, Christiane, de son fiancé, et le docteur Petersen, avec son inévitable instrument, était nécessairement du voyage.
Quant à la sixième place, sir James Elliot déclara qu’elle serait attribuée à Bob Midy ; et comme Georges se récriait :
– Il nous faut un domestique, expliqua l’Américain. Celui-là est habitué à nous servir ; il s’occupera de la cuisine et effectuera tout ce qui est travail de propreté. Il a une qualité rare dans ces régions, rare surtout pour un nègre, il est insensible au froid. Sa manie de touche-à-tout qui vous inquiète et surtout les tendances à l’ivrognerie que je lui reproche davantage, n’auront rien de dangereux dans cet espace restreint, puisque nous l’aurons constamment à l’œil. S’il se fait un jour couper un doigt dans un engrenage, il n’y reviendra pas deux fois. Quant à sa rage de grimper partout, nous aurons peut-être à l’utiliser, en lui demandant des tours de force comme celui que vous avez exécuté vous-même, en vous hissant près du gouvernail en pleine marche.
Et, sur ces considérations, Bob Midy avait été accepté.
Le capitaine Willy Harris, de l’Étoile Polaire, avait demandé à faire partie de l’expédition, mais le milliardaire lui avait déclaré qu’il ne pouvait, ni abandonner, ni céder à son second le commandement du navire.
– Vous aurez à nous suivre, Willy, jusqu’au Spitzberg d’abord, puis au-delà jusqu’à l’extrême limite des glaces. Là, vous louvoierez en nous attendant. Peut-être, au retour, serons-nous bien heureux de vous retrouver.
Le commandant de l’Étoile Polaire fut chargé de réunir et d’amariner dans la nacelle les provisions de bouche de l’expédition. Il fallait compter sur un approvisionnement de vingt jours, afin d’être paré au cas où l’expédition se prolongerait. Il dut en outre compléter le stock d’essence nécessaire en ajoutant six bidons de 80 litres aux 600 litres que contenait le réservoir, veiller à la question importante des armes et munitions : trois carabines, dont une Smith tirant des balles explosibles, furent suspendues au bordage extérieur de la nacelle et pourvues de 200 coups à tirer chacune. Il y avait là de quoi faire une hécatombe de morses et d’ours, suffisante pour nourrir l’expédition pendant six mois.
L’opération la plus urgente était la fabrication de l’hydrogène. Le docteur Petersen l’installa en moins d’une heure, à l’aide de six grandes bonbonnes vides dans lesquelles il empila de la limaille de zinc ; deux tubes traversaient le volumineux bouchon qui fermait chacune d’elles ; l’un d’eux recevait l’eau acidulée destinée à attaquer le métal, et l’autre conduisait l’hydrogène instantanément formé dans un manchon commun aboutissant à l’aérostat. Dès trois heures du soir, l’usine improvisée marchait à souhait, et le savant assura que le regonflement du Patrie serait achevé pour minuit.
En prévision de ce notable accroissement de force ascensionnelle, un supplément de lest fut installé dans la nacelle et les câbles qui retenaient le captif furent doublés.
Le vent était d’ailleurs complètement tombé ; la température marquait trois au-dessus de zéro. Le temps était propice à souhait pour ces préparatifs, menés avec une activité fiévreuse, que sir James Elliot avait communiquée à tout le monde.
Lui s’était chargé de disposer à l’avant de la nacelle une tente formée de peaux de rennes et pouvant donner abri aux deux femmes. Pour y maintenir une température supportable, il y fit porter un fourneau à pétrole d’un modèle perfectionné, sur lequel on pouvait en même temps faire fondre de la glace et bouillir dix litres d’eau.
Mais Georges Durtal, qui présidait à l’ensemble de l’arrimage, objecta que, même sous une tente en peau, même avec la distance considérable qui séparait la nacelle de l’aérostat, il était bien dangereux d’installer une source de chaleur dans le voisinage d’une pareille masse d’hydrogène. La difficulté fut surmontée par l’adaptation au fourneau d’un treillage métallique. Le forgeron du bord choisit à cet effet un grillage à mailles très serrées, et l’électricien y installa une mise de feu électrique par l’essence, qui dispensait d’allumer une allumette à l’extérieur du fourneau.
Expérimenté aussitôt, l’appareil fonctionna parfaitement, et, en moins d’une heure, amena à la température d’ébullition les dix litres d’eau de son récipient. En même temps, la température intérieure de la tente montait de 3 à 16 degrés.
C’était un résultat inappréciable pour le moment où les aéronautes aborderaient les 30 ou 40 degrés de froid du bloc polaire.
Quant aux autres passagers, pour lesquels il était impossible de monter une seconde tente, qui eût enrayé toute possibilité de manœuvre à bord du Pairie, ils devraient se contenter des sacs en peau, très confortablement aménagés d’ailleurs, dont l’Étoile-Polaire possédait un approvisionnement pour tout l’équipage. Un épais capuchon mobile, abritant la tête, mettait les yeux à l’abri du rayonnement atmosphérique, et des peaux d’ours, réparties sans compter au fond de la nacelle, y constituèrent des lits très supportables pour une expédition de courte durée.
– Avec un sac de peau comme ceux-là, Nansen a couché dans la neige, observa sir Elliot ; nous serons bien mieux que lui.
Ce fut l’Américain qui se chargea de fournir de vêtements polaires ses deux nouveaux amis.
Partie d’Andevanne en toilette légère, comme il convient au début de septembre, s’étant préservée tant bien que mal contre un abaissement de température de 20 à 22 degrés à l’aide du dolman de cuir trouvé à bord de la nacelle, Christiane de Soignes devait être équipée des pieds à la tête.
Elle le fut sans peine, car si elle était grande, fine et svelte, mistress Elliot était longue, maigre et sèche ; ce qui allait à l’une allait à l’autre ; chemises et jerseys de laine, corsages en peau de daim, boléros en mérinos, mocassins lapons doublés de feutre et toques de loutre constituèrent une première enveloppe qui laissait encore aux deux voyageuses une silhouette féminine nettement accusée.
Quand on arriverait dans les régions du « froid noir », elles devraient y joindre des passe-montagnes en fourrure, d’épais caleçons de laine, des guêtres en vadmel, sorte de drap très épais tissé par les paysans norvégiens, et des houppelandes en vison. Dès lors elles ne se différencieraient guère que par la voix de leurs compagnons de voyage.
Seul, le savant ne pouvait être confondu avec aucun autre. Sa petite taille, sa tête énorme, sa démarche d’oiseau de basse-cour lui constituaient un profil spécial, reconnaissable dans la plus épaisse obscurité.
Bob Midy avait repris sa pelure simiesque. Il marquait une joie extraordinaire, depuis que son maître lui avait annoncé son départ en ballon. Pendant plusieurs heures, sans se lasser, il fit la navette du navire au canot et du canot à la nacelle, portant les plus lourds fardeaux, et semblant vouloir prouver par là qu’il pouvait, malgré sa paresse invétérée, se rendre utile pendant le voyage.
De plus, à l’extrême surprise de mistress Elliot, il ne songea point, pendant toute la durée des préparatifs, à dérober le moindre verre de whisky, alors qu’en temps ordinaire il louchait constamment sur la vitrine où était renfermé l’approvisionnement personnel du milliardaire, sous forme de hautes et fines bouteilles au collier doré.
Tout le monde, d’ailleurs, dans l’équipage, collaborait à l’appareillage. Le personnel de l’Étoile-Polaire se composait de dix-huit hommes, mécaniciens, chauffeurs, électriciens, harponneur, cuisiniers et matelots de pont. Chacun, dans sa spécialité, travaillait avec ardeur ; on savait que sir Elliot voulait partir à minuit, qu’il récompenserait généreusement, qu’il allait se risquer dans une entreprise périlleuse, réparer, par la voie de l’air, es échecs subis dans l’assaut de la banquise depuis quatorze mois, et nul ne marchandait sa peine.
À dix heures du soir, le ballon avait repris sa forme et les plis inquiétants qui se creusaient dans son enveloppe avaient disparu. Les amarres consolidées se tendaient sous la poussée de la force ascensionnelle reconquise, le Patrie semblait impatient et de regagner son domaine.
Le premier soin de Georges Durtal avait été de faire l’ascension de l’échelle de cordes conduisant à la soupape, pour s’assurer que celle-ci était intacte et n’avait pas conservé l’un de ses clapets entrouverts, à la suite des efforts facétieux de Bob Midy.
Le souvenir du Géant de Nadar, qui s’était élevé ainsi en 1863 avec une soupape ouverte et avait fait une chute de 800 mètres, cassant bras et jambes à une douzaine de passagers, était là pour lui rappeler que, de cet organe essentiel, dépendait la sécurité de l’aérostat.
L’officier s’assura en même temps que le jeu des clapets actionné par de puissants tirants de caoutchouc réunis en faisceaux fonctionnait régulièrement. Maintenant, Georges Durtal avait une hâte de partir égale à celle de sir James Elliot lui-même.
C’était son bonheur qu’il allait chercher au Pôle.
Et il se rendait parfaitement compte que si, pour une raison, même des plus probantes, il ne partait pas, il perdrait aux yeux de l’aventureuse et enthousiaste jeune fille une partie du prestige dont elle l’avait revêtu et par lequel elle avait été séduite tout d’abord.
Pour une fille de race comme Christiane, chez qui la noblesse de cœur avait modifié, mais non détruit, les préjugés de caste, le fiancé de son choix devait réaliser le programme du vers de Voltaire :
Et jamais il ne retrouverait une occasion comme celle qui se présentait de servir son pays.





























