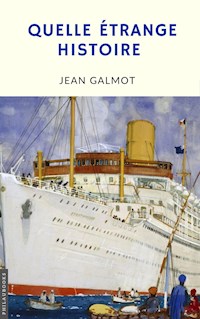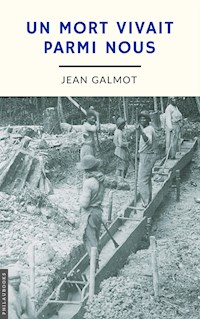
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
- Texte révisé suivi de repères chronologiques.
« Dans la nuit profonde, passent, à ras du sol, des bruits d’autrefois qui semblaient à jamais effacés de ma mémoire, dont le retour est mystérieux et lointain, comme s’ils venaient d’une existence antérieure : ce sont les chants des mineurs au placer Elysée, les aboiements des chiens, le souffle métallique de la drague au travail ; très loin, dans le fond du marécage, les appels des coupeurs de bois. Ce sont, aussi, les senteurs des jasmins et des bois de rose. Voici, suspendu dans la clairière, le jardin de Marthe où les roses rouges de France ont fleuri. »
Extrait de "Un mort vivait parmi nous" de Jean Galmot
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Un mort vivait parmi nous
JEAN GALMOT
Table des matières
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
Chapitre 45
Chapitre 46
Chapitre 47
Chapitre 48
Chapitre 49
Chapitre 50
Chapitre 51
Chapitre 52
Chapitre 53
Chapitre 54
Chapitre 55
Chapitre 56
Repères chronologiques
Couverture
Copyright © 2022 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0240-6
ChapitreUn
Ce n’est pas ici une place pour une femme… dit l’ingénieur.
Le boy eut un éclat de rire et sauta à pieds joints dans un godet de la drague pour éviter une gifle qui fit une arabesque dans le vide.
Un Indien bâti en géant, se dandinait, les pieds dans la boue.
— Nous l’avons chargée à Mana, avec la ferraille, dit-il. Elle a payé son passage de trois barils de corned-beef. Elle ne doit rien. Elle est là…
— Il n’y a rien à faire pour une femme ici… répéta Delorme, les mains derrière le dos.
Quelques hommes étaient assemblés autour de l’ingénieur. L’Indien les dominait tous. Haut de deux mètres, il avait une poitrine et un cou anormalement développés, la mâchoire massive et des jambes en forme de colonnes qui s’enfonçaient dans le sol, comme des troncs d’arbres. Tout, dans son visage et dans la puissante structure de son corps, indiquait un être dont la force était l’unique loi. Cependant, ce qui impressionnait surtout en lui, c’était son regard fixe de fauve. Ses prunelles brillaient d’un feu noir de diamants ; et il y avait, dans les cavités profondes de ses yeux, une lueur phosphorescente que l’éclat du jour voilait comme un brouillard.
La nuit soudaine des tropiques s’annonçait par la chute d’un toit de brume sur la forêt. Une équipe de coupeurs de bois déboucha de la brousse et s’engagea sur le sentier de la colline opposée, semblable à une longue chenille noire.
Le veilleur de nuit escalada l’élinde de la drague, une lanterne à la main.
Le lourd silence du soir mettait une ombre livide sur les visages exténués des hommes.
Delorme haussa les épaules, et dit :
— C’est bien.
⁂
Quand le cortège arriva au camp, la jeune femme était déjà là.
— Je suis, dit-elle, la femme de Pierre Deschamps. Je viens rejoindre mon mari. Il m’a écrit…
— Pierre Deschamps est parti depuis deux mois. Il a pris un chantier à Enfin.
Delorme s’assit sur la table, plaça ses jambes en croix et commença à racler au couteau la boue qui couvrait ses bottes.
Un forçat évadé, très pâle, les yeux injectés de bile, le corps décharné par les longues fièvres, rampait autour de la table, à la façon d’un esclave, en disposant les assiettes en bois, les verres et les préparatifs du repas.
Se tenant à distance respectueuse, par crainte des coups, il dit, les yeux tournés vers l’ingénieur :
— Faut-il mettre un couvert pour la dame ?
Delorme ne répondit pas. Il se dressa pour enlever sa veste de cuir, s’étira longuement et partit en sifflant.
Des lucioles, qui tremblaient dans l’encadrement de la porte, entrèrent soudain d’un trait et disparurent noyées par la lumière des lampes.
Les hommes qui arrivaient étaient tous semblablement vêtus de culottes de toile bleue, retenues par de larges bretelles de cuir sur une chemise de flanelle. Ils portaient tous une barbe grossièrement taillée à la tondeuse et de grands chapeaux américains en feutre épais.
Ils étaient de races différentes, mais la vie qu’ils menaient les avait réduits à peu près à un même type : visages émaciés par la fièvre, durcis par le travail et les privations, muscles de fer, regards aigus comme ceux des bêtes habituées au danger toujours présent.
On distinguait avec peine les mulâtres et les blancs. Les visages, brûlés par le soleil, avaient le même éclat, ardent, patiné, sous la barbe malsaine. L’accent créole, aux r mouillés, distinguait les hommes nés sous les tropiques.
Noirs et blancs, métis d’Indiens et mulâtres, tous savaient ce qu’est la vie. Ils avaient eu la même part d’aventures sur cette terre pétrie d’or ; ils avaient le même amour farouche de la liberté, la même passion pour l’or vierge. Prospecteurs et mineurs, nés pour la plupart à la Guyane, ils ne pouvaient concevoir qu’une autre vie pût être vécue.
La lutte en commun, les dangers et le travail partagés chaque jour, dans le même idéal, l’étroitesse même de l’horizon de leurs âmes, leur donnaient cette fraternelle égalité qui supprimait les barrières des races. Seuls, les noirs purs gardaient une orgueilleuse réserve qu’ils s’efforçaient en vain de masquer sous l’affabilité naturelle à la race.
Delorme, l’ingénieur de la drague, avait été nommé directeur par la Compagnie. Il n’utilisait ce titre que pour la signature du courrier aux rares jours où un canot descendait à Mana. Loubet, le chef mécanicien, avait gardé de son long séjour sur les vapeur de la Transat la démarche ivre des matelots. Le magasinier Ganne, long et décharné, chantait. Il n’avait ni âge, ni nationalité, ni race. Il parlait le taki-taki des Saramacas et la langue rauque des Indiens aussi parfaitement que le hollandais, le français et l’anglais. Les maraudeurs venus des colonies voisines de Surinam et de Demerara reconnaissaient par là son autorité, dont il usait pour frauder les balances à or.
La jeune femme les dévisageait ainsi, cherchant à lire sur le visage de chacun d’eux, l’histoire d’une vie tourmentée.
— Vous partirez au premier canot, dit tout à coup Delorme, tournant ses yeux bleus au regard aigu sur la femme à qui personne n’avait parlé pendant le repas.
— Nous attendons un canot sous huitaine… si la baisse des eaux le permet, acheva-t-il.
La jeune femme, les coudes sur la table, soutenant de ses mains une tête fleurie de boucles blondes, dit après une longue hésitation :
— Pierre Deschamps ne vous a-t-il jamais parlé de moi ?
Les hommes secouèrent la tête.
Le forçat avait accroché un hamac dans un angle obscur de la salle. Pour se protéger des vampires, il portait une cagoule, faite avec la toile d’un sac de farine, et qui le faisait ressembler à un moine ou à un bourreau.
ChapitreDeux
Je raconte à ma manière les choses qui se sont passées au placer Elysée, sur la crique Lézard. Vous me comprendrez, bien que je ne puisse pas dire tout ce que j’ai vu, car il y a encore des hommes vivants parmi ceux dont l’histoire emplit ce livre, et parce que la femme qui est là, pleurant dans cette première nuit sur la mine, pleurant de crainte et d’abandon, pendant que la jungle endormie rêve à haute voix auprès d’elle, parce que la femme qui est là, dans ce pauvre livre, est la plus belle image, le plus beau souvenir, la lumière qui éclaire encore et guide toute ma vie.
— Que faire ? dit Delorme. La crique est sèche… qui peut savoir quand reprendront les pluies ? Et cette femme qui tombe du ciel… Elle n’est utile à rien. Le diable m’emporte si j’ai jamais vu une femme blanche sur un placer…
Les hommes, absorbés par les soins de la nourriture, écoutent distraitement et approuvent en hochant la tête.
⁂
Les paupières rougies par l’insomnie, très pâle, la jeune femme, s’adressant à l’ingénieur, debout sur le seuil de la porte, parle d’une voix qui tremble légèrement :
— Je n’ai besoin de personne, dit-elle, je suis habituée à la vie des bois. J’ai de l’or pour payer ma nourriture au magasin. J’attendrai les hautes eaux…
Les hommes, penchés sur la table, se regardent à la dérobée, sans répondre.
— Je crois qu’il y a un tracé du placer au dépôt Lézard pour retrouver le fleuve…
— …
— Peut-être pourrais-je faire la route à pied… Il me faudrait un guide…
— Il n’y a pas de guide… Nous avons besoin de nos hommes…
Comme la jeune femme descend, Delorme la rappelle :
— J’espère que vous ne vous ennuierez pas trop… fait-il, avec une hésitation dans la voix.
Appuyée sur l’échelle qui monte à la case bâtie sur pilotis, la jeune femme montre à ras du sol sa tête ébouriffée :
— Je ne m’ennuie pas… J’ai seulement un peu peur de vous…
Un éclat de rire. Les hommes se regardent et partent à nouveau d’un grand rire qui secoue la table.
ChapitreTrois
Commentvous appelez-vous ?
Surprise à ma voix, la jeune femme se retourne, hausse les épaules et disparaît dans le carbet.
Les rayons du soleil s’étalent, obliques, en éventail, sur le plateau du camp. Ils sont chargés de feu, barres d’or sortant d’un brasier.
— Vous ai-je offensée ? Je suis un homme maladroit… Pourquoi ne venez-vous plus aux repas ? Tout le monde vous regrette, et personne n’ose vous le dire…
Elle porte un affreux pyjama qui la déshonore. Il y a dans la chambre des fleurs qui ressemblent à des lys sans parfum. Les volets clos font une pénombre que raient de longs fils de lumière. Le soleil jaillit en faisceaux pressés entre les planches qui sont les murs de la maison.
— Je suis ici l’agent de la Compagnie… Je n’ai qu’un travail d’écritures. C’est pour cela que les hommes me méprisent. Ils ne sont pas méchants… La brousse les a formés à son image. Ils vivent une vie intense qui est en eux-mêmes, et que les autres hommes ne comprennent pas.
— Je les connais bien… Ils sont grossiers, généreux et bons. Qu’importe… je m’ennuie…
— Venez visiter le camp.
Mais rien ne l’intéresse, et mon verbiage l’ennuie.
Elle s’empresse dans la case où l’éclat du jour pénètre en longues lames d’or étiré, parallèles.
Elle a des yeux qui sont verts et gris, bleus et violets et qui changent à chaque heure du jour, et dont l’éclat suit l’intensité de la lumière ou de la nuit.
Elle est blonde, grande et robuste. Sous la peau, que le soleil a brunie, de jeunes muscles bandent sous l’effort et témoignent qu’elle a longtemps pagayé.
Je sais maintenant qu’elle s’appelle Marthe.
Un visage d’enfant, des cheveux en boucles, un léger embonpoint de jeune animal sain ; et ce vêtement d’indienne et de tussor souple comme une gaze, et qui la laisse presque nue…
— Je crois avoir entendu les tigres, cette nuit, dit-elle.
ChapitreQuatre
Je n’ai jamais vu de créature aussi bizarre…
L’Indien ne parle à personne. Il va, semblable à un être égaré dans la vie. Son regard fixe les yeux et pénètre l’âme. Il exprime sa pensée par des gestes courts et rapides.
Et il rêve… Assis pendant des heures devant la balustrade qui domine la vallée, il regarde au loin devant lui. Il est enveloppé de mystère. Il y a, le soir, autour de lui, une lumière phosphorescente, comme si un feu intérieur le brûlait.
J’essaye en vain d’être son confident. Je ne peux rien apprendre de lui.
— Pourquoi parles-tu ? dit-il ; quel besoin as-tu de tes lèvres pour exprimer ta pensée ? Tu es comme un ara turbulent, comme un singe rouge qui s’agite et crie, comme un sourd qui pousse d’absurdes clameurs…
— …
— Je connais le secret de ton âme, les images et les pensées qui sont en toi. Ne parle pas… Lis dans mes yeux, ils te diront les mouvements de mon esprit…
Malgré son mutisme, l’Indien a l’allégresse matinale des oiseaux et des enfants bien portants. Il ne rit jamais, et cependant sa bonne humeur est contagieuse. Quelle que soit l’heure, à midi lorsque le camp embrasé est désert, le soir lorsque l’ombre des cocotiers est allongée sur le sol, toujours le rayonnement qui vient de lui met le cœur en joie pour le reste du jour.
La vie semble déborder de sa puissante structure. Ses yeux me fascinent ; lorsque ses doigts pressent les miens, et surtout lorsque, dans un geste qui lui est familier, il applique les paumes de ses mains sur mon front, je sens en moi un frémissement suivi d’une torpeur soudaine, délicieuse comme une ivresse.
Je l’ai quitté ce soir. Il était accoudé à la haute balustrade de wacapou, si profondément absorbé dans sa méditation, que je n’ai pas osé lui parler.
Dans la case commune où les hommes du camp vont et viennent avant le dîner, la silhouette de l’Indien apparaît tout à coup. Ce n’est qu’une ombre qui marche, sans toucher le sol, et qui semble translucide…
La lampe suspendue, balancée par le vent du soir, promène sur le plancher et sur les meubles des écharpes de lumière trouble et rougeâtre. J’ai vu, dans le clair-obscur, passer l’Indien qui a traversé la salle et qui s’est engagé sur le sentier conduisant au lac…
J’hésite cependant… et je crois que mes yeux n’ont vu qu’une image créée par mon esprit, car l’air n’a pas frémi au passage de l’homme, le plancher élastique et bruyant n’a pas révélé les pas robustes du lourd géant.
En me détournant, j’aperçois en effet l’Indien dans la position où je l’avais laissé quelques instants auparavant.
D’un élan, je viens à lui, et le secouant violemment :
— Que fais-tu ici ?
Il semble n’être plus un homme vivant. Son regard froid me fixe comme s’il n’était qu’un cadavre. Je prends ses mains ; elles sont tièdes et moites.
— Viens, dis-je avec colère.
Il se retourne pesamment ; ses bras s’appuient à nouveau sur la barre de wacapou, large comme un bastingage.
Les hommes du camp haussent les épaules à mes questions.
— L’Indien a traversé la salle, dis-je passionnément… vous l’avez vu ? Et pourtant il n’a pas quitté la terrasse. Je lui ai parlé… Il est inerte et hagard comme un homme qui aurait perdu son esprit.
Mais personne ne veut prêter attention au miracle. Cela ne mérite pas un pareil émoi. Il faut s’attendre à tout de la part de certains Indiens… Ils se dédoublent, ils se font invisibles, ils marchent au ras du sol sans laisser aucune trace ; ils sont pour les Blancs, déprimés ou exaspérés par le climat torride, des sujets d’incessantes et mystérieuses hallucinations.
ChapitreCinq
On ne la voit plus… dit Delorme.
La drague mugit. La chaîne à godets grince sur les tourteaux avec un bruit de train en marche et de roues de moulin. Les hommes éclaboussés de vase s’agitent et crient.
Je ne sais si l’ingénieur se parle à lui-même, car son regard reste fixé sur les creusets d’acier qui montent lentement, lourdement chargés de boue et d’eau. De temps à autre, il plonge le bras dans la vase nauséabonde, et retire une poignée de glaise qu’il examine avec attention.
— C’est à n’y rien comprendre, dit-il, en lavant une pépite au creux de la main. La prospection n’a pas donné la couleur, et cependant chaque godet contient de l’or.
Et, soudain, les yeux sur moi :
— Qu’est-ce que nous lui avons fait pour qu’elle boude ? Est-elle malade ?
Un hurlement de sirène annonce la fin de la journée. Avec des soufflements ralentis, les moteurs s’arrêtent. Un treuil, lancé à toute volée, fait un bruit de ferraille comme une chaîne d’ancre tombant à la mer. Puis, soudain, le silence.
Sur les fronts bourdonnants des hommes, étourdit par dix heures de vibrations métalliques, le silence s’applique comme un casque et bouche les oreilles.
Titubants, ivres de bruits et de fatigue, imprégnés de l’odeur de la boue pestilentielle, les hommes partent à la file indienne vers le camp. Le sentier longe le lac creusé par la drague.
Sur les flancs du coteau s’étagent les cases des ouvriers. Des jardins plantés de bananiers et de maïs ; des parcs fermés par une palissade en piquets de wara où les agamis sauvages gardent des poules comme nos chiens de berger gardent les moutons ; un bassin d’eau claire ; et, tout en haut, la maison sur pilotis du personnel de la drague.
⁂
Delorme, penché sur sa barbe, les genoux fléchissant à chaque pas suivant l’usage des hommes trop grands, songeait, en gravissant la côte, à cette maison qui lui apparaissait maintenant si misérable.
Il revoyait les planches placées sur des chevalets en forme de table, les vêtements de cuir jetés sur le sol, les outils épars, et tout le délabrement de la salle commune d’un camp de mineurs.
Après le bain du soir, il rôda entre les cases alignées sur le terre-plein qui formait une vaste terrasse. Un secret désir le poussait vers le carbet de Pierre Deschamps où habitait la jeune femme. Il passa devant la porte. La case était vide.
⁂
Delorme, se dirigeant vers la maison commune, fit un détour pour éviter l’Indien dont la haute stature barrait l’horizon, comme un croiseur à l’entrée d’un port. Une crainte secrète l’éloignait du géant.
Il vint s’asseoir sur les premières marches de la terrasse et regarda la naissance des étoiles. Elles éclataient dans la nuit, l’une après l’autre, comme les lumières de la ville, très au loin au fond d’une rade.
Une lourde chaleur humide collait aux épaules ainsi qu’un drap mouillé d’eau tiède.
Le cœur serré d’une angoisse indéfinissable, l’ingénieur eut la sensation qu’un être très cher venait à lui, dont il ne pouvait dire le nom, ni évoquer l’image avec précision. C’était un trouble inconnu, d’une sensualité profonde, qui donnait à ses lèvres un goût sucré et qui lui rappelait l’émoi de sa première adolescence.
Tout à coup, sur le tracé, il vit venir des robes blanches. Les ombres, sorties du marécage, s’avançaient en hésitant… Maintenant, des jeunes filles, se tenant par la main, riaient et couraient vers lui, en farandole. L’une d’elles passa si près qu’il sentit sur son visage le remous frais du vent secoué par une robe.
Du village des mineurs, venait la musique habituelle du soir : des lamentations d’accordéon et des chants.
Les jeunes filles en robe blanche cueillaient, aux palissades du camp, des roses dont elles avaient les bras chargés et qu’elles portaient en cortège à la case de Marthe Deschamps.
Un bien-être nouveau lui était venu. Il se sentait enveloppé de la présence de la femme. L’homme, qui s’est trouvé éloigné longtemps de l’odeur subtile de la femme, sent naître en lui un mal inconnu dont il ignore la cause et que rien ne peut guérir. C’est une plaie qui grandit chaque jour, et dont la mystérieuse souffrance explique tant de drames de la jungle.
⁂
Quand Delorme entra dans la salle, les hommes étaient assis et mangeaient. Pour la première fois, le repas avait commencé sans lui. Il vit que la table, couverte d’une nappe, était chargée de vaisselle claire. Il y avait des fleurs aux deux extrémités.
Personne ne fit attention au retard de l’ingénieur. Marthe Deschamps se tenait en face de lui, à la place d’honneur. Elle lui sourit. Il ne sut pas répondre ; il voulut gourmander le forçat pour se donner une contenance et ne trouva pas les mots habituels.
Il lui sembla que les hommes étaient intimidés par leur tenue débraillée. Cependant, ils parlaient, comme tous les soirs, de la production et du travail de la journée.
Elle était là, en robe claire, toute semblable aux jeunes filles qui lui avaient rendu visite tout à l’heure. Il n’osait pas entreprendre une conversation, de peur de la froisser.
— Nous aurons sans doute le courrier avant un mois, dit-il soudain.
Une rougeur lui vint au front. Les convives le regardaient sans répondre. Il se reprocha ce propos, craignant qu’elle le considérât comme une allusion à son départ.
Un silence timide et heureux pesait sur cette table habituée aux clameurs des coureurs des bois réunis.
Ainsi la paix descend parfois au cœur des hommes.
ChapitreSix
Quelle vie ardente dans la vallée…
La drague au travail rugit. Les coups de compresseurs, les hurlements des sirènes, les cris des treuils, les grondements métalliques de l’élinde, les vibrations des tables de séparation semblables à d’immenses cribles, les gémissements des godets dégouttant de boue jaune et cheminant lourdement sur les plans inclinés, tous les bruits d’une cité bourdonnante d’usines emplissent l’air d’une clameur ininterrompue.
Sur la berge du lac, les tracteurs rampent avec un crépitement de moteurs. Des troncs d’arbres en grume, halés par les filins d’acier invisibles, ressemblent à de monstrueuses chenilles sortant à la file de la brousse. Ils buttent aux roches du chemin, basculent, contournent les obstacles, et vont, avec de courts soubresauts, agiles, ballotés et houleux, vers la scierie qui les dévore.
La scierie stridente a des toits de zinc qui flamboient au soleil. Une longue vibration, aiguë et douloureuse aux nerfs, secoue l’air embué de poussière de bois. Par le pan ouvert, les arbres couchés entrent un à un, et très vite, comme les pirogues sous la voûte des palétuviers au tournant d’un rapide.
Les excavateurs accrochés au flanc de la colline mordent la pierre et crachent en sifflant. Alignés devant la faille du rocher béant, ils sont comme des terrassiers noirs chargeant en cadence les wagonnets actionnés par une force mystérieuse.
À l’est, une falaise, attaquée au monitor, s’effrite et s’écroule. Une rivière de boue et de sable descend en cascade vers les sluices étagés en aval. On entend les coups de marteau des pistons des pompes dissimulées dans une tranchée.
Les machines fouillent le soi, lavent les alluvions, abattent les quartz, transportent les matériaux et bouleversent l’ordre des choses, sans que l’homme apparaisse dans ce formidable labeur.
Les ouvriers du placer, disséminés parmi la machinerie géante, tiennent moins de place que les ombres errantes des aras voletant sur le lac.
La vallée de l’Elysée gémit, gronde et crépite parmi les détonations des coups de mine et le fracas des moteurs. Les gestes et la voix des hommes ne sont rien dans cette agitation qui transforme le monde, dans cette clameur qui fait osciller les colonnes de l’air.
Et cependant, l’âme humaine seule peuple cette ruche au travail.
⁂
De la terrasse du camp d’où je vois luire au loin les feux des chantiers je ne vois que l’image des hommes, je n’entends qu’une large voix humaine déployée sur la plaine.
Je sais bien que les hommes, seuls, ont créé cette force. Ce soir, Delorme apportera la production d’or. Assis devant la grande table, ayant à ses côtés Ganne, Loubet, Marcellin et Colbert, il pèsera les pépites et la poudre d’or pressée dans les peaux de chamois. Puis, tous signeront le procès-verbal pour la Compagnie. Leurs yeux auront des regards aigus de convoitise, les plis de leurs visages frémiront devant l’or étalé. Il n’y a pas solution de continuité entre l’âme obscure de ces hommes et le métal brillant, il n’y a qu’une gradation de lumière. Toute leur vie n’a qu’un seul objectif : l’or. C’est pour lui qu’ils vivent ici, pour lui qu’ils souffrent cette vie d’enfer dans la fournaise du marécage. Il n’y a pas de place dans leur esprit pour d’autre passion que la passion de l’or.
⁂
Un nuage glisse sur mon front ; un court vertige m’oblige à m’appuyer au parapet.
Sur la terrasse où j’étais seul, un homme est venu dont les pas sont comme une trace sur l’eau. Il est là, près de moi, et je sens sur mes épaules un fardeau qui m’accable.
C’est l’Indien. Il se tient debout et regarde l’horizon. La flamme qui jaillit de ses yeux est douce et pénétrante ; elle est dorée et semblable aux rayons du soleil.