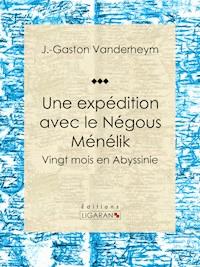
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il est une loi commune : tout voyageur, qu'il coure un monde connu ou inconnu, qu'il traverse des contrées battues ou inexplorées, éprouve, au retour, le besoin irrésistible d'écrire ses impressions. Il a la prétention que les choses ont été vues par lui sous un aspect nouveau. Il désire faire partager à ses amis les émotions ressenties et faire revivre pour eux les scènes de sa vie d'aventures."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335075960
©Ligaran 2015
À MA MÈRE,
J.-G. VANDERHEYM.
Cher Monsieur,
Votre livre arrive à son heure et au moment où, on peut le dire sans exagération, le monde entier a les yeux tournés sur ce coin de terre que Ménélik emplit de ses hauts faits. Vous avez eu l’étrange bonne fortune, que pour un peu vous auriez payée cher, de voir de près, d’étudier ce personnage quasi légendaire, entouré d’une sorte d’auréole rouge, et vous en avez tracé un portrait que l’histoire devra consulter. Ce qui me plaît dans votre témoignage, c’est sa précision. Votre plume a la netteté, le relief, la sincérité des instantanés qu’a pu prendre votre détective photographique. Le Négous est là vivant, agissant, attirant – et terrible.
Je lisais, il y a quelques jours, un article du Correspondant où Ménélik est présenté sous un aspect plus brillant, et je me figurais ce héros – car c’est un héros – sous des traits plus sympathiques. Il y a du prophète en lui, du mystiqueet aussi de l’homme moderne. Il croit à l’intervention de Dieu dans ses batailles et (vous l’avez dit) aux vertus de l’iodoforme après la tuerie. Vous le montrez surveillant des expériences de dynamite, et l’on nous apprend qu’il vient de commander, à son effigie, des timbres-poste tout comme un ministre des télégraphes de notre République. Il est chrétien, il déplore le sang que les Italiens, dit-il, le contraignent à verser, et dans cette expédition contre les Oualamos, à laquelle vous avez assisté, il semble prendre plaisir à loger les balles de son winchester dans de l’humaine chair noire.
Vous pouvez, cher Monsieur, vous vanter d’avoir vu là d’horribles et stupéfiants spectacles. Il me semble, en vous lisant, entendre les soldats du roi d’Éthiopie hurler leur sinistre chant de guerre :
Quand je pense que les bataillons du malheureux Baratieri ont entendu cet hymne du massacre, je songe à tous ces deuils des mères italiennes dont les lances abyssines ont tué, dont lesarmes recourbées ont tailladé les fils. L’Afrique noire aura bu bien du sang européen avant qu’elle nous ait livré son secret. Je sais que tout pas en avant s’achète par de tels sacrifices et que le progrès est une plante qui plonge ses racines dans un lugubre humus nourri de cadavres. Ne pourrait-on rêver des conquêtes sans égorgements ?
L’Italie, héroïquement, donne ses enfants pour une idée. La France a donné de même les siens. Nous avons tous ressenti une impression de pitié lorsque nous avons appris le désastre que les soldats de race latine avaient subi. Nous nous rappelions pourtant qu’à l’heure de nos défaites ce Ménélik, dont vous avez été l’hôte, apprenant qu’on exigeait de nous une rançon de guerre, offrait, par un mouvement généreux et d’une naïveté touchante, une partie de son trésor pour payer cette dette, pour « racheter », comme il disait, la France.
Cet homme n’a rien de vulgaire. Il se dresse au milieu de nos débilités d’intellectuels ou de nos subtilités de politiciens, comme une incarnation brutale et pourtant imposante du patriotisme et de la résistance à l’étranger. Il y a du Théodorosen lui, avec plus de grandeur d’âme. Il n’a pas la poésie hautaine à la fois et mélancolique d’un Abd-el-Kader, mais il en a l’énergie et, dans l’attaque et la tactique, le génie. Il ne fait pas bon le voir apparaître dans la fumée rouge du combat, et il semble alors une sorte de démon noir, mais c’est le démon de la patrie. Il défend aux mortels venus de loin d’approcher des tombeaux de ses pères.
Et ceux-là sont braves et marchent au devoir, sous le drapeau aux trois couleurs qui flotta tout près de notre tricolore ; ils ont quitté leurs fermes lombardes, leurs vignes napolitaines, leurs lagunes vénitiennes, leurs villages aux toits rouges, leur terre natale, pleine de soleil et de chansons, et ils se heurtent aux vainqueurs des Oualamos, aux remington et aux zagaies du Négous. Je crois bien que personne mieux que vous n’aura fait comprendre la gravité de la situation et les efforts de la vaillante armée italienne. Ce sont de terribles adversaires que les Choans et vous avez vu à l’œuvre et au carnage les vainqueurs du combat d’Adoua.
En tout autre moment, la lecture de vos souvenirs de voyage eût offert un intérêt profond àceux qui, du fond de leur fauteuil, prennent plaisir à se rendre compte de la vaste vie universelle. Mais, aujourd’hui, comme à la lueur de ces combats, le récit de votre expédition acquiert un caractère tout à fait captivant. Je ne doute pas du succès que va obtenir votre déposition si importante dans ce grand procès engagé entre les Européens et les Abyssins et qui se plaide à coups de canon. Parisien de Paris, vous apportez sur l’Abyssinie des détails très nouveaux, et votre livre, plus actuel que le remarquable ouvrage de M. d’Abbadie, sera certainement un de ceux qu’en Italie et en France et peut-être, là-bas, à Addis-Ababa – où le Négous se fait apporter les coupures de journaux et les articles des reporters, – on lira avec le plus d’empressement.
Je suis heureux d’avoir, le premier, jeté les yeux sur ces pages, très sincères, et je vous remercie cordialement du plaisir, ou plutôt de l’émotion, que je vous dois et que le public va partager.
Cordialement à vous,
JULES CLARETIE, de l’Académie française.
10 mars 1896.
De Paris à Obok. – Obok. – Djibouti. – De Djibouti au Harrar. – Le Harrar. – Du Harrar à Addis-Ababa (Choa). – Notre factorerie à Addis-Ababa.
Il est une loi commune : tout voyageur, qu’il coure un monde connu ou inconnu, qu’il traverse des contrées battues ou inexplorées, éprouve, au retour, le besoin irrésistible d’écrire ses impressions.
Il a la prétention que les choses ont été vues par lui sous un aspect nouveau.
Il désire faire partager à ses amis les émotions ressenties et faire revivre pour eux les scènes de sa vie d’aventures.
De là à transformer par la pensée ses amis en lecteurs, et à vouloir publier ses notes, il n’y a qu’un pas.
Je l’ai franchi et me présente aujourd’hui à ceux qui voudront bien me lire, par amitié ou par intérêt du sujet, comme un voyageur atteint de la manie commune à chacun, qu’il revienne d’Asnières ou du centre de l’Afrique.
Le 12 novembre 1893, je quittais Marseille à bord de l’Ava, courrier de Madagascar des Messageries maritimes.
M. Jules Rueff, président du Conseil d’administration de la Compagnie commerciale Franco-Africaine, m’envoyait en Abyssinie comme agent de cette compagnie, qui possédait un comptoir à Djibouti, un autre au Harrar, un troisième, enfin, à Addis-Ababa, dans le Choa.
Je devais visiter ces trois agences.
Le peu d’affaires qui se sont traitées pendant mon séjour à Obok, Djibouti, au Harrar et au Choa m’a permis de prendre bon nombre de notes et de photographies.
De plus, j’ai accompagné le Négous Ménélik dans une de ses expéditions, et pendant les deux mois que j’ai vécu avec lui j’ai été témoin de faits qui, racontés sans parti pris, jetteront peut-être quelque lumière sur l’empereur d’Éthiopie et feront un peu connaître ces contrées dont il est tant parlé en ce moment.
Je fis une très agréable traversée, ayant trouvé à bord les RR. PP. Cyprien et Théodore, de la mission catholique d’Obok. C’est avec le R.P. Cyprien que je fis le voyage de Djibouti au Harrar. C’est un homme de haute stature. Son regard reflète la bonté et la franchise. Son nez d’aigle surmonte une bouche souriante, encadrée d’une moustache et d’une longue barbe grisonnante, qui descend sur la poitrine et se détache sur le blanc de sa robe de flanelle. Sa parole est intéressante ; il a beaucoup vu, beaucoup retenu, et emploie des mots justes pour évoquer les souvenirs des vingt années passées à l’île Maurice. Il paraît chasseur passionné et sait quelque peu réparer une arme ou une machine. Il emportait avec lui tout un attirail de forgeron et de mécanicien.
Le P. Théodore est petit et âgé de vingt ans à peine ; il parle, avec un fort accent du Midi, en termes exubérants. Il espérait que nous ferions route ensemble jusqu’au Harrar : « Nous tuerons des pannthères, me disait-il, des liongnes et des éléphangnes. » Photographe comme moi, nous dissertions des heures entières sur tel ou tel procédé de développement.
Je trouvai également à bord M. Davault, agent des Messageries maritimes, qui rentrait après un congé ; il me fit une description d’Obok et de ses habitants, fonctionnaires et civils, qui ne me donna pas envie d’arriver plus vite dans cette terre promise.
À Port-Saïd, nous prîmes quelques passagers, dont M. Eysseric, géographe distingué, avec lequel je suis resté en correspondance, et M. Greffulhe, négociant et agent des Messageries maritimes à Zanzibar.
Nous bavardions souvent de longues heures ou jouions au whist.
Des soldats d’infanterie de marine, voguant vers l’île de la Réunion, chantaient, à l’avant, des scies de régiment ou jouaient au loto, renouvelant, à la sortie de chaque numéro, les légendaires à peu près.
Quelques Anglais et Allemands, qui devaient prendre à Aden un bateau pour les Indes ou la Chine, complétaient notre société.
Un colonel anglais de l’armée des Indes, flanqué de ses deux charmantes filles, ne quittait pas son appareil photographique, prenant, à tous moments, des instantanés.
Devisant gaiement avec ces passagers, nous arrivâmes assez rapidement à Obok, le 23 novembre, au petit jour. De nombreux boutres arabes accostent aussitôt l’Ava, et les petits Somalis, si souvent décrits, se plongent dans la mer pour attraper des sous que leur jettent les passagers, aux cris répétés de : « Oh ! oh ! à la mer ! à la mer ! » et de « bakchich », le seul mot compris par toutes les peuplades orientales.
Obok, vu de la rade, n’a rien de très engageant, et la descente à terre tente peu les passagers de la ligne de Madagascar, dont les paquebots s’arrêtent trois heures, deux fois par mois, à l’aller et au retour, pour y faire leur charbon. Quelques maisons arabes, d’une blancheur éclatante, le village indigène, le pénitencier et la factorerie Mesnier se détachent sur un fond de sable jaune à l’aspect sec et aride, et sur un ciel bleu d’Orient.
Obok a été acheté par la France, en 1862, aux chefs indigènes du pays, afin de servir de dépôt de charbon sur la route de Cochinchine.
À cette époque, ce n’était qu’une plage inhabitée, mais on avait compris le parti que l’on pouvait tirer de sa rade, reconnue excellente pour le mouillage.
On acquit en sus, et le tout pour 10 000 thalaris, représentant à cette époque environ 55 000 francs de notre monnaie, une bande littorale longeant le détroit de Bab-el-Mandeb depuis le ras (cap) Zantour, contournant le golfe de Tadjoura pour finir auras Djibouti et présentant une étendue de 25 lieues carrées.
Ce n’est que vers 1882 que l’on s’occupa de cette nouvelle colonie. Quelques maisons commerciales s’y portèrent pour pénétrer en Abyssinie, mais durent abandonner ce port, la route vers l’intérieur étant impraticable. Les négociants s’établirent à Djibouti, port situé de l’autre côté du golfe de Tadjoura, et véritable point de départ de la route vers le Harrar.
Le gouvernement français suivit le mouvement. Le transport de la colonie d’Obok à Djibouti est définitif depuis novembre 1895. On pense même que, d’ici à peu, l’ancien dépôt de charbon sera complètement abandonné.
Voici, à titre de document, la composition européenne de la colonie d’Obok et de Djibouti, lors de mon passage :
Le gouverneur ; 1 administrateur de 1re classe ; 2 administrateurs de 2e classe ; 1 trésorier ; 1 médecin colonial ; 2 infirmiers ; 1 capitaine de port ; 1 adjudant d’infanterie de marine (représentant le gouverneur à Djibouti) ; 1 agent des postes ; 1 mécanicien (pour la machine à glace) ; 1 garde d’artillerie ; 12 surveillants militaires (remplissant diverses fonctions : chef du service indigène, commandant le Pingouin, postier à Djibouti, commandant de milice indigène, etc.), plus l’équipage du stationnaire l’Étoile, avec 3 officiers, environ 50 miliciens et une vingtaine d’employés indigènes (cuisinier du gouverneur, interprètes, employés des postes, etc.) ; 4 sœurs pour l’hôpital ; 3 pères capucins.
Population civile : 10 négociants et employés français ; 1 Anglais ; 6 Grecs ; environ 1 000 indigènes, somalis, dankalis, abyssins et arabes pour Obok, et 1 200 pour Djibouti.
La ville, qui s’étend sur une longueur de plage d’environ 5 kilomètres, peut se diviser en quatre parties bien distinctes : le camp, le village arabe, les paillotes indigènes et le groupe de la factorerie Mesnier et du pénitencier.
La résidence du gouverneur, M. Lagarde, construction cubique à deux étages, d’une architecture primitive, est bâtie sur une élévation qui domine la mer. Elle est entourée de massifs de cailloux, avec des plates-bandes de cailloux un peu plus gros, séparés par des allées sablées, à l’instar des jardins anglais. Deux palmiers, dans des caisses, soignés comme des nouveau-nés, gardent la porte principale, pendant que quatre petits canons dirigent leurs gueules minuscules vers l’étendue de la mer. À côté de la résidence, un phare jette, la nuit, ses feux verts et rouges pour indiquer l’entrée de la passe. Derrière la résidence se dressent quelques bâtiments à étiquettes pompeuses : bibliothèque, trésorerie, postes et télégraphes, qui contiennent les nombreux fonctionnaires chargés des services administratifs ; l’hôpital sert d’escale aux militaires malades de la ligne de Madagascar, trop fatigués pour entreprendre la cuisante traversée de la mer Rouge.
Le cimetière, situé sur la plage, rappelle aux rares visiteurs les noms de héros inconnus, victimes des insolations ou de fièvres coloniales. Une série de tombes avec l’émouvante mention « mort en service commandé » indique la sépulture des braves matelots de l’aviso le Pingouin, massacrés à Ambado par des hordes somalies. Le Pingouin est à Djibouti et sert de résidence maritime au gouverneur, qui quitte chaque soir sa résidence terrestre pour tâcher de respirer un peu de fraîcheur. Cet aviso fut jadis commandé spécialement pour la colonie, dans le but de remonter la rivière ( ?) d’Obok, dont le lit est à sec 364 jours de l’année et se termine par un petit estuaire boueux où poussent quelques maigres palétuviers.
Devant la résidence, une estacade de quelque cent mètres avance sa gracieuse charpente de fer en pleine mer. En arrière, sur un plateau madréporique, on aperçoit les maisons des missionnaires catholiques et des religieuses.
La mission d’Obok se compose de plusieurs capucins sous les ordres du R.P. Léon, dépendant lui-même de Mgr Thaurin, évêque du Harrar.
En sortant du camp et sur la plage se dressent les bâtiments contenant les appareils à glace et à distillation, que l’administration coloniale entretient pour fournir aux peu nombreux colons de la glace à 1 franc le kilogramme et de l’eau distillée à 7 centimes le litre.
Puis on distingue les premières habitations du village proprement dit, composé seulement d’une bordée de maisons arabes en pierre. Deux de celles-ci ont un premier étage, et encore l’étage supérieur de l’une est construit en torchis comme les paillotes indigènes.
Dans l’unique rue d’Obok se trouvent l’agence des Messageries maritimes, un hôtel-épicerie-restaurant français ; quelques négociants grecs ou arabes tiennent des échoppes maigrement approvisionnées de cotonnades à bon marché, de comestibles, de poissons ou de viande de boucherie. Enfin on trouve le poste de police, composé de miliciens indigènes en tenue coloniale, pantalon et veste de toile blanche à boutons d’or, avec une large ceinture à boucle de cuivre, le chef couronné d’un calot blanc à galon jaune ou bleu et rouge.
Deux cafés arabes déversent leur clientèle dans la rue : les consommateurs, les reins ceints d’un pagne blanc à bordure multicolore, les épaules couvertes d’un tob laissant voir leur poitrine généralement osseuse, un long bâton à la main, vautrés sur des banquettes boiteuses et dépaillées, fument leur narguilé en s’interpellant ou en jouant aux cartes ; des Abyssines drapées à l’antique dans un vaste péplum de mousseline plus ou moins blanche, des Arabes voilées au déhanchement languissant, des petites filles couvertes de bijoux d’argent ou de colliers d’ambre et de verroterie, passent dans la foule, où se mêlent les poulets étiques, les gracieuses chevrettes somalies, les petits ânes gris ou les beaux moutons à grosse queue, à toison blanche et à tête noire. Quelques femmes somalies ou dankalies, habillées de guenilles aux tons neutres, les cheveux gras, d’une saleté repoussante, portant de larges boucles d’oreilles à pendeloques carrées, des colliers de billes de verre avec plaques en étain, et de lourds bracelets de cuivre, sont accroupies à l’ombre des murs et vendent, dans des outres qui suintent, du lait ou du beurre liquide.
Elles s’effarouchent et se cachent le visage à l’approche des Européens.





























