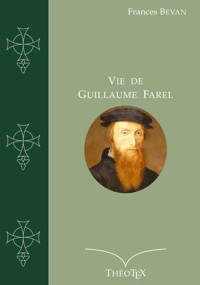
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Si Guillaume Farel (1489-1565) n'est pas aussi célèbre que Luther ou Calvin, son rôle dans la propagation de la Réforme protestante en Suisse et en France a cependant été immensément important. Évangéliste audacieux, orateur passionné et puissant, il a influencé en bénédiction petits et grands personnages qui ont croisé sa route. Sa vie nous est connue par la correspondance qu'il a entretenue avec les autres acteurs de la Réforme. Frances Bevan (1827-1907), traductrice et poétesse de nationalité britannique mais bilingue, installée à Cannes, a écrit la biographie la plus complète qui existe de Farel. Théologiquement issue des Frères de Plymouth, on peut sans doute lui reprocher son style assez mômier (c-à-d qui cherche trop souvent à convertir le lecteur), cependant son ouvrage se lit agréablement ; il reste une référence pour faire revivre dans nos coeurs un héros de la foi, dont la carrière démontre la puissance de Dieu, lorsqu'il daigne s'emparer d'un homme pauvre et d'apparence chétive, mais totalement dévoué à sa cause. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1885.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322259458
Auteur Frances Bevan. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]En écrivant la biographie du grand réformateur de la Suisse romande, nous nous sommes tenu aussi près que possible de la vérité historique. Nous exprimons ici nos vifs sentiments de reconnaissance au modeste savant, auteur de la Correspondance des réformateurs, qui nous a permis de puiser largement dans son précieux recueil.
Outre le désir de remettre en lumière un des Français les plus dignes d'être connus, nous nous sommes proposé un but plus élevé encore, celui d'éveiller dans les cœurs français et suisses l'intérêt pour la vérité révélée dans la Bible et l'amour pour Celui qui a envoyé son fils semblable à Lui, afin que nous le recevions comme notre Sauveur, notre Dieu et notre Maître.
Si la vie de Farel est l'histoire d'une âme en rapport continuel avec Christ, c'est que le réformateur sentait sa responsabilité. Il avait reçu gratuitement un don précieux et son cœur brûlait du désir d'en rendre tous les hommes participants en leur faisant connaître le chemin de la délivrance du péché. Que le nombre de ces affranchis du péché soit augmenté de jour en jour ! c'est le désir et la prière de l'auteur de ce livre : elle le place sous la bénédiction de Celui qui s'est souvent servi des instruments les plus faibles et les plus petits !
Près de la ville de Gap, non loin de la frontière sud-est de la France, au pied des Alpes, existe un petit hameau à demi caché sous les arbres et entouré de vertes prairies émaillées de fleurs. — La Durance, qui descend en bouillonnant des montagnes, passe près du village. A la fin du quinzième siècle, les Farelles, c'est le nom du hameau, dépendaient d'un manoir dominant les chaumières et habité par un seigneur nommé Farel. On voit encore les ruines du château et de sa haute terrasse entourée d'un verger. Ce seigneur avait cinq fils, Daniel, Jean, Jacques, Claude, Guillaume et Gauthier, et une fille. Guillaume, qui paraît avoir été l'avant-dernier, naquit en 1489. Le nid paternel de Guillaume Farel n'était pas une retraite que ni troubles ni tumultes ne pouvaient atteindre. Au contraire, les montagnes du Dauphiné n'étaient rien moins que paisibles. Les vallées voisines du Piémont étaient habitées par les Vaudois, humbles montagnards qui obéissaient en grande partie à la Parole de Dieu et avaient souvent été persécutés par les papes de Rome et leurs suppôts.
Deux ans avant la naissance de Farel, Innocent VIII ordonna que ce qui restait du malheureux peuple des Vaudois, fût poursuivi et exterminé. « Ecrasez ces hérétiques sous vos pieds, s'écria le pontife, comme des serpents venimeux. » Conformément à cet ordre pastoral, les modestes demeures qui abritaient le petit troupeau de Christ, furent attaquées en 1488 et 89, par une armée de dix-huit mille soldats, à la tête desquels marchait le légat du pape. Les malheureux Vaudois se réfugièrent dans les cavernes et les antres des rochers, mais les soldats les poursuivirent de retraite en retraite, ne laissant pas une forêt ou un vallon inexploré et couvrant le sol des victimes de celui qui s'appelait le vicaire de Christ sur la terre ! Ces scènes sanglantes se passaient autour du village des Farelles lorsque Guillaume naquit, et ses parents ont dû en avoir connaissance, mais ils ne paraissent pas avoir mis en doute que les soldats du pape ne fissent l'œuvre de Dieu ; ils avaient des oreilles pour ne pas ouïr, des yeux pour ne pas voir. Du reste, les parents de Farel avaient une apparence de raison à alléguer en faveur du massacre des Vaudois : c'est que les prêtres affirmaient que ces pauvres gens étaient tous des sorciers et des magiciens, qui se réunissaient avec les Juifs les nuits de sabbat pour adorer le diable et commettre toute sorte d'abominations. Les prêtres racontaient encore que les Vaudois se rendaient à ces sabbats nocturnes en chevauchant à travers les airs sur le dos de monstres, ou bien assis sur un manche à balai, en bois de bouleau, franchissant ainsi de grandes distances avec la rapidité de l'éclair. C'étaient, ajoutait le clergé, ces invocations des hérétiques au diable, qui produisaient les mauvaises récoltes, les épidémies et autres calamités.
« Mes parents, dit Farel, croyaient à toutes ces choses. » Il nous est difficile de comprendre que pareille folie et pareille ignorance aient jamais existé. Et pourtant il y a de nos jours bien des gens aussi crédules que les Farel, qui mettent la parole de l'homme à la place de celle de Dieu et pensent faire acte de foi en acceptant les inventions de l'homme. Il y a, par exemple, des milliers de personnes qui croient encore qu'un prêtre peut pardonner les péchés, et qu'il suffit d'être baptisé d'eau par un ministre pour être né de nouveau. Cela nous paraît peut-être moins absurde que de croire aux sorciers voyageant dans les airs sur des manches à balai, mais aux yeux de Dieu c'est tout aussi condamnable, surtout de la part de ceux qui, ayant la Bible, peuvent s'éclairer. Nous devons avoir pitié des Farel, car ils n'avaient que la parole de l'homme, celle de Dieu leur était inconnue ; il croyaient bien, mais leur foi était en l'homme et non en Dieu, or le Seigneur Jésus a dit : « Croyez en Dieu. » Cette foi-là est la seule efficace.
Guillaume était aussi crédule que ses parents ; on lui enseigna, comme il le dit lui-même, à prier tant de saints et d'anges, que son esprit devint comme un temple d'idoles et qu'il était semblable à un calendrier ambulant des jours de saints et de jeûnes. Guillaume apprit en outre les merveilleuses légendes de ces saints ; comment St-François en causant amicalement avec un loup dans les bois, lui persuada de ne plus dévorer les hommes, comment il fit monter en chaire devant toute la congrégation le loup qui donna la patte en signe d'obéissance, et enfin comment ce bon loup tint fidèlement sa promesse. On lui racontait aussi l'histoire de Ste-Elisabeth dont le mari lui avait défendu de donner du pain aux pauvres. La sainte continua ses distributions malgré les ordres de son mari. Or un jour qu'elle allait en ville avec son tablier plein de pain et de viande, elle rencontra son époux qui lui demanda ce qu'elle portait. Ste-Elisabeth répondit que c'étaient des fleurs ; le mari méfiant ouvrit son tablier, mais n'y trouva en effet que des lis et des roses, Le petit Guillaume aimait à réfléchir, il aura pu se demander s'il était louable pour une femme de désobéir à son mari, et s'il pouvait être mal de mentir puisque les saints en donnaient l'exemple. On racontait à l'enfant bien d'autres histoires des saints qui, après avoir été décapités, avaient marché en portant leur tête, qui avaient prêché aux oiseaux et aux chenilles, qui avaient marché sur la mer, tué des dragons et eu des visions. On lui parla aussi des saints qui avaient vécu pendant des années sur une colonne, de ceux qui ne se lavant jamais par renoncement, se laissaient ronger par la vermine ou mêlaient des ordures avec leurs aliments.
On lui apprit à lire lorsqu'il était encore un tout jeune garçon, mais hélas ! personne ne lui donna la Bible, c'était un livre que lui et ses parents n'avaient jamais vu. « Quand je pense, dit-il lui-même, où j'en ai été auparavant, l'horreur me prend, en songeant aux heures, prières et services divins que j'ai faits et fait faire à la croix et à autres telles choses contre le commandement de Dieu. Et si alors Satan ne m'eût aveuglé, ce que je faisais et ce que je voyais me devait bien montrer et faire connaître combien j'étais hors du droit chemin. La première notable idolâtrie dont il me souvienne et le premier pèlerinage auquel j'ai été, fut à la sainte croix qui est en une montagne auprès de Tallard, diocèse de Gap, laquelle croix sert, à ce qu'on dit, à faire recouvrer la vue ; le lieu porte le nom de la croix et l'on dit qu'elle est du propre bois de la croix en laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Or le bois d'icelle croix est couleur de cendre, c'est un bois tout rude et non aplani, et en tout contraire à celui de la croix que j'ai adorée et baisée à Paris… et je ne pense point qu'il y ait un seul des bois que j'ai vus qu'on dit être de la croix, qui ressemble à l'autre ni qui soit de la même espèce de bois. Cette croix de laquelle j'ai tantôt parlé est garnie de cuivre… si le bois est saint, le cuivre l'est aussi au dire des prêtres, car ils prétendent qu'il vient du bassin dans lequel notre Seigneur lava les pieds à ses disciples… On a voulu maintes fois transporter cette croix ailleurs et l'enfermer, néanmoins elle retourne toujours en son lieu… le prêtre nous disait que quand le mauvais temps venait, toute la croix frémissait ; mais que cela arrivait surtout à un petit crucifix mal en ordre et peint d'une manière burlesque, lequel était attaché à la croix. Ce crucifix, disait le prêtre, se mouvait tellement qu'il semblait sur le point de se détacher de la croix, comme voulant courir contre le diable. Et, en outre, il disait que le crucifix jetait des étincelles de feu, affirmant que si cela ne se faisait, il ne demeurerait rien sur la terre. »
Le père et la mère de Guillaume, il avait alors sept ans, écoutaient tous ces prodiges et y croyaient fermement. Mais leur enfant semble avoir déjà eu l'esprit éveillé et manifesté cet amour du vrai, cette haine des faux semblants qui, nous le verrons plus tard, est un des traits les plus remarquables de son caractère. Il nous raconte que pendant que lui et ses parents regardaient avec dévotion cette croix, une jeune femme arriva pour rendre visite au prêtre qui eut l'air enchanté de la voir et l'emmena dans la chapelle voisine. « J'ose bien dire, ajoute Farel, que jamais danseur ne prit femme et ne la mena faisant meilleure mine que ces deux ne faisaient. » Même alors, les manières effrontées de la jeune femme déplurent à Farel. « Mais, dit-il, nous étions tous si aveuglés que nous n'eussions pas même osé soupçonner quelque mal. » Il y avait encore un spectacle à contempler au pied de cette croix, c'était un homme qu'on appelait « le sorcier du prêtre. » Il était effrayant à voir avec ses yeux couverts de peaux blanches ; le sorcier avait pour mission d'appuyer tous les récits miraculeux du prêtre, lequel affirmait que personne ne pouvait voir trembler le crucifix excepté lui et le sorcier aux yeux blancs.
La famille Farel s'en retournait satisfaite d'avoir vu la croix merveilleuse, mais Guillaume se livrait à beaucoup de réflexions qu'il ne communiquait à personne. Néanmoins, il ajoutait foi à ce que ses parents lui disaient et il ne se serait pas permis de douter de la véracité des prêtres, mais il se sentait malheureux et perplexe.
C'est à regret que j'ai donné cette esquisse peu édifiante de l'enfance de Guillaume Farel. Dieu veut que nous sachions ces choses afin qu'elles nous servent d'avertissement. Il a fait écrire les histoires de Jéroboam, d'Achab et d'Achaz, afin qu'Israël vît les fruits amers de la désobéissance envers Dieu. Les péchés des Juifs et de la chrétienté doivent nous servir d'avertissement. Laissez-moi vous faire observer que pour les Juifs comme pour la chrétienté, les malheurs qui sont survenus ont eu pour origine l'abandon de la Parole de Dieu pour des inventions humaines. Et dans les deux cas, ce sont les pasteurs et les docteurs qui ont été les aveugles conducteurs d'autres aveugles.
« Il est arrivé dans le pays, dit l'Éternel à Israël, une chose étonnante et qui fait horreur, les prophètes prophétisent le mensonge, les sacrificateurs dominent par leur moyen et mon peuple a pris plaisir à cela. » Nous avons vu que Paul prédisait un temps où les hommes détourneraient leurs oreilles pour rechercher des fables. Ne croyez pas, chers lecteurs, que ce temps-là soit passé et que nous ne soyons pas en danger de nous laisser conduire par l'homme plutôt que par Dieu. Satan met peut-être plus d'habileté que jadis à se déguiser en ange de lumière, mais cela ne fait qu'augmenter le péril, à moins que nous ne soyons enseignés de Dieu à reconnaître la voix du bon Berger et à la distinguer de celle de Satan. Du temps de Farel, alors que la Bible était introuvable, Satan pouvait bien faire enseigner des erreurs par ses serviteurs, sans être obligé de dissimuler le mal sous un mélange de bien. Les ténèbres étaient si profondes que les hommes n'auraient pas su discerner de la vérité les plus absurdes folies. Mais à présent que nous avons tous la Bible, l'Ennemi s'y prend autrement ; il réunit dans un même livre (peut-être un recueil d'hymnes ou de sermons), le bien et le mal, si habilement présentés que Dieu seul peut nous faire découvrir le piège.
Plus tard Farel écrivit les paroles suivantes que je voudrais savoir gravées dans tous les cœurs à jamais : « Je prie tous ceux qui aiment Jésus-Christ… de ne pas prendre autrement qu'il ne faut, si je ne mets pas les Pères de l'Église au rang de la Sainte Écriture et si je regarde diligemment si ce qu'ils ont écrit est selon la vérité de la Sainte Écriture ou non. Tant s'en faut que je voulusse contredire les grands et saints personnages disant la vérité, car même le plus petit, le moindre qui soit et le moins estimé, parlant vérité, m'est en telle réputation que pour quoi que ce soit, je ne voudrais le contredire dans ce qu'il dit de vrai. Or la vérité doit être manifestée par la Sainte Écriture et maintenue parce qu'elle y est contenue… car l'Écriture est très ferme et ne dit rien qui ne soit vrai et que chacun ne doive recevoir et tenir, mais tout ce qui est sans l'Écriture ne doit avoir lieu, poids ni autorité dans les choses qui regardent le service de Dieu… Christ est la vérité et Lui seul doit être écouté ; il ne faut avoir égard à aucun autre, quoi qu'il dise ou fasse, mais suivre Jésus-Christ. Et si l'on doute que Jésus-Christ ait dit ou ordonné quelque chose, il faut en référer aux Saintes Écritures comme à la source divine par laquelle le Seigneur veut que nous éprouvions toutes choses pour savoir ce qui est selon Jésus-Christ et ce que nous devons selon lui, croire et tenir, sans y faire rien ajouter ou diminuer, sans tirer ni çà ni là, ni à droite ni à gauche, mais seulement suivre ce qu'il a ordonné. »
Qu'il serait à désirer que tous ceux qui s'appellent chrétiens marchassent en suivant une telle règle !
Revenons au petit Guillaume, qui, j'aime à le constater, ne passait pas tout son temps à apprendre les légendes des saints. C'était un enfant courageux, entreprenant, parfois même téméraire et emporté. Le développement de son corps fut plus rapide que celui de son âme, car de bonne heure il apprit à escalader les rochers et à traverser les rivières à la nage. Il était fort et robuste, Dieu lui avait donné une grande énergie physique, laquelle devait un jour lui être précieuse. Guillaume grimpait avec ses frères dans les endroits les plus périlleux, il ne craignait ni les hommes ni les bêtes, ni les précipices, ni les torrents impétueux. Son père, qui le destinait à la carrière des armes, disait qu'il ferait un excellent soldat. Mais, en grandissant, Guillaume manifesta de tout autres désirs. Il demanda à consacrer tout son temps à l'étude afin de devenir un savant.
A cette époque les études commençaient à être à la mode, non seulement parmi les fils de familles nobles, mais dans toutes les classes de la société. Il y avait un grand désir d'apprendre ; en France et ailleurs, le peuple sentait son ignorance et soupirait après la lumière. Je crois pouvoir signaler trois faits qui contribuaient surtout à cet état des esprits.
Premièrement, il était arrivé en Italie beaucoup de savants de Constantinople, d'où les Turcs les avaient chassés une trentaine d'années avant la naissance de Farel. Les Grecs, qui possédaient Constantinople avant l'invasion des Turcs, étaient des chrétiens de nom, aussi éloignés de Christ que leurs frères d'occident, bien que supérieurs aux Français et aux Italiens quant à l'instruction. Lorsque les Turcs arrivèrent en Europe, les savants grecs se réfugièrent en Italie, emportant avec eux les livres de la bibliothèque de Constantinople. Malheureusement la plupart de ces écrits étaient ceux d'anciens philosophes et poètes païens de la Grèce qui ne pouvaient être d'aucun profit pour le bien des âmes, mais Dieu fait servir toutes choses à ses desseins bénis. Le désir de pouvoir lire les livres des savants fugitifs poussa beaucoup de personnes à apprendre le grec ; des écoles où l'on enseignait cette langue s'ouvrirent à Paris et attirèrent une foule d'étudiants. On pouvait voir, pendant les nuits d'hiver, des vieillards, des jeunes gens, même de jeunes garçons, traverser les rues en tenant un chandelier d'une main et un gros cahier de notes dans l'autre. C'est ainsi que se préparaient les voies par lesquelles le Nouveau Testament dans l'original grec devait se répandre rapidement avant d'être traduit dans toutes les langues de l'Europe.
Cette remarquable soif d'instruction fut encore excitée par un second fait. Peu avant l'époque dont nous parlons, les Maures, qui possédaient depuis des siècles une partie de l'Espagne, en furent expulsés par les soi-disant chrétiens espagnols. Ces Maures étaient des Mahométans comme les Turcs ; les sciences étaient en grand honneur parmi eux ; ils semblent les avoir reçues surtout des Juifs qu'ils encourageaient à vivre dans leurs états. Les Juifs avaient d'anciens livres appelés la Cabale qui contenaient des choses fort curieuses ; ils avaient aussi l'Ancien Testament en hébreu et en avaient fait de nombreuses copies ; de sorte que tandis que les chrétiens étaient privés de la Bible, les Juifs en avaient une partie et la connaissaient très bien. Du moins ils en avaient la connaissance qui vient de l'intelligence naturelle, mais non celle que donne l'Esprit de Dieu, qui est la seule efficace.
Quand les chrétiens s'emparèrent du territoire des Maures, ils commencèrent une persécution terrible contre les Juifs qui s'y trouvaient. Beaucoup d'entre eux furent mis à la torture, brûlés vifs et massacrés de diverses manières. En 1492, 800 000 Juifs furent bannis de l'Espagne et dispersés dans toute l'Europe, emportant avec eux leurs livres cabalistiques et leurs copies de l'Ancien Testament. Les moines dominicains se signalèrent parmi leurs plus acharnés persécuteurs. Un million de volumes juifs et maures furent brûlés à Grenade. Quatre-vingt mille manuscrits juifs furent aussi brûlés par les ordres du cardinal Ximénès. Mais il arriva le contraire de ce que voulaient le clergé et les moines ; la curiosité s'éveilla, et chacun voulut savoir ce que contenaient les livres défendus. Les Juifs seuls, écrivait en 1494 Reuchlin, un savant allemand qui avait étudié leurs livres, les Juifs seuls ont conservé quelque connaissance du nom de Dieu.
En vain les prêtres avertissaient le peuple que quiconque apprenait l'hébreu se trouvait immédiatement transformé en Juif, et que le grec était une langue d'invention nouvelle dont tout chrétien devait se méfier. Ils ne réussissaient pas à arrêter le mouvement et beaucoup de personnes se mirent à apprendre l'hébreu aussi bien que le grec. Si vous lisez la biographie de Thomas Platter, vous verrez comment ce jeune homme, qui vivait du temps de Farel et qui avait gardé les chèvres dans les montagnes, copia toute une grammaire hébraïque et donna jusqu'à son dernier sou pour acheter un Nouveau Testament. Dieu préparait donc les voies pour l'Ancien aussi bien que pour le Nouveau Testament, mais jusqu'alors on ne savait que copier les livres à la main et ils n'auraient jamais pu se répandre facilement, si Dieu dans sa Providence n'y avait pourvu.
Ceci m'amène à vous parler du troisième fait qui contribua puissamment à mettre les études à la mode, comme dit Thomas Platter. Vers le milieu du quinzième siècle, l'art de l'imprimerie fut découvert ; avant l'an 1500, quatre millions de volumes furent imprimés, et dix-sept millions dans les trente-six années qui suivirent. C'étaient les premiers rayons de lumière qui commençaient à éclairer les hommes ; Satan excita en vain les ennemis de Dieu, ils ne réussirent pas à les éteindre et cependant de 1480 à 1488 les persécutions furent continuelles en Espagne. Les Juifs furent cruellement éprouvés, mais les persécuteurs tournèrent aussi leur fureur contre les personnes qui avaient commencé à lire la Parole de Dieu. En 1481, à Séville seulement, deux mille hommes et femmes furent brûlés par les dominicains. Pour sauver les âmes et remettre en lumière l'Évangile de Dieu, il ne suffisait pas d'avoir retrouvé la Bible, ni de savoir le grec et l'hébreu, car les Juifs qui lisaient si diligemment l'Ancien Testament demeuraient aussi aveuglés que jamais. La Bible seule, sans l'enseignement de Dieu le St-Esprit, est un livre scellé. Or le St-Esprit n'habite que dans des temples vivants, dans le cour des croyants, et s'il n'y avait point de vrais croyants, le monde serait plongé dans les ténèbres, lors même qu'il serait rempli de Bibles. C'est pourquoi Dieu ne préparait pas seulement les moyens de répandre sa Parole, mais aussi des hommes qui la comprissent et qui étant remplis du St-Esprit, prêchassent la bonne nouvelle. Cependant les premières lueurs du jour avaient seules commencé à poindre ; des imprimeurs travaillaient sans relâche ; malheureusement ils ne publiaient que des Bibles ou des psautiers en latin, des livres de messe ou des classiques païens. Aussi Guillaume Farel et les autres hommes choisis du Maître étaient-ils encore dans l'aveuglement. Dieu seul pouvait dire : « Que la lumière soit » et quand vint le temps, la lumière parut.
Mais le temps n'était pas encore venu, les Turcs et les Juifs incrédules avaient été employés de Dieu sans le savoir ; plus tard le Maître enverra des ouvriers qui travailleront par amour pour Lui et dans la puissance du St-Esprit.
Le seigneur Farel était mécontent du goût que son fils manifestait pour l'étude ; cependant Guillaume finit par obtenir ce qu'il désirait. Il chercha d'abord quelqu'un qui pût lui enseigner le latin, mais il ne trouva que des maîtres très ignorants, probablement les prêtres du voisinage. Les messes et tout le service d'église se faisait pourtant en latin, il semble donc que le clergé aurait dû connaître cette langue, mais les prêtres apprenaient à réciter les paroles sans en comprendre le sens. Nous pouvons juger d'après le témoignage d'un membre du clergé d'alors, Nicolas de Clemengis, de la corruption et de l'ignorance dans laquelle les prêtres étaient tombés. Un évêque allemand, qui vivait aussi à cette époque, s'exprime ainsi : « Le malheureux clergé de nos jours s'adonne aux choses temporelles, étant destitué de lumière divine. Ils s'aiment eux-mêmes, négligeant l'amour de Dieu et du prochain ; ils sont pires que les gens du monde qu'ils entraînent avec eux à la destruction. Ils sont adonnés à toutes sortes de pratiques honteuses ; en voyant leur mauvaise conduite le peuple perd tout respect pour l'Église et tombe dans l'insubordination, étant égaré par des guides, aveugles qui, ô honte ! sont d'ignorants idiots, vains, avides, hypocrites. On les voit plus souvent dans les banquets, les tavernes et les théâtres, que dans les lieux de culte. Les évêques ornent leur corps avec de l'or, mais ils souillent leurs âmes d'impuretés. Ils regardent comme une honte de s'occuper des choses spirituelles et mettent leur gloire à se mêler de celles qui sont viles. Ils prennent avec violence ce qui appartient à autrui et distribuent les biens de l'Église à leurs familles, à des comédiens, à des flatteurs, à leurs gens de chasse et aux personnes de mauvaise vie. »
Vous comprenez que Guillaume chercha vainement parmi de telles gens un maître instruit ; il fut amèrement désappointé de voir leur ignorance du latin, mais encore bien plus de découvrir que ces hommes traitaient avec mépris les cérémonies et les rites de leur propre Église. Guillaume dit qu'il chercha partout un prêtre qui parût sincère et convaincu de la religion qu'il professait. Ne trouvant autour de lui ni hommes religieux, ni moyens d'étudier, Farel réussit à forces d'instances à obtenir de son père qu'il le laissât aller à Paris où il pourrait étudier à son aise.
Ce fut en 1509 que Guillaume Farel partit pour la capitale. Ses parents avaient lieu d'être satisfaits de l'éducation qu'ils lui avaient donnée, car il était plein de zèle pour la religion et sa dévotion austère contrastait avec l'indifférence des autres jeunes gens. « Le papisme lui-même, raconte Farel, n'était pas si papiste que moi, non par méchanceté, ni que je tinsse à ceux qui vivaient dans le péché, lorsque j'en avais connaissance, mais le diable, se transformant en ange de lumière, me détournait complètement de Dieu, de la vérité, de la foi et de la doctrine chrétienne. De telle sorte que je tournais le dos à Dieu, abandonnant tous ses commandements et m'enfonçant toujours plus dans l'esclavage du diable, car Satan m'avait tellement aveuglé et perverti, que si quelqu'un était approuvé du pape, il était pour moi en lieu et place de Dieu et j'aurais voulu, quand j'entendais quelqu'un mépriser le pape, que cette personne fût détruite et ruinée. »
Cependant Guillaume doit avoir entendu souvent proférer des paroles de mépris contre le pape, même dans son village, car pendant son enfance il y avait eu des guerres continuelles entre les rois de France et quelques-uns des états italiens. Les soldats français, parfois les rois eux-mêmes, avaient franchi les Alpes dans le voisinage de Gap. Les soldats revenaient en faisant d'étranges récits sur le St-Père qu'ils avaient pourtant regardé comme Dieu sur la terre, jusqu'à ce qu'ils eussent été eux-mêmes à Rome.
Innocent VIII, celui qui avait fait mettre à mort les Vaudois, mourut trois ans après les massacres. Sa mémoire fut maudite du peuple romain parce qu'il avait négligé les pauvres et enrichi sa famille aux dépens de l'état. Son successeur, Alexandre VI, que maint soldat français avait vu à Rome, était un homme abominable dont nous passerons la vie sous silence, mais les circonstances de sa mort ont dû parvenir aux oreilles de Farel et nous devons en dire un mot.
Ce pape ayant invité quelques cardinaux à un banquet, empoisonna les mets qu'il voulait leur offrir. Son fils, un vaurien qui était cardinal et archevêque, faisait partie du complot, dont la rapacité était le mobile. Le pape était à court d'argent et les richesses de ces cardinaux devaient à leur mort passer entre ses mains. Le meurtre n'était pas chose nouvelle pour le pape et son fils, ces deux misérables en avaient commis bien d'autres, mais, cette fois-ci, l'heure du jugement avait sonné ; les domestiques du palais, soit par erreur, soit qu'ils eussent été gagnés par les cardinaux, servirent les plats empoisonnés au pape et à son fils. Le premier mourut la même nuit, après avoir demandé les sacrements en guise de passeport pour se présenter devant Dieu. Son fils, le cardinal, se guérit après une longue maladie et continua à augmenter le nombre de ses crimes.
C'est précisément Alexandre VI qui eut le premier la prétention de pardonner aux pécheurs. Ce fut un des moyens qu'il inventa pour se procurer de l'argent, et il se mit à vendre la rémission des péchés à tous ceux qui voulurent l'acheter. Bientôt tout ce qui avait eu le nom d'Église de Dieu se détourna de l'Agneau sans tache qui donne le pardon complet, gratuit, sans argent et sans aucun prix, préférant l'acheter d'un criminel dont les vices remplissaient Rome d'horreur.
A l'époque où nous sommes arrivés, le pape se nommait Jules II. Farel le révérait à l'égal d'un dieu et cependant Llorente, dans sa Vie politique des papes, nous dit que Jules II était un « prodige de vice, » qu'il était « abhorré par les Italiens qui le regardaient comme un monstre féroce, sanguinaire, batailleur, turbulent, ennemi de la paix. » La foi de Farel n'était-elle pas ébranlée à l'ouïe de ces choses ? Au contraire, il nous dit qu'il grinçait les dents comme un loup en colère, à la pensée qu'on pouvait ainsi calomnier celui qu'il regardait comme un Dieu parmi les hommes et qui avait déclaré au dernier concile, tenu à Rome, que lui, le pape, avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.
« La vie d'un grand nombre de papes, dit encore Llorente, a été telle que ce serait insulter le St-Esprit que de prétendre que ces monstres de vice furent choisis sous sa direction, pour être mis à la tête de l'Église. » Mais Guillaume Farel était alors ce que nous sommes vous et moi dans notre état naturel, c'est-à-dire, sans intelligence. (Romains.3.11) Que la Parole de Dieu est vraie, mais qu'il est rare qu'on y ajoute foi ! « Je croyais être un bon chrétien, dit Farel, justement à cause des choses qui m'éloignaient le plus de Jésus-Christ… j'étais tellement plongé dans les ténèbres et la fange de la papauté qu'aucun pouvoir, ni sur la terre ni dans le ciel, n'eût pu m'en retirer, si ce bon Dieu et notre tendre Sauveur Jésus-Christ, par sa grande grâce, ne m'en eût sauvé, en m'amenant à son Évangile qui est la doctrine du salut. Je vois et je sens que j'ai été plongé jusqu'au plus profond des abîmes d'iniquité, quand je me souviens de la foi que je mettais aux croix, aux pèlerinages, reliques, vœux et autres inventions du diable. Mais surtout quand je pense à l'idolâtrie de la messe, il me semble que des légions de démons m'avaient possédé et tenu en leur pouvoir. Sans cela, comment aurais-je pu m'éloigner à ce point de ce que Dieu commande, et croire que l'hostie que le prêtre tenait en ses mains, mettait dans une boîte, mangeait et donnait à manger, fût mon Seul Vrai Dieu… qu'il n'y en eût point d'autre sur la terre ni dans le ciel ! Pouvais-je plus ouvertement prendre le diable pour maître et abandonner plus complètement la Parole de Dieu, qu'en acceptant ainsi une tromperie pour mon Dieu ! Oh que j'ai horreur de moi et de mes fautes quand j'y pense ! Car l'enfer ne pouvait rien inventer contre Dieu de plus abominable que cette idolâtrie pour laquelle j'ai tant souffert dans mon âme, mon corps et mes biens. O Seigneur, si je t'avais servi, prié et honoré par une foi vivante et vraie, comme tu l'as commandé et comme l'ont fait tes fidèles serviteurs, au lieu d'avoir mis mon cœur à la messe, à servir un morceau de pâte ! J'ai pu croire que toi, le Dieu bon sage et vrai, tu approuvais une pareille tromperie et méchanceté, comme si ce Dieu de pâte n'était pas aussi éloigné de Toi que je l'étais de la vraie foi !… Et en suivant cette doctrine endiablée, je croyais être ton serviteur et ceux qui étaient égarés comme moi, m'aimaient et me tenaient en haute estime à cause de mon excès d'idolâtrie… Ainsi Satan avait introduit le pape et le papisme dans mon cœur à tel point que je pense bien que le pape lui-même ne croyait pas à ses droits aussi fermement que moi, car on dit que lui et son entourage ont parfois des doutes, tandis que je n'en avais aucun. »
Tel était l'état d'âme de Farel lorsqu'il arriva à Paris à la recherche de la science. Il ne se doutait guère de ce qu'il allait y découvrir ! Avant de continuer l'histoire de Farel, je voudrais attirer l'attention sur le contraste offert par la vie austère et dévote de ce jeune homme qui croyait servir Dieu, et la corruption dégradante des papes de ce temps-là. Pourquoi ces hommes dépravés, plongés dans les vices qui font horreur aux païens, nous paraissent-ils beaucoup plus coupables que Farel ? On dira peut-être : Parce que les papes étaient des hypocrites, tandis que Farel était sincère. Cela est vrai, mais nous lisons dans la première épître à Timothée que Paul était « selon la justice de la loi irréprochable, » qu'il a obtenu miséricorde, parce qu'il péché dans l'ignorance et qu'il croyait réellement devoir faire des choses qui étaient contraires à la volonté du Seigneur. Cependant Dieu nous dit par sa propre bouche qu'il était lui Paul « le premier des pécheurs. » De même Farel, après que le St-Esprit lui eut enseigné la pensée de Dieu, a pu nous dire : « J'étais tellement rempli de toute idolâtrie papiste qu'entre tous ceux que j'ai connus, il n'y a personne qui m'ait égalé et j'aurais eu droit à la couronne de malédiction, de tourment, de mort et damnation, car je m'employais jour et nuit au service du diable. »
Farel n'a porté ce jugement sur lui-même qu'après avoir été enseigné de Dieu. L'homme ne juge jamais le péché de cette manière : il s'indignera contre Alexandre VI et Jules II, mais il regardera Farel avec admiration, parce qu'un homme sent toute la noirceur de péchés commis contre d'autres hommes, tandis qu'il n'attache aucune importance à ceux qui se commettent contre Dieu. Quand les papes sont adultères, meurtriers, voleurs, le monde les blâme, mais il ne s'inquiète nullement des obligations de l'homme vis-à-vis de Dieu. Un mauvais serviteur jugera de la conduite de ses camarades, parce qu'ils sont avec lui, mais il tolérera sans objection leur malhonnêteté ou leur insolence envers leur maître. Et il en est de même de vous et de moi, à moins que Dieu n'ait répandu son amour dans nos cœurs. Notre conscience ne nous reproche point d'être incrédules à ses promesses de salut, ni d'introduire des commandements d'homme dans le culte et le service qui lui sont dus, tandis que nous sentons bien le poids de péchés commis contre nos semblables, lesquels ne sont pourtant que d'une importance secondaire.
Que personne ne se méprenne sur mes paroles et ne croie que je considère la malhonnêteté, l'envie, la malice, le mensonge, comme de petits péchés. Telle n'est pas ma pensée, mais on ne comprend pas assez que le plus grand de tous les péchés c'est l'incrédulité à l'égard de Dieu. On ne voit pas grand mal à croire ce que l'homme invente plutôt que la Parole de Dieu. Et dans le temps de tiédeur où nous vivons, le langage de Farel à ce sujet paraît beaucoup trop énergique. Combien de personnes de nos jours, estimées et respectées, ne voient aucun mal à ce que chacun soit libre dans ce qui concerne la vérité de Dieu, de penser ce qu'il voudra. « Ne partageons pas un cheveu en quatre pour des affaires d'opinion, chacun a la sienne. » Ces phrases qui viennent de l'ennemi, sont admirées et approuvées. Dieu demande que nous obéissions à sa Parole, sans nous en écarter même de l'épaisseur du centième d'un cheveu. Puissions-nous tous marcher dans cette obéissance.
Le jour vint enfin pour Guillaume de quitter ses montagnes et de se lancer dans le vaste monde ; c'était un vrai campagnard, jeune et simple, qui dans sa tranquille demeure avait été tenu à l'abri de la corruption des grandes villes. Il nous raconte que lorsqu'il arriva en vue de Lyon et qu'il entendit les cloches sans nombre des églises, son cœur tressaillit de joie, en pensant à tous les gens pieux et saints qui devaient vivre près de ces cloches qui résonnaient nuit et jour. « Hélas ! ajouta-t-il, j'en vis assez, rien qu'en passant, pour m'étonner de ce que la terre ne s'ouvrait point et n'engloutissait pas une cité si corrompue. » Il devait s'étonner encore plus de ce qu'il verrait à Paris !
Cette ville était, depuis longtemps déjà, le rendez-vous des savants et de tous ceux qui désiraient s'instruire. Les étudiants accouraient de toutes les parties de l'Europe, se logeant en chambres garnies ou dans les nombreux collèges qui existaient alors. La faculté de théologie portait le nom de Sorbonne en souvenir de Robert Sorbon, qui l'avait fondée vers le milieu du treizième siècle. Une portion considérable de la ville s'appelait l'Université ; il y avait des cours, des conférences, des professeurs en nombre suffisant pour satisfaire le jeune homme le plus avide de science. Guillaume put apprendre le latin à son aise, car nous lisons que dans les maisons des grands imprimeurs, les femmes, les enfants et même les domestiques parlaient toujours latin, afin de pouvoir converser avec les étrangers qui arrivaient à Paris. L'un des souhaits de Guillaume put donc recevoir son accomplissement, mais il lui restait encore à découvrir des hommes sincèrement dévoués à Dieu et aux saints. Ce désir-là semblait plus loin que jamais d'être exaucé. Les étudiants parisiens étaient célèbres dans l'Europe entière pour leur désordre et leur turbulence ; ils ne se souciaient point de la religion et n'y pensaient qu'à l'époque de trois grandes fêtes : Noël, la fête des fous et la foire du Lendit.
Dans ces occasions-là, ils jouaient avec grand zèle leur rôle qui consistait à se déguiser à l'aide des habits les plus bouffons, à boire, à chanter et à se quereller dans les églises, les rues, les auberges, partout enfin… La foire du Lendit était le plus grand jour de l'année pour eux ; ils se réunissaient hors de la ville, dans une plaine, appelée le Pré aux Clercs ; deux cérémonies avaient lieu dans cet endroit. D'abord on exhibait un morceau de la vraie croix, ensuite le recteur de l'Université achetait la provision de parchemin dont l'Université avait besoin pour l'année. Après cela les étudiants banquetaient, buvaient, tapageaient et finissaient dans leur excitation par des batailles rangées. Cette foire ne se terminait jamais, disait-on, sans qu'il y eût du sang répandu, aussi fut-elle abolie plus tard pour ce motif ; d'ailleurs le papier ayant remplacé le parchemin, cette fête n'avait plus de raison d'être. Bientôt on dut aussi mettre fin aux folies de Noël à cause des scènes inconvenantes qui se passaient dans les églises. Peu à peu les étudiants remplacèrent leurs fêtes par des représentations théâtrales dans lesquelles ils paraissaient comme acteurs. La mort du Sauveur était le sujet des pièces qu'ils jouaient le plus fréquemment, avec d'autres scènes de la Bible dans lesquelles des jeunes gens impies jouaient les rôles de Moïse, Paul ou David. Beaucoup d'entre eux blasphémaient ouvertement le nom de Dieu, et quant à la Bible, ils la connaissaient très peu et la traitaient comme un recueil de fables.
Dans la nuit Guillaume était souvent réveillé par ses camarades, qui parcouraient les rues en troublant le sommeil des citoyens paisibles par leurs cris et leurs chants. Un de leurs amusements favoris était de se saisir des agents de police qui les poursuivaient et de les jeter dans la Seine.
Ce fut en vain que Farel chercha parmi ces tapageurs l'homme qu'il désirait, mais un beau jour lui était réservé. Il n'avait pas été longtemps à Paris lorsqu'il remarqua dans les églises où il allait souvent, un petit vieillard d'apparence chétive. « Sur ceci, dit Farel, Dieu dans sa sage et grande patience, voyant un si grand pécheur et si infâme idolâtre, fait que j'en trouve un qui passait tous les autres, car jamais je n'avais vu chanteur de messe qui la tînt en plus grande révérence, quoique partout je les aie cherché, jusqu'au plus profond des chartreux. Celui-ci s'appelait maître Fabera, il faisait aux images plus grandes révérences qu'aucun autre personnage que j'aie jamais connu, demeurant à genoux et disant ses heures devant icelles, à quoi souvent je lui ai tenu compagnie, fort joyeux d'avoir accès à un tel homme. »
Guillaume avait facilement trouvé moyen de faire la connaissance de Faber ; il apprit à sa grande joie que c'était un des professeurs les plus savants de Paris, où il jouissait de l'estime et du respect universel. Il était docteur en théologie, avait étudié les classiques païens et les écrits prétendument chrétiens ; de plus, il avait voyagé, à la recherche de la science, non seulement en Europe, mais en Asie et en Afrique. D'après Erasme, c'était le premier des savants de France. « Vous ne trouverez pas, disait-il, un Faber sur mille. » son talent pour l'enseignement était aussi remarquable que son érudition, et ce fut bientôt un des plus grands plaisirs de Farel que de suivre ses cours, de causer avec lui et de l'accompagner d'église en église pour adorer à ses côtés. C'est ainsi que Farel trouva dans l'amitié de Faber l'accomplissement de tous ses souhaits. Ce vieillard était d'ailleurs un excellent compagnon, bienveillant, sympathique et parfois même très gai.
Mais il avait des heures de tristesse ; souvent Guillaume et lui allaient ensemble déposer des roses, des muguets et des boutons d'or sur l'autel de Notre-Dame, puis ils s'agenouillaient côte à côte pendant longtemps et priaient avec ferveur. Mais en retournant chez eux, Faber disait à Farel que Dieu renouvellerait le monde et que lui, Guillaume, le verrait, car « il était impossible que le monde demeurât en sa méchanceté. »
Oui, il était nécessaire que Dieu renouvelât tout, même maître Faber ; mais celui-ci ne se doutait pas encore qu'il dût avoir sa part de la réforme. Il voyait avec indignation l'hypocrisie de ceux qui l'entouraient : « Que c'est inconvenant, disait-il, de voir un évêque inviter des amis à venir boire, jouer aux cartes et aux dés avec lui, ou bien passer son temps au milieu des chiens et des faucons, à la chasse et dans les mauvaises compagnies ! »
Maître Faber discernait la paille dans l'œil de son prochain, mais il était complètement aveugle quant à la poutre qui se trouvait dans le sien, je veux dire sa terrible idolâtrie. Loin d'avoir la moindre hésitation à cet égard, Faber était justement occupé à faire un recueil de légendes de saints ; il rassemblait soigneusement ces innombrables histoires, les classait par ordre d'après le calendrier. C'était un travail long et laborieux, mais le pauvre homme croyait employer utilement son temps, car il pensait rendre service à Dieu !
Pendant ce temps, Farel travaillait avec zèle à ses études ; il lut d'abord les classiques païens, comme maître Faber l'avait fait avant lui, espérant en retirer quelque bien pour son âme, car on lui avait dit que les philosophes de l'antiquité étaient des hommes d'un savoir et d'une sagesse extraordinaire. Mais il ne trouva pas dans leurs livres ce qu'il cherchait ; il avait dans son âme des besoins que ces écrits païens ne pouvaient satisfaire, car Farel voulait la paix avec Dieu. « Je m'efforçais de devenir chrétien avec le secours d'Aristote, écrivait-il, cherchant le bon fruit sur un mauvais arbre. » Guillaume se mit ensuite à lire plus soigneusement que jamais les légendes des saints, « qui me rendirent, dit-il, encore plus insensé que je ne l'étais. » Il s'étonnait fort de se sentir, malgré tout son zèle à prier, lire et adorer, toujours plus effrayé à la pensée de Dieu et de l'éternité. A ce moment-là, le pape Jules II, celui qu'on nommait « un prodige de vice », donna la permission d'appeler l'Ancien et le Nouveau Testament « la Sainte Bible ». Farel, en apprenant cela, conçut pour les Saintes Écritures un respect qu'il n'avait jamais éprouvé jusqu'alors et il commença à les lire.
Voici ce qu'il nous dit lui-même à ce sujet : « J'eusse été perdu sans cela, car tout était tellement retiré de la doctrine de Dieu, que rien n'était demeuré sain, sauf la Bible. Mais quoiqu'ayant lu la Bible et me trouvant fort ébahi en voyant que tout sur la terre lui était contraire en vie et doctrine, et que tout était autrement que ne le porte la Sainte Écriture… tant s'en faut, pour cela que je me sois retiré, je suis demeuré autant séduit et abusé qu'auparavant… car soudain Satan est survenu de peur de perdre sa possession et a travaillé en moi selon sa coutume… car auparavant j'obéissais à ses commandements de grand cœur et sans m'enquérir si je faisais mal, croyant sans aucun doute que ses commandements et ce qu'il avait dit par la bouche du pape était chose bonne et parfaite… Maintenant cet ennemi, dans sa malice, me bailla toute sorte de craintes et de doutes, alors que j'aurais dû croire à la parole de Dieu, assuré qu'elle ne peut mentir et qu'en la suivant on ne peut faire mal… Au lieu de cela, Satan me persuadait que je ne prenais et n'entendais pas bien ces choses… que je devais bien me garder de suivre mon propre jugement et avis, mais qu'il fallait me tenir à l'ordonnance de l'Église, c'est-à-dire de l'Église papiste, car je n'en connaissais point d'autre. Ayant ainsi ouï prêcher Satan et les siens, je me tins, tout comme auparavant, coi sous la tyrannie du diable et de son premier-né, chef de toute iniquité, le pape. »
Guillaume rencontra à la même époque un docteur qui le blâma sévèrement d'avoir lu les Écritures, lui disant qu'il ne fallait jamais le faire sans avoir d'abord étudié la philosophie. Guillaume obéit et mit de côté sa Bible, mais il en avait lu assez pour être profondément malheureux. La Parole avait atteint sa conscience, et sa fausse paix avait disparu pour toujours. « J'étais le plus misérable des hommes, nous dit-il, fermant les yeux de peur de voir trop clair. » Faber ne pouvait lui être d'aucun secours. « Il demeurait, dit Farel, en sa vieillesse papale (ses anciennes erreurs), et faisait que j'y fusse toujours plus enragé ».
Quelques personnes riches, qui vivaient à Paris, crurent bien faire d'employer Guillaume à distribuer de l'argent aux pauvres. Il accepta cette offre avec empressement, comme un moyen de tranquilliser son esprit. Mais tous ses efforts échouaient les uns après le autres et la paix ne venait pas, quoiqu'il eût auprès de Dieu « des sauveurs et des avocats sans nombre », c'est-à-dire les saints, qu'il adorait maintenant plus dévotement que jamais. Il y avait près de Paris un couvent de chartreux, dans lequel Guillaume se retira pour un temps, afin de se soumettre à leurs jeûnes et à leurs pénitences.
Les règles de ce monastère étaient fort sévères ; il n'était presque jamais permis de parler, et même les personnes qui s'y retiraient pour quelque temps, comme Farel, ne pouvaient parler qu'au confessionnal. On ne mangeait qu'une fois par jour et l'on ne se rencontrait qu'à l'office divin. Il n'est donc pas étonnant si Farel nous dit qu'« après avoir été insensé, il devenait fou ». Fort heureusement, il ne resta pas longtemps chez les chartreux ; peut-être soupirait-il après la société de son cher vieux professeur. « Je n'ai jamais trouvé nulle part, dit-il, le pareil de maître Faber ».
[Remarquons en passant que tous les réformateurs ont été amenés de la même manière à la découverte de la vérité. Les doutes de Farel, sa conscience troublée, ses lectures dans la Bible, lectures qui le frappent sans produire d'abord de résultat sensible, sans le détacher de longtemps encore des croyances de ses pères, tout cela se remarque chez Zwingli et surtout chez Luther.]
Ce n'était point de maître Faber, ni d'aucun autre savant docteur, que devait venir la délivrance. Guillaume entendit quelque part certaines paroles qui descendirent dans son âme troublée comme un rayon lumineux de la gloire d'en haut. Dieu seul pourrait nous dire maintenant quelles furent les lèvres qui prononcèrent ces paroles de grâce. Il y avait, dans les recoins ignorés de Paris, quelques petits troupeaux du Seigneur, pauvres et méprisés ; ils sont oubliés depuis longtemps, mais Farel nous dit qu'ils « faisaient mention de l'Évangile ». « Et Dieu sait comment, par les plus méprisés de ses enfants, Il m'apprit à connaître la valeur de la mort de Jésus. Lorsque j'ouïs ces choses, je priai Dieu pendant trois ans de m'enseigner la bonne voie. Je comparais ce que j'entendais avec les Testaments grec et latin, les lisant souvent sur mes genoux. Et je parlais de ces choses avec grands et petits, ne cherchant qu'à être éclairé et ne méprisant personne ». Peut-être une vieille femme dans son galetas, ou un humble domestique, enseignèrent-ils le jeune professeur. Guillaume était devenu bachelier ès-arts et donnait des cours de philosophie dans un des principaux collèges de Paris. Mais ces croyants obscurs et inconnus lui avaient parlé de la valeur de la mort de Jésus, et ce seul rayon de la glorieuse grâce de Dieu éclipsa tout le reste. Ce trésor qu'on appelle l'amour de Dieu était seul digne de ses pensées et de ses désirs. Si seulement il pouvait apprendre ce que les anges désirent sonder : la valeur de la mort de Christ ! La connaissez-vous, chers lecteurs ? Avez-vous conscience de la valeur du précieux sang du Fils de Dieu aux yeux de Celui qui l'a donné pour nous ? Soyez assurés, si vous avez quelque peu compris la valeur de ce sang, que l'entrée dans la gloire vous est pleinement assurée, car il a été versé pour vous, il est pleinement suffisant pour assurer votre salut, et vous ne chercherez plus à ajouter des prières, des larmes, des œuvres, des sentiments, à ce qui est d'une valeur infinie aux yeux de Dieu.
Il paraît que Guillaume n'ouvrit pas tout de suite son cœur à Faber ; cependant son respect pour le vieux maître augmentait journellement. « Faber avait du savoir, plus que tous les autres docteurs de Paris, ce qui était cause qu'il était persécuté par eux ; je commençais par cela à voir la lâcheté des théologiens et ne les eus en telle estime comme auparavant. Et avec cela comme ce pauvre idolâtre, par sa vie, fit que l'estime des docteurs fut abattue en mon cœur, aussi par sa parole il me retira de la fausse opinion du mérite et m'enseigna que nous n'avons point de mérite, mais que tout vient de la grâce de Dieu, sans qu'aucun l'ait mérité. » C'était justement cette question qui tourmentait Farel depuis trois ans. Car si la mort de Christ seule sauve les pécheurs qui se confient en Lui, de quelle utilité sont donc leurs œuvres, leur repentance, leurs prières et leurs aumônes ? Maître Faber répondait à cela que nous n'avons point de mérites, que tout vient de la pure grâce de Dieu accordée à ceux qui ne méritent rien, « ce que je crus, raconte Farel, sitôt que cela me fut dit ». Oui, maître Faber, « ce pauvre idolâtre, faisait aussi mention de l'Évangile ». Il avait même écrit ces choses déjà en 1512, dans son Commentaire sur les Epîtres de Paul. Mais c'était un livre qu'on lisait peu, et au lieu d'enseigner cette précieuse vérité, Faber semble l'avoir gardée cachée dans son cœur sous une masse d'idolâtries. Ceci semble difficile à comprendre, mais l'esprit de l'homme déchu est un étrange mystère. Pareil à cet aveugle qui vit d'abord des hommes « semblables à des arbres qui marchent », maître Faber aura été touché de Dieu et aura reçu d'abord quelque faible lueur de la lumière qu'il devait recevoir plus éclatante, par un second appel divin dont Farel nous parle en ces termes : « Après cela me fut proposée (par quelqu'un à qui Dieu fasse grâce) la pure invocation de Dieu, parce que j'avais tant de confiance dans la vierge Marie, les saints et les saintes. » Pendant ce temps, maître Faber était toujours occupé à préparer son Recueil de légendes, et il publia pour janvier 1519 les Vies de tous les saints dont les noms sont dans le calendrier pour ce mois. Il fit de même pour le mois de février, mais il en resta là. Une transformation aussi soudaine qu'inattendue s'était opérée chez le vieux maître, comme si, au milieu de ses stériles labeurs, la main de Christ s'était soudain posée sur ses yeux à demi ouverts. Il se sentit saisi d'horreur et d'effroi à la pensée des paroles contenues dans les légendes des saints et des prières qui leur étaient adressées. Il les jeta loin de lui pour toujours, en disant que c'était du soufre propre à alimenter le feu de l'idolâtrie ; il les laissa, pour lire les saintes Écritures et ne plus adorer que Dieu seul.
Et maintenant que la lumière s'était faite dans son âme, Faber se mit à enseigner à tous autour de lui ce qu'il avait vu et entendu. Etant professeur de philosophie, ses leçons devaient traiter des livres de l'antiquité, mais dans les conversations et peut-être dans ces réunions privées qui avaient déjà lieu à Paris, il parlait hardiment et fidèlement de son Sauveur béni. « Dieu, disait le vieillard, Dieu seul, dans sa grâce et par la foi, justifie les pécheurs. Il donne la vie éternelle. Il y a une justice des œuvres qui est de l'homme, et une justice de grâce qui vient de Dieu. La justice de la grâce procède de Dieu Lui-même, c'est Lui qui la donne à l'homme, ce n'est pas une justice que l'homme apporte à Dieu. Comme la lumière vient du soleil et nous la recevons dans nos yeux, ainsi la justice descend de Dieu. La lumière n'est pas dans nos yeux, mais dans le soleil. La justice de Dieu est révélée et les hommes sont justifiés, c'est-à-dire qu'ils deviennent justes en croyant en Lui. Tel par exemple un miroir qui brille aux rayons du soleil et réfléchit la lumière qu'il reçoit du ciel ; c'est l'image du soleil qu'il réfléchit, n'ayant point de lumière à lui.
— Alors pourquoi ferions-nous de bonnes œuvres ? demandèrent les docteurs de Paris. Si nous sommes rendus justes par Dieu sans les bonnes œuvres, il est bien inutile d'en faire.
— Il est vrai, répondait Faber, que nous sommes justifiés sans les œuvres ; nous sommes justifiés avant d'avoir accompli une seule bonne œuvre, et alors que nous n'en avons encore fait que de mauvaises. Nous sommes justifiés dès le moment où nous croyons en Jésus ; mais comme un miroir terni ou défectueux reflète la lumière du soleil imparfaitement, de même si nous ne sommes pas saints dans notre marche et notre conversation, nous ne reflétons que faiblement la lumière qui a lui dans nos âmes de la part de Dieu. Nous devons être comme des miroirs bien polis et bien unis dans lesquels on voit Dieu. »
Ces paroles étonnantes furent comme un coup de foudre au milieu des docteurs et des étudiants de Paris. Les uns s'élevaient contre le vieux maître, les autres étaient stupéfaits. Mais il y avait quelqu'un d'autre plongé dans la contemplation, non de Faber, mais du Sauveur béni qui venait de se révéler à son âme et qui justifie les pécheurs





























