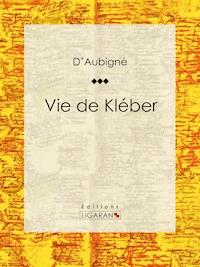
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
"Vie de Kléber est un ouvrage captivant qui retrace la vie extraordinaire de Kléber, l'un des généraux les plus talentueux de l'histoire de France. Écrit par Merle d'Aubigné, Jean-André, ce livre nous plonge au cœur des batailles épiques et des intrigues politiques de l'époque révolutionnaire.
À travers une plume vive et immersive, l'auteur nous fait revivre les exploits militaires de Kléber, depuis ses premiers pas dans l'armée jusqu'à sa mort tragique en Égypte. Nous découvrons un homme courageux, stratège brillant et leader charismatique, qui a su se distinguer sur les champs de bataille les plus sanglants.
Mais Vie de Kléber ne se limite pas à une simple biographie militaire. Merle d'Aubigné nous offre également un aperçu fascinant de la personnalité complexe de Kléber. Nous découvrons ses doutes, ses aspirations, ses relations avec ses camarades et ses supérieurs. L'auteur nous dévoile les coulisses de la vie politique de l'époque, où les rivalités et les ambitions se mêlent aux enjeux militaires.
Au-delà de l'aspect historique, ce livre nous invite à réfléchir sur les valeurs et les idéaux qui ont animé Kléber tout au long de sa vie. Son engagement en faveur de la liberté, de l'égalité et de la justice transparaît à travers chaque page. Merle d'Aubigné nous offre ainsi une véritable leçon d'histoire, mais aussi de courage et de détermination.
Vie de Kléber est un ouvrage incontournable pour tous les passionnés d'histoire, mais aussi pour ceux qui cherchent à comprendre les hommes et les femmes qui ont marqué leur époque. À travers cette biographie captivante, Merle d'Aubigné rend hommage à un grand homme, dont l'héritage continue d'inspirer et de fasciner.
Extrait : ""Jean-Baptiste Kléber naquit à Strasbourg, en 1750 suivant un de ses biographes, en 1753 suivant les autres et d'après les registres de la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux, qu'habitaient ses parents. Son père, originaire de Geispolsheim (Bas-Rhin), s'était établi tailleur de pierres. Sa mère, Reine Borgart, appartenait à une famille aisée de Ruffach (Haut-Rhin). C'était une grande et jolie femme."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335005684
©Ligaran 2015
Jean-Baptiste Kléber naquit à Strasbourg, en 1750 suivant un de ses biographes, en 1753 suivant les autres et d’après les registres de la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux, qu’habitaient ses parents. Son père, originaire de Geispolsheim (Bas-Rhin), s’était établi tailleur de pierres. Sa mère, Reine Borgart, appartenait à une famille aisée de Ruffach (Haut-Rhin). C’était une grande et jolie femme.
Kléber ne connut pour ainsi dire pas l’auteur de ses jours : il avait à peine cinq mois lorsqu’il le perdit. Deux ans après, sa mère, encore jeune, se remaria. Elle épousa un certain Burger, veuf comme elle, et qui, comme elle, avait déjà des enfants d’un premier lit.
Ce Burger était un homme dur et brutal, qui n’eut jamais d’affection pour son beau-fils et qui le maltraitait fréquemment. Pour soustraire son enfant aux sévérités de son mari, madame Burger le mit en pension chez un brave curé de campagne, à quelques lieues de Strasbourg. – C’est là que le jeune Kléber reçut les premiers principes d’éducation. Doué des plus heureuses dispositions pour les sciences, il ne tarda pas à y faire de grands progrès ; en latin aussi, grande était son application. Il eut de bonne heure et garda toute sa vie le goût de l’histoire ancienne. Les exploits des Fabius et des Scipions l’attiraient, et quand plus tard, à l’imitation des modèles qui avaient charmé sa jeunesse, il fut devenu lui-même un héros, il faisait encore ses délices de la lecture des grands écrivains de l’antiquité. Par exemple, il n’avait pas le même goût pour le sacré : les sublimes enseignements de la religion, les beautés de l’Évangile n’émurent jamais sa jeune âme. Dès cette époque, il était ce qu’on appelle un esprit fort. Son curé, dont il faisait, sous ce rapport, le désespoir, n’en put jamais rien tirer : après maintes corrections demeurées complètement inutiles, il dut renoncer à lui apprendre le catéchisme.
Parfois même notre jeune mauvais sujet lui jouait de fort mauvais tours. Une fois, entre autres, comme le curé l’avait envoyé porter les burettes à l’église et se mettre en costume pour servir la messe, il avala, chemin faisant, tout le vin, plaça dans la sacristie les burettes vides, et se sauva, pour se cacher, dans la forêt voisine. Cette belle escapade lui valut deux jours de prison dans la cave ; après quoi le bon curé, à bout de patience, écrivit à ses parents de le retirer, ce qu’ils firent peu de temps après.
Rentré chez lui, Kléber continua quelque temps ses études sans maître. Cependant la nature avait déjà développé chez lui ces formes presque colossales, et cette force athlétique qui contribuèrent tant, plus tard, à lui donner de l’empire sur sa troupe. Il n’avait pas encore les six pieds qu’il devait bientôt atteindre, mais il en avait bien cinq et demi à peine au sortir de l’enfance. Un si vigoureux gaillard ne pouvait demeurer plus longtemps les bras croisés. Ses parents, pour l’occuper, l’engagèrent à choisir un métier. Ayant toujours eu du goût pour les constructions, il prit celui d’architecte ; mais il ne se borna pas, comme tant d’autres, à l’étude des mathématiques et du dessin : il voulut acquérir la pratique même de son art, et souvent on le voyait, au sortir de ses classes, équarrir une poutre ou tailler une pierre comme eût fait un ouvrier. Il n’y mettait aucun amour-propre, et malheur à qui s’avisait de le plaisanter.
« Un jour – c’est Kléber lui-même qui aimait à raconter cette anecdote – un de ces petits messieurs, comme il en existe beaucoup, pour qui tout ce qui est utile est déshonorant et qui, sans doute parce que je lui avais plu à de certains égards, semblait me rechercher, se promenant un matin dans les environs de la ville, fut étrangement surpris de me trouver taillant la pierre. Il vint à moi, mais il ne me traita plus comme il avait coutume. Il ne me dissimula même pas qu’il n’avait pas cru auparavant se trouver dans la société d’un maçon ; il ajouta d’autres mots piquants et chercha à me mortifier. J’endurai quelques instants ses mauvais propos, mais, à la fin, fatigué de ses fades plaisanteries, je lui applique sur le dos quelques coups du manche de mon marteau, en le prévenant que s’il était curieux d’apprendre comment j’en savais manier d’autres, il ne lui serait pas difficile de me rencontrer. Mon petit homme fut sans doute content de la leçon ; car, ajoutait Kléber, il ne chercha point à en recevoir une nouvelle, et toutes les fois que le hasard nous fit trouver ensemble, il baissait humblement les yeux. » À quelque temps de là, Kléber ayant à peu près acquis toutes les connaissances qu’il pouvait puiser à Strasbourg, partit pour Paris, afin de se perfectionner dans son art. Ses parents avaient obtenu du célèbre Chalgrin qu’il le prît avec lui. Kléber ne pouvait être en de meilleures mains. Malheureusement il se lia, dès son arrivée dans la capitale, avec quelques mauvais sujets dans la société desquels il perdit beaucoup de temps et dépensa bientôt plus d’argent que ses parents ne pouvaient lui en envoyer. Imprévoyant, généreux, aimant le plaisir à la folie, le séjour d’une ville comme Paris ne pouvait que lui être funeste. Sa mère, émue des dangers qu’il courait et des tentations auxquelles il était exposé, n’hésita pas à le rappeler. Il obéit, non toutefois sans regretter un lieu où il avait trouvé tous les plaisirs, et reprit le chemin de l’Alsace par Besançon, où il devait s’arrêter quelques jours chez des amis.
Il lui arriva dans cette dernière ville une aventure qui peint bien son caractère batailleur. Un soir, dans une maison où il était reçu avec d’autres jeunes gens de son âge, un nommé Doney, qui le connaissait mal sans doute, eut l’imprudence de lui dire un mot piquant. Kléber, dont la patience n’était pas la vertu favorite, répondit vivement, on s’échauffa des deux parts, tant et si bien qu’au bout d’un moment on résolut de se battre. Le jour choisi fut le lendemain, et la place désignée, les prés de Vaux. À l’heure et au lieu dits, Kléber arriva très exactement, accompagné de ses témoins. Doney se fit attendre un peu, cependant il vint. Le combat s’engagea et fut presque aussitôt terminé que commencé. À la première passe, Kléber, se fendant à fond traversa de part en part le bras de son adversaire. Cependant l’éveil avait été donné par le père même de Doney, que celui-ci avait eu l’indélicatesse de prévenir, dans l’espérance que le duel serait de la sorte empêché. La garde arriva et Kléber fût arrêté. On le mit en prison, et, sans l’intervention des jeunes gens de la ville, qui, ne voulant pas paraître approuver la conduite de leur compatriote, firent de pressantes démarches auprès du commandant de place, il y fût resté plusieurs jours. Quand il sortit, ces mêmes jeunes gens l’attendaient à la porte et le reconduisirent en triomphe.
Quelques jours plus tard, de retour à Strasbourg, il eut dans un café qu’il avait la mauvaise habitude de fréquenter, une autre aventure qui, celle-là, décida de sa carrière. Il y avait en même temps que lui, dans ce café, plusieurs jeunes Bavarois qui fumaient tranquillement leur grande pipe en buvant de la bière. De jeunes étourdis qui se trouvaient aussi là, imaginèrent de les tourner méchamment en ridicule. Kléber, qui, s’il était quelquefois emporté, haïssait l’injustice, ne put voir de sang-froid cette scène. Il s’approcha de ses compatriotes, leur reprocha leur conduite, et, finalement, leur imposa silence. Touchés de son intervention, les Bavarois lui témoignèrent leur gratitude de la manière la plus affectueuse et lièrent aussitôt connaissance avec lui. Kléber, qui était assez communicatif, leur eut bientôt raconté sa vie, ses projets, ses espérances. Eux, de leur côté, lui apprirent qu’ils faisaient leur éducation de soldats à l’École militaire de Munich, et l’engagèrent fort à se tourner vers une carrière pour laquelle il semblait si bien fait. Même ils se firent fort d’obtenir de l’électeur un brevet pour leur jeune ami. Kléber, séduit par la pensée de quitter le marteau pour l’épée, ne se fit pas prier. Il accepta, et huit jours après, ayant reçu son brevet, il partait pour Munich. C’est ainsi que le futur vainqueur de Sambre-et-Meuse fit ses débuts dans le noble métier des armes à l’étranger. Le prince de Kaunitz, général autrichien, ne tarda pas à le distinguer et le fit entrer, en 1776, comme cadet dans le régiment dont il était propriétaire ; Kléber devint successivement enseigne, sous-lieutenant. Mais bientôt l’inaction et le dégoût d’un service où l’avancement n’était accordé qu’à la naissance, le poussèrent à donner sa démission. Le prince de Wurtemberg, qui avait succédé comme colonel propriétaire au prince de Kaunitz, fit de vains efforts pour le retenir. Kléber maintint sa démission et rentra au pays, bien résolu désormais à vivre de son ancien métier d’architecte auquel il se remit courageusement, et d’un modeste emploi d’inspecteur des bâtiments publics de la haute Alsace, que sa mère avait sollicité et obtenu pour lui de l’intendant de la province. Ce n’était pas la fortune, mais c’était l’aisance. Kléber s’en contenta : rien ne pouvait à ce moment lui faire prévoir les grands évènements qui allaient survenir et la haute destinée qui l’attendait.
Lorsque la Révolution éclata, Kléber avait déjà trente-six ans : c’est-à-dire qu’il était dans toute la force de l’âge et de l’intelligence. Les principes de 1789 trouvèrent en lui, dès les premiers jours, un partisan résolu. Il les adopta, comme il faisait toutes choses, avec une extrême ardeur, mais sans bien se rendre compte des suites qu’ils pouvaient avoir et qu’ils eurent en effet. Honnête et bon comme il était, il ne soupçonna pas que la Révolution pût être déshonorée par les excès des révolutionnaires, il n’en vit que les côtés généreux, élevés, patriotiques, et la salua comme une ère nouvelle où les peuples allaient gagner leur affranchissement définitif et leur rédemption.
Le 21 octobre 1790, Belfort, où il résidait, fut le théâtre d’une manifestation inconvenante : officiers et soldats de la garnison, échauffés par le vin, se répandirent par la ville en criant : « Vive le roi ! au diable la nation ! » De leur côté, les patriotes de Belfort, croyant à une provocation, s’assemblèrent, et les deux partis allaient en venir aux mains, quand soudain, du milieu de la foule, un homme s’élance le sabre au poing et, du geste en même temps que de la voix, provoque en combat singulier le colonel du régiment de Lauzun qui se préparait à charger : c’était Kléber. Cette intervention hardie prévint l’effusion du sang : une minute plus tard les fusils seraient partis.
C’est par de semblables agitations que la Révolution préludait aux grands bouleversements qui devaient marquer les dernières années du XVIIIème siècle. De Paris l’émotion avait gagné la province, et partout il s’était formé deux camps : celui des révolutionnaires, et celui des contre-révolutionnaires, qui allait bientôt devenir celui des émigrés. Déjà un certain nombre de ces derniers, inquiétés dans leurs personnes et leurs biens, avaient passé la frontière et formaient des rassemblements dans les villes du Rhin, notamment à Coblentz, où s’étaient donné rendez-vous les principaux chefs du parti royaliste. Une situation aussi tendue ne pouvait se prolonger longtemps : la fuite du roi, les imprudences de son entourage, et la surexcitation générale des esprits ne tardèrent pas à en précipiter le dénouement.
Au début, Louis XVI avait paru s’accommoder assez bien de la situation amoindrie sans doute, mais encore considérable, que les premières résolutions de l’Assemblée constituante lui avaient faite. L’assemblée, de son côté, s’était efforcée de lui éviter d’inutiles humiliations ; elle lui avait maintenu les titres de sire et de Majesté. Malheureusement cette modération, qui seule aurait pu sauver la royauté, avait fait place à d’autres sentiments. Sous la pression des clubs, l’Assemblée s’était laissé entraîner à de regrettables résolutions, notamment en ce qui concerne le clergé. Quant au roi, faible, mal conseillé et mal entouré, il avait fini par désespérer de sa cause, et, au milieu de la confusion générale, il ne voyait plus de salut pour sa famille et pour lui que dans l’intervention de l’Europe. Ce fut cette croyance qui le perdit. Ramené à Paris, après une tentative d’évasion manquée, il avait été suspendu de ses pouvoirs et placé sous la surveillance d’une garde. Plus tard, quand la constitution fut votée, on lui rendit bien son autorité ; mais pouvait-on lui rendre son prestige et sa popularité ? Pouvait-on surtout éviter que les puissances n’achevassent de le perdre en intervenant pour le sauver ? Le 27 août 1791, à Pilnitz, le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche Léopold avaient déjà manifesté hautement leur intention de rétablir Louis XVI dans ses droits et prérogatives. L’an d’après, le célèbre manifeste du duc de Brunswick, dans lequel ce général déclarait entrer en France au nom des rois pour rétablir l’ordre, mit le comble à l’exaspération. L’Assemblée législative, qui venait de succéder à la Constituante, avait répondu à la première de ces manifestations par des mesures plus rigoureuses contre les prêtres non assermentés et contre les émigrés. Paris répondit à la seconde par la journée du 10 août, où le roi fut fait prisonnier et conduit au Temple, et par les massacres de septembre, que le fameux Danton, alors ministre de la Justice, ordonna ou tout au moins laissa faire. Ce fut une horrible boucherie : pendant quatre jours, les 2,3, 4 et 5 septembre, une bande d’égorgeurs soudoyés par la commune s’empara des prisons. Les uns se constituèrent en tribunal, les autres servirent de bourreaux. On appelait les prisonniers par ordre alphabétique, on les interrogeait ou plutôt on faisait semblant de les interroger, et, suivant le caprice de ces juges improvisés, on les mettait en liberté au cri de Vive la nation ! ou bien on les conduisait dans la cour de la prison, et là on les tuait à coups de sabre et de pique. Il n’y eut point de pitié pour les prêtres non assermentés, les Suisses et les gardes du corps. La princesse de Lamballe, une amie de la reine, fut déchirée en morceaux et sa tête, fichée au bout d’une pique, promenée par toute la ville, jusque sous les fenêtres de Marie-Antoinette. Cette infortunée princesse put ainsi deviner le sort qui l’attendait et, dès ce moment, elle s’y prépara.
Mais le courage de nos soldats permet heureusement de détourner les yeux de ces horribles scènes pour contempler une des plus heureuses victoires de nos longues guerres. Quelques jours après les massacres de septembre, Dumouriez, à la tête de la jeune armée française, gagnait la victoire de Valmy 160 000 Prussiens et Impériaux étaient partis de Coblentz le 10 juillet 1792, divisés en plusieurs corps. Nous n’avions à leur opposer que 96 000 hommes sans discipline et sans confiance en eux-mêmes et qui n’auraient certainement pas empêché l’ennemi d’arriver jusque sous les murs de Paris, si sa marche avait été habile et prompte. Le 22 août, il n’était encore qu’à Longwy, dont il s’empara. Verdun ouvrit ensuite ses portes. Le commandant Beaurepaire voulait défendre la ville ; le conseil municipal s’y opposa. « J’ai juré, s’écria Beaurepaire, de sauver la place ou de périr, je tiendrai mon serment ; » et, tirant un pistolet, il se fit sauter la cervelle dans la salle même du conseil. Un soldat refusa aussi de capituler. À l’approche des Prussiens, il déchargea sur eux son fusil ; saisi aussitôt, il fut laissé libre ; mais gardé à vue, en attendant qu’on décidât de son sort. Pendant qu’on délibérait, il courut à la Meuse, enjamba le parapet du pont, se précipita dans le fleuve et s’y noya.
Cet acte d’héroïque énergie fit-il réfléchir Brunswick ? Il ne trouvait pas la France telle que les émigrés la lui avaient représentée ; et quoiqu’il n’y eût pas une seule place forte entre son armée et Paris, il hésitait à s’enfoncer au milieu de ce peuple irrité. Il s’étendit lentement derrière la Meuse ; Dumouriez eut le temps d’accourir, et, montrant à ses lieutenants les défilés de l’Argonne : « Voilà les Thermopyles de la France, » dit-il. Il les occupa, forma en arrière deux camps retranchés sous Reims et Chalons, un autre à Meaux, où on recevait les soldats, qui accouraient de tous côtés. Deux mille volontaires sortaient chaque jour de Paris.
Cependant un des défilés fut forcé ; la route de Chalons était libre. Dumouriez, au lieu de se réfugier sous cette ville, persiste à rester dans l’Argonne, pays de facile défense, et à s’établir au besoin sur les derrières des Prussiens. Ceux-ci s’arrêtent pour le combattre. Kellermann venait de le rejoindre. L’effort principal porta sur la butte de Valmy, où Kellermann avait pris position avec ses conscrits, que les émigrés appelaient des tailleurs et des cordonniers ; mais il se trouva que ces courtauds de boutique respiraient, comme de vieux soldats, l’odeur de la poudre. Ces conscrits supportèrent le feu avec un sang-froid sur lequel l’ennemi ne comptait pas.
L’action ne fut guère qu’une canonnade de plusieurs heures. Les obus ayant mis le feu à quelques caissons des batteries françaises, l’explosion blessa ou tua beaucoup de monde, et il y eut un moment de désordre : Brunswick en profita pour lancer son artillerie en colonnes d’attaque. Kellermann les laisse avancer sans tirer un coup de feu, puis se met au premier rang, et, au cri de Vive la patrie ! que toute la ligne répète, s’apprête à charger l’ennemi à la baïonnette. Ce cri immense, qui se prolonge durant plusieurs minutes, cette fière attitude, arrêtent les Prussiens ; le canon de Dumouriez laboure le flanc de leur colonne ; ils redescendent à la hâte, et Brunswick fait cesser l’action.
Le lendemain de Valmy, la Convention se réunissait et proclamait la république. Sa première réponse aux négociations proposées par Brunswick, fut digne du vieux sénat de Rome : « La république française ne peut entendre aucune proposition avant que les troupes prussiennes n’aient entièrement évacué le territoire français. » Les Prussiens, cruellement décimés par la disette et les maladies, commencèrent, le 1er octobre, leur mouvement pour sortir de France.





























