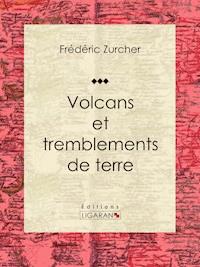
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les Romains savaient que le Vésuve avait été autrefois en activité, mais ces souvenirs, qui se rapportaient à des époques très lointaines, s'étaient presque effacés. On habitait sans aucune inquiétude les villes construites sur ses pentes. Ces lieux, dit Strabon, en parlant d'Herculanum et de Pompéi, sont dominés par le mont Vésuve..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043334
©Ligaran 2015
Première éruption. – Mort de Pline. – Herculanum et Pompei. – Éruptions de 1631, 1737, 1822 et 1858. – Ascensions. – Les champs Phlégréens. – La Solfatare. – L’Averne.
Les Romains savaient que le Vésuve avait été autrefois en activité, mais ces souvenirs, qui se rapportaient à des époques très lointaines, s’étaient presque effacés. On habitait sans aucune inquiétude les villes construites sur ses pentes. « Ces lieux, dit Strabon, en parlant d’Herculanum et de Pompéi, sont dominés par le mont Vésuve, entouré de riches campagnes, excepté à son sommet, dont la majeure partie offre une surface plane complètement stérile, qui a l’aspect d’un monceau de cendres. Au milieu de rochers de couleur sombre, qui semblent avoir été consumés par le feu, on aperçoit des couches crevassées. On serait tenté de croire que ces lieux ont brûlé jadis, et qu’ils renferment des cratères où l’incendie s’est éteint faute d’aliment. »
La guerre servile qui éclata dans la Campanie, en l’année 73 avant notre ère, et qui tint si longtemps en échec les armées consulaires, commença par la révolte de deux cents gladiateurs gaulois et thraces, ayant Spartacus pour chef. Réfugiés sur le Vésuve, ils y furent attaqués par des troupes envoyées de Rome, mais ils durent leur salut à l’une des crevasses de la montagne, par laquelle ils purent arriver au-delà des cantonnements des assiégeants, qui, se voyant enveloppés, prirent la fuite, et laissèrent leur camp au pouvoir de l’ennemi.
Le volcan, malgré son long repos, n’était pas éteint. Il devait se réveiller tout à coup par une formidable éruption qui ensevelit plusieurs villes à ses pieds. C’était au mois d’août 79, après des tremblements de terre assez violents, qui, dans le cours des seize années précédentes, avaient ébranlé la contrée. Pline le Jeune, dans la lettre suivante, adressée à l’historien Tacite, fait le récit de cet évènement, au milieu duquel son oncle périt victime de son humanité et de son amour généreux pour la science.
« Vous me demandez des détails sur la mort de mon oncle, afin d’en transmettre plus fidèlement le récit à la postérité. Je vous en remercie, car je ne doute pas qu’une gloire impérissable ne s’attache à ses derniers moments si vous en retracez l’histoire. Quoiqu’il ait péri dans un désastre qui a ravagé la plus heureuse contrée de l’univers, quoiqu’il soit tombé avec des peuples et des villes entières, victime d’une catastrophe qui doit éterniser sa mémoire, quoiqu’il ait élevé lui-même tant de monuments durables de son génie, l’immortalité de vos ouvrages ajoutera beaucoup à celle de son nom. Heureux les hommes auxquels il a été donné de faire des choses dignes d’être écrites, ou d’en écrire qui soient dignes d’être lues ! plus heureux encore ceux à qui les dieux ont départi ce double avantage ! Mon oncle tiendra son rang entre les derniers, et par vos écrits et par les siens. J’entreprends donc volontiers la tâche que vous m’imposez, ou, pour mieux dire, je la réclame.
« Il était à Misène, où il commandait la flotte. Le vingt-troisième jour d’août, environ à une heure après midi, ma mère l’avertit qu’il paraissait un nuage d’une grandeur et d’une forme extraordinaires. Après sa station au soleil et son bain d’eau froide, il s’était jeté sur son lit, où il avait pris son repos ordinaire, et il se livrait à l’étude. Aussitôt il se lève et monte en un lieu d’où il pouvait aisément observer ce prodige. La nuée s’élançait dans l’air, sans qu’on pût distinguer, à une si grande distance, de quelle montagne elle était sortie ; l’évènement fit connaître ensuite que c’était du mont Vésuve. Sa forme approchait de celle d’un arbre, et particulièrement d’un pin ; car, s’élevant vers le ciel comme un tronc immense, sa tête s’étendait en rameaux. J’imagine qu’un vent souterrain poussait d’abord cette vapeur avec cette impétuosité, mais que l’action du vent ne se faisant plus sentir à une certaine hauteur, ou le nuage s’affaissant sous son propre poids, il se répandait en surface. Il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, et tantôt de diverses couleurs, selon qu’il était plus chargé ou de cendre ou de terre.
« Ce prodige surprit mon oncle ; et, dans son zèle pour la science, il voulut l’examiner de plus près. Il fit appareiller un bâtiment léger, et me laissa la liberté de le suivre. Je lui répondis que j’aimais mieux étudier ; il m’avait, par hasard, donné lui-même quelque chose à écrire. Il sortait de chez lui, lorsqu’il reçut un billet de Rectine, femme de Cœsius Bassius. Effrayée de l’imminence du péril (car sa maison était située au pied du Vésuve, et elle ne pouvait s’échapper que par la mer), elle le priait de lui porter secours. Alors il change de but, et poursuit par dévouement ce qu’il n’avait d’abord entrepris que par le désir de s’instruire. Il fait préparer des quadrirèmes, et y monte lui-même pour aller secourir Rectine et beaucoup d’autres personnes qui avaient fixé leur habitation dans ce site attrayant. Il se dirige à la hâte vers des lieux d’où le monde s’enfuit : il va droit au danger, l’esprit tellement libre de crainte qu’il dictait la description des divers accidents et des scènes changeantes que le prodige offrait à ses yeux.
« Déjà sur ses vaisseaux volait une cendre plus chaude à mesure qu’ils approchaient ; déjà tombaient autour d’eux des pierres calcinées et des cailloux tout noirs, tout brisés par la violence du feu.
La mer abaissée tout à coup n’avait plus de profondeur, et le rivage était inaccessible par suite de l’amas de pierres qui le couvrait. Mon oncle fut un moment incertain s’il retournerait ; mais il dit bientôt à son pilote qui l’engageait à revenir : « La fortune favorise le courage, menez-nous chez Pomponianus. » Pomponianus était à Stabies, de l’autre côté d’un petit golfe, formé par une courbure insensible du rivage. Là, à la vue du péril qui était encore éloigné, mais qui s’approchait incessamment, Pomponianus avait fait porter tous ses meubles sur des vaisseaux, et n’attendait, pour s’éloigner, qu’un vent moins contraire. Mon oncle, favorisé par le même vent, aborde chez lui, l’embrasse, calme son agitation, le rassure, l’encourage, et pour dissiper par sa sécurité la crainte de son ami il se fait porter au bain. Après le bain, il se met à table, et mange avec gaieté, ou, ce qui ne suppose pas moins de force d’âme, avec toutes les apparences de la gaieté.
« Cependant on voyait luire, en plusieurs endroits du mont Vésuve, de larges flammes et un vaste embrasement, dont les ténèbres augmentaient l’éclat. Pour rassurer ceux qui l’accompagnaient, mon oncle leur disait que c’étaient des maisons de campagne abandonnées au feu par des paysans effrayés. Ensuite il se coucha et dormit réellement d’un profond sommeil, car on entendait de la porte le bruit de sa respiration. Cependant la cour par laquelle on entrait dans son appartement commençait à se remplir de cendres et de pierres, et, pour peu qu’il y fût resté plus longtemps, il ne lui eût plus été possible de sortir. On l’éveille ; il sort, et va rejoindre Pomponianus et les autres qui avaient veillé. Ils tiennent conseil, et délibèrent s’ils se renfermeront dans la maison ou s’ils erreront dans la campagne ; car les maisons étaient tellement ébranlées par les violents tremblements de terre qui se succédaient, qu’elles semblaient arrachées de leurs fondements, poussées tour à tour dans tous les sens, puis ramenées à leur place. D’un autre côté, on avait à craindre, hors de la ville, la chute des pierres, quoiqu’elles fussent légères, et desséchées par le feu. De ces périls on choisit le dernier. Dans l’esprit de mon oncle, la raison la plus forte prévalut sur la plus faible ; dans l’esprit de ceux qui l’entouraient une crainte l’emporta sur une autre. Ils attachent donc des oreillers autour de leur tête, sorte de boucliers contre les pierres qui tombaient.
« Le jour recommençait ailleurs ; mais autour d’eux régnait la plus sombre des nuits, éclairée cependant par des feux de toute espèce. On voulut s’approcher du rivage pour examiner si la mer permettait quelque tentative ; mais on la trouva toujours orageuse et contraire. Là, mon oncle se coucha sur un drap étendu, demanda de l’eau froide et en but deux fois. Bientôt des flammes et une odeur de soufre qui en annonçait l’approche mirent tout le monde en fuite, et forcèrent mon oncle à s’éloigner. Il se lève appuyé sur deux jeunes esclaves, et au même instant il tombe mort. J’imagine que cette épaisse fumée arrêta sa respiration et le suffoqua : il avait naturellement la poitrine faible, étroite et souvent haletante. Lorsque la lumière reparut (trois jours après le dernier qui avait lui pour mon oncle), on retrouva son corps entier sans blessures : rien n’était changé dans l’état de son vêtement, et son attitude était celle du sommeil plutôt que de la mort. »
La chute des pierres ponces au début de l’éruption montre que l’immense gerbe projetée par les gaz du nouveau cratère était formée à la fois par les cendres sorties des profondeurs de la terre, et par les débris d’une grande partie de l’ancien cône du Vésuve, qu’on désigne sous le nom de Somma. C’est par la pluie continuelle de ces matières qu’on explique d’ordinaire la disparition des villes d’Herculanum, de Pompéi et de Stabies ; mais le transport de couches aussi épaisses est difficile à admettre pour la distance qui les sépare du cratère, et l’idée émise à ce sujet par M. Ch. Sainte-Claire Deville nous paraît beaucoup plus juste. Ce savant explorateur des volcans nous montre, en effet, qu’au moment où le Vésuve est redevenu actif, sa cime s’est étoilée, suivant des fissures transversales dont il a reconnu le lien avec tout le système volcanique de la Campanie, et que deux d’entre elles passaient précisément par les villes détruites, qui, dès lors, auraient été englouties par des cendres, des boues et des laves jaillissant de ces orifices.
On sait que, jusqu’au milieu du dernier siècle, le véritable emplacement de ces villes est resté ignoré. Une série de fouilles entreprises depuis cette époque a permis aux modernes de se transporter comme par magie au milieu de la vie antique, et de retrouver, dans les ruines conservées par les couches volcaniques à travers dix-huit siècles, les plus précieuses révélations pour la science et l’histoire.
Un livre très intéressant de M. Marc Monnier donne la description de ces ruines. On a exhumé les monuments, les édifices et mille objets d’art ou d’industrie. Depuis quelques années, des formes humaines ont été retrouvées. Mais de bien tristes formes ! les cendres, détrempées par la vapeur d’eau, se sont moulées en enveloppant les corps au moment où ils expiraient ! Un procédé très simple a permis d’en reproduire l’image en plâtre.
« Rien de plus saisissant, dit M. Marc Monnier, que ce spectacle. Ce ne sont pas des statues, mais des corps humains moulés par le Vésuve ; les squelettes sont encore là, dans ces enveloppes de plâtre qui reproduisent ce que le temps aurait détruit, ce que la cendre humide a gardé, les vêtements et la chair, je dirais presque la vie. Les os percent çà et là certains endroits où la coulée n’a pu parvenir. Il n’existe nulle part rien de pareil. Les momies égyptiennes sont nues, noires, hideuses ; elles n’ont plus rien de commun avec nous ; elles sont arrangées pour le repos éternel dans une attitude consacrée. Mais les Pompéiens exhumés sont des êtres humains qu’on voit mourir. »
Depuis 79, il existe des indications d’éruption dans les années 204, 472, 512, 685, 995, 1056, 1156. Celle de 1136 fut très violente, mais le volcan se reposa ensuite pendant près de cinq cents ans. Au commencement du dix-septième siècle, le sommet avait la forme d’un large bassin qui, d’après le témoignage des voyageurs, était couvert de vieux chênes, de châtaigniers et d’érables.
Pendant le mois de décembre 1631, le volcan s’ouvrit au-dessus du vaste fossé qui sépare le cratère de la Somma, et qu’on appelle l’Atrio del Cavallo. Une grande partie de la montagne s’écroula, et l’éruption se termina par une coulée de lave qui alla s’éteindre dans la mer, près de Portici, après avoir brûlé les maisons et les arbres sur son passage. Le volcan se ralluma en 1660, et subit de grands changements de formes par des éruptions successives jusqu’en 1685. Les années 1707 et 1724 marquent ensuite des périodes d’activité.
Au mois de mai 1757, la montagne jetait beaucoup de fumée, et du 16 au 19, on entendit des mugissements souterrains accompagnés de bruyantes détonations. « La lundi, 20, à neuf heures du matin, le volcan fit une si forte explosion, que le choc fut sensible à plus de 12 milles à la ronde. Une fumée noire mêlée de cendres parut s’élever tout d’un coup en vastes globes ondoyants, qui se dilataient en s’éloignant du cratère. Les explosions continuèrent très fortes et très fréquentes toute la journée, lançant de grosses pierres au milieu des tourbillons de fumée et de cendres, jusqu’à un mille de hauteur.
« À huit heures du soir, au milieu du bruit et d’affreuses secousses, la montagne creva sur la première plaine, à un mille de distance du sommet, et il sortit un vaste torrent de feu de la nouvelle ouverture : dès lors toute la partie méridionale de la montagne parut embrasée. Le torrent coula dans la plaine au-dessous, qui a plus d’un mille de longueur et près de 4 milles de largeur. Il s’élargit bientôt de près d’un mille, et à la quatrième heure de la nuit il atteignit l’extrémité de la plaine et le pied des monticules qui sont du côté du sud. Mais ces monticules étant composés de rochers escarpés, la plus grande partie du torrent coula dans les intervalles de ces rochers, parcourut deux vallons, et tomba successivement dans l’autre plaine qui forme la base de la montagne. Après s’y être réuni, il se divisa en quatre branches, dont l’une s’arrêta au milieu du chemin, à un mille de Torre del Greco ; la seconde coula dans un large vallon ; la troisième finit sous Torre del Greco, au voisinage de la mer, et la quatrième à une petite distance de la nouvelle bouche.
« En même temps qu’elle s’ouvrait, celle du sommet vomissait une grande quantité de matière brûlante, qui se divisant en torrents et en petits courants, se dirigea en partie vers le Salvadore et en partie vers Ottajano ; on voyait, en outre, des pierres ardentes s’élancer du haut de la montagne au milieu d’une épaisse fumée accompagnée d’éclairs et de tonnerres fréquents.
« Les vomissements enflammés continuèrent jusqu’au mardi, et ce jour l’éruption des matières fondues, les éclairs et le bruit cessèrent ; mais un vent de sud-ouest s’étant mis à souffler fortement, les cendres furent charriées en grande quantité jusqu’aux extrémités du royaume. Dans quelques endroits elles étaient très fines, dans d’autres grosses comme du gravier.
Dans le voisinage du Vésuve, on éprouva non seulement la pluie de cendres, mais encore une grêle de pierres ponces et autres.
« La fureur du volcan ayant commencé à s’apaiser le mardi au soir, le dimanche suivant il n’y avait presque plus de flammes à la bouche supérieure, et le lundi on ne vit que peu de fumée et de cendres. Il commença de pleuvoir abondamment ce jour-là, et la pluie continua le mardi et plusieurs jours ensuite, circonstance qui a constamment accompagné les éruptions.
« Les dommages occasionnés dans le voisinage par cette éruption de feu et de cendres sont incroyables. À Ottajano, situé à 4 ou 5 milles du Vésuve, les cendres avaient quatre palmes de hauteur sur le terrain. Tous les arbres furent brûlés. Les habitants étaient dans la consternation et l’effroi, et beaucoup de maisons s’écroulaient écrasées sous le poids des cendres et des pierres. »
C’est près de Torre del Greco qu’en 1797 une rivière de lave, large de 1 500 pieds, haute de 14, courut 5 milles et demi, puis s’avança à 600 pieds dans la mer. L’ambassadeur anglais, sir William Hamilton, qui a laissé d’intéressantes études sur le Vésuve, monta dans une barque, et se fit conduire auprès de cette muraille ardente. « À 300 pieds à la ronde, dit-il, la lave faisait fumer et bouillonner l’eau, et jusqu’à 2 milles au-delà les poissons périrent. »
En 1822, l’éruption fut précédée par un affaissement du sommet. Le cône, qui avait été soulevé sur le sol du cratère à la hauteur de 200 mètres, et qui apparaissait au-dessus des bords, s’écroula dans la nuit du 22 octobre avec un horrible fracas. « La nuit suivante, dit Humboldt, commença l’éruption ignée des cendres et des rapilli. Elle dura douze jours sans interruption : les quatre premiers jours elle avait atteint son maximum. Pendant ce temps, les détonations dans l’intérieur du volcan furent si violentes, que le simple ébranlement de l’air (on n’avait senti aucune secousse du sol) fit éclater les plafonds des appartements du palais de Portici.
« La vapeur d’eau chaude qui s’élevait du cratère se condensait, au contact de l’atmosphère, en un nuage épais, haut de 9 000 pieds. Cette condensation si brusque de la vapeur et la formation même de nuage augmentaient la tension électrique. Des éclairs sillonnaient en tous sens la colonne de cendres, et on entendait distinctement le roulement du tonnerre, sans le confondre avec le fracas intérieur du volcan. Dans aucune autre éruption l’électricité ne s’était manifestée d’une manière aussi frappante. »
En 1850, la lave sortit du cratère avec une abondance extraordinaire, entraînant de très grands blocs graniteux. Les bords du vaste plateau formé par ce courant constituent une sorte de rempart cyclopéen élevé de plus de 5 milles au-dessus de la plaine où le torrent s’est arrêté.
De 1855 jusqu’en 1858, le Vésuve, a été en éruption continuelle. À la fin de mai et au commencement de juin de cette dernière année, le phénomène se manifesta avec une très grande violence. Dans l’espace de deux jours, cinq fissures vomissant une énorme quantité de laves et de fumée s’ouvrirent sur les flancs du cône. La figure ci-contre, qui reproduit un dessin fait à cette époque, représente plusieurs de ces fissures situées près de la base au moment de leur plus grande activité. C’était un magnifique spectacle au milieu de la nuit. Les laves formèrent de larges fleuves qui se divisèrent en plusieurs branches. M. Palmieri, directeur de l’observatoire construit sur le Vésuve, a soigneusement décrit tous les phénomènes de cette éruption, ainsi que ceux qui accompagnèrent, en 1861, la violente éruption de Torre del Greco.
Nous avons eu l’occasion de visiter deux fois le Vésuve. Ce fut d’abord en 1836, pendant une période de repos. Après avoir quitté au bord de la mer le village de Résina, on monte à travers les vignobles qui produisent le vin renommé de lacryma-christi. D’anciennes coulées de lave apparaissent de distance en distance, mais en partie revêtues d’une fraîche verdure. Un groupe de grands arbres ombrage encore le plateau de l’ermitage situé à mi-hauteur de la montagne. La végétation diminue ensuite, et on entre dans la région purement minérale. L’immense désert de scories et de cendres s’étend de tous côtés.
L’aspect des champs de lave est surtout frappant. Comme dans les glaciers des Alpes, c’est une mer avec ses vagues qui semble avoir été tout à coup figée. Mais au lieu d’un cristal brillant sous les rayons du soleil, on a devant soi une matière noire et terne sur laquelle se détachent çà et là des scories grises ou jaunâtres comme des crêtes d’écume.
Il est nécessaire de s’engager pendant quelque temps dans la vallée qui est formée par la Somma et le cône, afin de trouver le point où l’ascension de celui-ci devient le plus facilement praticable. À cause de la grande inclinaison de la pente, elle est toujours pénible et emploie près d’une heure. Dans la partie inférieure, ce sont des scories qui dominent. Les amas qu’on gravit s’écroulent souvent et forcent à recommencer le chemin. Plus haut les pieds s’enfoncent dans une cendre fine qui gêne extrêmement la marche.
Le sommet atteint, on domine le cratère, et les yeux se portent alternativement sur l’abîme horriblement bouleversé, et sur l’harmonieux paysage que présente le golfe de Naples avec ses îles et ses promontoires. Répétons ce qu’a dit Chateaubriand : « C’est le paradis vu de l’enfer. »
À chaque éruption, le vaste bassin qui constitue le cratère change de forme. Des cônes nouveaux s’élèvent et s’écroulent, des roches se superposent en retombant, des crevasses s’ouvrent. Nous avons pu observer le fond de quelques-unes où les matières présentaient une remarquable variété de coloration, et la bouche même du volcan d’où l’on voyait sortir une épaisse colonne de famée. Les circonstances nous favorisaient. Le vent dégageait le côté du gouffre auquel nous arrivions, et facilitait l’examen des parois intérieures couvertes de pierres calcinées et des vitrifications.
Peu de minutes suffisent pour arriver au bas du cône, escaladé avec tant d’efforts. On se laisse glisser sur les cendres comme dans les neiges des hautes montagnes.
Le retour au milieu de la nature vivante a un très grand charme après ce séjour dans l’aride solitude du volcan. Avec quel plaisir on retrouve l’ombrage des pins, les fleurs et les oiseaux !
En 1846, le contraste devait être plus complet encore. Nous avions passé la journée sur la côte de Sorrente, dans la belle contrée qui a vu naître le Tasse, et à l’entrée de la nuit nous arrivions sur le Vésuve, alors en éruption.
Les explosions n’étaient pas assez violentes pour empêcher de visiter le cratère. Un sombre nuage le dominait et se teignait des reflets de l’incendie intérieur ; on entendait le bruit d’une formidable haleine sortant du gouffre, et des pierres brûlantes lancées en gerbes à perte de vue retombaient avec fracas sur les bords du cône. Le plus souvent l’éruption était précédée d’un roulement de tonnerre dans les profondeurs de la montagne, le sol tremblait, et pendant que le jet de gaz pénétrait dans le grand panache de fumée, des détonations semblables à des décharges d’artillerie ébranlaient l’air.
On voyait la lave sourdre à travers les fentes du cratère et couler en pétillant dans des canaux inclinés. La température diminue assez rapidement à partir de l’orifice ; le courant se couvre de scories qui s’agglutinent et forment bientôt une voûte solide sur laquelle on peut passer sans danger. Au centre, la matière est encore incandescente après cinq ou six ans.
Indépendamment des phénomènes éruptifs intermittents du Vésuve, on constate autour de sa base quelques manifestations permanentes d’un ordre secondaire, comme les nombreuses sources minérales de Castellamare, de Santa Lucia, et les émanations gazeuses de la mer aux environs de Torre del Greco. Une région située à l’ouest de Naples renferme encore d’autres organes importants liés à ce grand évent des feux souterrains. Les anciens la désignaient sous le nom de champs Phlégréens, ou même sous celui de Forum de Vulcain. La mythologie y plaçait l’un des travaux d’Hercule, sa victoire sur les géants « fils de la Terre, » symbolisant ainsi la conquête du sol fertile de cette contrée pendant la période du repos qui succédait aux éruptions de l’âge primitif.
Sur une surface de 300 kilomètres carrés s’élève une série de collines en tuf ponceux, ayant la forme régulièrement circulaire qui caractérise les cratères. Naples est bâtie au milieu d’un bassin semblable. On en distingue d’autres, très voisins, du haut du couvent des Camaldules et du Promontoire de Pausilippe. La petite île de Nisida est aussi un cône éruptif avec un cratère ouvert du côté de la mer. La même disposition circulaire s’observe dans l’ensemble des collines de Cumes. Ajoutons l’île Procida, le groupe des Ponza, les îles Ventotienne et San Stefano, qui sont évidemment les restes d’une île plus grande. Le Vésuve d’ailleurs se lie à la chaîne des volcans éteints du Latium et de l’Italie septentrionale par deux cônes de grande dimension qui se trouvent sur le flanc des Apennins, à mi-distance des deux mers, les monts Vultur et Rocca Monfina. On y voit de vastes cratères qui n’ont pas été en activité depuis les temps historiques, mais qui présentent encore quelques émanations carboniques.
Au centre des champs Phlégréens, un cratère très remarquable a reçu le nom de Solfatare, à cause des nombreuses matières sulfureuses qu’il renferme. Il est situé près de la ville de Pouzzoles, dont le terrain fournit surtout le produit volcanique appelé pouzzolane, si utile pour toutes les constructions hydrauliques.
Ce bassin, dans lequel une éruption a eu lieu en 1198, présente encore d’incontestables traces de la haute température des laves souterraines avec lesquelles une fissure le met sans doute en communication. De chaudes vapeurs sulfureuses s’élèvent constamment des différents orifices percés au fond de l’entonnoir ou dans les roches volcaniques qui l’entourent. On a donné dans l’antiquité le nom de Leucogée ou colline blanche à l’éminence formée par ces roches décomposées et blanchies par la vapeur. Le minerai qui est exploité d’ordinaire contient un tiers de soufre ; cependant, dans quelques parties, ce corps a sublimé naturellement et apparaît presque pur. Les roches dissoutes par la pluie forment sur le plancher du cratère des couches semblables à de la terre de pipe, que les gaz remplissent de boursouflures. C’est ainsi que M. Poulelt Scrope rend compte de la résonnance (rimbomba) que chaque pas fait entendre, et que d’autres savants ont attribuée à l’abîme situé au-dessous de la voûte.
« Expliquons maintenant la nature de ces lieux funestes, de ces lacs nommés Avernes. D’abord, ce nom leur a été donné parce qu’ils sont mortels pour les oiseaux ; en effet, quand les habitants de l’air sont arrivés directement au-dessus de ces lieux, ils semblent avoir oublié l’art de voler ; leurs ailes n’ont plus de ressort ; ils tombent sans force, la tête penchée, ou sur la terre ou dans les eaux, si c’est un lac qui leur donne la mort.
« Ainsi à Cumes, près du mont Vésuve, est un endroit où les fontaines chaudes exhalent une épaisse fumée. On en trouve encore un semblable dans les murs d’Athènes au sommet de la citadelle, à côté du temple de Minerve : les rauques corneilles n’osent jamais en approcher, tant elles fuient avec effroi, non pas la colère de Pallas, que leur attira leur vigilance, selon le récit des poètes grecs, mais les exhalaisons mêmes de ce lieu, qui suffisent pour les en détourner. On dit qu’il y a encore un autre Averne de cette espèce en Syrie, et que les quadrupèdes eux-mêmes ne peuvent y porter leurs pas sans que la vapeur les fasse tomber comme des victimes immolées tout à coup aux dieux mânes. Tous ces effets sont naturels, et l’on peut en trouver les causes, sans s’imaginer que ces lieux soient autant de portes du Tartare, par où les divinités infernales attirent les âmes sur les bords d’Achéron. »
À l’ouest de Pouzzoles, plusieurs cratères se sont remplis d’eau et forment des lacs. C’est là que se trouve l’Averne, auquel l’imagination des anciens attachait une sombre légende. Après les éruptions primitives, d’épaisses forêts avaient couvert le flanc des collines qui l’entourent, et au milieu de leurs profondes ténèbres Homère place la demeure des Cimmériens. Virgile en fait le lieu terrible où une sibylle conduit son héros à l’entrée des enfers.
Aujourd’hui les forêts ont disparu et l’oiseau franchit sans crainte un lac bleu dont les bords sont plantés de vignes. Mais les gaz délétères ont dû se dégager longtemps près de l’Averne, comme cela arrive encore en plusieurs endroits, sur les rives du lac voisin d’Agnano. À peu de distance se trouve la grotte du chien, excavation dans laquelle, sans ressentir le moindre mal, on voit périr près de soi, quand on reste debout, des animaux de petite taille. Cette grotte renferme une fissure par laquelle sort du gaz carbonique, qui, plus pesant que l’air, forme une couche près du sol et n’étend son influence qu’à une hauteur d’environ 2 pieds.
Anciennes éruptions. – Le val del Bove. – Cratère de l’Etna. – Éruption de 1669. – Éruption de 1365. – Empédbcle. – Les Cyclopes. – lies Éoliennes. – Stromboli.
On lit dans l’Énéide : « … Cependant le vent nous quitte avec le soleil. Fatigués, nous touchons aux rives des Cyclopes. Près du port, inaccessible aux vents, l’Etna tonne dans ses effroyables éruptions. Tantôt lançant aux nues un noir nuage mêlé de fumée, il roule des globes enflammés : tantôt vomissant des rocs de ses entrailles ardentes, il mugit, rassemble dans les airs les pierres calcinées, et bouillonne au fond de ses abîmes.
« Encelade, le corps à demi brûlé de la foudre, est enseveli sous cette masse. À travers les soupiraux du grand Etna qui le presse, il exhale la flamme, et chaque fois qu’il retourne ses flancs fatigués, toute la Trinacrie tremble, le ciel se couvre de fumée.
« Effrayés de ce prodige, nous passons la nuit sous le toit des forêts, sans voir la cause de ce fracas horrible ; les astres étaient sans clarté, le pôle ne brillait pas des célestes splendeurs, et les nuages d’un ciel obscur enveloppaient la lune de ténèbres. »
Cette description de Virgile est un des récits qui prouvent l’activité de l’Etna pendant les siècles qui ont précédé l’ère chrétienne. À partir de cette époque, le volcan a traversé une longue phase de repos, mais depuis huit siècles, de violentes éruptions se sont succédé à de courts intervalles, et leur fréquent retour a multiplié les dislocations du sol à tel point que l’on compte aujourd’hui sur les flancs de la montagne plus de deux cents couches secondaires. Le cône principal élève à 3 300 mètres au-dessus de la mer sa cime fumante et couverte de neige. Parmi les ravins qui en sillonnent les pentes, on remarque une profonde vallée, le célèbre val del Bove, ouverte dans son flanc oriental, et qui descend jusqu’à la mer. « Le val del Bove, dit M. Poulett Scrope, m’a toujours paru provenir d’une grande fissure, transformée en cratère par quelque paroxysme qui a fait sauter jusqu’au cœur de la montagne, et élargie par l’action de débâcles aqueuses, provenant de la fonte soudaine des neiges sur les hauteurs, sous l’influence de la chaleur émanant des laves expulsées et des averses de scories rougies retombant à la surface. On rapporte, en effet, qu’un pareil torrent roula dans cette vallée au mois de mars 1755, le volcan étant alors tout couvert de neige. D’après Ricupero, il avait une vitesse de 2 kilomètres à la minute sur un espace de 20 kilomètres, vitesse qui devait lui donner une force énorme de destruction et d’entraînement.
Aussi, son lit, de 3 kilomètres de large, est-il encore très visiblement ouvert, à une profondeur de 10 à 12 mètres, de sables et de fragments de rochers. De semblables débâcles ont auparavant, pendant plusieurs siècles, dû suivre le même cours, et former la vaste accumulation de débris qui se trouve à l’entrée de la vallée, du côté de la mer, près de Giarri. Ce banc d’alluvion a plus de 50 mètres de profondeur, mesure 46 kilomètres sur 5, et semble une plage soulevée à 140 mètres au-dessus de la mer. »
Pendant la grande éruption du 21 août 1852, décrite par sir Charles Lyell, un grand nombre d’ouvertures se déclarèrent depuis le sommet jusqu’à la base du grand précipice qui forme l’entrée du val. Du cône formé par l’ouverture la plus basse partit une large nappe de lave, qui, se précipitant en cascade dans un profond précipice, faisait entendre dans sa chute un bruit de « substances métalliques et de verres qui se brisent. » Cette éruption dura neuf mois, et la profondeur des laves accumulées atteignit en certains points 50 mètres.





























