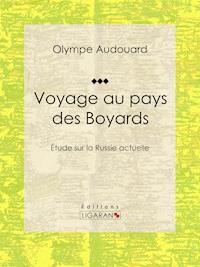
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lecteurs, j'aime mieux vous l'avouer tout de suite que de vous donner la peine de vous apercevoir ; peut-être alors me reconnaîtrez-vous une qualité : la franchise. Eh bien ! ma mission n'est pas précisément de vous amuser, mais de faire faire connaissance avec la Russie à ceux de vous qui n'ont pas visité cette contrée."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038606
©Ligaran 2015
Lecteurs, j’aime mieux vous l’avouer tout de suite que de vous donner la peine de vous en apercevoir ; peut-être alors me reconnaîtrez-vous une qualité : la franchise. Eh bien ! ma mission n’est pas précisément de vous amuser, mais de faire faire connaissance avec la Russie à ceux de vous qui n’ont pas visité cette contrée.
Avec un brin d’imagination, on peut toujours rendre la fable amusante ; mais il n’en est pas de même pour la vérité : cette respectable vertu est parfois intéressante et attachante, mais parfois aussi elle est aride et monotone. Si je pouvais ne parler que de tels ou tels sujets, je choisirais ceux qui sont curieux et amusants et j’éviterais facilement l’écueil d’être ennuyeuse ; mais on m’a dit : Vous devez parler de tout, mœurs, usages, parties pittoresques, armée, politique, idées, révolutions, nihilisme, commerce, et religion. Quelques-unes de ces questions sont intéressantes, sans doute, pour certaines personnes, mais elles paraîtront fastidieuses à d’autres ; que ces dernières m’excusent en se souvenant que ce n’est pas ma faute, puisque je dois traiter même les sujets arides. Tout ce que je pourrai faire sera d’appuyer sur les parties amusantes et de glisser rapidement sur celles qui sont par trop sérieuses ; je le ferai.
L’empire russe, qui représente la civilisation glaciale, est l’état le plus vaste du globe. Il s’étend en Europe, en Asie et en Amérique, c’est un colosse monstrueux à trois pieds d’argile, a-t-on dit ; ceux sur qui ces pieds de géant s’appesantissent, les trouvent de fer.
Sa population, en y comprenant la Pologne et la Finlande, est de 75 millions ; mais, et ceci est le revers de la médaille de cette force numérique, dans ces 75 millions de sujets, il y en a beaucoup de si mal soumis, qu’il faut plus de deux cent mille hommes pour les maintenir sujets du czar, et c’est là une cause de faiblesse pour le gouvernement de ce pays.
Les peuples les plus étranges de mœurs, les plus féroces et les plus farouches, sont compris dans ces 75 millions ; deux grandes races ont formé la population de cette contrée : la race slave à laquelle appartiennent les Russes de la Moscovie, les Polonais les Courlandais et les Lithuaniens, et la race finnoise ou tchoude, dont descendent les Finnois, les Lapons, les Samoyèdes, les Tchérémisses, les Ostiaks, les Tchouvackes, les Permiens, les Tartares, les Kalmouks, les Aléoutes, etc. Ajoutons à tous ces peuples les Mongols, les Arméniens, les Turcs, les Géorgiens et les tribus farouches du Caucase ; ceci constitue, il faut en convenir, une nation peu homogène, et forme un peuple composé d’hommes, de mœurs et d’instincts bien opposés.
Comme à la fameuse tour de Babel, on parle en Russie trente-trois langues différentes, mauvais moyen pour s’entendre toujours !
Les Tchoudes sont les Scythes des anciens.
Les Slaves sont venus s’établir à l’ouest du Volga, plus de douze cents ans avant l’Ère chrétienne ; on le voit, ce pays est bien leur propriété par rang d’ancienneté.
On nomme grande Russie la partie qui occupe le nord et le centre de la Russie d’Europe, c’est l’ancienne Moscovie.
On appelle petite Russie tout le sud-ouest de la Russie d’Europe.
La nouvelle Russie se compose des États méridionaux nouvellement acquis, ils forment les gouvernements de Kherson, Iékatérinoslav, la Tauride, la Bessarabie, et du territoire des Cosaques du Don et de ceux de la mer Noire.
On nomme Russie noire la partie occidentale de la Lithuanie, elle forme les gouvernements de Minsk et de Grodno. La Russie blanche est la partie de la Pologne détachée en 1772, elle forme les gouvernements de Smolensk, de Mohilev et de Vitevsk.
Les parties du territoire qu’occupaient jadis les palatinats polonais de Lemberg, de Chelm et de Belcz portent le nom de Russie rouge, une partie appartient aujourd’hui à l’Autriche.
La Russie a pour elle le nombre, et je viens de faire remarquer que ceci est plutôt un élément de faiblesse qu’un élément de force pour elle.
Elle possède l’immensité ; de loin cette immensité éblouit, de près elle attriste, et elle constitue elle aussi un élément de faiblesse ; les villes sont séparées par des steppes arides, les communications sont pénibles et lentes, et comme sol, la qualité est certes préférable à la qualité, le peuple russe en fait la triste expérience.
L’eau occupe presque un quart du territoire russe, qui possède la mer Blanche, la mer Caspienne, la mer Baltique et la mer d’Azov ; ses fleuves peuvent être comptés au nombre des plus grands cours d’eau du globe, ce sont : le Don, le Volga, le Dnieper, le Petchora, les deux Dwina, le Niémen et le Dniester ; ajoutez à toute cette masse d’eau des lacs innombrables, des rivières aussi nombreuses que fortes et des canaux, vous comprendrez que la Russie d’Europe n’étant qu’une grande plaine bien basse et bien plate, elle soit, dès que l’hiver est fini, transformée en un immense marais. Comme montagnes elle ne possède que les monts Ourals ou Poyas, qui se trouvent à son ouest et qui la séparent de la Russie d’Asie ; trop d’eau et pas assez de monts.
Je ne connais pas un paysage plus morne et plus dénué de tout pittoresque que ce marécage sans fin qu’on nomme Russie d’Europe. On ne peut pas voir au loin, car dans ces plaines, tout fait obstacle à l’œil : buisson, barrière, simple amas de terre, vous cachent des lieues de terrain, l’horizon y est toujours borné, les plans sont rares, sans mouvement, sans une seule ligne pittoresque ; aussi, aucun de ces sites ne se grave dans la mémoire, aucun n’attire vos regards, et le voyage devient d’une tristesse mortelle.
Partout ailleurs l’artiste Dieu a peint des tableaux saisissants, éblouissants de coloris, étranges de figures, bizarres d’aspect ; mais en Russie, on croirait qu’il s’est essayé dans son art et qu’il a fusiné d’une main peu sûre encore, et en traits vagues et indécis, une ébauche de nature.
En hiver, alors que le sol est couvert d’un tapis de glace, que les arbres sont changés en stalactites de cristal, que le ciel verse sur votre tête sans discontinuité la neige, cette blancheur sans fin fait un effet singulier ; la silhouette de l’homme se dessine sèchement sur ce fond éclatant, et il se sent mai à l’aise ; il a cette vague impression qu’il erre dans l’empire de la mort, une angoisse douloureuse s’empare de lui, il tressaille au moindre bruit, tout lui apparaît comme un augure de mort ; il croit à tout, même aux génies, aux fées et aux farfadets. Les aspects de la nature influencent tellement le moral de l’homme, qu’il faut se bien garder d’accuser de faiblesse d’esprit les peuples superstitieux ; il faut se dire qu’ils ne font que subir les conséquences des sites qui les entourent, des aspects qui frappent leur vue.
La Russie est donc livide et morne en hiver.
Au printemps, elle n’est plus que fange, mares et trous d’eau ; son terrain doit absorber l’eau du mètre cinquante d’épaisseur de neige qui l’a recouvert pendant l’hiver ; les fleuves et les rivières qui coulent à pleins bords avec ce supplément d’eau, débordent ; le pays ne devient habitable que pour les canards, et je ne comprends pas que les Russes n’aient pas adopté la coutume de marcher sur des échasses pendant cette saison.
Les eaux de ses mers n’étant point maintenues par des rocs élevés et solides, ont toujours l’air, elles aussi, de vouloir envahir la Russie et la transformer en une immense nappe d’eau.
Nous allons voir à Pétersbourg l’eau apparaître comme un fléau terrible, menaçant sans cesse de mort cette ville.
À 205 kilomètres nord de Pétersbourg, entre le gouvernement d’Olonetz et le grand-duché de Finlande, se trouve le lac Ladoga, qui est le plus grand de l’Europe et qui est plus périlleux à la navigation que la plus mauvaise des mers. Du fond de ce lac, tout près de l’île sur laquelle est construite la forteresse de Schlusselbourg, s’élève en tourbillonnant une source d’un volume colossal ; elle agite toutes les eaux calmes du lac, elle mugit, forme des vagues, puis s’élance en un cours d’une rapidité effrayante. Cette source, c’est la Néva. Des écluses d’un travail remarquable lui font une série de digues et la jettent dans un lit ; elle fait communiquer le lac Ladoga avec les lacs Limes et Saïma, et elle vient se jeter dans la Baltique. À son embouchure, elle dépose du sable et du limon ; ce sable et ce limon, en se durcissant, ont formé des îles. Une de ces îles est Cronstadt, trois autres forment Pétersbourg : l’une est l’île de l’Amirauté, l’autre Vassili-Ostrof, et la troisième l’île de Pétersbourg. À côté de l’île de l’Amirauté, la Néva donne naissance à la Moika qui, elle aussi, traverse la ville. La Néva coule à pleins bords ; en face du quai de la Cour elle a 600 mètres de large ; sa largeur moyenne est de 400 mètres.
À son embouchure elle rencontre une mer dont les eaux, trouvant une terre basse et plate, refoulent souvent les eaux de la Néva qui viennent inonder Pétersbourg. Un jour, l’eau engloutira monuments, hommes et czars.
En face de la Baltique sont des îles sur lesquelles on a construit des maisons de plaisance ; l’été, la promenade aux îles remplace la promenade des Parisiens au bois de Boulogne. Eh bien, on y marche littéralement sur un tapis vivant de grenouilles et de crapauds !
Un canal met en communication la mer Noire et la mer Baltique. Il sert de débouché à tout le commerce de la Russie. Il traverse la ville qui a en plus, en fait d’eau, dix larges rivières dans ses environs.
On pourrait appeler Pétersbourg la Venise du Nord ; mais la Venise italienne charme, elle est belle et gaie, tandis que la Venise du Nord n’est qu’étonnante et étrange.
Cette cité comprend trois grands quartiers, l’île de l’Amirauté, la Litéinia et Woiborg ; elle a 35 kilomètres de tour, 9 de longueur et 8 de largeur, cinq cent mille habitants, dont un tiers femmes et deux tiers hommes ; le grand nombre de soldats qui y sont casernés, les ouvriers célibataires qui viennent y travailler, sont cause de cette bizarrerie de deux hommes et demi pour une femme dans cette population.
L’immensité est la loi russe ; les 450 rues de Pétersbourg, bien droites, sont larges ; la perspective Newsky et la Morskoï ont 50 mètres de largeur. Sur la place Saint-Isaac, cent mille hommes pourraient, manœuvrer à l’aise. Dans ce pays, l’immensité étant adoptée comme type de la beauté parfaite, et la campagne n’étant qu’une plaine sans horizons, il faudrait des monuments énormes s’élevant fièrement vers les nues ; ceux de Pétersbourg sont si bas, que de loin on les prendrait pour de simples palissades, et notez qu’en hiver le sol est rehaussé d’un mètre cinquante de neige.
Les mâts des bateaux dépassent les toits des maisons, ces toits sont en fer et très bas à la mode italienne, tandis que hauts et pointus ils donneraient un peu de pittoresque.
Tout ici est construit à contresens, les vents y sont fréquents et impétueux, et les rues sont larges et bien alignées de façon à permettre aux vents de tout balayer sur leur passage.
Il y a à Pétersbourg plus de trois cents églises, cinq cents palais, quinze cents cabarets et neuf mille maisons.
Cent trente-huit ponts traversent la Néva, quelques-uns sont beaux, le pont Saint-Nicolas entre autres.
Les quais de la Néva peuvent être classés parmi les travaux grandioses des temps modernes.
L’eau coulait à pleins bords, la terre manquait ; tout autre que Pierre le Grand aurait été embarrassé. Ce despote de génie a sacrifié la vie de cent mille hommes et il a vaincu l’élément eau, il lui a opposé le granit, des blocs énormes ont été transportés sur les rives de la Néva et ils forment un rempart à l’envahissement des eaux.
Les parapets en granit qui bordent ce fleuve ont une longueur de dix kilomètres, les Russes ont accompli un travail digne des Romains.
Si l’on arrive à Pétersbourg par le chemin de fer, l’impression est bien moindre que si on entre dans cette ville par Cronstadt, aussi je vais vous décrire l’aspect qu’elle offre à ceux qui y viennent par mer.
À Cronstadt, forteresse sous-marine, à 30 kilomètres de Pétersbourg, il règne une grande animation, une forêt de mâts charme le regard ; pour gagner la capitale et remonter la Néva, on quitte le pyroscaphe, et l’on s’embarque dans un bateau ayant un moins fort tirant d’eau ; on se trouve entre l’Ingrie à gauche, et la Finlande à droite, mais des deux côtés le paysage est lugubre, une plaine grise parsemée de bouleaux d’un vert pâle et de pins noirâtres, c’est tout ; on passe près du somptueux château, que se fit jadis bâtir le célèbre Menschikoff, on aperçoit devant soi comme une nappe, d’eau d’où s’élèvent des mâts et des aiguilles gigantesques, c’est Pétersbourg. Peu à peu les monuments se dessinent, on distingue les coupoles dorées des églises, les campaniles grecs, tout cela mêlé aux mâts des bateaux, on navigue enfin entre ces quais de granit qui sont d’un effet imposant, on passe devant des sphinx également en granit qui sont de dimensions colossales.
Le palais de marbre du grand-duc Constantin, le palais d’hiver, la bourse, la douane, des écoles, des musées, des églises, la statue équestre de Pierre Ier sur un rocher, et bien d’autres monuments encore vous apparaissent tour à tour et la capitale de la Russie a un fort grand air ainsi vue : l’œil ne contemple que dômes dorés, flèches, arcades et colonnades, on se demande si un génie vous aurait transporté soudain dans les pays de l’Orient ; mais le ciel est terne ; la campagne, plaine marécageuse, fait un vilain cadre à cette architecture du bas empire.
Saint-Isaac se trouve aussi sur les rives de la Néva ; cette église un peu calquée sur notre Panthéon, possède une coupole d’airain si colossale, qu’à elle seule elle est un monument.
Le palais d’hiver donne d’une de ses façades sur la Néva, la façade principale fait face à la place de l’Amirauté ; son style régence fait grand effet et sa couleur d’un gris un peu rouge plaît à l’œil, il est à peu près de la dimension du Louvre réuni aux défuntes Tuileries. Ce palais est la preuve palpable de ce que peut faire le despotisme en bien comme en mal, il est l’œuvre de l’esclavage, le résultat d’une volonté tyrannique ; construit par l’impératrice Élisabeth, détruit par les flammes en 1839, l’empereur Nicolas, pendant que les ruines du palais fumaient encore, signifia au prince Pierre Wolkonski, ministre de sa maison, qu’il fallait que sur ce même emplacement, un palais en tous points semblable au brûlé fût rebâti, et qu’il fallait qu’il fût prêt à être habité à un an de là jour pour jour.
Le prince Wolkonski répondit timidement que ce délai était insuffisant pour édifier un monument aussi colossal.
Le despote fronçant les sourcils, lui dit : – Rappelez-vous, monsieur, que tout ce que le czar veut est possible.
– Votre Majesté a raison, sa volonté peut opérer des miracles, le palais sera reconstruit à la date qu’elle daigne me fixer. Telle fut la réponse du courtisan. En effet, ce travail gigantesque a été fait en un an. C’est merveilleux, me dira-t-on, et voilà ce qui doit faire aimer l’autocratie, seule capable de faire faire de ces tours de force-là.
Moi je dis : C’est affreux ! et c’est bien fait pour dégoûter des tyrans, car plus de cent mille hommes sont morts à la peine ; – six mille ouvriers ont dû travailler nuit et jour, les travaux ont continué pendant des froids de 25 et 30 degrés, – les ouvriers, martyrs de l’obéissance passive, martyrs du caprice d’un homme qui se croit l’élu de Dieu, par la seule raison qu’il peut commettre le mal, ce qui devrait lui faire comprendre qu’il est plutôt l’élu de Satan ; les ouvriers étaient enfermés dans des salles chauffées à 30 degrés afin d’en sécher plus vite les murailles. Ces malheureux, en entrant et en sortant, subissaient une différence de température de 60 degrés, ils prenaient des maladies mortelles, un détail ! Qu’est la vie de milliers d’hommes lorsqu’il s’agit de satisfaire le caprice d’un souverain ? rien, selon les courtisans, beaucoup aux yeux du Dieu de justice, de celui dont l’envoyé nous a dit : « Au royaume de mon père les pauvres et les petits seront les premiers. »
Et c’est en souvenir de ces paroles divines, que je pense que ceux qui se disent élus de Dieu pourraient bien être les élus du diable, car ils oublient souvent que Dieu a dit : « Homicide point ne seras de fait, ni volontairement. »
Les peintres, les décorateurs travaillant dans ce palais funeste étaient obligés de mettre sur leurs têtes, des sortes de bonnets de glace, afin de n’avoir pas un transport au cerveau ; malgré cette précaution beaucoup étaient frappés de congestion. L’empereur Nicolas venait un quart d’heure par jour examiner le travail, il se frottait les mains en voyant qu’il avançait ; les morts et les mourants étaient à ses yeux un vrai détail dont il ne daignait pas s’occuper, n’était-il pas naturel du reste que ses sujets souffrent pour lui !
Et les Russes appellent leur czar, le petit père ! Des milliers d’hommes étant morts à la peine, d’autres milliers y ayant souffert et pris de graves maladies, le palais a été achevé, l’Empereur s’y est installé le cœur léger, les courtisans y ont chanté ses louanges, des femmes couvertes de diamants ont dansé dans ses grands et somptueux salons. Ainsi va le monde, l’autocratie opère des miracles, mais c’est aux dépens de la vie d’une multitude d’êtres humains ; ces miracles me font horreur et ce palais d’hiver me donne le frisson.
L’intérieur du palais d’hiver est fort beau, le parquet est une merveille ; il y a des planchers de bois travaillés en forme de mosaïque qui sont remarquables. Le Russe, du reste, travaille le bois avec un sentiment très artistique ; il y a dans de simples maisons bourgeoises des armoires, des bahuts pouvant hardiment rivaliser avec ces vieux bahuts que nous payons si chers à l’hôtel des ventes.
La chapelle du palais est petite, mais ses lambris sont éblouissants d’or et de pierreries ; assister à un service religieux dans cette église, y entendre chanter les chœurs, vaut pour un mélomane la peine de faire le fatigant voyage de Russie ; jamais je n’ai, entendu musique aussi divine, l’ensemble est admirable, et elle se distingue par un profond sentiment religieux ; c’est bien l’accent que doit avoir l’âme humaine en s’élevant vers son Dieu, et les voix sont d’une beauté incomparable. Le Slave est musicien de nature ; idéaliste et rêveur, il a trouvé mieux que personne le caractère que doit avoir la musique religieuse et aussi la manière dont elle doit être exécutée.
Que les mélomanes aillent entendre chanter à la chapelle du palais et au couvent de Sergus et, j’en suis sûre, ils seront de mon avis.
Dans une superbe serre, sorte de jardin d’hiver, s’étale toute la flore exotique ; des fontaines font entendre leur doux murmure, des statues de marbre blanc se cachent dans de verts bosquets. Il y a une Vénus de Médicis dans le costume… que vous savez, et qui porte sur une inscription placée sur son socle la mention qu’elle a été offerte par le pape des catholiques à Pierre Ier ; ce pape envoyant cette belle nudité à un schismatique…, c’est… original.
Le palais d’hiver donne en façade sur la place de l’Amirauté, où se trouvent jetés, amoncelés, semés, tous les monuments que je vais vous décrire, et qui pourtant a un air démeublée ; ceci vous fera comprendre la dimension de cette place. En face du palais se trouve l’Amirauté, sorte de temple grec avec double rangée de colonnes ; une aiguille, flèche fine comme un paratonnerre, s’élève au-dessus de lui à une hauteur prodigieuse, elle est dorée en or pur avec les ducats d’or que les États-Unis de Hollande avaient envoyés à Pierre Ier.
L’église Saint-Isaac avec son péristyle et son dôme colossal occupe un des angles faisant face au palais d’hiver ; plusieurs ministères, construits aussi en forme de temples païens, entourent cette place ; même les commis sont logés dans des temples !
À l’angle qui se trouve vers la Neva, sur un bloc énorme de roche est huché un cheval qui se cabre ; il a l’air d’être prêt à dégringoler du roc, on craint de le recevoir sur la tête, mais on se rassure en apercevant un serpent qui s’enroule à sa jambe et le retient… Pourquoi ce serpent sur ce rocher ? pourquoi resserre-t-il de ses anneaux la jambe de ce coursier ? Peut-être, tout est possible, l’artiste qui a fait cette œuvre le savait-il, moi, je n’ai jamais pu le deviner. Sur le cheval se tient farouche le czar de pierre, Pierre le Grand ; il lève un bras protecteur sur la ville de Pétersbourg, mais avec un geste de menace qui s’adresse sans doute à la vieille Moscou ; une inscription porte ces trois mots : « À Pierre Ier Catherine II. »
Cette czarine était une femme d’un esprit éminent, aussi en trois mots elle a su dire ceci Tu étais grand, je suis grande ; tu avais du génie, j’ai du génie ; tu étais puissant, je suis puissante ; cette statue que je t’élève avec l’argent de mon peuple redira ces trois vérités aux générations futures.
Au milieu de la place se dresse la colonne Alexandre ; elle est plus haute que celle de la place Vendôme ; son fût, d’un seul morceau de granit, est le plus énorme bloc que mains d’hommes aient travaillé.
Le Sénat, palais païen avec péristyles, colonnes et frontons, se trouve encore sur cette place ; en face du palais impérial, et donnant issue dans la Morskoï, on admire une arcade en demi-cercle, surmontée d’un char attelé de six chevaux de front, le tout en bronze doré.
Récapitulons, si vous le voulez bien, les monuments construits sur cette seule place : le palais d’hiver, l’église Saint-Isaac de dimensions colossales, le palais de l’Amirauté, celui du Sénat, trois ministères, la colonne Alexandre, le bloc de rochers, le Cheval et Pierre Ier, l’Arc de triomphe ; et malgré cette profusion de monuments on a dû planter quelques arbres pour meubler un peu la place !
Derrière le palais Michel il y a une autre place qui est aussi vaste que notre Champ de Mars.
La profusion est le bon goût du Russe, l’immensité est le caractère distinctif de cette nation.
La perspective Newski a une lieue de long et 50 mètres de large, c’est une des rues les plus animées de la capitale, elle aussi possède bon nombre de monuments ; tout au bout il y a le couvent d’Alexandre Newski, le monastère est immense, l’église est belle. Le tombeau de saint Newski est une vraie curiosité, il vaut son pesant… d’argent ; on peut l’appeler précieux, l’autel est en argent massif, il est surmonté d’une pyramide en argent massif qui s’élève jusqu’au dôme du temple. On ne saurait dire que cette œuvre d’art est sans valeur.
Les églises de toutes les communions étrangères sont sur la perspective Newski, église catholique, église arménienne, église luthérienne et l’église hollandaise ; tous ces temples n’ont rien de remarquable comme architecture.
Le palais Anitschkoff, demeure du grand-duc héritier, se trouve placé en face du pont du même nom ; le théâtre Alexandre, construction grecque, orne aussi cette rue ; la Bibliothèque impériale se trouve sur le square de Catherine. Le monument de la bibliothèque est aussi bourgeois que possible, et la statue de Catherine II, qui s’élève au milieu du square, est un chef-d’œuvre de mauvais goût comme exécution de la statue au point de vue de l’art… l’artiste a montré plus de malice que de bon goût en plaçant autour du socle de la statue les principaux favoris de cette czarine, dont les amours coupables sont ainsi gravés à jamais dans la pierre. Le peuple dans son langage grossier donne un vilain nom à ce square.
C’est encore sur la perspective Newski que se trouve le Gostenoï-dvor, grand bazar populaire, qui a un cachet tout à fait russe ; enfin un des plus jolis monuments, selon moi, de Pétersbourg, la cathédrale du Kasan, se trouve aussi sur cette voie.
L’aspect de Pétersbourg, à défaut d’admiration, fait naître l’étonnement ; si ce n’est pas parfaitement beau, c’est complètement étrange.
La couleur ocre passe en Russie comme l’indice de sentiments conservateurs et les propriétaires s’empressent de prendre cette sage enseigne, ils font badigeonner leur maison de couleur rhubarbe ; les dômes des églises sont dorés, les aiguilles qui les surmontent sont dorées aussi, quelques églises ont des dômes peints couleur vert choux ; pendant six mois le sol est blanc, ces trois couleurs avec cette blancheur pour cadre font un singulier effet.
La ville taillée sur ce vaste patron étant très peu peuplée, elle paraît toujours déserte ; lorsque la cour s’y trouve, il y règne une certaine agitation, les courtisans vont au palais, en reviennent, les officiers circulent affairés. Lorsque la cour est absente on croirait parcourir une ville atteinte de la peste.
Le penseur considère cette ville avec autant de curiosité que d’intérêt, car devinant la pensée de son fondateur, il comprend que cette cité n’est autre chose qu’une espérance taillée dans le granit. Pierre Ier après avoir jeté un regard sur le passé de sa patrie, se sentit pris d’un morne découragement ; enfin, son énergie se réveillant, il voulut détruire le passé, édifier l’avenir. Il décapita Moscou, fonda Pétersbourg sur le coin de terre qui, par la Baltique, jette un regard vers l’Europe, indiquant par là sa volonté ferme de créer une civilisation européenne ; il a taillé cette volonté dans le roc et dans le granit.
Les autres capitales du monde se sont bâties lentement, elles ont mis des siècles à s’embellir ; la capitale russe a surgi brusquement, avec ses sphinx, ses pilastres et ses colonnes, du limon de la Néva. Elle est le résultat de l’effort puissant de la volonté d’un seul homme, elle représente la puissance humaine luttant victorieusement contre les forces de la nature.
Mais, l’homme sera-t-il toujours le plus fort ? that is the question. Il est à craindre qu’un jour l’élément eau prenne une terrible revanche. En automne et au printemps le canon, servant de cloche d’alarme, a toujours l’air d’annoncer la fin de cette ville, de sonner son glas funèbre ; c’est par un coup de canon qu’on annonce le débordement de la Néva, et alors chacun tremble ; les riches propriétaires jettent un regard consterné sur les merveilles artistiques qui sont réunies chez eux et sur leur palais de marbre, tout cela sera peut-être la proie de l’eau… et de tout ce luxe il ne restera qu’un souvenir, se disent-ils.
Dans le XVIIIe siècle sept inondations ont failli détruire cette ville.
Le 10 septembre 1777, l’eau de la Néva est montée de onze pieds, la crue arriva rapide et imprévue au milieu de la nuit ; les bateaux, même d’un fort tonnage, furent jetés sur les quais, d’autres furent entraînés en pleins champs ; plus de mille personnes furent noyées, leurs cadavres allèrent dans la Baltique, quelques-uns furent retrouvés dans la campagne où l’eau les avait portés.
En novembre 1824, les eaux de la Néva repoussées de leur embouchure par un vent furieux, s’élevèrent en vagues formidables, elles étaient refoulées vers leur source, emportant les ponts, entraînant les bateaux. Cette masse effrayante s’abattit soudain dans la ville, arrivant jusqu’au deuxième étage des palais ; les débris des ponts heurtaient les maisons, les bateaux à moitié brisés s’engageaient dans les rues, la population surprise cherchait en vain le salut sur l’impériale des voitures, bientôt les chevaux, noyés, tombaient, l’eau ne tardait pas à dépasser la hauteur des carrosses, des grappes humaines s’accrochaient aux arbres, qui se brisaient sous le poids, entraînant des centaines de malheureux dans le gouffre… Les croix, les pierres des cimetières heurtaient dans la ville les nombreux cadavres, nouvelles victimes de la mort.
Cela dura douze heures, et douze heures de mortelles angoisses ; vers le soir les eaux se retirèrent, la ville dut rester toute la nuit plongée dans l’obscurité ; des maisons s’étaient écroulées, les victimes se comptaient par centaines. Muni de lanternes, chacun, barbotant dans la vase, allait à la recherche des siens ; beaucoup n’eurent pas même la suprême consolation de retrouver le cadavre des êtres qui leur étaient chers. Le lendemain, le soleil éclaira un spectacle lugubre ; la ville elle-même menaçait ruine, les maisons qui avaient résisté au torrent impétueux étaient ébranlées, les quais de granit avaient ôté ravagés.
Pertes énormes d’argent, et près de mille êtres humains noyés.
En 1827 et en 1830, nouvelles crues ; en 1862, autres inondations. Chaque année, du reste, que ce soit au moment de la débâcle des glaces, ou en automne, le canon fait tressaillir les habitants de cette cité, qui a ses petites inondations périodiques ; ainsi les sous-sols sont régulièrement visités par les eaux deux fois par an ; les pauvres s’y logent pourtant, les loyers de ces réduits malsains, étant les seuls abordables pour leur misère.
Les vieux Russes, ennemis jurés de la civilisation européenne, disent que Dieu lui-même souffle sur les eaux de la Néva afin qu’elles viennent détruire cette ville cosmopolite et impie, et noyer ces audacieux étrangers non orthodoxes qui osent souiller le sol russe.
Qui sera le plus fort… de l’élément eau ou du granit ? Dieu seul le sait.
Pétersbourg a quatre aspects distincts et bien différents ; son aspect change avec les saisons et je dois vous la présenter en hiver, au printemps, en été et en automne, pour vous faire faire sa connaissance complète.
Mais d’abord, pour être un bon cicerone, laissez-moi vous dire un mot de la douane, des hôtels et de la police ; ceci fait, nous mènerons, lecteurs, vous en imagination, et moi en souvenir, la vie bruyante et agitée que mène en hiver le grand monde russe, et nous étudierons la physionomie de cette capitale de l’empire des glaces.
La douane russe est bien la plus déplaisante de toutes les douanes, elle pousse au grotesque la manie de fureter dans vos effets et de saisir les objets, qui pourtant vous semblent le moins passibles de payer droit d’entrée.
Mais ce que l’autocratie fait surtout saisir avec un soin méticuleux, c’est la pensée fixée sur le papier ; livres, journaux, chiffons de papier, sont aux yeux d’Argus des douaniers, des ennemis dangereux. Pensez donc, si on allait introduire dans la sainte Russie un de ces écrits à idées libérales, osant soutenir que les peuples ont des droits et que tout homme a non seulement le droit, mais encore le devoir de penser, de réfléchir et de raisonner ! Ce serait affreux ; aussi, avec un entrain diabolique, les hommes de la douane s’emparent de vos livres, vous assurant du reste que la censure vous les rendra dès qu’elle aura acquis la preuve qu’ils ne sont pas dangereux ; ils déplient vos chaussures, remplacent les journaux qui les enveloppent par des feuilles de papier blanc.
Tout objet de toilette, robes, gants, chapeaux, qui ne porte pas les marques d’une certaine usure, paye l’entrée ; j’ai vu les douaniers saisir une poupée qu’une fillette portait dans ses bras ; en vain la mère a-t-elle dit que c’était un joujou donné à l’enfant pour la distraire pendant la route, il a fallu payer, la poupée ayant un petit air frais et neuf.
Cette douane, si rigoureuse, exaspère ; mais, pour être juste, je dois convenir que tous les gens très riches de Russie, allant dépenser leur argent loin de leur patrie et y achetant tous leurs vêtements et bijoux, si les droits d’entrée n’étaient pas excessifs et perçus avec rigueur, le budget de l’État perdrait par trop.
Une étude curieuse à faire pendant le trajet de Paris à Pétersbourg, c’est celle de l’humeur des Russes. En quittant la capitale de la France, ils sont gais, communicatifs, ils plaisantent agréablement le régime de l’autocratie et le climat de la Russie ; aux approches de la frontière de leur patrie, ils ne se permettent plus de juger le régime autoritaire, seul le climat est encore attaqué par eux ; mais, la frontière russe dépassée, ils n’osent même plus trouver le froid désagréable, ils deviennent muets ; ayez, le tact de ne pas leur rappeler les opinions qu’ils ont émises, afin de leur éviter l’ennui de vous dire que jamais ils n’ont dit chose semblable… Ils étaient en vacances ; à présent ils sont sous la férule du maître, la classe va commencer.
Il y a trois grands hôtels à Pétersbourg : l’hôtel de France, dirigé par M. Croissant, un Français ; l’hôtel Demouth, sur le canal, et le grand hôtel d’Europe, situé au coin de la rue Michel et de la perspective Newski. Les prix y sont très élevés ; je payai, dans le dernier de ces hôtels, six roubles par jour, pour deux pièces au troisième, nourriture non comprise.
Vous le savez, le rouble argent vaut 4 francs, le rouble papier suit les variations du cours, qui le mettent tantôt à 3 fr. 80, pour le faire descendre à 2 fr. 75. Le voyageur pratique doit emporter beaucoup d’or en Russie, il le change pour du papier, il gagne au change et il diminue ainsi les frais d’un séjour fort coûteux.
La table d’hôte est peu dans les mœurs ; en tout cas une femme comme il faut ne doit pas y dîner, il faut manger dans son appartement, et le moindre repas vous revient à trois ou quatre roubles. On peut établir ceci : ce qui coûte un franc à Paris, coûte un rouble à Pétersbourg.
En arrivant dans un hôtel et même chez une famille amie, vous devez envoyer bien vite votre passeport à la police, et pourtant vous n’avez pu franchir la frontière qu’après l’avoir montré aux policiers qui s’y trouvent ; deux ou trois jours après, un homme de cette police vient chez vous et vous fait subir le petit interrogatoire suivant :
– Que venez-vous faire ?
– Avez-vous un but caché ou avoué ?
– Comptez-vous rester longtemps ? Fixez le nombre de jours ?
Notez que, pour obtenir un billet à la gare de Moscou, vous devez encore montrer votre passeport, et que vous ne pouvez obtenir un billet pour quitter la Russie sans montrer votre passeport ; ce papier étant resté entre les mains des hommes de la police, vous devez le réclamer trois jours avant celui que vous avez fixé pour votre départ, car on ne vous le rend qu’après avoir fait une minutieuse enquête pour savoir si vous n’avez aucune dette, si vous avez payé bien intégralement tous vos fournisseurs. Tant pis pour vous si une affaire pressée, si la maladie d’un parent, exigent votre prompt départ ; mais cette mesure est sage, elle préserve bien l’intérêt des marchands ; si elle était adoptée à Paris, nos commerçants, si confiants pour l’étranger, seraient moins volés.
Voici l’aspect de Pétersbourg pendant l’hiver : un blanc tapis de neige bien durcie, ayant un mètre et parfois un mètre cinquante d’épaisseur, recouvre le sol ; les toits ont à supporter cette même masse neigeuse, les arbres sont blancs, la façade couleur rhubarbe des maisons et l’or des aiguilles des dômes se détachent criards sur cette blancheur. Des nuées de corbeaux noirs s’abattent sur la ville ; l’œil, fatigué du blanc, voit avec plaisir ces petits points sombres des gros moineaux, avec une chaude robe de plumes épaisses et toujours hérissées, s’abattent sur la neige, dévorant ce que les chevaux y laissent tomber. Les pigeons sont innombrables en Russie, ils sont considérés comme le symbole du Saint-Esprit, et sont sacres pour tous les orthodoxes ; on leur donne à manger, on ne les tue jamais, ils peuvent donc multiplier à l’aise.
Si vous regardez la ville de la tour de la Douma, par exemple, vous ne voyez que monticules de neige d’inégale hauteur, et dominant ces blanches petites montagnes, des dômes reluisants d’or et des aiguilles dorées ; ce tableau est étrange et bizarre.
Les rues, comme je l’ai dit, sont larges, les maisons basses, l’homme aurait dû éprouver le besoin de se grandir un peu ; le sol des rues étant transformé en mares puantes et boueuses en automne et au printemps, il aurait dû inventer des véhicules très hauts. Eh bien ! les carrossiers russes n’ont cherché qu’une chose, faire les voitures les plus basses possibles, si bien que l’homme glisse à ras de terre, derrière la queue des chevaux, ce qui le rapetisse et lui enlève beaucoup de son prestige. Je suppose qu’il a été guidé par un sentiment de courtisanerie, le czar allant ordinairement en carrosse, le Russe rampe à ras-terre, pour montrer à son maître qu’en toute circonstance il se fait petit devant lui.
La drowski, voiture russe, consiste en une banquette avec un petit dossier très bas, un immense garde-crotte en cuir vernis, et quatre roues. De loin, cet attelage représente un insecte courant sur terre, les ailes déployées ; les jambes du cocher touchent les jarrets du cheval ; la seconde banquette est tellement rapprochée de celle du cocher, qu’au moindre cahot le voyageur heurte sa figure dans le dos du cocher ; le pavé étant inégal, semé de trous et de monticules, les chevaux étant souvent lancés à toute vitesse, se tenir en drowski est presque aussi difficile que de se tenir sur une corde raide. Le siège est à peine assez large pour une personne, souvent deux et même trois y sont assises sur un seul côté ; lorsque ce sont des femmes, elles se cramponnent au cocher ; celui-ci fouette ses chevaux, la voiture est jetée d’une hauteur dans un trou, les vêtements des femmes volent de droite et de gauche, le cheval domine ces êtres humains ainsi cahotés ; c’est grotesque, mais peu digne.
Les drowski ne servent que dans les saisons où le sol n’est point encore durci par la neige et la glace ; en hiver, le traîneau est le seul véhicule commode, car dans les voitures fermées la glace forme couche sur les vitres, ce qui a deux inconvénients, celui d’emprisonner le voyageur qui ne voit plus au dehors et que le cocher peut conduire où il veut. Le second inconvénient, plus grave encore, est que, lorsque vous venez pour ouvrir la portière, le verre des vitres se brise et vous blesse.
Les chevaux russes ont pour eux la rapidité, mais ils n’ont pas la force, et ceci explique les attelages à deux et à trois chevaux ; dans ces derniers, le cheval principal, celui du brancard, a la tête passée dans un demi-cercle assez élevé et ne le touchant pas ; les diverses parties des harnais s’adaptent à ce bois d’une façon élégante, une sonnette est attachée à ce demi-cerceau. Le second cheval, attaché hors mains, est encore plus libre que le timonier ; il porte la tête en dehors, il a l’encolure ployée à gauche, et il galope alors même que son compagnon ne fait que trotter ; on l’appelle le furieux.
L’ancienne drowski consistait en une planche posée en long, supportée par quatre ressorts placés de longueur, sur quatre roues ; les hommes se mettaient à cheval sur cette planche. La drowski moderne et civilisée a le banc en travers, il est posé sur une petite caisse forme tilbury, qui est soutenue par quatre ressorts portés par quatre essieux ; ces ressorts ont l’inconvénient de se briser comme verre, si bien qu’on devrait appeler ces voitures des casse-cou, ou des voitures à belles-mères.
Il y a encore une sorte de petit char-à-banc, sans ressort, avec un banc non rembourré, qu’on nomme kibitka ; on s’en sert dans l’intérieur de la Russie, c’est l’équipage ordinaire des feldjâgers, courriers allant porter les ordres de l’empereur en province. Ils doivent ne prendre aucun repos, ne s’arrêter en route que le temps absolument nécessaire pour faire changer les chevaux et avaler quelques tasses de thé ; ils arrivent moulus, brisés, à leur destination, et ils sentent que le service du bon petit père manque de douceur.
Pétersbourg n’est, à vrai dire, qu’une vaste dépendance de la cour.
La cour est un centre qui rayonne sur tout et sur qui tout aboutit.
Le czar est le soleil devant qui tout se prosterne ; il est la tête de 75 millions d’êtres qui, décapités, n’ont plus que le droit de se mouvoir pour exécuter machinalement les ordres qu’on leur donne. Alors qu’on invente des machines parlantes, l’autocratie s’applique à faire des hommes automates.
Le mouvement en Russie se fait autour des palais : fonctionnaires et courtisans s’y rendent d’un air préoccupé ; les uns en sortent joyeux, le maître a daigné leur sourire ; les autres s’en éloignent l’air morne et sombre, le maître a froncé les sourcils, et ils savent qu’un froncement de sourcils suffit pour envoyer un homme à la forteresse ou en Sibérie.
À côté de la cour centrale et impériale, il y a les petites cours des grandes-duchesses, et enfin les cours de la main gauche. Autour de celles-là, il y a aussi une certaine agitation ; le reste de la ville est calme.
La famille impériale est très nombreuse, et la Russie a fort à faire pour bâtir des palais pour tous les princes et princesses ; ces palais ornent la ville, c’est vrai, mais ils grèvent le budget d’une rude façon.
L’Allemagne a choisi la Russie comme mère nourricière de ses innombrables et blondes princesses, et elle est fort satisfaite, je pense, de se décharger de ce soin onéreux sur sa voisine.
Ces jeunes filles, tant qu’elles vivent dans leur patrie, pratiquent la vertueuse simplicité ; mais comme elles se dédommagent lorsque, par un changement de religion et par un mariage, elles sont devenues Russes !
S’il était possible d’additionner exactement le budget de la cour centrale, ceux de toutes les cours satellites, ceux des cours des favorites, celui de la police secrète, on arriverait à un total si énorme que ceci expliquerait le piteux état des finances russes.
Il y a cinq grands théâtres à Pétersbourg. On sait par les journaux avec quelle galanterie et avec quelle générosité nos charmantes actrices sont reçues en Russie ; mais ce dont on ne peut se faire une idée sans l’avoir vu, c’est de la chambrée de ces théâtres : le costume civil n’étant porté en Russie que par les coiffeurs, tous, les spectateurs ont des uniformes éblouissants ; des décorations, des rubans et des plaques brillent sur leurs poitrines ; les spectatrices sont mises avec autant de goût que de richesse. La femme russe surpasse peut-être la Parisienne dans l’art de la toilette ; elle possède une suprême élégance, si bien qu’au spectacle la chambrée charme autant les yeux que la scène.
À la porte des théâtres, le coup d’œil est bizarre. Autour de grands feux allumés par les soins de la police, se pressent tous les cochers ; les flammes rouges du brasier éclairent d’une façon sinistre leur longue sarafane et leur barbe parsemée de glaçons ; ils sautent, dansent et rient ; on les prendrait pour les démons de l’enfer polaire.
Quelquefois, des âmes charitables leur font servir du thé et de l’eau-de-vie ; ces soirs-là, leur gaieté ne connaît plus de bornes.
Voici le costume que portent les ouvriers, petits marchands, cochers et portefaix : En été, une sorte de chapeau carre plat, à bords aplatis, plus large d’en haut que d’en bas. Cette coiffure sied bien aux vieux comme aux jeunes ; ils aiment l’ornementation, souvent ils mettent un galon ou une plume à leur chapeau. Ils portent tous la barbe longue ; on voit des vieillards ayant une barbe argentée qui leur descend jusqu’à la taille et qui leur donne un faux air de patriarches de la Bible. Pendant l’hiver, ils remplacent le chapeau par un bonnet fourré, et par-dessus ce bonnet un vieux châle qu’ils attachent à la bonne femme derrière le dos.
Ils portent les cheveux longs par devant et retombant en tire-bouchons de chaque côté des joues, coupés courts sur le dessus et derrière la tête ; cette coiffure pourrait s’appeler : à la guillotine, d’autant plus qu’ils ne mettent jamais de cravate et que leur cafetan, coupé à ras du cou, n’a pas de col ; le cafetan est une sorte de longue robe persane en drap très ample. Les couleurs qu’ils adoptent de préférence sont le chamois, le bleu et le vert bouteille ; ils serrent ce vêtement autour des reins par une ceinture en soie ou en laine de couleur voyante, mais pourtant s’harmonisant bien avec la couleur de la robe ; ils portent de larges bottes arrondies par le bout ; pendant l’hiver, ils mettent au-dessus de la sarafane une pelisse fourrée.
Les paysans portent une pelisse en peaux de mouton, la toison est en dehors.
Il est facile aux peuples vivant dans des pays au climat tempéré d’être propres, mais avec le froid intense de la Russie, la propreté est presque impossible aux pauvres ; dans leur taudis, les fenêtres sont calfeutrées de façon à ne pas laisser pénétrer l’air, un immense poêle répand une chaleur asphyxiante ; la fumée, l’odeur de la cuisine, les odeurs sui generis s’amassent, elles forment une atmosphère épaisse et fade, la chaleur devient humide, les murs suintent, l’horrible vermine éclot en hiver en Russie comme elle éclot au mois d’août en Égypte ; ces insectes immondes aiment la fourrure, ils s’y installent, y multiplient, si bien que les Russes promènent avec eux tous ceux qui ne forment pas des dessins fantaisistes sur les murs de leur chambre. Il faut se tenir à distance de la pelisse de l’isvowchik (cocher) et de la peau de mouton du moujick (paysan), car toutes les hideuses variétés de la vermine y pullulent.
La race slave est belle : taille haute et très élégante, attaches fines, les yeux bleu foncé, le regard rêveur, amer parfois. Mais à Pétersbourg, les races sont tellement mêlées, qu’il faut se bien garder de juger du type slave par les hommes qu’on y voit ; c’est la ville cosmopolite, sa race est cosmopolite, elle a été formée par les Finnois ou Tchoudes, les Suédois, les Allemands, les Livoniens ; les Lapons et les Kalmouks ont même un peu travaillé à cette race, ainsi que les Tatares.
L’empereur Nicolas disait que les distances étaient les plus grands fléaux de la Russie ; cette remarque était très juste : comme je l’ai dit, l’immensité du territoire russe est une des principales causes de faiblesse pour cet empire, et la distance, même à Pétersbourg, fait obstacle à bien des choses ; souvent une visite à faire équivaut à un voyage ; la troïka ; attelage à trois chevaux, et les attelages à quatre chevaux, conduits par un cocher et un postillon, sont bien plus une nécessité du mauvais pavé et de la longueur des courses qu’un luxe. Aller à pied est impossible ; aussi, pauvres comme riches, tout le monde va l’hiver en traîneau. Sauf sur la perspective Newski, rendez-vous de tous les désœuvrés et de toutes les petites dames, on ne rencontre que de rares piétons ; les maisons, dans de certains quartiers, étant séparées les unes des autres par des enclos, des terrains vagues, en sortant du centre, Pétersbourg rappelle le steppe.
Les palais, les églises y sont nombreux, mais tout cela se trouve un peu pôle-môle avec d’horribles bicoques en bois ; le cabaret hideux est à côté de l’église reluisante d’or, la froide caserne s’adosse au palais somptueux et grec ; pour rendre le contraste moins frappant, il est vrai qu’on a orné la caserne d’un péristyle ! Cette agglomération de masures de bois, de sphinx de granit, de colonnes, de temples païens, de chalets suisses, dans cette plaine coupée d’espaces vides, forme un tout étrange, bizarre, mais non complètement beau.
Le vieux Russe, le rascolnick, celui qui proteste contre la civilisation européenne, persiste à vivre dans une maison en bois ; elle est grande, confortable, mais le bois est une protestation contre l’Europe impie.
Beaucoup de rues sont pavées en bois, et l’on s’étonne de la fréquence des incendies ; on se plaît à ; les attribuer aux nihilistes ! En Turquie, où les constructions de bois sont aussi nombreuses, quoiqu’il n’y ait pas le moindre nihiliste, des incendies terribles détruisent souvent des quartiers entiers.
L’aspect des rues pendant les jours de fête est original, mais dégoûtant ; pour s’amuser, le peuple russe boit à se griser et mange à être forcé de restituer. Il n’y a ni colonnes Rambuteau, ni établissements à trois sous, si bien que le moujick blesse les yeux d’une singulière façon, tandis que les oreilles sont choquées par ses propos orduriers ; il est impossible aux femmes de sortir à pied ces jours-là, et en voiture elles doivent baisser constamment les yeux. Des gardovoï parcourent les rues ; ils ramassent les ivrognes qui ont roulé sur la glace, ils les placent dans des traîneaux : quelquefois cinq ou six ivrognes sont tassés les uns sur les autres dans le même véhicule ; on les porte au corps de garde ; ceux qui ne sont pas relevés à temps ne se réveillent que dans l’autre monde.





























