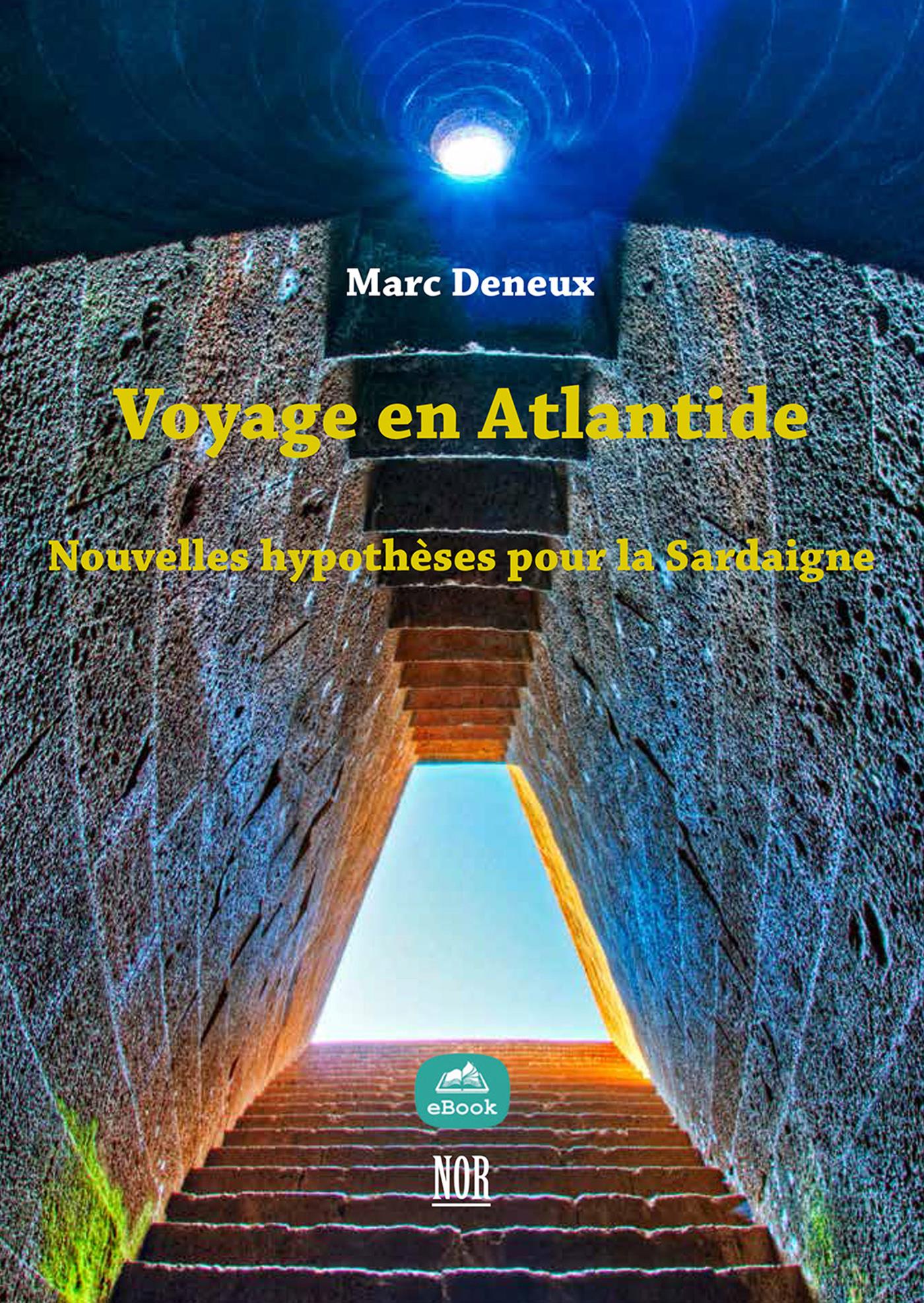
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOR
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Surplombant les collines de la campagne sarde, d’innombrables tours veillent sur le passé d’une civilisation brillante, fille de la lune et des étoiles, qui s’est développée pendant des millénaires au milieu de la Méditerranée. En été, les touristes massés sur les plages de sable fin ne soupçonnent pas qu’à l’intérieur des terres, des monuments énigmatiques parsèment le paysage de l’île. Tout à leur bronzage, ils ne réalisent pas que des temples du soleil sont nés ici. Ils ne pensent pas qu’il y a eu plus de constructions mégalithiques en Sardaigne qu’à Carnac ou en Grande-Bretagne. Ils ne se doutent pas que la plupart de ces vestiges sont l’oeuvre d’architectes de génie qui les ont mesurés et orientés pour donner rendez-vous à la lumière à certaines périodes de l’année. Ils n’imaginent pas qu’allongés tranquillement face à la mer, ils tournent le dos à ce qui fut l’une des histoires les plus incroyables de l’Antiquité : l’Atlantide...
La découverte de l’Atlantide, une quête des origines de notre civilisation, une plongée dans le passé de nos ancêtres, quand les nouvelles technologies ressuscitent les savoirs anciens, quand les grandes énigmes de la fin de la préhistoire sont confrontées à de nouvelles hypothèses nées de la conscience de la réalité́ du récit de Platon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
«Quelles que soient les erreurs dans lesquelles je pourrais être tombé, quelque hasardées et même extravagantes que puissent paraître les interprétations que je propose (...) si mon travail peut épargner des moments précieux aux véritables archéologues, et préparer la voie à de plus exactes et de plus amples observations, je serai amplement dédommagé du sacrifice d’amour-propre que je fais et j’aurai payé mon tribut à la science: il est permis, en des matières aussi obscures, de proposer des conjectures; elles donnent quelquefois lieu à des découvertes importantes.»
Alberto La Marmora
Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825, Avant-Propos
Marc Deneux
Voyage en Atlantide
Nouvelles hypothèses pour la Sardaigne
ISBN 978-88-3309-079-5
Les roches rouges d’Arbatax: que le voyage commence! (Photo de l’auteur)
Première Partie
La Découverte
«Journal de bord» d’une recherche qui, à partir du texte de Platon, va amener un esprit candide et sans a priori, mais curieux par nature et attiré par les grandes énigmes de l’Histoire, à formuler de nouvelles hypothèses concernant la localisation de la cité royale de l’Atlantide et des Colonnes d’Hercule.
Carte des reliefs de la Sardaigne figurant quelques-uns
des principaux sites évoqués.
«La Sardaigne est une île située au milieu de la Méditerranée occidentale, cette position centrale ayant favorisé depuis l’Antiquité les rapports commerciaux et culturels avec les peuples voisins.» (Dictionnaire encyclopédique)
Mon histoire commence le 1er août 2017. Ce jour-là, j’arrive à l’aéroport de Cagliari, capitale de la Sardaigne, pour rentrer à Paris après quelques jours de vacances passés en famille. J’aime bien cette date, le 1/8/17. Je l’avais choisie parce que le premier jour d’un mois m’a toujours paru quelque chose d’un peu particulier. Quand je fumais, j’essayais d’arrêter un «premier du mois» parce que je pouvais alors facilement compter les jours passés sans tabac. Le premier de l’an, c’était le moment des bonnes résolutions, des abdos du matin, du premier footing, des premiers régimes, pas seulement alimentaires d’ailleurs.
Bref, j’entre dans l’aéroport et je suis un peu en avance sur l’horaire prévu. Dans le hall, des grands panneaux invitent à l’exposition d’un journaliste italien, Sergio Frau. Ça s’appelle Omphalos, il primo centro del mondo («Omphalos, le premier centre du monde»), qui est aussi le titre de son dernier livre. Je rentre dans une salle remplie de textes et d’illustrations, j’ai le temps de voir rapidement les 300 photos, cartes et articles, je n’y comprends pas grand-chose, mais je flâne. Je regarde les belles images jetées pêle-mêle sur les murs et j’enregistre sur mon téléphone quelques fiches d’explication en français que je ne peux plus lire car on nous appelle, c’est l’heure.
Je prends mon avion et durant le vol je me remémore quelques souvenirs de vacances, quelques flashs. Les coquilles de murex découvertes à plusieurs jours d’intervalle sous l’eau, au même endroit (c’est la première fois que j’en trouvais en Sardaigne, en parfait état de conservation, sous le sable, près d’un tas de grosses roches, ruines de quelque construction mégalithique). Une petite pierre scintillante avec des formes géométriques gravées, trouvée sous les pieds de ma compagne, au soleil couchant, sur la plage. Et le plus curieux, à Bithia, après avoir remis à l’eau deux bernard-l’ermite logés dans des coquillages qui avaient attiré mon attention, la découverte de deux ancres –ou du moins ce que je m’imaginais être des ancres très anciennes– l’une de forme ronde, percée d’un grand trou, l’autre plate, avec des angles marqués et des ouvertures destinées sans doute à des baguettes de bois pour accrocher le fond de l’eau au mouillage d’une petite barque.
Quelques jours plus tard, un peu avant mon départ, lors d’une dernière promenade dans le petit port de pêche de Nora, j’avais trouvé sur le rivage une troisième ancre, ronde comme la première mais plus petite. Ce qui est très étonnant, c’est qu’en presque vingt ans je n’étais jamais tombé sur une seule ancre antique en Sardaigne, et là, en si peu de temps, trois…
Il reste encore une heure de vol avant la descente sur Paris et je décide de lire les documents de l’exposition sur mon téléphone. J’apprends alors avec stupéfaction que la Sardaigne aurait été la légendaire Atlantide... Comment? L’île où je passais mes vacances depuis si longtemps aurait pu être l’origine d’un mythe qui avait donné lieu à tant d’interprétations diverses, très souvent délirantes, depuis plus de 2.000 ans, et personne ne m’en avait jamais rien dit?
De retour chez moi, je commence à me documenter sur internet et à lire Platon, Timée et surtout Critias, dont je trouve dans diverses bibliothèques quatre traductions différentes. L’une est très littéraire, bien écrite, mais par moments un peu éloignée du texte original, d’autres sont plus proches du grec ancien mais moins agréables, parfois fastidieuses. En tout cas, l’ensemble doit me donner une idée assez précise de l’esprit et des intentions du philosophe.
J’entame alors une analyse de texte qui me ramène presque 30 ans en arrière, quand j’avais écrit un mémoire de maîtrise de lettres modernes sur Illuminations de Rimbaud, une des œuvres les plus obscures de la littérature française du XIXe siècle, passant une année dans les grandes bibliothèques parisiennes (Ste Geneviève, La Sorbonne, L’Arsenal, Beaubourg, la BNF…), ce qui me valut les félicitations du jury et la proposition de mon directeur de recherche de concourir au titre de meilleur mémoire au niveau national.
Mais Illuminations était mon livre de chevet depuis l’adolescence, celui qui m’avait donné envie d’écrire des poèmes en prose, qui m’avait fait concevoir la création littéraire comme un acte révolutionnaire et pour lequel j’avais donné une année de mon existence, me concentrant presque exclusivement sur ce sujet. Je ne connaissais rien de l’Atlantide, à part ce vague souvenir d’une île engloutie et d’une civilisation disparue.
J’apprends que ce récit est issu d’une tradition orale vieille de plusieurs millénaires, que Platon introduit subtilement dans deux dialogues, Timée et Critias, censés décrire l’origine de l’univers, celle de l’homme et celle de la société. C’est la source de toute civilisation qu’il évoque avec le début de l’histoire de l’Atlantide, la naissance de l’intelligence collective, l’union des hommes entre eux aboutissant aux premiers grands travaux de l’histoire de l’humanité. Mais c’est aussi la glorification des ancêtres des grecs qui auraient vaincu les Atlantes, devenus le peuple le plus puissant de la Méditerranée, ayant constitué «un empire vaste et merveilleux» avant d’être englouti sous la mer. (Fig. 1)
Un soir, en ouvrant un livre de Jacques-Yves Cousteau et Yves Paccalet, A la recherche de l’Atlantide, je tombe par hasard dans le glossaire sur une illustration de murex, ce coquillage dont les Anciens tiraient la pourpre avec laquelle ils donnaient à leurs tissus une couleur rouge sombre. Est-ce le souvenir encore bien présent de mes vacances en Sardaigne et de mes trouvailles sous-marines, toujours est-il que je m’enthousiasme moins pour l’histoire de Cousteau, qui soutenait l’hypothèse d’une Atlantide minoenne, que pour l’annexe du livre qui contient une belle traduction d’Emile Chambry d’un passage de Timée:
«C’est donc de tes concitoyens d’il y a neuf mille ans que je vais t’exposer brièvement les institutions et le plus glorieux de leurs exploits». C’est ainsi que s’adresse un vieux prêtre égyptien de la région du delta du Nil à Solon, «le plus sage des hommes et le plus noble des poètes», un notable athénien, homme d’état et législateur, possible parent de Platon du côté de sa mère, qui aurait fait le voyage en Egypte aux alentours de 600 av. J.-C.
Nous gardons ici par écrit beaucoup de grandes actions de votre cité (Athènes) qui provoquent l’admiration, mais il en est une qui les dépasse toutes en grandeur et en héroïsme. En effet, les monuments écrits disent que votre cité détruisit jadis une immense puissance qui marchait insolemment sur l’Europe et l’Asie tout entières, venant d’un autre monde situé dans l’océan Atlantique.
On pouvait alors traverser cet océan; car il s’y trouvait une île devant ce détroit que vous appelez, dites-vous, les Colonnes d’Héraclès (Hercule). Cette île était plus grande que la Libye et l’Asie réunies. De cette île on pouvait alors passer dans les autres îles et de celles-ci gagner tout le continent qui s’étend en face d’elles et borde cette véritable mer. Car tout ce qui est en deçà du détroit dont nous parlons ressemble à un port dont l’entrée est étroite, tandis que ce qui est au-delà forme une véritable mer et que la terre qui l’entoure a vraiment tous les titres pour être appelée continent. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé une grande et admirable puissance, qui étendait sa domination sur l’île entière et sur beaucoup d’autres îles et quelques parties du continent. En outre, en deçà du détroit, de notre côté, ils étaient maîtres de la Libye jusqu’à l’Egypte, et de l’Europe jusqu’à la Tyrrhénie.
Or, un jour, cette puissance, réunissant toutes ses forces, entreprit d’asservir d’un seul coup votre pays, le nôtre et tous les peuples en deçà du détroit. Ce fut alors, Solon, que la puissance de votre cité fit éclater aux yeux du monde sa valeur et sa force. Comme elle l’emportait sur toutes les autres par le courage et tous les arts de la guerre, ce fut elle qui prit le commandement des Hellènes; mais, réduite à ses seules forces par la défection des autres et mise ainsi dans la situation la plus critique, elle vainquit les envahisseurs, éleva un trophée, préserva de l’esclavage les peuples qui n’avaient pas encore été asservis, et rendit généreusement à la liberté tous ceux qui, comme nous, habitent à l’intérieur des Colonnes d’Héraclès.
Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires, et, dans l’espace d’un seul jour et d’une seule nuit néfastes, tout ce que vous aviez de combattants fut englouti d’un seul coup dans la terre, et l’île Atlantide, s’étant abîmée dans la mer, disparut de même.»
Après avoir lu plusieurs fois Platon, Timée et surtout la quinzaine de pages décrivant l’Atlantide dans Critias, j’essaye de remettre dans son contexte l’époque de ces «concitoyens d’il y a neuf mille ans», c’est-à-dire autour de 11.600 ans avant nous (puisque Solon est censé avoir recueilli ce récit en Egypte vers -600), une époque qui correspond curieusement à la conjonction de plusieurs événements importants et scientifiquement reconnus aujourd’hui.
C’est le moment de la fin de la dernière glaciation (dite «de Würm») qui a vu les glaciers recouvrir l’Europe, du nord du Portugal (où les eaux côtières ne devaient pas dépasser les 4°C) à la plaine du Pô, gelant les sols en profondeur, réduisant drastiquement les ressources alimentaires des animaux et des hommes. La croissance des calottes glaciaires a produit une régression marine importante puisque la mer est descendue de 120 à 130 m sous son niveau actuel il y a 20.000 ans avant de remonter progressivement. Les continents étaient tous liés les uns aux autres par des ponts terrestres, mis à part l’Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée qui formaient une seule île immense, Sahul. On pouvait alors passer à pied de France en Angleterre, de Sicile en Calabre, et de Corse en Sardaigne. Le golfe du Lion n’existait pas, Majorque était rattachée à Minorque, le canal de Sicile séparait la Méditerranée en deux bassins distincts et les hommes pouvaient atteindre l’Amérique en traversant une large bande de terre émergée reliant la Sibérie à l’Alaska, qui au moment de la remontée de la mer deviendra le détroit de Béring. (Fig. 2)
A partir de 14.500 BP (Before Present, «avant le temps présent»), la fonte des glaciers a provoqué une élévation spectaculaire de la mer, épisode que les géologues désignent sous le terme de «Meltwater pulse 1A». Puis c’est un nouveau refroidissement brutal: le front polaire revient jusqu’à la latitude du nord de l’Espagne et la température des eaux en surface ne dépasse pas les 10°C. C’est ce qu’on appelle le Dryas Récent, ultime oscillation froide datée approximativement de 12.700 à 11.700 BP et précédant donc juste l’époque à laquelle Platon situe son récit.
Cette période est marquée par une chute considérable de la température moyenne dans l’hémisphère nord enregistrée dans les sédiments et les carottes glaciaires. On peut penser que de nombreuses tribus de chasseurs-cueilleurs ont alors cherché vers le sud un climat plus hospitalier, s’installant sur les plaines littorales bordant les océans, s’établissant autour de la Méditerranée sur des plateaux continentaux situés entre -55 et -60 m, niveau vers lequel la mer va se stabiliser.
Pendant plusieurs générations, quelques siècles peut-être, on peut supposer que différents clans vont se retrouver dans ces régions, s’agglomérer sur les terres les plus propices, profitant de la douceur que les températures leur offraient. Ces groupes vont s’accroître et rester au contact de ce milieu favorable, cessant alors de nomadiser. Tout en continuant à chasser et à collecter ce que la nature mettait à leur disposition, ils ne vont plus avoir besoin de migrer au gré des saisons pour subsister et vont donc commencer à s’établir, à coloniser ces nouveaux territoires.
Un réchauffement très important des températures va faire remonter la mer brusquement («Meltwater pulse 1B»), noyant les régions sur lesquelles les hommes avaient appris à se sédentariser. C’est le passage du Dryas Récent au Boréal, du Pléistocène à l’Holocène, et c’est exactement à ce moment-là que l’Atlantide va se trouver submergée. (Fig. 3)
Parallèlement à cette évolution du climat à qui elle semble intimement liée apparaît la «Révolution néolithique» que l’on associe généralement à la naissance de l’agriculture. Ce bouleversement qui va changer radicalement la vie des hommes va s’effectuer sur plusieurs milliers d’années, et sera très variable en fonction des régions concernées (le Croissant Fertile par exemple, large bande de terre cultivable du Proche-Orient, va se développer 5.000 ans avant certains pays du centre de l’Europe grâce à un climat plus favorable).
L’homme passe alors du prélèvement direct dans la nature au contrôle et à la production de ressources par la culture et l’élevage. Le mode de vie nomade, essentiellement basé sur la chasse et la cueillette, qui durait depuis des millions d’années, poussant l’homme à peupler la terre entière, porté par les changements climatiques, soumis aux aléas des cycles saisonniers et à la migration du gibier, va se transformer en un mode de vie plus raisonné.
Toutes les conditions étaient réunies pour que ce processus apparaisse dans le bassin méditerranéen. Le climat, très froid en Europe, ce qui correspondait généralement à des conditions très arides en Afrique, poussait les populations du nord et du sud vers la «mer du milieu des terres» qui est le sens littéral de «Méditerranée». Sur son littoral devait régner une certaine douceur, et plus encore sur ses îles, que le développement de la navigation rendait accessibles.
Des déplacements maritimes sont attestés en Méditerranée au XIe millénaire av. J.C. On a retrouvé dans le Péloponnèse, en Grèce, parmi des couches de terrain de la grotte Franchthi datant de cette période, de l’obsidienne provenant de l’île de Milos, à plus de 100 km en bateau. On sait aussi que Chypre a été occupée par l’homme à la même époque, avec des traversées de 70 km depuis le sud de l’Anatolie ou de 100 km depuis l’ouest de la Syrie. Mais si l’on considère que la première colonisation de l’île de Florès en Indonésie date de 800.000 ans (19 km de traversée) ou que l’Australie (plus exactement l’île-continent Sahul) a été atteinte il y a 45.000 ans par voie maritime, on peut légitimement penser que les échanges autour du bassin Méditerranéen sont beaucoup plus anciens que ce que nous en dit l’archéologie aujourd’hui.
Bien sûr, il fallut d’abord naviguer à vue, en longeant les côtes, ce qui permettait de rejoindre la terre ferme quand la mer devenait trop mauvaise. Sachant qu’un individu d’1,70 m debout au bord de l’eau peut voir l’horizon à 4,5 km mais que, dès qu’il prend de la hauteur, il voit beaucoup plus loin (posté sur une falaise de 100 m il peut voir jusqu’à 35 km), on comprend mieux comment certaines îles ont pu être colonisées par l’homme.
Ainsi, la Corse et la Sardaigne, liées l’une à l’autre de 70.000 BP à 14.000 BP (durant toute cette période la mer ne remonta pas au-delà de -80 m), pouvaient être atteintes depuis le continent: il fallait faire une traversée d’une dizaine de kilomètres depuis le bout de ce qui deviendra l’île d’Elbe (vers 10.000 BP) jusqu’à l’île de Capraia, puis de là franchir le canal de Corse (une vingtaine de kilomètres) pour rejoindre le fameux «doigt» de l’Ile de Beauté. Pour un trajet direct, «sans escale», on pouvait aller au bout de ce qui deviendra l’île Pianosa et qui était alors encore liée à la péninsule italienne, pour rejoindre les côtes corses après une trentaine de kilomètres de navigation. Ce sont ces deux passages qu’empruntèrent les hommes pendant la préhistoire pour peupler ce qui était alors la plus grande île de la Méditerranée. (Fig. 4)
Après s’être séparée de la Corse il y a 13.000 ans, la Sardaigne resta isolée au milieu de la Méditerranée occidentale. C’est cette notion de centre justement, comme le soulignait le titre de l’exposition de l’aéroport de Cagliari, l’Omphalos, le «nombril du monde», qui devait la faire jouir d’un climat exceptionnel, des meilleures terres que l’on pouvait trouver à l’époque dans cette partie du globe, d’une faune et d’une flore d’une richesse incomparables car encore peu exploitées, de nombreuses sources d’eau, chaudes et froides, de minerais et de roches de tous les types qui allaient la faire passer sans transition du Paléolithique au Néolithique, de la pierre taillée à la pierre polie, puis au Chalcolithique et à l’âge de bronze.
Il y a une particularité qui dut jouer un grand rôle au moment de l’arrivée des premières tribus de chasseurs-cueilleurs: la Sardaigne est une terre de volcans très ancienne et à ce titre elle possède une variété lithique incroyable. Alors que la Corse ne possède pas de gisements de silex, élément indispensable à un peuplement durable pendant la préhistoire, sa grande sœur en compte à profusion, à tel point qu’elle fournira l’Ile de Beauté en matières premières pendant plusieurs millénaires. Dans la région de Perfugas, par exemple, une aire d’affleurement exceptionnelle à la fois en quantité et en qualité a livré les outils taillés d’une grande partie de la Corse méridionale.
Pourtant, si le silex était une pierre taillée commune, l’obsidienne était un matériau beaucoup plus prestigieux. Et même si la Corse est située à plus de 100 kilomètres de la source la plus proche, le Monte Arci en Sardaigne, on y compte des pièces d’obsidienne par milliers, représentant plus de 75% des vestiges lithiques étudiés. Elle était rare, puisqu’on ne compte que quatre sites de provenance en Méditerranée occidentale, mais elle était beaucoup plus efficace que toutes les autres roches, et elle était très belle, cette considération esthétique n’étant peut-être pas si futile qu’on pourrait le penser au premier abord. D’un noir profond, elle reflétait parfaitement les rayons du soleil et elle pouvait servir de miroir ou de bijou.
Ainsi, le Monte Arci livra aux premiers colons de l’île une quantité énorme d’obsidienne d’excellente qualité. Ce que certains qualifient d’«or noir de la préhistoire», fournit pendant des millénaires les meilleurs outils et les meilleures armes de l’époque grâce à son tranchant incomparable (qui servira encore l’homme moderne jusqu’au XXe siècle en chirurgie). Aujourd’hui, les archéologues la considèrent comme un marqueur d’échanges très important puisque contrairement aux autres produits de l’époque, hautement périssables, elle est parvenue jusqu’à nous. On a recensé près de 250 amas de taille sur les flancs du Monte Arci et à ses pieds, dans la plaine. Mais surtout, l’obsidienne sarde a été retrouvée du latium (Rome) au sud de l’Espagne, sur tout le pourtour méditerranéen occidental, témoignant d’un réseau commercial qui devait faire transiter avec elle les peuples, les idées et les croyances.
Mais d’où pouvaient bien partir les tailleurs-colporteurs d’obsidienne, emportant sur leur barque les blocs qu’ils s’en allaient débiter toujours plus loin, en Corse (où le trafic est attesté sur une durée de près de quatre millénaires), puis dans tout le sud de la France, en Italie, en Espagne, en Tunisie...? Les barques devaient certainement descendre les rivières qui, depuis le Monte Arci, allaient se jeter presque vingt kilomètres plus bas, dans le golfe d’Oristano, à l’ouest de l’île, pour, de là, rayonner sur l’ensemble du bassin occidental de la Méditerranée. (Fig. 5)
Après avoir scruté attentivement la région d’Oristano avec les photos satellite, qui offrent de nos jours une résolution optimale, le Monte Arci à l’est, l’immense golfe entouré de ses nombreux étangs, Mistras et Cabras au nord, Corru s’Ittiri au sud, Santa Giusta presque rond au milieu, et les deux caps formant comme une porte d’accès à la pleine mer, Capo Frasca au sud et Capo San Marco au nord, m’attardant sur les détails qui semblent présenter quelque intérêt à la compréhension de cette époque reculée, je relis Platon et ses fameux dialogues.
Il y a trois interprétations possibles concernant l’histoire de l’Atlantide et elles s’opposent depuis plus de deux mille ans. La première soutient que c’est une pure fiction écrite pour soutenir le propos d’un philosophe cherchant à définir la société idéale. «L’homme qui a inventé l’Atlantide est aussi celui qui l’a fait disparaître», position défendue par Aristote, reprise au XVIe siècle (notamment par Giuseppe Bartoli, antiquaire du roi de Sardaigne) jusqu’à nos jours (Pierre Vidal-Naquet écrit: «Avec une perversité qui lui a valu un immense succès, Platon a fondé le roman historique, c’est-à-dire le roman situé dans l’espace et le temps»).
A l’inverse, on peut penser comme Crantor, successeur de Platon à la tête de l’Académie, que ce récit est «purement et simplement de l’Histoire» et rechercher dans le monde entier des traces de cette île disparue. La localisation de l’Atlantide «au-delà des Colonnes d’Hercule», que la tradition assimilait au détroit de Gibraltar, a longtemps fait penser qu’elle se trouvait dans l’océan Atlantique, dont la toponymie était le gage d’une vérité indiscutable. Mais le journaliste italien S. Frau (Le Colonne d’Ercole, un’inchiesta, Nur Neon, 2002), et d’autres avant lui, comme M. Rousseaux (Une Atlantide en Méditerranée occidentale?, Bulletin de l’Association Guillaume Budé n°3, octobre 1970, pp 337-358) ont justement replacé ces fameuses Colonnes plus à l’est. Elles auraient pu séparer en deux la Méditerranée, le bassin oriental et ses brillantes civilisations, le bassin occidental dont on ne savait presque rien. En effet, le monde antique s’est longtemps arrêté au canal de Sicile. Au-delà vivaient des puissances terribles, les Gorgones, Géryon le guerrier à trois têtes, le Titan Atlas... Au-delà se trouvait également la Sardaigne...
La troisième interprétation voit dans l’évocation de Platon un mélange de faits réels et de traits mythiques à travers deux styles de récit très différents qui se succèdent dans deux parties distinctes. La première raconte la fondation de cette civilisation par Poséidon, référence convenue à la mythologie cédant rapidement la place à une description réaliste et à une localisation précise.
Dans Critias, on peut lire que non loin de la mer, vers le milieu de la côte de la grande île Atlantide, il y avait une plaine, la plus belle et la plus fertile d’entre toutes, où s’élevait une petite colline à une distance de près de neuf kilomètres du rivage. Située au centre de cette plaine, elle mesurait à peine 900 m de diamètre et était entourée de deux anneaux de terre et de trois anneaux d’eau qui allaient en s’élargissant, parfaitement ronds. Les hommes creusèrent un canal de pratiquement neuf kilomètres de long pour permettre aux bateaux d’arriver depuis la mer jusqu’aux aux trois ports qui desservaient la colline dominant la plaine dont Platon souligne expressément qu’elle produisait avant l’heure tout ce dont le monde profite aujourd’hui («tous les parfums que la terre nourrit à présent, en quelque endroit que ce soit, qu’ils viennent de racines ou d’herbes ou de bois, ou de sucs distillés par les fleurs ou les fruits, elle les produisait et les nourrissait parfaitement»).
Par contre, au moment de la description du temple de Poséidon, situé au beau milieu de la colline, le texte bascule dans le mythe: «le temple tout entier, à l’extérieur, était revêtu d’argent, hormis les acrotères, qui l’étaient d’or; à l’intérieur, la voûte était tout entière d’ivoire émaillé d’or». L’or est partout (clôture entourant le temple, statues du dieu...), les chiffres enflent («cent Néréides sur des dauphins» alors que la tradition grecque n’en représentait que cinquante), les dimensions explosent (une plaine de 3000 stades sur 2000, soit 540 km sur 360 km, entourée d’un fossé «dû à la main de l’homme» de 30 m de profondeur, de 180 m de largeur et de 1800 km de long!).
Le gigantisme que Platon utilise alors jusqu’à la fin de son récit est destiné à servir son propos: les ancêtres des Grecs ont bien accompli un exploit en résistant à l’envahisseur atlante venu d’une île immense avec une richesse et des forces colossales. Les chiffres avancés pour les décrire vont d’ailleurs dans ce sens: 60.000 chefs, 120.000 cavaliers, 60.000 soldats à pied, 60.000 soldats montés, 120.000 hoplites, 120.000 archers, 120.000 frondeurs, 180.000 lanceurs de pierres, 180.000 lanceurs de javelot, 240.000 marins, soit 1.260.000 hommes, accompagnés de 120.000 chevaux, 10.000 chars de combat, et d’une flotte de 1.200 navires.
On pourrait penser que Platon s’arrêterait là, après avoir repris certains chiffres d’Hérodote décomptant les forces de l’armée Perse de Xerxès lors de la seconde guerre médique, dont Voltaire déclarait déjà qu’il fallait «suspendre son jugement et douter beaucoup». Mais il ajoute ironiquement pour finir, reconnaissant alors implicitement que cette partie du récit a valeur de mythe : «C’est ainsi qu’avait été réglée l’organisation militaire de la cité royale. Pour les neuf autres provinces, chacune avait son organisation particulière, dont l’explication demanderait beaucoup de temps».
Mais à quoi pouvait donc bien ressembler la cité royale? C’est, au début de l’histoire, une «colline», une montagne «qui était toute de petite taille», «d’altitude médiocre», une simple «hauteur» pour reprendre les différentes traductions qui la caractérisent. En ce sens, le début du récit de Platon est encore très éloigné du mythe, des détails insignifiants parsèment la description du berceau de la civilisation atlante. Pourquoi ne pas penser qu’ils seraient alors véridiques, directement tirés de la version la plus ancienne de la tradition orale?
Sur cette hauteur vivait une jeune fille nommée Clito dont Poséidon tomba amoureux. Pour la protéger, il abattit les pentes et «fortifia la colline où elle demeurait en en découpant le pourtour par des enceintes faites alternativement de mer et de terre, les plus grandes enveloppant les plus petites. Il en traça deux de terre et trois de mer et les arrondit en partant du milieu de l’île, dont elles étaient partout à égale distance de manière à rendre le passage infranchissable aux hommes; car on ne connaissait encore en ce temps-là ni vaisseaux ni navigation». C’est une forteresse qu’il construit ainsi, en rendant la colline inaccessible, mais c’est aussi une merveille de la nature transformée par son intervention, car les anneaux d’eau sont parfaitement ronds, «comme s’il eût fait marcher un tour de potier, de tous côtés équidistants du centre de l’île». (Fig. 6)
Cette image de cercles concentriques va devenir un «cliché» de l’Atlantide. L’histoire de cette île au milieu d’autres îles aurait pu se transmettre de bouche à oreille pendant des millénaires. Une symbolique aurait pu naître de cette tradition orale, se retrouvant gravée sur les pierres, les parois, les sols, de la Méditerranée au littoral atlantique, parcourant l’espace et le temps, de Göbekli Tepe à Minorque, de Rujm el-Hiri à Stonehenge, se développant à travers les cromlechs, au Portugal, en France, dans des exemples fameux, de la Bretagne (Carnac) à la Grande-Bretagne jusqu’au nord de l’Ecosse (Brodgar), se retrouvant enfin dans différents récits fondateurs, de la mythologie nordique (le Midgard, qui signifie littéralement «enceinte du milieu», désigne la fortification érigée autour du monde par les hommes pour se protéger des géants) jusqu’aux romans de Tolkien et la «Terre du Milieu», dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux...
Mais la structure originelle n’a jamais été retrouvée. Où étaient situés ces anneaux d’eau et de terre? Et si la Sardaigne est bien l’Atlantide, comment expliquer pourquoi l’île italienne est encore émergée alors que, d’après Platon, elle devrait être sous l’eau? (Fig. 7)
Les enfants de Clito et Poséidon, cinq couples de jumeaux mâles, vont recevoir en partage les dix parties de l’ensemble de l’île Atlantide et «l’autorité sur un grand nombre d’hommes». C’est l’importance de cette main d’oeuvre qui va permettre les premiers grands travaux de ce peuple de bâtisseurs. Les tranchées, les ponts, les toits, les murs de pierre, les portes, les tours, les palais, toutes ces innovations sont le résultat de l’union des forces de dizaines, de centaines d’hommes.
Alors que les tribus de chasseurs-cueilleurs ne comptaient que quelques individus oeuvrant pour une communauté restreinte, une famille élargie, leur agrégation et l’accroissement de leur nombre sur un territoire restreint, la petite colline entourée d’eau jouant peut-être le rôle de «piège démographique», comme plus tard la vallée du Nil, ou le Tigre et l’Euphrate en Mésopotamie, va multiplier les bras, les intelligences, les projets. Ce n’est plus le travail de subsistance de la journée qui va être en jeu, c’est la prise en compte du futur, la vision du lendemain. Ce n’est plus la satisfaction d’un besoin immédiat, c’est la conscience de la survivance de la collectivité.
L’aîné des jumeaux, Atlas, va recevoir la demeure de sa mère et la plaine qui l’entoure, «la plus belle de toutes et la plus fertile». Elle est située «vers le milieu de la côte de l’île entière» et la colline, elle, domine légèrement la plaine, «encore une fois au milieu», à une distance de la mer «d’environ cinquante stades». Pour les Egyptiens, le stade valait 157,5 mètres et pour les Grecs 177,6 mètres. Puisque tout le récit adopte un point de vue grec (par l’adaptation des noms propres par exemple, le dieu -ou la déesse– des mers devenant Poséidon), je décide de retenir cette seconde valeur qui correspond pour 50 stades à presque 9 km (8880 m pour être exact). Cette distance semble tellement ordinaire qu’on pourrait la croire réelle, sans aucune trace d’exagération ni d’intention mythique. Cette indication ferait-elle partie du récit originel transmis oralement pendant des millénaires?
Il en est de même pour les dimensions de la colline, «l’île au milieu des îles», d’un diamètre de cinq stades (presque 900 m), ridiculement petite et contrastant fortement avec la puissance qu’elle aurait générée. Par commodité et pour éviter une confusion qui survient parfois en lisant le texte de Platon, j’appellerai «Atlantis» la ville royale, la cité mère, et «Atlantide» l’ensemble de l’île.
Le premier des grands travaux des Atlantes est le creusement d’un canal de «trois plèthres de large, cent pieds de profondeur et cinquante stades de long» (90 m de large, 30 m de profondeur et presque 9 km de long, une distance que l’on retrouve à nouveau et qui a pu jouer un rôle mnémotechnique dans la transmission orale du récit).
Il serpente à travers la plaine, de la mer à l’anneau extérieur, pour permettre aux bateaux d’atteindre l’île centrale, les cercles d’eau étant reliés les uns aux autres par des ouvertures, des tranchées assez larges pour que la navigation y soit possible. Les bâtisseurs extraient les pierres du sol, montent des murs, des tours, des portes sur les ponts, ils construisent deux bassins creusés dans l’intérieur de l’île et «couverts d’un toit par le roc même», indices d’un mégalithisme qui n’a absolument rien de mythique, avant que l’auteur ne passe à la description du temple de Poséidon et à un changement radical de registre.
Mais peut-on voir encore aujourd’hui des traces de ces grands travaux? Et où pourrait-on localiser ces anneaux concentriques et ce grand canal de près de 9 km qui permit de relier Atlantis à la mer?
Tout en me posant ces questions, je regarde les photos satellite de la région d’Oristano et, en consultant des images d’archives, je tombe sur une vue incroyable montrant clairement des canaux autour de l’étang de Santa Giusta. C’est un cliché qui date d’un mois et une semaine avant la naissance de ma fille le 24/5/2004, et ce qui est étonnant, c’est que les photos actuelles, prises sans doute par grand vent, ne laissent pas imaginer une seule seconde qu’il y a sous l’eau opaque de l’étang de Santa Giusta des canaux, clairement creusés par la main de l’homme. (Fig. 8)
En les observant attentivement, on remarque que c’est un circuit semi-fermé, dont le but n’était donc pas l’irrigation des champs. L’étang lui-même est immense, une petite rivière s’y jette et y apporte de l’eau douce. D’après ce que j’ai pu en lire, il semblerait que le fleuve Tirso, le plus important de l’île, l’alimentait avant d’être dévié pour se jeter directement dans la mer du golfe d’Oristano. Mais ce qui m’impressionne, c’est la forme magnifique, ovoïde, et surtout les dimensions des canaux: le canal central fait 110 à 120 m de large et 2400 m de long, le périphérique est moins large (60 à 70 m) mais sa longueur prise à l’intérieur du tracé et sans tenir compte du canal central me laisse sans voix: il fait 9 km!
Quelle pouvait donc être la fonction de Santa Giusta et à quelle époque ces canaux ont-ils été creusés? Le fait que l’étang soit entièrement recouvert d’eau (sa profondeur varie de 40 cm à 2 m) tendrait à prouver que les travaux ne datent pas d’hier. Si personne n’en parle, c’est certainement que le souvenir s’en est perdu, mais depuis quand? Si je reste dans l’expectative concernant la chronologie, je suis sûr d’une chose en regardant attentivement ces canaux: lorsque l’eau n’avait pas envahi la partie centrale de Santa Giusta, c’était un port!
Et tout en réfléchissant à l’étang de Santa Giusta, je descends un peu vers le sud du golfe d’Oristano et j’arrive à la lagune de Corru s’Ittiri. Là, je passe en revue les images d’archives et, comme précédemment, il y en a une qui me frappe plus particulièrement, assez récente puisqu’elle date du 14/04/2013. La vue est magnifique. On y voit vers l’est des champs parfaitement alignés, orientés sur les axes cardinaux et s’étendant sur plus de 70 km2. Mais surtout, là aussi, des canaux: trois lignes qui, partant du sud-ouest, se rejoignent au nord-est, donnant une impression de construction planifiée. Le canal le plus à l’est fait à peu près 3 km de longueur, ce qui multiplié par 3 donne à nouveau une mesure de 9 km, comme à Santa Giusta. Est-ce un hasard? (Fig. 9)
A l’oeil nu, la largeur des canaux semble s’accentuer en direction de la mer à l’ouest et effectivement les mesures viennent confirmer cette impression: 35 à 40 m à l’est, une cinquantaine de mètres au centre et une moyenne de 70 m pour le canal le plus à l’ouest. Je me rappelle alors que les trois anneaux d’eau d’Atlantis s’agrandissaient régulièrement en direction de la mer. Serait-il possible que les canaux de Corru s’Ittiri y fassent référence?





























