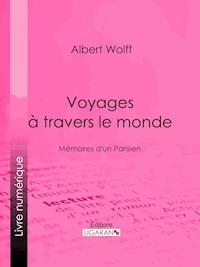
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Partis de Paris, à la poursuite d'un voleur, nous arrivions dix heures après à Charing-Cross. M. Pietri, préfet de police sous l'Empire, avait annoncé notre visite à sir Richard Mayne, le chef de la police anglaise qui devait mettre ses plus fins limiers à notre disposition. Quelle ne fut pas ma surprise en apercevant le petit hôtel du préfet de police, qui ne ressemble en rien à la préfecture de Paris !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Partis de Paris, à la poursuite d’un voleur, nous arrivions dix heures après à Charing-Cross.
M. Pietri, préfet de police sous l’Empire, avait annoncé notre visite à sir Richard Mayne, le chef de la police anglaise qui devait mettre ses plus fins limiers à notre disposition. Quelle ne fut pas ma surprise en apercevant le petit hôtel du préfet de police, qui ne ressemble en rien à la préfecture de Paris ! Aucun corps de garde, pas un factionnaire ni un policeman armé. On dirait le bureau d’un huissier ou d’un notaire.
Nous fîmes passer nos lettres de recommandation à sir Richard Mayne, qui nous reçut sur-le-champ.
Il nous accueillit, non en fonctionnaire important qui songerait à la petite danseuse, tandis que le visiteur lui expose le motif de sa visite, mais en homme du monde ; sir Richard Mayne était seul dans son cabinet ; aucun homme d’armes ne veillait à la porte du temple. Après avoir écouté avec beaucoup d’attention l’exposé des motifs qui nous avait fait entreprendre le voyage de Londres, sir Richard hocha la tête, et dit :
– Que voulez-vous que je fasse, Messieurs ? Votre individu est un affreux gredin, mais je n’ai même pas le droit de le déranger sans un ordre des magistrats.
Et comme il lut notre extrême surprise dans nos yeux, sir Richard Mayne ajouta :
– Je sais ce que vous pensez… que la loi anglaise est pitoyable… Mais que voulez-vous, Messieurs ? c’est une loi, et je dois plus que tous les autres citoyens la respecter, même dans ses erreurs. Allez trouver le sollicitor, dont voici l’adresse. Il se rendra avec vous chez le président du tribunal, à qui je vous recommande. Le magistrat avisera… Ce qu’il fera sera bien fait… Je ne suis que le bras de la justice ; mais ce bras est à vous, croyez-le bien.
Je vous laisse à deviner si nous fûmes stupéfaits en entendant ce petit discours de l’un des premiers fonctionnaires de Londres. Son raisonnement si simple, si logique, n’admettait pas de réplique.
Sir Richard Mayne sonna son secrétaire, qui devait nous accompagner, et il nous congédia, en nous priant de venir lui rendre compte de nos démarches.
Nous voici donc chez le sollicitor. C’est un avoué anglais, très anglais. On lui expose l’affaire : il consulte le traité d’extradition, toute une collection de lois, puis :
– Nous ne pouvons rien contre votre voleur, dit-il. Nous avons à Londres dix ou quinze mille filous étrangers qui mangent en toute sécurité le fruit de leurs vols. S’ils escroquaient seulement un penny à un citoyen du royaume, on les coffrerait. Mais ils ont volé à l’étranger ; aucun Anglais n’a à se plaindre d’eux… que voulez-vous que la loi anglaise fasse en pareil cas ? Votre homme n’est ni faussaire ni assassin, et le traité d’extradition ne porte que sur les criminels de ces deux catégories. C’est égal ! allons toujours trouver le juge.
Nous remontons en cab et nous nous rendons au tribunal. Le juge est seul, sans conseiller ; il ne porte ni robe ni uniforme. Mais je remarque non sans une nouvelle stupéfaction avec quelle extrême politesse il parle aux témoins. Il les appelle « Messieurs », les interroge avec beaucoup de bienveillance et les prie de se défendre sans crainte. Il s’agit d’une rixe entre matelots. Les coupables sont à la barre ; ils balbutient quelques mots d’excuse. Pierre accuse Paul et Paul dit que Pierre a commencé. Le président de police correctionnelle écoute les prévenus avec une grande attention, puis il leur dit d’un ton tout paternel :
– Mes enfants, je pourrais vous envoyer en prison, mais, en ne vous condamnant qu’à une légère amende, j’espère vous donner une leçon suffisante, dont vous profiterez. Allez, mes enfants, et ne recommencez plus !
Le sollicitor s’avance vers le président et lui expose l’affaire.
– La loi d’extradition n’ayant pas prévu le vol, nous ne pouvons rien contre le voleur, dit le juge.
– Je vous l’avais bien dit, semble ajouter le sollicitor.
Nous remontons en voiture pour retourner auprès de sir Richard Mayne.
– Mais quelle est donc cette singulière loi qui protège le voleur ? demandons-nous au sollicitor.
– Que voulez-vous ? nous répondit-il, il faut respecter la liberté anglaise.
Il y avait bien des choses à répondre à cet axiome, mais nous arrivions à la préfecture de police. Le sollicitor nous abandonne, et nous remontons au premier étage, où est situé le cabinet du préfet.
– Eh bien ? nous demande sir Richard Mayne.
– Il n’y a rien à faire.
– Je vous le disais bien.
C’est alors que mon compagnon, qui était le volé, et qui avait bien payé le droit de maudire la loi anglaise, demande au préfet de police :
– Mais si je rencontrais mon voleur dans la rue… S’il me riait au nez… Si je lui cassais ma canne sur la figure…
– C’est vous qui iriez en prison pour un délit commis en Angleterre, répond en souriant sir Mayne, et moi, préfet, je n’aurais pas le droit de vous faire mettre en liberté ! La loi est plus forte que moi !
Je profitai de la tournure gaie que venait de prendre la conversation pour dire au préfet :
– Monsieur, vous savez que je suis écrivain, sachez encore que, depuis mon départ de Paris, j’ai l’idée de vous demander un service.
– Lequel ?
– J’ai, Monsieur, le désir de visiter la nuit les quartiers les plus mal famés de Londres, de m’arrêter dans les cabarets borgnes, de voir les mendiants de Whitechapel et les voleurs de Spittelfield…
– Je ne vous le conseille pas, me dit en souriant le préfet de police.
– Cependant, hasardai-je, si vous vouliez bien me faire accompagner par deux ou trois agents…
Sir Richard Mayne réfléchit pendant quelques instants, puis :
– Écoutez, Monsieur, me dit-il du ton le plus aimable, je n’ai jamais accordé à personne ce que vous me demandez. Mais je comprends tout l’intérêt que doit offrir à un écrivain étranger ce tableau sombre de Londres. Vous le verrez demain soir. Où demeurez-vous ?
– À Alexandra-Hôtel, Hyde-Park.
Sir Richard Mayne inscrivit mon adresse sur un registre et me dit en me tendant la main :
– Demain soir, à neuf heures, un homme viendra vous prendre à l’hôtel. Vous pouvez sans crainte le suivre partout où il vous conduira. C’est mon agent le plus sûr, le plus fin et le plus intelligent. Il vous fera les honneurs de Londres.
Il était neuf heures du soir quand nous montions en voiture avec l’officier de police. Le temps était atroce. Il faisait un froid abominable, et un brouillard épais s’était abattu sur la ville. Le vent sifflait avec véhémence, et de temps en temps une bordée de grêle faisait tressaillir les glaces de notre cab. La mise en scène ne laissait rien à désirer, comme vous voyez.
Notre voiture, partie d’Hyde-Park, roulait le long de Piccadilly, cette chaussée aristocratique où toute maison abrite un millionnaire. Nous passons devant Regent-street, la rue aux brillants magasins, nous laissons à droite le bruyant Hay-Market, où la basse prostitution envahit les trottoirs et se propage dans les estaminets. Voici Leicester square et l’Alhambra, illuminé de mille becs de gaz. Nous traversons Trafalgar-Square, la grande place, gigantesque monument du mauvais goût anglais.
Nous passons devant Charing-Cross, nous longeons le Strand, la rue la plus bruyante de Londres. Voici l’Adelphi-Théâtre, où Fechter l’Armand Duval de la Dame aux camélias joue le drame en anglais. Nous traversons Temple Bar, puis toute la City. Nous laissons à gauche l’église Saint-Paul et nous passons devant la Banque, cet arc de triomphe des Anglais. Notre fiacre marche toujours vers la destination que l’agent a indiquée au cocher.
Après avoir traversé le West-End, où la froide folie des viveurs se débat, ainsi que la City silencieuse et déserte, car tous les bureaux de ce quartier commerçant sont fermés depuis longtemps, nous errons dans un district de la ville calme et tranquille, comme une cité de petits rentiers. Puis, tout à coup, au détour d’une rue, le tableau change comme dans une féerie. Nous retombons dans le bruit, le mouvement et l’agitation d’une population ouvrière qui envahit toutes les rues, toutes les boutiques des bouchers, des boulangers et des épiciers pour faire les provisions du lendemain, vendredi saint : holy day.
Malgré la grêle, le vent et le froid, mille marchands ambulants stationnent le long du trottoir et mille tuyaux de gaz, rampant le long des baraques, se faufilent à travers les charrettes et étalages et projettent une clarté éblouissante sur le tableau fantastique. On court, on marche, on crie, on marchande ; hommes, femmes et enfants encombrent les trottoirs ; les uns portent un pain, les autres des choux, les plus misérables une poignée de pommes de terre, car demain toutes les boutiques seront fermées et l’on pourra mourir de faim pour le salut de son âme. On voit passer des êtres étranges, couverts de haillons, des fantômes qui jettent un regard éteint sur l’étalage des boulangers, des ivrognes portés par la foule, des filles que leur fol amant entraîne au comptoir des marchands d’eau-de-vie.
Le cocher crie et jure dans cette foule qui l’empêche d’avancer ; enfin le fiacre tourne à droite, entre dans une rue tranquille et s’arrête devant une maison noire comme toutes les maisons de Londres.
Nous sommes au bureau de police de Whitechapel.
Nous descendons de voiture ; nous pénétrons dans une étroite allée où nous heurtons en passant quelques mendiants. Nous voici dans une cour. Quel spectacle ! Assis sur les marches qui conduisent au bureau, adossés contre le mur, couchés sur les dalles humides et froides, une centaine de misérables, hommes, femmes, enfants et vieillards forment un vaste camp de la misère. Des nez colorés par le froid se détachent sur des visages blêmes décomposés par la faim. Parmi ces pauvres gens, le mendiant classique de Londres, avec son habit en haillons et son chapeau crasseux, est représenté par plus d’un exemplaire ; c’est navrant de voir ces enfants sans souliers et presque sans vêtements, ces vieillards écrasés par l’âge et les privations.
Toutes ces femmes et ces hommes ont faim, ont froid et ne savent où passer la nuit.
Le souvenir brillant du West-End, avec ses palais et ses millionnaires, se dresse devant vos yeux pour faire pendant à cette étude sombre de la misère humaine qui déchire le cœur et remplit l’âme d’une immense mélancolie. Je ne sais au monde de spectacle plus attristant que la vue d’un enfant qui grelotte dans la pluie et vous demande un morceau de pain. On ignore quelles causes inconnues ont pu conduire ces hommes et ces femmes dans cette lugubre cour de la police ; c’est peut-être la conséquence logique de leurs fautes ; mais ces enfants, innocents de leur misère, ces pauvres petits maudits, qu’ont-ils pu faire pour tomber si bas ! Rien ? Quelle faute ont-ils pu commettre pour être si misérables ? Aucune.
Leurs parents étaient pauvres… ils le sont à leur tour… C’est l’hérédité de la misère.
Nous portons instinctivement nos mains à nos porte-monnaie.
– Pas ici ! nous dit l’agent de police. Nous ne pouvons recueillir que les individus absolument dépourvus de moyens d’existence. Si vous leur donniez un shilling, nous serions forcés de les renvoyer. D’ailleurs vous aurez plus d’une fois, cette nuit, l’occasion de vous débarrasser de votre argent.
– Et jusqu’à quelle heure tous ces pauvres gens resteront-ils dans cette cour ?
– Jusqu’à dix heures. Passé ce délai, nous ne recevons plus personne ; quant aux pauvres qui se sont présentés avant cette heure, nous leur délivrons un bon qui leur assure un morceau de pain et un lit. Vous les voyez ici. Dans une heure vous les verrez là-bas dans des dortoirs bien chauffés, étendus sur des matelas, enveloppés dans de bonnes couvertures. La police paye au logeur six sous de votre monnaie par tête, et elle surveille ces asiles dont l’extrême propreté ne sera pas votre moindre étonnement.
– Mais, c’est très bien ! m’écriai-je.
– Avec notre système, répondit l’agent de police, le vagabondage n’a plus d’excuses. Dans d’autres pays, l’homme trouvé la nuit sur la voie publique est taxé de vagabond, quels que soient ses malheurs et les efforts qu’il ait pu faire pour vivre honnêtement. Nous aussi, nous arrêtons sans pitié les vagabonds, mais du moins nous avons le droit de dire aux misérables de Londres : « Si nous vous ramassons sur la voie publique, c’est que vous n’avez pas voulu accepter l’hospitalité que nous offrons aux pauvres. Donc, vous n’avez pas d’excuses, et le magistrat qui vous jugera demain ne flottera pas, comme ailleurs, entre la loi qui le forcera de vous condamner et son cœur qui voudrait vous acquitter. » Nous autres, Anglais, continua l’agent, nous appliquons la loi dans toute sa rigueur, mais aussi nous nous efforçons de soustraire à ses sévérités tous les misérables. Arrêter un vagabond, c’est bientôt fait ; mais mieux vaut encore lui offrir un gîte pour la nuit et un morceau de pain pour la faim. Tenez, Monsieur, vous voyez une centaine d’individus dans cette cour ; dans un quart d’heure ils seront deux cents ; vous en trouverez autant dans tous les bureaux de police de Londres. Que deviendraient-ils sans nous ? Ceux qui ne mourraient pas de faim ou de froid sur la voie publique seraient arrêtés par les policemen et peupleraient demain nos prisons déjà suffisamment garnies. Grâce à nous, ils vont dans un instant manger et dormir. Nous aimons mieux les nourrir et les chauffer une nuit que les arrêter et les nourrir ensuite un mois en prison. En distribuant volontairement aux pauvres le pain que nous sommes forcés de leur donner en prison, nous combattons le vagabondage par les moyens les plus humains, et nous permettons aux misérables d’espérer en le lendemain. La besogne est plus agréable et plus facile.
Cet agent parlait d’or, et je compris en un instant pourquoi la police est en Angleterre plus respectée et surtout plus estimée que partout ailleurs.
Il était alors dix heures moins un quart.
– Le dernier délai approche, me dit l’officier de police. Voyez venir les retardataires !
En effet, de l’étroite allée qui conduit à la cour, débouchait une nouvelle collection de pauvres. D’aucuns, exténués de fatigue et de faim, se traînaient péniblement et tombèrent tout d’une pièce sur les dalles froides. Des enfants qui avaient ramassé quelques restes sur la voie publique les rongeaient, et leurs petites dents grinçaient sur l’os que le hasard avait jeté sur leur passage. Un pauvre en redingote fit semblant de boutonner son vêtement qui n’avait pas un seul bouton ; je vis un jeune malheureux qui portait des gants autrefois blancs. On a souvent dépeint l’accoutrement fantastique des pauvres de Londres, mais aucune description, aucun tableau ne peut vous donner une idée de la réalité. Il faut les avoir vus dans la cour du bureau de police, transformée en une sorte de Cour des miracles, pour comprendre comment on peut se faire un habillement complet avec un vieux sac et un bout de ficelle.
Nous entrons dans le bureau où les policemen, nous voyant arriver avec l’un de leurs chefs, s’écartent respectueusement sur notre passage. Tout au bout de ce nouveau couloir nous apercevons une série de petits cachots. L’officier de police fait signe à un policeman d’ouvrir les portes. Le couloir est éclairé au gaz, mais, afin de mieux nous faire voir l’intérieur des cellules, le policeman arrive avec une lanterne sourde.
Il ouvre le premier cachot. Trois ivrognes se roulent dans leurs déjections ; le parquet forme un plan incliné, d’où le liquide coule dans un égout. Ivres morts, ces gens ne nous voient pas venir : ils ne nous entendent pas. La porte se referme sur eux, le verrou crie… ils dorment du sommeil du juste.
On ouvre une seconde cellule.
Là, sont assis sur un banc étroit cinq ou six filous de toute espèce. Parmi eux, un pickpocket vêtu à la dernière mode, rasé de frais, avec des bottines vernies, et qui proteste de son innocence.
– Vous vous expliquerez demain matin avec le magistrat, lui répond l’officier.
Et la porte se referme.
On ouvre une troisième cellule. La lumière de la lanterne frappe en plein visage un petit être chétif, malingre, hideux ; c’est un homme de cinquante ans à peu près ; son crâne est chauve, quelques rares poils gris garnissent ses joues. Le vent qui souffle dehors jetterait cet homme à terre tant il paraît faible et malade.
– Quel délit a-t-il pu commettre ? dis-je à l’agent.
– Oh ! presque rien, me répondit-il, c’est l’auteur présumé d’un double assassinat. On l’a arrêté il y a une heure chez une fille…
On ferme la porte et nous retournons dans la cour.
Dix heures sonnent. Les pauvres accroupis à terre se relèvent… un policeman apparaît, il leur distribue des petits morceaux de fer-blanc. Ce sont des billets de faveur qui leur ouvrent les salles à manger et les dortoirs des asiles. À mesure qu’ils reçoivent leur ticket, ils s’éloignent vivement et sans bruit et sans escorte. C’est qu’ils savent le chemin.
– Plus tard, nous reverrons tous ces malheureux, me dit mon guide. En attendant, je vais vous montrer un tableau plus gai. Voulez-vous faire un tour dans les petits théâtres et les petits cafés-concerts ?
– Volontiers. Le spectacle que je viens de voir m’a écœuré. Je ne serais pas fâché de rire un peu.
– Eh bien ! en voiture !
L’officier de police ouvre la portière et nous remontons en cab. Après avoir dit quelques mots au cocher, notre guide nous rejoint. Mais, au moment où le fiacre part, je vois une sorte d’hercule armé d’une canne plombée qui grimpe sur le siège à côté du cocher.
– Voyez donc, dis-je à l’officier de police, voilà un homme qui monte sur le siège.
– Ne faites pas attention, dit mon guide, c’est un de mes amis à qui j’avais donné rendez-vous au bureau de police de Whitechapel.
Après avoir quitté le bureau de police, nous étions remontés en voiture. L’hercule qui avait grimpé sur le siège n’était autre que l’inspecteur de Whitechapel, une sorte d’officier de paix anglais. Il était en bourgeois comme son chef à qui il témoignait beaucoup de respect, conformément à la hiérarchie de l’administration.
– Votre ami restera-t-il toute la nuit, avec nous ? demandai-je à mon guide.
– Oui, me répondit-il, il connaît mieux que moi tous les mystères des quartiers que nous visiterons…
– Et, hasardai-je, c’est un gaillard solide de la race des Porthos.
– Quel Porthos ? fit l’agent ; est-il de la police de Paris.
– Oui, dis-je, pour éviter une conférence sur la littérature française ; oui c’est Porthos qui a arrêté Lacenaire.
Après quelques minutes, le fiacre s’arrêta. L’hercule vint ouvrir la portière. Nous descendîmes, et, tandis que la voiture stationnait au coin, nous nous engageâmes dans les rues étroites de ce quartier d’ouvriers et de mendiants.
– Veuillez me suivre, dit l’hercule.
Nous descendons dans une cave. Devant un buffet couvert de sandwichs douteux, de saucissons qui avaient eu des malheurs, d’œufs durs et de bouteilles contenant différentes liqueurs, stationnent quelques individus qui absorbent plusieurs grands verres de brandy ; derrière le buffet un homme en manches de chemise… c’est le gargotier directeur.
Le théâtre est au fond. Pour y arriver, il faut d’abord traverser un couloir humide ; on tourne à droite. Voici la salle de spectacle. C’est le maître de l’établissement qui nous fait les honneurs de son théâtre. En nous voyant arriver avec l’inspecteur, il a quitté son comptoir et nous conduit dans la salle. À l’entrée du couloir se tient une marchande d’oranges qui est en même temps buraliste. Le prix d’entrée est de deux pence… quatre sous. Je fais mine de prendre des billets, mais le directeur m’arrête et me dit que nous sommes ses hôtes.
Un peu plus, il me donnait mes entrées à vie.
La salle est éclairée au gaz… c’est-à-dire du plafond descend une lampe à deux bras qui a dû autrefois fonctionner au-dessus d’un billard. Des planches remplacent les fauteuils d’orchestre. Sur ces planches d’orchestre, où les dames sont admises, la foule avide d’émotions se compose de jeunes ouvriers, de vauriens, de filous et de petites filles de treize ou quatorze ans dont les traits sont déjà flétris par le vice. Les premières banquettes seules sont garnies. La semaine sainte fait du tort au théâtre. Sur les autres bancs s’étalent dans toute leur longueur des ivrognes qui, pour quatre sous, viennent dormir deux ou trois heures. L’un de ces messieurs a glissé de son lit et est tombé sur la terre humide, où il continue ses doux rêves.
Notre hercule s’approche de lui, l’enlève d’une seule main comme un pot de fleurs, et le recouche sur son banc. Une harpiste ambulante figure à la place de l’orchestre, et arrache des accords étranges aux trois ou quatre cordes qui lui restent de son immense prospérité d’autrefois. Le public exhale une odeur de gin et de tabac qui vous donne des nausées ; mais il faut rester pour voir les spectateurs qui n’ont pas d’yeux pour le jeune premier qui vient d’entrer en scène et nous contemplent à leur aise. Quelques pâles voyous se montrent l’hercule… Décidément, cet homme jouit dans le quartier de quelque célébrité.
– Retrouvez-vous quelques figures de connaissance parmi ces gens-là ? lui demandai-je.
– Parbleu ! répond l’hercule, il y a là une douzaine de gredins qui ne sont pas à leur aise depuis notre entrée.
– Auriez-vous l’intention de les arrêter ?
– Je m’en garderai bien, dit l’hercule, les uns ont fait leur temps… les autres ne sont pas encore mûrs pour la prison… c’est une question de temps… voilà tout.
Le maître de la maison nous avait quittés un instant. Il revient et dit quelques mots à mon agent qui paraît être visiblement embarrassé ; le directeur semble lui demander quelque chose qu’il refuse avec obstination. Une explication directe entre le directeur et son ami nous apprend tout. Voulant nous faire les honneurs de la maison, le directeur a préparé de sa propre main quatre verres de grog qu’il nous prie d’accepter au comptoir.
Une politesse en vaut une autre ! Allons trinquer avec ce brave homme. D’ailleurs, je n’étais pas fâché de goûter le brandy du peuple. À la première gorgée, un cri de douleur nous échappe. C’est du vitriol et de l’eau chaude.
L’officier de police boit son verre en donnant des signes d’une visible satisfaction. Nous déposons les nôtres sur le comptoir en remerciant notre amphitryon.
L’hercule, qui ne laisse rien traîner, absorbe nos deux verres de brandy, qui, ajoutés au sien, font trois. Ce gros homme est décidément le tonneau d’Heidelberg de l’eau-de-vie.
Nous visitons successivement une douzaine de théâtres borgnes.
À la Comédie-Française de l’endroit on paye huit sous une loge d’avant-scène. Partout les directeurs nous reçoivent avec le même empressement ; l’un d’eux nous offre de nous conduire dans les coulisses, où nous adressons quelques compliments à l’actrice qui joue lady Macbeth ; car on joue du Shakespeare comme à l’Odéon, à cette différence près, toutefois, que le grand poète national n’est qu’un auteur de lever de rideau… la great attraction de la soirée est le ballet final.
Versons un pleur sur la décadence de la littérature sérieuse en Angleterre et partons.
Nous remontons en cab… nous traversons Whitechapel… le fiacre s’engage dans des rues étroites et peu éclairées.
– Où allons-nous ? dis-je à l’officier de police.
– Nous allons retrouver nos pauvres à l’asile.
Je manifestai quelque répugnance à visiter ce bouge. Dans une relation, publiée d’abord par un journal anglais, puis reproduite dans les feuilles françaises, il y a deux ans à peu près, ces réduits des misérables avaient été dépeints sous des couleurs si sombres que je n’osais y pénétrer. On avait écrit que ces pauvres, rongés par la vermine, gisaient à terre et qu’on emportait d’une visite de cinq minutes, une collection d’animaux choisis… une ménagerie complète !
– Vous verrez, se contenta de répondre l’agent.
La voiture s’arrête devant une petite maison… Nous y entrons. Dans le vestibule, derrière un comptoir, se tient une fort jolie Anglaise qui reçoit les tickets des pauvres. Les femmes entrent à droite, les hommes à gauche.
– Combien ? lui demande l’officier de police.
– Cent vingt-trois hommes, cent trente-quatre femmes.
Nous prenons la gauche, et nous sommes dans une salle de bains ; quatre hommes se débattent dans les quatre baignoires, et se lavent avec du savon que leur fournit l’administration ; les derniers qui ont quitté ce bain, où l’eau se renouvelle sans cesse, sont à côté dans une grande pièce où ils sèchent leur peau tout autour d’un immense four. Dans ce four sont enfermés les haillons de tous les locataires, et, tandis qu’ils se reposent, la chaleur et la vapeur détruisent la vermine de leurs vêtements.
Quoi ! le massacre des innocents !
Le misérable, après avoir pris son bain, se couvre d’une chemise qu’il lui faut rendre le lendemain. On lui donne un énorme morceau de pain, un verre d’eau, et il prend son numéro d’ordre dans le dortoir.
Nous les suivons. Le dortoir est une longue galerie : deux lits de camp occupent toute la longueur ; des planches, hautes de quinze centimètres environ, séparent le lit de camp en autant de couchettes. Un matelas, une couverture, un oreiller, voilà pour le luxe. Les premiers arrivés dorment déjà, et les bottes ferrées de l’hercule qui résonnent sur les dalles ne troublent pas le repos de ces malheureux. D’autres, assis sur leur lit, dévorent le pain qu’on vient de leur délivrer.
On a quelque peine à croire que ce sont là les mêmes individus que nous avons rencontrés tout à l’heure dans la cour de la police, tant leurs figures sont transformées par le savonnage et le souper. Tout dans cet asile est d’une propreté parfaite : les dalles du parquet sont luisantes, les murs sont blancs. Assurément, je ne conseillerais pas à M. de Rothschild de descendre dans un de ces asiles à son prochain voyage à Londres. Mais un pauvre qui, une heure auparavant, se mourait de faim et de froid, doit se croire au Grand-Hôtel quand la police lui a ouvert les portes de la maison hospitalière.
À six heures du matin, tous les locataires doivent être debout. Ils rendent leurs chemises, reprennent leurs vêtements épurés, mangent une bonne soupe et s’en vont sans qu’à leur départ pas plus qu’à leur arrivée on leur demande tous les détails sur leur état civil que l’on exige dans d’autres pays. À Paris, par exemple, où l’administration est bourrée de bonne volonté, les choses se passent tout autrement. Ainsi, j’ai l’honneur de connaître le Directeur de l’assistance publique à Paris ; c’est un excellent homme, toujours prêt à soulager l’infortune qu’on signale à son attention ; mais que de formalités à remplir avant que le secours arrive au pauvre ! Les employés marchent, trottent, se démènent, prennent des renseignements, tandis que le pauvre attend dans son grabat le secours qui arrivera infailliblement, mais un peu tard.
En Angleterre, on procède tout autrement. Un pauvre a faim, ou commence par lui donner un morceau de pain ; il a froid, on le chauffe ; il est sale, on le lave, et en un tour de main on fait un homme d’un être étrange qui ressemblait à une bête.
– Et si ces misérables ne trouvent pas d’ouvrage demain, si ces mendiants n’encaissent pas un penny, peuvent-ils revenir demain soir ? demandai-je à mon guide.
– Tant qu’ils voudront, me répondit-il. Les trois premiers jours ils ont leurs entrées de faveur ; mais, pour éviter que les paresseux viennent prendre la place des honnêtes gens, nous forçons nos locataires à payer leur loyer à partir du quatrième jour.
– Qu’exigez-vous d’eux, en échange de votre hospitalité écossaise ?
– Du travail dans la mesure de leurs forces.
Les derniers misérables s’étaient glissés sous leurs couvertures… Il fallait les laisser dormir.
– Puis-je leur offrir quelques shillings ? demanda mon compagnon de voyage.
– Non, fit l’agent, c’est rigoureusement défendu.
Après avoir répondu ainsi selon la consigne, le brave officier de police se détourna pour laisser à mon ami le temps de jeter quelque monnaie sur les lits.
L’hercule est déjà à la porte. Nous le suivons. Le fiacre repart au grand trot. L’allure de ce cheval donnerait le vertige à un cocher de la Compagnie des fiacres parisiens. Nous traversons une foule de rues, nous longeons quelques docks et nous arrivons dans le quartier des matelots où chaque maison est une taverne… Dans toute taverne on danse.
Nous entrons au premier bal, et, en passant devant le comptoir du marchand d’eau-de-vie, nous apercevons une pancarte qui vaut tout une étude de mœurs :
AVIS AU PUBLIC
Les personnes qui ont des couteaux sont priées de les laisser au comptoir.
Le quartier des matelots n’a plus le grand mouvement que nous dépeignent les récits des romanciers anglais : la vapeur a enlevé aux tavernes des docks une partie de leur animation. Les navires arrivent, débarquent les marchandises et en embarquent d’autres ; le tout se fait à la vapeur, en un tour de main et si bien que les marins ont à peine le temps de s’amuser un brin et d’échanger quelques coups de couteau avec leurs camarades. D’ailleurs, le plaisir n’est pas concentré comme à Paris ; là-bas, il n’y a pas une de ces immenses salles où un grand nombre de matelots pourraient se réunir à la fois. Ils se dispersent dans les petites tavernes au nombre de cinquante ou soixante, tenues par des hommes de tous pays, où l’on parle toutes les langues et où l’on se grise avec les boissons nationales des quatre coins du globe.
Ainsi le tavernier qui prie messieurs ses clients de laisser les couteaux au comptoir est de Francfort, le pays des saucissons et des banquiers. Il était venu à Londres lors de la première Exposition universelle, avait commencé par servir les Allemands au Cristal-Palace d’Hyde-Park, et finalement avait créé près des docks une taverne à l’enseigne de la Marine de la confédération du Nord.
À mesure qu’on approche du quartier des matelots, l’oreille est charmée par les accords des nombreux orchestres qui entraînent les viveurs de la marine à la danse.
De loin, on peut croire qu’on se rend à la foire de Saint-Cloud, à l’heure où les saltimbanques font la parade.
Les violons, cornets à pistons, tambourins, flageolets et grosses caisses entonnent pêle-mêle des airs nationaux de tous les pays. On danse au rez-de-chaussée, au premier, dans des hangars, dans des caves. Devant tous les comptoirs des innombrables marchands de vin et de bière, une foule pittoresque s’attroupe ; le brandy circule et le grog de l’amour unit deux cœurs faits pour se comprendre. Des femelles de la dernière catégorie trébuchent de comptoir en comptoir, et, l’œil allumé par l’ivresse, les toilettes détériorées par les luttes, se jettent des bras d’un Portugais dans ceux d’un Américain, prennent un petit verre par-ci, un grog par-là, plus loin du porter ou de l’ale jusqu’au moment où quelque matelot en ribote les demande en mariage pour quelques heures. Dehors, les couples trébuchent sur le trottoir, et c’est vraiment un tableau charmant, que de voir monsieur se rouler dans le ruisseau, où madame va le rejoindre quand, dans un effort désespéré pour ramasser son amant, elle a, à son tour, perdu l’équilibre.
Les femmes entre trois âges qui se grisent au comptoir n’inspirent que du dégoût ; mais à la vue de jeunes filles, disons plutôt de tant d’enfants de douze, treize ou quatorze ans, que la prostitution a jetées dans la circulation, on éprouve je ne sais quelle pitié, mêlée d’un fort dédain de ce respect de la liberté individuelle qui tolère jusqu’aux orgies de l’enfance.
Pêle-mêle, toute cette foule prise de gin se heurte, trinque, s’embrasse et se disperse dans les salles de bal, où deux ou trois musiciens ambulants arrachent des sons plaintifs à leurs instruments invalides.
Des deux côtés de la salle est une longue file de tables ; tout autour, des matelots, des vieilles femmes ivres, des jeunes filles, des danseuses de corde et autres acrobates que le maître de la maison a engagés pour une soirée, et qui, entre deux gigues, donnent des représentations sur le théâtre qui est là-bas au fond. Quand je dis théâtre, vous lirez : tréteaux ; car ces petites scènes n’ont que tout juste la place pour permettre à un père de jongler avec la vie de son enfant, ou à une danseuse ambulante d’exécuter un pas fantaisiste avec accompagnement de cornet à piston.
Le porter et le brandy, renversés par les amoureux dans les fureurs d’un épanchement intime, fusionnent sur le parquet et forment un petit ruisseau fort gentil qui donne une certaine gaieté au tableau.
L’agent de police a laissé l’hercule dans la rue, car sa personne redoutée arrêterait l’élan de cette populace qu’on veut nous montrer dans toute sa splendeur.
De tous les renseignements que je recueille sur l’hercule, il résulte à l’évidence qu’il est la terreur de ce quartier. Ainsi, la semaine dernière, une querelle a surgi dans une maison mal famée où des matelots italiens et espagnols se sont rencontrés. Une bataille s’est engagée… les couteaux sortent de toutes les poches… les dames se précipitent dans la rue et appellent : Au secours ! Deux ou trois policemen arrivent sur le champ du carnage… on n’en fait qu’une bouchée !… Mais voici l’hercule en tournée dans ces parages, qui arrive au pas de course… il fend la foule, s’élance dans la mêlée, fait le vide autour de lui avec sa canne plombée, sépare les combattants et recueille treize blessés.
On voit que l’agent de police avait choisi un gaillard solide pour notre escorte. D’ailleurs, qu’on se rassure, aucun danger ne nous menaçait. Nous nous attablons avec la populace, qui répète en chœur le refrain d’une chanson vulgaire qu’une artiste vient chanter sur la scène, et quelques verres de brandy, offerts par nous aux chefs du parti voyou, nous attirent sur-le-champ de nombreuses sympathies. Les dames veulent bien accepter six pence ou un verre de brandy, et la danseuse en maillot, qui a précédé la chanteuse sur la scène, vient nous offrir des cigares ; car cette pauvre fille cumule les deux professions, de première danseuse et de marchande de tabac. Au reste, les artistes ne sont pas fiers ici ; après chaque exercice, de nombreuses monnaies de cuivre tombent sur la scène, et le premier sujet interrompt son speech pour ramasser l’aumône ; quand il a fait sa caisse, il reprend son rôle…
Le cornet à piston prélude à la danse ; les clowns, chanteurs et pitres ambulants se mêlent au public panaché. La première danseuse, avec son maillot couleur de charbon, fait vis-à-vis à un matelot ; le clown enlace la taille svelte d’une petite fille de treize ans au plus, qui a depuis longtemps oublié de se défendre, et l’entraîne à la danse. Le cornet à piston entonne une gigue que le reste de l’orchestre, se composant d’une seule contrebasse, accompagne de ses lourds grognements.
De temps en temps quelques filles ivres, attirées par la musique, sautent parmi les danseurs et gigotent au hasard dans les groupes. L’une de ces rosières, qui a perdu la moitié de son corsage dans une bagarre et porte une rose artificielle dans ses cheveux défrisés, gêne un matelot dans ses mouvements gracieux ; le butor la renvoie d’un coup de poing, et la malheureuse tombe sur une table, où elle se console en vidant d’un trait un verre de brandy dont le propriétaire est occupé ailleurs.
Assurément, le tableau que nous avons sous les yeux, et qui se répète dans toutes les tavernes d’alentour, est plein de charmes et de fantaisies, mais il arrive un moment où la meilleure société se quitte.
Dans la rue, nous retrouvons l’hercule. L’officier de police échange quelques paroles avec lui ; Porthos rejoint le cocher et lui dit de nous attendre ailleurs. Puis nous continuons notre promenade à pied à travers toutes les hontes accumulées pour les besoins de la marine internationale. Le vent ne nous apporte plus que de faibles échos des bals. Nous nous hasardons dans un quartier affreux, à peine éclairé par quelques rares becs de gaz. Les rues deviennent de plus en plus étroites, et nous nous engageons dans une boue profonde. Au détour d’une rue nous rencontrons deux policemen en tournée. L’officier de police se fait connaître et ordonne à ses inférieurs de nous précéder avec leurs petites lanternes pour éclairer la route ; les policemans vont devant nous et l’hercule ferme la marche. De loin en loin une fenêtre des masures à un étage s’ouvre, et quelque étrange figure nous contemple d’un air hébété.
Nous avons l’air de marcher à la recherche d’une bande de faux-monnayeurs.
Le vent souffle avec plus de véhémence. Quelques volets invalides, agités par l’ouragan, grincent et vont heurter le mur. Les rues sont désertes, les lumières éteintes dans toutes les chambres et il est une heure du matin. On pourrait se croire dans un cimetière et prendre les petites maisons pour des tombeaux de famille. Le quartier est habité par des pauvres, des ouvriers et des misérables qui payent deux schellings de loyer par semaine pour une maison entière.
Nous nous arrêtons enfin devant l’un de ces taudis ; l’officier de police pousse la porte, qui est entrebâillée.
– Qui va là ? s’écrie le locataire.
– Ne crains rien, Jack, c’est moi ! répond l’hercule.
Et il ouvre la porte donnant sur un étroit vestibule. Une odeur étrange, nauséabonde, s’échappe de la chambre, et nous reculons vivement.
– Entrez toujours ! dit l’agent. C’est l’odeur de l’opium.
À la lueur vacillante du feu qui brûle dans la cheminée, j’aperçois celui que l’hercule a appelé Jack. C’est un Chinois qui tient un petit taudis où l’on peut s’enivrer d’opium. La chambre où nous pénétrons est si basse de plafond, que nous ne pouvons pas nous tenir debout. Sur un matelas, étendu par terre, gisent pêle-mêle des Chinois, des Lascars de l’Inde et des voyous anglais qui savourent l’opium. Les uns, étendus sur le dos, s’abandonnent aux hallucinations de l’ivresse ; les autres commencent seulement la petite fête et allument leurs pipes à une sorte de veilleuse placée à côté de chaque fumeur.
Jack, le maître de la maison, baragouine un peu l’anglais. Il nous demande si nous voulons fumer de l’opium et nous indique sur une table, entre quelques pommes de terre et deux ou trois morceaux de charbon, des pipes qui ont déjà passé par mille bouches gracieuses et qu’il serait heureux de nous offrir. L’officier de police explique à ce tavernier du diable que nous sommes venus en simples curieux. Puis :
– N’y a-t-il personne là-haut ? demanda-t-il ?
– Si, il y a une femme.
– Où, là-haut ? dis-je en regardant autour de moi, il n’y a pas d’escalier.
Jack cherche dans la cour une petite échelle, l’adosse contre le mur où sont suspendus des haillons, des peaux de chats et des peaux de rats, monte trois échelons, découvre un trou dans le plafond, et dit :
– Par ici !
– Nous ne tiendrons pas tous là-haut, me dit l’agent ; suivez le Chinois. Je vous attends ici.
À notre tour nous grimpons et nous nous faufilons à travers l’ouverture. Une vieille femme, les cheveux gris épars, l’œil éteint dans un visage amaigri, éclairée par la seule lampe des fumeurs d’opium, lâche un nuage de fumée, se redresse sur son matelas, tousse comme une phtisique de première classe, jette sur nous un regard hébété, se recouche, reprend sa pipe et continue de fumer de l’opium.
La pièce où elle se trouve est un petit grenier encombré par mille objets de ménage de l’excellent Jack : mais, en dehors du matelas sur lequel gît la vieille sorcière, pas un meuble… L’atmosphère est tellement empestée par l’opium, que, sur le point de suffoquer, je casse avec ma canne le seul carreau d’une fenêtre par où un chat aurait eu de la peine à pénétrer.
L’air frais inonde la chambre… la sorcière se soulève et lâche une bordée d’injures dans une langue incompréhensible. Un shilling, jeté sur cette couche immonde, radoucit la vieille ; ses yeux s’ouvrent tout grands, dans un effort surhumain ; elle prend l’argent dans sa main osseuse et le contemple avec bonheur. Un nouvel accès de toux plus formidable que le premier ébranle la poitrine de cette phtisique et déchire le reste de ses poumons, tandis que nous nous en retournons par le petit trou et l’échelle. Au rez-de-chaussée nous retrouvons nos guides, qui vont nous faire l’honneur de nous présenter aux voleurs de Londres.
Dans toutes les grandes villes, les pauvres sont refoulés par la marche triomphale de la civilisation dans les quartiers éloignés du bruit et du mouvement et que les rôdeurs de nuit, voleurs et autres mauvais drôles recherchent, parce qu’ils s’y croient à l’abri de la justice. C’est la plus triste des servitudes de la pauvreté que d’être constamment exposée au voisinage du crime. En appréciant cette cause première de bien des démoralisations, on ne peut s’empêcher d’admirer les honnêtes gens, nés misérables, qui depuis leur naissance ont vécu dans un contact immédiat avec les malfaiteurs et des filles, et ont néanmoins conservé quelques bons instincts dont on ne leur sait d’ailleurs pas le moindre gré.
Il en est de même à Londres. Le quartier de Spittelfield n’héberge pas seulement des filous de toute espèce, mais encore toute une population de pauvres tisserands et de braves ouvriers qu’un trop maigre salaire et une trop nombreuse famille rejettent dans les coins reculés de cette immense cité. Je n’étais pas fâché d’apprendre tout cela de la bouche de l’agent de police, tandis que notre cab roulait de nouveau à travers la nuit. Le lecteur sera assurément fort désappointé quand en quelques lignes je lui aurai dépeint le quartier : j’ai été fort surpris moi-même en arrivant à Spittelfield. Au lieu d’un décor de mélodrame, avec des maisons pittoresques se découpant sur un ciel étoilé, je vis, à ma grande stupéfaction, une petite ville de cabarets et d’hôtels garnis dont la mise en scène extérieure n’a rien qui puisse surprendre le voyageur.
Rien, dans cette monotone architecture n’est de nature à inspirer un décorateur. Ce sont les mêmes petites maisons en briques, noircies par la fumée du charbon que l’on revoit partout à Londres, où, sauf quelques chaussées aristocratiques, toutes les rues se ressemblent, et où toutes les maisons semblent avoir été bâties par le même architecte. Seuls les nombreux policemen qui circulent avec leurs petites lanternes, nous disent que les hommes de sir Richard Mayne ont ici plus de besogne qu’ailleurs. On ne sera plus surpris que les filous de Londres se donnent ainsi rendez-vous dans un quartier bien connu de la police, où ils sont presque sûrs d’être pincés par elle, quand on voudra bien se rappeler que, malgré les nombreuses arrestations que la police de sûreté opère dans les carrières d’Amérique à Paris, messieurs les vagabonds n’ont pas encore compris chez nous les inconvénients du four à plâtre.
– Il faut à tous ces gens-là un centre de réunion, me disait l’officier de police. C’est ici qu’ils ont leurs relations et leurs amis. Spittelfield est une sorte de bourse du méfait où les voleurs se trouvent, s’associent pour une seule entreprise ou pour une série d’exploits, où ils échangent leurs confidences. Les ouvriers qui logent à la nuit moyennant quatre sous dans ces tavernes, ne fraternisent pas avec les malfaiteurs. Ici, chaque lodging-house, toute maison garnie de bas étage a sa clientèle déterminée. Il est bien rare de voir un voleur se faufiler dans les greniers où couchent les ouvriers sans ouvrage. Qu’y ferait-il ? Il n’y a rien à voler dans ces taudis, et l’ouvrier, sachant qu’il vit au milieu de voleurs, est méfiant et ne se lie pas facilement avec les inconnus.
Nous entrons dans certains hôtels garnis où les tisserands passent la nuit. À l’estaminet du rez-de-chaussée, quelques retardataires seuls sont encore assis devant la grande cheminée où flamboie le charbon de terre. Les autres dorment déjà au grenier que nous visitons. Moyennant deux pence, payables d’avance, on leur permet de s’étendre sur les vastes lits de camp qui rappellent les dortoirs des asiles. À l’hôtel du Louvre de l’endroit, on paye trois pence ; on ne repose plus sur un lit de camp, mais chaque locataire a droit à un lit dans le grenier, qui, aux deux extrémités, est éclairé par un bec de gaz.
À mesure que nous avançons dans ce quartier maudit, nous rencontrons de ces figures, que l’on n’aime pas à contempler dans un bois entre deux et trois heures du matin.
Des filous, qui ont manqué leur journée, se traînent dans les rues étroites, où ils guettent un ami qui leur offrirait l’hospitalité dans une taverne quelconque. Les filles ivres, chassées du quartier des matelots, où la petite fête se termine avant deux heures, arrivent par groupes, et trébuchent à chaque obstacle dans le ruisseau.
La police voit tout, ne dit rien, laisse faire, jusqu’au moment où quelque attroupement trop considérable se forme et menace de troubler le doux repos des milliers d’individus entassés dans tous les greniers.
Alors, comme par enchantement, surgissent quelques policemen qui s’étaient cachés on ne sait où. Ils rejettent toute cette populace ambulante dans les maisons aux lanternes rouges qui portent cette inscription : Good Beds.
Nous avions déjà visité cinq ou six de ces tavernes, quand notre guide nous désigne un de ces taudis et nous dit :
– Entrez seuls, ma présence générait ces messieurs et ces dames. Je vous préviens que dans cette taverne il n’est pas un honnête homme.
Et comme nous hésitons, il ajoute cette phrase, qui lui avait déjà échappé à notre départ de l’hôtel :
– You are in our hands !
– Yes ! dit l’hercule en fendant l’air avec sa canne plombée.
Oui, nous étions dans les mains de la police : mais qu’entendait l’agent par ces mots ? Se fiait-il à nos propres forces pour nous tirer au besoin d’un mauvais pas ? Avait-il envoyé des agents en bourgeois dans ces tavernes de voleurs ? À vous franchement parler, je l’ai cru et je le crois encore, quoique l’officier de police ne m’ait fait aucun aveu à ce sujet.
Nous entrons cependant.
La porte donnant sur la rue est toute grande ouverte. Dans l’allée, on se trouve devant une autre porte battante que l’on pousse.
À gauche, dans une sorte de loge de concierge, une adorable petite fille de dix ans remplace à la caisse sa mère malade, qui dort là-bas au fond, tandis que l’enfant délivre des tickets à messieurs les voleurs. L’enfant, qui s’était endormie, se réveille au bruit de nos pas, et frotte ses grands yeux bleus ; nous lui jetons quatre pence, en échange desquels elle nous délivre les tickets en fer-blanc… bon pour un lit.
Quelques pas plus loin, une troisième porte… nous l’ouvrons.
Quel tableau fantastique ! Là dans une salle longue, étroite, basse de plafond, nous voyons, noyé dans la fumée du tabac et du charbon, tout un camp de mauvais drôles.
Les uns ont fait une bonne journée et le gin coule à flots sur les tables qu’ils occupent ; d’autres, couchés devant l’immense cheminée qui occupe toute la largeur de la salle au fond, sont accroupis à terre et sèchent leurs vêtements tout en prenant du thé, dans lequel ils trempent du pain de seigle. Un filou qui a dérobé un jambon, le partage avec un confrère qui a volé un pain chez le boulanger. Des filles hideuses, plus repoussantes encore que les vieilles ivrognes du quartier des matelots, circulent dans les groupes ou se sont endormies sur un banc. On voit des hommes sans chemise, avec des souliers percés en dix endroits, et qui portent un paletot tout neuf qu’ils ont volé dans la journée ; un autre, couvert de haillons, a un chapeau gris à la dernière mode ; celui-ci a des bottines vernies très élégantes, mais son pantalon retroussé fait voir qu’il n’a pas de chaussettes.
Sur les épaules d’une vieille fille, dont la robe, couverte de boue, est déchirée en vingt endroits, un fol amant a jeté un manteau de velours, qu’il a conquis dans quelque escapade. Je vois des groupes où l’on discute avec passion ; d’autres où l’on échange des confidences à voix basse. Une odeur de charbon et de grog se mêle agréablement aux nuages de vapeur qui s’échappent de tous ces haillons trempés par la pluie et qui sèchent devant l’âtre.
Cependant nous avançons, non sans un serrement de cœur, je l’avoue, et nous nous glissons derrière une des tables, contre le mur.
Aussitôt quelques filles et deux ou trois voyous nous entourent et nous regardent d’un air surpris. En nous entendant parler français, tous ces gens-là ont l’air de se dire :
– Voilà deux petits camarades étrangers.
Une de ces filles se lève vivement, va réveiller un misérable qui dort devant la cheminée et nous l’amène.
– Ces messieurs sont Français ? nous demande le nouveau venu.
– Oui, et vous aussi ?
– Parfaitement, dit-il en s’attablant. Ah ! qu’il est bon de rencontrer des compatriotes ! Vous allez me donner des nouvelles de mon cher Paris !
– Volontiers ! Acceptez-vous un verre de bière ?
– Avec plaisir, fit le voleur français.
Le tavernier arrive avec l’ale demandé, qu’il se garde cependant de poser sur la table ; mais il étend vers moi sa main calleuse et me regarde en clignant des yeux comme un homme qui semble me dire :
– La monnaie d’abord !
Nous lui jetons un shilling. Il lâche la bière et nous voici attablés avec les voleurs. Le Français nous demande des nouvelles des nouveaux boulevards, qu’il ne connaît que par les journaux. Nous lui donnons tous les renseignements désirés sur les efforts du baron Haussmann et de ses démolisseurs.
– Ô mon cher Paris ! s’écrie le filou de temps en temps, mon cher Paris !
Puis il se tourne vers ses amis et leur explique en anglais le sujet de notre conversation : après quoi il me tape amicalement sur l’épaule en me disant en français :
– Que je suis donc heureux de vous avoir rencontré !
Je voyais venir le moment où il allait ajouter :
– Qu’il est doux de retrouver un ancien camarade de pension !
Tout à coup il se fait un mouvement au fond de la salle. Quel évènement extraordinaire agite cette foule ? C’est que l’agent a été vu à la porte… la nouvelle vient de se propager que la police n’est pas loin… elle parvient jusqu’à notre table. Le Parisien, comme mû par un ressort, se lève et me dit :
– Dis donc ! est-ce que tu serais un mouchard ?
– French policemen ! s’écrient les Anglais.
C’est alors… je l’avoue franchement, c’est alors que j’eus peur un instant, et j’armai dans ma poche le revolver, que d’ailleurs ma main n’avait pas quitté un instant… Il y eut deux ou trois secondes d’une angoisse terrible ; mais voici la porte d’entrée qui s’ouvre. J’aperçois les traits chéris de l’agent et de l’hercule.
Sauvé ! sauvé ! merci, mon Dieu !
Rien ne me serait plus facile que de finir cette petite série de croquis par un roman à grande sensation. Je n’aurais qu’à raconter au lecteur comment les choses ne se passèrent pas, après l’entrée de l’agent et l’hercule ; il me suffirait d’inventer quelque scène de mélodrame, de vous raconter une lutte entre la police et les voleurs qui finirait par l’arrestation d’une bande de malfaiteurs. Dans cette histoire, mon revolver pourrait jouer le premier rôle, et la canne à épée de mon ami pourrait tenir l’emploi de jeune première, mais je ne me laisserai pas égarer sur le terrain de la haute fantaisie par le désir d’émouvoir le lecteur autrement que par la vérité pure.
Elle suffit d’ailleurs.
L’entrée de l’agent et de son camarade fut un coup de théâtre.
Au cri : « La police ! » les dormeurs se réveillent, les ivrognes se dégrisent, et moi, je respire.
Mais, cette sensation joyeuse fait aussitôt place à un désir sauvage, féroce.
Il y a des moments où les instincts de la bête féroce se montrent chez l’homme le plus doux et le moins aventureux. Ainsi, votre très humble serviteur est ordinairement tout juste assez sanguinaire pour épargner la vie du lièvre qui, à la chasse, s’égare à la portée de son fusil ; mais les surexcitations de la soirée, les sensations diverses que j’avais éprouvées, venaient de bouleverser mon système nerveux, et cet état anormal faisait naître en moi des espérances cruelles.
Les choses ne devaient pas prendre une tournure tragique, et je m’en réjouis aujourd’hui. À l’entrée de l’agent, une clameur immense s’était élevée autour de nous. Lui, l’officier de police, calme comme un général au début d’une bataille, intrépide comme le dompteur Batty, pénètre dans cette cage et s’avance résolument vers tous ces misérables, qui reculent, en grognant, devant cet adversaire redouté.
Seule, une vieille femme s’élance d’un bond sur l’agent, le saisit par le revers de sa redingote, et lui dit, d’un ton où la colère se mêle à la menace :
– Ah çà ! quand me rendrez-vous mon mari ?
L’officier de police la repousse doucement, et lui répond en souriant :
– Eh ! la mère, vous êtes donc encore amoureuse, à votre âge !
À ce lazzi, un immense éclat de rire part de toutes les gorges. L’officier s’avance toujours, tandis que l’hercule reste immobile près de la porte pour pouvoir, au besoin, opérer sa jonction avec les policemen de la rue, et que nous suivons l’agent dans les groupes. Décidément, cet homme jouit d’une certaine réputation dans le quartier, car devant lui les plus récalcitrants se découvrent respectueusement. Lui, qui n’a plus d’émotions, distingue dans le groupe une vieille connaissance, va droit à ce malfaiteur et lui dit :
– Eh bien ! mon garçon, quand es-tu sorti de prison ?
– Hier.
– Eh bien ! tâche de ne pas te faire repincer ! reprend l’agent.
– Ah ! quant à cela, je vous le promets, dit l’autre.
La vieille femme qui a réclamé son mari essaye bien encore de maudire la police, mais elle est accueillie par des huées de la foule idiote et abrutie qui se range du côté du plus fort ; elle pense assurément qu’au dehors une légion de policemen n’attend qu’un signal pour se précipiter dans la taverne. Le maître du logis, qui s’était sans doute endormi dans la cave, est attiré par le bruit ; il fend la foule d’un bras robuste et parvient jusqu’à nous.
– Eh bien ? demande-t-il à l’agent d’un air inquiet.
Celui-ci lui glisse quelques mots dans l’oreille… la figure du tavernier s’illumine d’un rayon de bonheur ; il nous regarde avec étonnement, puis vient à moi et me dit tout bas :
– Pardonnez-moi, Sir, de ne pas vous avoir délivré la bière sans argent… Je ne savais pas.
L’agent ne lui laisse pas le temps de finir.
– Montons ! dit-il.
Il va droit à une petite porte du fond qu’il ouvre et fait voir un escalier tortueux. L’hercule, s’avance, se poste devant cette porte, faisant face à l’estimable assemblée qu’il surveille, et, précédés du tavernier qui porte une lampe, nous montons dix ou douze marches et nous arrivons dans les dortoirs.
Un bon tiers du lit de camp est déjà occupé par des drôles qui dorment.
– Debout, mes gars ! s’écrie l’agent avec la voix de Bertram évoquant les nonnes trépassées…
Aussitôt les couvertures se remuent de toutes parts. Des hommes étranges, hideux, sinistres, se dressent sur les matelas, se frottent les yeux et nous regardent d’un air hébété. Au fond de la salle j’aperçois quelques femmes à peine vêtues qui restent dans l’ombre.
Elles ont deviné la présence de la police.
Nous passons alors la grande revue non de minuit, mais de quatre heures du matin ; nous parcourons le grenier d’un bout à l’autre ; de temps en temps, l’agent s’entretient un instant avec ces repris de justice qui, dominés par la peur, balbutient à peine quelques paroles ; un seul, qui connaît la loi comme un sollicitor, s’écrie :
– C’est abominable de réveiller les gens paisibles pour rien !
– Voyons, lui répond l’agent, nous nous fâchons donc avec les amis ?
– Fichez-moi la paix ! riposte le drôle, j’ai fait mon temps, et je me moque de vous !
Il se glisse sous la couverture et nous tourne le dos en signe de mépris.
À mesure que nous avançons vers le fond du grenier, les silhouettes de femmes s’évanouissent. Ces misérables sont allées rejoindre leurs hommes dans les cabinets particuliers. Au bout du grenier se trouve une autre pièce que de minces cloisons en bois, autrefois blanc, séparent en loges comme les restaurants anglais. Dans chaque box des lits plus larges pour les heureux couples qui se retrouvent au foyer conjugal après le labeur du jour.
Notre écœurement est à son comble.
– Allons-nous-en ! dis-je à l’agent.
Le tavernier nous précède avec la lampe, et l’agent forme l’arrière-garde. Nous descendons l’escalier, au bas duquel l’hercule est toujours fidèle au poste ; les malfaiteurs du rez-de-chaussée semblent tout surpris de nous voir revenir sans prisonniers. Nous traversons la longue salle, et ce n’est que lorsque nous sommes près de la porte de sortie, que l’hercule quitte son poste d’observation et vient nous rejoindre. Nous repassons devant la loge du concierge où l’on prend les tickets. La petite fille, vaincue par la fatigue, s’est endormie sur la caisse.





























