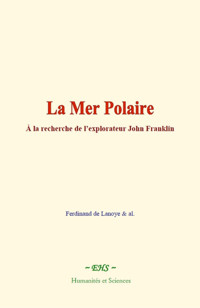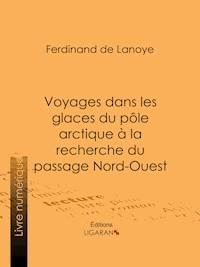
Voyages dans les glaces du pôle arctique à la recherche du passage Nord-Ouest E-Book
Ferdinand de Lanoye
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "A peine Colomb eut-il révélé à l'Europe l'existence de l'Amérique, que le désir de trouver au nord de ces nouvelles terres une route directe vers les roches contrées des épices, où les Portugais venaient d'aborder par la voie d'Orient, poussa les navigateurs jusqu'à une très haute latitude le long des côtes de l'Amérique septentrionale."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Coup d’œil sur les voyages au nord-ouest de l’Amérique antérieurs au XIXe siècle. – Fin mystérieuse des frères Cortéreal, de Jean de Munck, d’Hudson. – Voyages de Baffin, de Behring, de Hearne, de Mackensie.
À peine Colomb eut-il révélé à l’Europe l’existence de l’Amérique, que le désir de trouver au nord de ces nouvelles terres une route directe vers les riches contrées des épices, où les Portugais venaient d’aborder par la voie de l’Orient, poussa les navigateurs jusqu’à une très haute latitude le long des côtes de l’Amérique septentrionale. De 1494 à 1497, les frères Cabot explorèrent les rivages que les États-Unis possèdent aujourd’hui sur l’Atlantique. En 1500, le Portugais Cortéreal découvrit Terre-Neuve et le golfe où débouche le Saint-Laurent ; puis, ayant suivi les côtes du Labrador jusqu’au point où elles s’infléchissent vers l’ouest pour former les contours méridionaux du détroit et de la mer qui reçurent plus tard le nom d’Hudson, il crut avoir découvert le passage tant désiré et revint en Portugal publier sa découverte.
Il repartit peu après pour la vérifier, mais on attendit en vain son retour.
Après plusieurs années, un de ses frères, étant allé à sa recherche, disparut à son tour, sans laisser de traces, dans les parages désolés du nord, et il fallut un ordre formel du roi qui régnait alors en Portugal pour empêcher un troisième et dernier Cortéreal d’aller partager la fin mystérieuse de ses aînés.
Ainsi s’ouvrit pour les seules régions du nord-ouest de l’Amérique une liste spéciale de martyrs de la science, à laquelle, depuis lors, chaque génération a apporté son contingent, et où la nôtre ne peut se résoudre encore, après sept ans d’attente, à inscrire le nom de sir John Franklin.
Cortéreal avait donné à son passage supposé le nom d’Anian. Pendant que les Espagnols en cherchaient le débouché occidental au nord de leurs possessions du Mexique, et que des aventuriers comme Urdanietta, Jean de Fuca, de Fonte et Maldonado, publiaient leurs prétendues navigations à travers des golfes, des lacs et des détroits imaginaires qui n’ont disparu des cartes du Canada et de l’Orégon que devant les pas des voyageurs modernes, des marins dignes de ce titre s’efforçaient de trouver sur les eaux glacées, sur les côtes inhospitalières du nord de l’Atlantique, la route indiquée par leur devancier portugais.
Sans parler du Florentin Verazzano, qui, dès 1524, visita, par ordre de François Ier, les rivages découverts par les frères Cabot, et y trouva la mort de la main des Peaux-Rouges, la géographie dut successivement : au Malouin Jacques Cartier, l’exploration exacte du Saint-Laurent, qu’il remonta par trois fois jusqu’aux lacs dont il est l’estuaire ; à l’Anglais Forbisher, une nouvelle notion du Groenland méridional, colonisé six cents ans auparavant par les Scandinaves d’Islande, et oublié de l’Europe depuis le terrible passage de la peste noire, au XIVe siècle ; enfin, à Davis, une reconnaissance plus suivie de ces mêmes régions et du large canal qui sépare leurs côtes occidentales de l’archipel de Cumberland.
Dans les premières années du XVIIe siècle, Hudson, ayant été envoyé par l’Angleterre à la recherche du même passage, et s’étant d’abord dirigé droit au nord, se heurta le premier à l’immuable barrière de glaces qui défend les approches du pôle et qui, appuyée d’un côté sur la Nouvelle-Zemble et les extrémités septentrionales de l’Asie, s’infléchit, après avoir longé le Spitzberg, jusque sur les caps méridionaux du Groenland, dont elle interdit l’atterrage. L’intrépide marin lança en vain ses navires dans les interstices de la terrible banquise ; il n’y put pénétrer au-delà du 82e parallèle, limite que, depuis lui, l’on n’a guère dépassée. Repoussé de ce côté, il se rabattit vers le sud-ouest, contourna le Groenland, et retrouva, en cinglant vers l’occident, le détroit et le golfe immense où Cortéreal avait cru voir une route ouverte vers l’océan Pacifique. Après avoir suivi et relevé leurs rivages sinueux et sans issues, Hudson, comme le navigateur portugais, n’y trouva que son tombeau ; mais au moins il obtint à ce prix l’honneur de leur imposer son nom. Plus malheureux que lui, le Danois Jean Munck, qui, à peu près dans le même temps, explorait les mêmes parages, n’échappa aux tempêtes, aux récifs et aux glaces de la baie d’Hudson, aux horreurs d’un hivernage sur des côtes inhabitées, ne survécut à tout son équipage, emporté par la faim, le froid et le scorbut, que pour venir, la raison égarée par tant d’épreuves, périr par le suicide dans le port de Copenhague.
À ces explorations succédèrent celles de James et de Fox, qui essayèrent de se frayer un chemin entre les amas de sable et les rochers cimentés de glace qui forment ce que les cartes nomment les archipels de Cumberland et de Southampton ; mais les périls de ces tentatives, vaines quant au but proposé, mais le résultat du grand voyage de Baffin, qui, ayant fait le tour de la baie qui garde son nom, prit pour de simples baies les trois larges canaux qui en unissent les eaux à celles du bassin polaire, réduisirent la navigation de ces parages à ce qu’elle est restée jusqu’à nos jours, c’est-à-dire aux communications que, chaque été, la compagnie anglaise de pelleterie et le gouvernement danois entretiennent, celui-ci avec les pâles embryons de colonies que des souvenirs historiques l’ont entraîné à implanter sur les côtes occidentales du Groenland, celle-là avec ses factoreries échelonnées le long des fondrières de la baie d’Hudson.
Dès lors les regards et les espérances de tous ceux qui prenaient intérêt à la découverte d’un passage au nord-ouest de l’Amérique se retournèrent vers les rivages de ce continent qui font face aux extrémités orientales de l’Asie, et qu’en ce moment même d’aventureux Cosaques, s’abandonnant à la dérive des glaçons et des courants, venaient de contourner heureusement.
Mais, après que le commodore Behring, habile marin danois au service de la Russie, eut délimité exactement la position et les rives du détroit qui sépare les deux hémisphères, honneur que lui aussi paya de sa vie, ainsi que le savant Français Delisle de La Croyère, qui l’accompagnait ; après que les plus illustres navigateurs de l’Angleterre, de l’Espagne et de la France, des hommes tels que Cook, Malaspina, Quadra, Vancouver et Lapeyrouse eurent relevé avec soin toute la ligne des côtes nord-ouest de l’Amérique, sondé toutes leurs baies, fouillé toutes leurs anfractuosités, lorsque, enfin, Hearne et Mackensie, partant, le premier, de la baie d’Hudson, le second, du Canada, eurent abouti aux bords de l’océan Glacial, bien au-delà du cercle polaire, sans avoir traversé le moindre bras de mer, il devint évident que le passage, objet de tant de recherches et de désirs, ne pouvait exister que sous une latitude qui, dans les conditions physiques actuelles du globe, en interdisait l’usage permanent à la marine marchande. Dès lors aussi, dans la solution tant poursuivie de ce problème, on ne vit plus qu’un de ces desiderata dont la science ne se préoccupe qu’à ses heures de loisir, et sur lesquels elle appelle sans impatience l’examen ou l’analyse.
Le dernier nom que le XVIIIe siècle, près de finir, nous montre lié à cette recherche géographique est un nom français, qu’une haute célébrité attendait dans une autre carrière. Chateaubriand, après avoir parcouru les États-Unis en touriste rêveur et aventureux, se dirigeait vers les régions arctiques, lorsque les retentissements lointains de la Révolution française le rappelèrent en Europe.
Les terres arctiques du nouveau monde. – Circonscription. – Géologie. – Trois natures de sol. – Les landes stériles. – La région boisée. – La Provence du nord-ouest. – Faune arctique. – L’homme. – Les Esquimaux. – Les Indiens ou Peaux-Rouges. – Chant de mort. – Les nabuchodonosors Indiens. – Légendes sanglantes. – Scènes de famine. – La théorie de Volney justifiée. – Cannibalisme. – Pensée d’Arago. – Phénomène d’amour paternel. – Le missionnaire.
L’Amérique septentrionale, n’étalant qu’une faible masse de terres sous la zone tropicale et n’étant garantie, par la direction de ses principales chaînes de montagnes, d’aucun des souffles du pôle, abandonne, toute proportion gardée, plus de surface que l’ancien continent aux phénomènes du ciel, de la terre et des eaux qui constituent le climat arctique. Tandis que dans notre Europe ce climat reste renfermé dans l’intérieur du cercle polaire, il descend en Amérique jusqu’à la faible ligne de faîte qui sépare des cours d’eau qui fluent vers la mer d’Hudson les trois bassins du Saint-Laurent, des cinq grands lacs et du Mississippi. Cette ligne, partant du cap le plus oriental du Labrador, ondule entre le 52e et le 49e degrés de latitude jusqu’aux sources du Saschatchewan dans les Montagnes Rocheuses, d’où elle s’infléchit vers l’océan Pacifique en contournant par le nord le bassin de la Colombia.
Ainsi circonscrites du côté du sud, les terres arctiques de l’Amérique, en y comprenant les archipels du nord et du nord-est, ne doivent pas mesurer moins de 560 000 lieues carrées. Elles dépassent donc de beaucoup en superficie la masse de toutes les terres européennes, mais ne renferment certes pas autant de milliers d’hommes que l’Europe en nourrit de millions. Trois natures de sol que nous allons décrire ; trois races d’hommes : les Esquimaux, les Indiens et les Européens ; trois dominations politiques : le Danemark, la Russie et l’Angleterre, se partagent cet espace immense.
Une ligne tirée de l’embouchure du Churchill dans la mer d’Hudson, au mont Saint-Élie sur l’océan Pacifique, et passant par les rives méridionales des vastes nappes d’eau douce qui portent les noms de l’Esclave et du grand Ours, laisse entre elle et le bassin polaire une large zone que les Canadiens ont appelée, à bon droit, landes stériles. Au nord, elle se perd sous les glaces éternelles avec les dernières terres de l’archipel de Parry. À l’ouest et au sud-ouest, la conformité du sol et du climat lui rattache le Groenland tout entier et la plus grande partie du Labrador.
Dans ces vastes contrées, la croûte primitive du globe conserve encore le caractère chaotique qu’elle prit au moment où elle se solidifia. À l’exception du fond des ravines et des concavités, où la fonte de chaque hiver entraîne de longues plaques de mousse et les détritus des saules nains, végétation embryonnaire des terres polaires, nulle part la lente action des siècles n’a oxydé cette rude écorce au point de revêtir d’une couche d’humus son abrupte nudité. Là, nul terrain de transition ne s’étend entre le granit primordial et les roches éruptives.
Là de longues chaînes de trachyte, de gigantesques chaussées de basalte, étalent encore leurs strates aussi régulières, leurs arêtes aussi vives, leurs déchirures aussi profondes que le lendemain du jour où elles jaillirent de leurs faillesde soulèvement. Sur un grand nombre de points, comme au fond de la baie Repulse et dans l’intérieur de l’île Melville, des squelettes entiers de baleines, émergés du fond de l’Océan avec la couche sous-marine où la mort les avait déposés, n’ont encore reçu des âges écoulés depuis leur mise au jour d’autre linceul que la neige de chaque hiver, qui, en se fondant au soleil de chaque été, découvre annuellement leurs ossements blanchis, preuves irrécusables d’une grande loi géologique.
Un autre problème du même ordre scientifique a encore trouvé sa solution dans l’étude du bassin polaire : souvent les hautes falaises de roches vives qui dominent les plages, minées par les courants, par la pression des glaces accumulées à leurs pieds, ou désagrégées par l’action du froid, s’écroulent en masses énormes sur la surface congelée de la mer ; puis, quand après des mois, après des années parfois, vient le moment de la débâcle, ces débris, portés sur les glaçons flottants à des centaines de lieues de leurs roches-mères et disséminés sur les couches d’alluvions qui s’élaborent au fond de l’Océan, donnent à l’observateur l’explication de la formation et du transport des blocs erratiques dispersés par myriades sur la surface des continents actuels.
Au sud des landes stériles et à l’orient des Montagnes Rocheuses, s’étend la région moyenne ou boisée des terres arctiques. Elle comprend les vastes bassins du haut Mackensie, du Churchill, du Nelson et du Severn. La baie d’Hudson la découpe à l’orient de ses profondes anfractuosités. La navigation de cette Méditerranée, ouverte aux courants et à la dérive des glaces du pôle, ne s’ouvre qu’en juin pour se fermer en septembre ; encore, durant cet intervalle, l’encombrement des glaces est tel, que les navires mettent plus de deux mois à franchir le diamètre de la baie, et que les primes des assurances maritimes anglaises ne s’élèvent pour aucune destination, aussi haut que pour cette traversée. Sur tous les pourtours de cette mer, le sol ne dégèle jamais à fond, et souvent même il gèle à sa surface au cœur de l’été. En vain la nature a prodigué à ces rivages des ports nombreux et superbes et y fait déboucher des fleuves qui n’ont guère d’analogues en Europe, ni pour la longueur de leur cours, ni pour la masse de leurs eaux. En vain des chaînes de lacs établissent entre leurs affluents un réseau de communication qui serait, dans nos climats, une source inépuisable de fécondité pour l’agriculture, le commerce et l’industrie ; le canot d’écorce du chasseur à peau rouge ou du voyageur canadien sillonne seul, et pendant quelques semaines d’été seulement, ces grandes voies fluviales, et ce n’est pas à elles que Pascal aurait donné la qualification de grandes routes qui marchent.
L’hiver règne en tyran sur leurs bords pendant huit ou neuf mois. Dès la fin de septembre, terre, lacs, rivières, tout disparaît sous une épaisse couche de frimas, qui prend la consistance et le poli du marbre. Dans toute l’Amérique, la diminution graduelle de la température moyenne, à mesure que l’on s’élève en latitude, est beaucoup plus rapide qu’en Europe. Tandis que cette dernière est à peine effleurée, au cap nord de Laponie, par la ligne isotherme de zéro chaleur, cette même ligne descend en Amérique à 20 degrés de latitude plus bas, jusqu’au sud de la baie de James ; et les provinces de la Nouvelle-Galles et du Maine oriental (noms anglais de la zone moyenne arctique) ne jouissent que pendant trois mois de la température de 11° centigrades, nécessaire au développement normal de la végétation forestière. Les rives méridionales des grands lacs de l’Ours et de l’Esclave ne possèdent même cette température que pendant deux mois au plus. Inutile d’ajouter qu’à de rares exceptions près, résultant d’une exposition privilégiée, les landes stériles du nord en sont déshéritées.
Ce n’est guère qu’en mai que le thermomètre, descendu souvent, pendant l’hiver, au point où se congèle le mercure (40° cent.), remonte peu à peu jusqu’à zéro dans la région des bois. Alors seulement un souffle de vie passe sur les plantes : les pousses rougeâtres des saules, des peupliers et des bouleaux se couvrent de longs chatons cotonneux ; les buissons verdissent ; aux pieds des rochers fleurissent la dent de lion, la bardane, de nombreuses variétés de mousses et de saxifrages, tandis que l’églantier, les groseilliers et les airelles se chargent de grappes nombreuses, et que la baie du framboisier du Canada mûrit sur sa tige grêle, rampant à la surface des marécages. Alors aussi les pins, les thuyas, les mélèzes, rois de ce petit monde végétal, étalent tout le luxe de leur verdure résineuse ; mais à leurs pieds la neige, fondue par les mêmes rayons qui ont lustré à neuf leurs rameaux, a changé toutes les dépressions du sol en fondrières mouvantes et en marais tourbeux, où la même cause fait éclore des myriades de moustiques et de maringouins, peste intolérable à laquelle on n’échappe qu’en se plongeant dans des tourbillons d’une fumée suffocante. La plupart des autres insectes se couchent avec le soleil ; les moustiques de l’Hudson ne dorment jamais.
Ainsi dans ces régions, il n’y a, à proprement parler, ni printemps, ni été, ni automne, mais seulement un mélange incomplet et avorté de ces trois saisons, si pleines de charme et de variété dans nos climats ; mélange au sein duquel on espérerait en vain trouver un jour, un seul, exempt de souffrances ; un jour où l’on puisse dire ce mot que nous avons tous entendu si souvent sortir de la bouche de nos paysans d’Europe, élevant des yeux reconnaissants de la terre fécondée par leurs bras au ciel calme et pur qui a béni leurs travaux : « Il fait bon vivre aujourd’hui ! »
La croissance des céréales et des végétaux les plus utiles à l’homme dépendant surtout de l’intensité et de la durée des chaleurs de l’été, on conçoit que les faibles essais de culture tentés autour des principaux établissements de la compagnie d’Hudson aient complètement échoué.
La troisième et dernière zone des terres arctiques, formée des plaines de la rivière Rouge, du double bassin du Saschatchewan et des vallées qui s’inclinent des flancs des Montagnes Rocheuses vers le grand Océan, au nord de la Columbia, possède seule le germe d’un avenir agricole. Les prairies qui se déroulent au sud-ouest du grand lac Winnipeg, où se groupent déjà plusieurs milliers de colons sédentaires, peuvent être considérées comme la Provence des solitudes du nord-ouest américain. De même, lorsque, ayant franchi par des cols élevés de 3 000 à 3 500 mètres le large massif de montagnes qui par l’athapeskâ, le haut Saskatchewan et le Frazer, verse à la fois un tribut fluvial au bassin polaire, à la mer d’Hudson et au grand Océan, on descend le grand versant occidental des Stoney-Mountains, on peut constater un changement sensible dans le climat. Les mêmes nuages qui accablent de tourbillons de neige et de giboulées les plaines de la Nouvelle-Galles et du Maine oriental, arrosent seulement de pluies bienfaisantes les vallées de la Nouvelle-Hanovre, de la Nouvelle-Calédonie, et de la Nouvelle-Géorgie, subdivisions géographiques de la côte, que découpent les innombrables détroits de l’archipel de Quadra et Vancouver.
Sur toute cette lisière océanique, le climat est plus désagréable par l’humidité que par la rigueur du froid ; mais une végétation vigoureuse y indique la profondeur et la fécondité du sol. Là se trouvent mêlés en d’épaisses forêts la sapinette à feuille d’if, le chêne noir et blanc, différentes variétés du peuplier, du frêne, du sycomore et de l’érable, l’aune et le sureau américain, et déployant leurs rameaux gigantesques au-dessus de la première voûte de verdure formée par l’entrecroisement de cette haute futaie, les pins de Coulter et de Sabine élèvent parfois leurs cimes à 100 mètres de leurs racines.
Les terres arctiques embrassent au moins trente degrés de latitude. Dans un pareil périmètre, que les hautes terres, les vallées, les bois, les prairies accidentent à un si haut point, on doit s’attendre, suivant l’observation d’un de ses plus courageux explorateurs, le docteur Richardson, « à rencontrer une grande variété d’animaux, d’autant plus intéressants pour le zoologiste, qu’ils sont moins connus que leurs correspondants d’Europe, et que, moins décimés par la civilisation, moins soumis à l’influence de l’homme, ils offrent des sujets neufs d’étude et d’instruction. » En effet, les terres arctiques américaines forment le plus vaste parc de chasse, et, après l’Afrique australe, le plus riche en espèces animales que la Providence ait préparé à l’homme. Ce n’est plus que là qu’on peut admirer encore les travaux du castor et observer les émigrations régulières du bison et du renne, soit qu’ils retournent à leurs pâturages du sud, soit qu’ils se rendent dans ces solitudes lointaines où les femelles mettent bas leurs petits. Les passages périodiques des espèces ailées, quittant, en multitudes innombrables, les climats tempérés et habités pour les plages désertes de la mer Glaciale, ouvrent dans ces régions, une source d’études toujours curieuse et toujours nouvelle. L’ichthyologiste y fera d’abondantes découvertes dans les eaux douces des lacs et des rivières, ainsi que dans les fiords profonds des mers environnantes, et l’entomologiste le plus déterminé ne pourra contempler sans surprise les irruptions soudaines des insectes qui bourdonnent dans l’atmosphère, la remplissent de leurs masses noires et serrées et s’élèvent incessamment de la surface des eaux, dès que l’hiver a disparu.
Les landes stériles ont leur faune particulière : on y remarque en première ligne le bœuf musqué, qui ne quitte guère les îles et les rivages, le renard arctique, la marmotte de Parry, le lièvre polaire, la petite variété du renne, qui vient hiverner à la limite des bois et remonte en été jusque dans l’Archipel de Parry pour y déposer ses faons, attirant sur sa piste le loup et le wolvérenne, qui errent également dans les régions boisées. L’ours blanc, tyran de cette création sauvage, ne s’éloigne guère des plages maritimes : c’est peut-être le quadrupède qui s’approche le plus du pôle et qui s’aventure le plus sur la surface solidifiée de l’Océan. On en a tué parfois à plus de 60 milles de toute terre.
Les animaux dont la chair, avidement recherchée par l’homme, lui tient lieu, dans la zone boisée, de la nourriture multiple que l’agriculture prodigue aux peuples civilisés, sont l’élan, le renne, le cerf et une espèce d’antilope particulière aux basses plaines du Saskaschanan. Ceux qu’on poursuit pour leur fourrure sont les ours et les renards de diverses variétés, le loup gris, le lynx, la martre, le rat musqué, la loutre, bien plus estimée que celle d’Europe, et surtout le castor. Les chasseurs font des histoires surprenantes sur la sagacité de ce dernier animal. Le docteur Richardson raconte qu’il a comparé ce qu’en rapportent Buffon et Cuvier avec ce que lui en ont dit les Indiens et que les deux récits concordent de tout point. « On les a vus souvent, au clair de lune, occupés à construire leurs digues ou leurs habitations, portant entre leurs dents les pierres, le bois dont ils ont besoin, ou les appuyant sur leurs épaules. Leur nourriture favorite est l’écorce du tremble, du bouleau, du saule, ou bien encore la racine du nénuphar à fleurs jaunes. Ils cachent sous l’eau, en face de leurs habitations, des amas de ces provisions. Certains cours d’eau des solitudes de l’Ouest ne sont navigables que grâce aux endiguements élevés par l’instinct de ces ingénieux animaux, et là, la compagnie de pelleteries s’est efforcée de sauvegarder leur multiplication ; mais quel règlement peut prévaloir contre l’avidité brutale des Indiens, surexcitée par la voix impérieuse de la faim ? »
La partie des prairies ou plaines sans bois qui s’étend entre les Montagnes Rocheuses et le lac Vinnipeg d’une part, et de l’autre, entre le bassin du Mackensie et celui du Missouri, jouissant d’un climat plus doux que les districts orientaux, est parcourue par une classe d’animaux dont les bisons sont les plus importants.
Ces puissants quadrupèdes, dont les Peaux-Rouges n’ont su tirer que la chair et le sang, et que la race blanche a négligé de domestiquer jusqu’ici, errent en troupeaux innombrables dans les pâturages naturels des Prairies, et forment le fond de la nourriture d’une population indienne bien plus nombreuse que la population des forêts. On trouve cependant des bisons dans les bois, mais en petit nombre, et jamais à l’orient du 105e méridien de Paris. Ces animaux, au contraire, ont pu franchir les cols des Montagnes Rocheuses et se multiplier dans les fertiles vallées qui s’ouvrent sur l’océan Pacifique ; mais, sur l’un comme sur l’autre versant de cette chaîne, mis en coupes réglées par l’homme, ils sont encore poursuivis par la plus formidable variété de l’espèce de l’ours, l’ours terrible, qui prélève sur leurs troupeaux sa pitance quotidienne, et dont la masse colossale et les griffes redoutables, taillées à l’image des carnassiers enfouis dans la dernière couche géologique du globe, font pâlir les plus intrépides chasseurs.
« À l’opposé des êtres inférieurs à lui, que la dépendance du sol, de la nourriture et du climat, parque de toute nécessité dans les contrées qui les voient naître, dans les milieux que leur imposa la Providence, l’homme a fait son domaine du monde entier. Sous les feux de l’équateur et sous la coupole glacée des espaces polaires, aux lieux où les dernières graminées marquent, au bord des neiges éternelles, les limites de la végétation expirante, comme dans les climats étincelants où la vie bouillonne à flots dans la sève des palmiers, il subsiste et se multiplie et lutte pour se subordonner la nature, aussi avare pour ses besoins, aussi sévère pour son libre arbitre, qu’elle semble généreuse et prodigue pour l’instinct passif des autres espèces vivantes.
Dans cette lutte qui date des premiers pas de l’humanité sur la terre, les générations successives des hommes, gravissant la voie du progrès en raison de leurs efforts et des obstacles surmontés, ou précipitées et retenues en arrière par les résistances d’un milieu plus fort que leur énergie ou que leur activité, ont formé sur la face du globe une série de couches sociales, dans lesquelles les différents âges de notre race peuvent se lire aussi clairement que les époques de la nature dans les couches géologiques de la terre. »
Dans les régions arctiques du nouveau continent, le premier âge de l’humanité a encore pour représentants les sauvages clairsemés sur les pourtours et sur les archipels de la mer polaire. Liés ethnologiquement aux Tschoutchis et aux Samoièdes du vieux monde, les Esquimaux ont été, sans doute, l’avant-garde, les éclaireurs de la race humaine sur le sol américain. Observés par Ross et Inglefield, dans la baie de Baffin, sous le 77e parallèle, et par Clavering, sur la côte orientale du Groenland, sous le 76e, ils se rapprochent du pôle plus qu’aucune autre variété de notre espèce ; mais, au XIIe siècle de notre ère, ils s’étendaient vers le sud jusqu’aux rives du Potomack et de la Delaware, où les Scandinaves les rencontrèrent pour la première fois et leur donnèrent le nom de Skrellings, mot qui a la même signification que celui d’Esquimaux ou Mange-Cru. Refoulés peu à peu vers le nord par les invasions de peuplades plus jeunes et plus puissantes, ils ne pénétrèrent dans le Groenland que vers la fin du XIVe siècle, en même temps que la peste noire ; et les Sagas islandaises attribuent à ces deux fléaux réunis la ruine des établissements scandinaves qui florissaient depuis quatre cents ans dans cette contrée.
Du reste, entièrement et radicalement distincts des Peaux-Rouges de l’intérieur, dont les sépare une haine mutuelle et égale à celle qui séparait, il y a deux mille ans, les chasseurs de la Germanie des pêcheurs finnois de la Baltique, les Esquimaux n’occupent que la côte du continent et des îles. Ils ne la quittent jamais, et ils ne pourraient le faire sans changer entièrement leurs usages et leur genre de vie, dont l’identité parmi toutes leurs peuplades, depuis la presqu’île d’Alaska jusqu’au cap Farewell et depuis la baie de James jusqu’aux Highlands arctiques, n’est pas un des faits les moins remarquables de l’anthropologie. Non seulement l’intérieur d’une habitation de la baie Norton est la répétition exacte de celle d’un Groenlandais, mais les mœurs, les caractères physiques, le langage, l’attitude, l’habillement des habitants de ces deux huttes, séparées par 110 degrés de longitude, sont semblables. Ils préfèrent la viande et le poisson crus à toute autre nourriture, l’huile de cétacé et le sang chaud de mammifère à toute autre boisson. Ils n’ont, dans leurs tanières d’hiver comme dans leurs tentes d’été, d’autre feu que celui d’une lampe fabriquée en pierre ollaire et alimentée par une longue tranche de graisse de phoque ; leurs canots et les instruments de pêche qui y sont attachés sont pareils et disposés de la même manière ; enfin, et c’est le point principal, leurs errements sociaux, leurs modes d’adoption, de mariage, de funérailles ne présentent rien de différentiel ; ils ont les mêmes croyances superstitieuses et reconnaissent, en tremblant à un égal degré, le pouvoir mystérieux des angekoks ou sorciers.
Les Esquimaux sont, en général, au-dessous de la taille moyenne ; mais leurs membres, trempés, dès l’enfance, dans une atmosphère qui tue les faibles, sont, chez ceux qui résistent, vigoureux et bien proportionnés. Une tête large, des lèvres épaisses, de belles dents, un nez court et plat, un œil enfoncé, peu ouvert et fendu obliquement comme celui des Chinois, un teint couleur de cuivre gris, forment leurs caractères typiques. Chez les deux sexes les cheveux sont roides, durs, luisants et noirs ; les hommes les portent longs et tombant en désordre sur leurs épaules ; les femmes, au contraire, fières de leur chevelure, la tressent en deux nattes égales, ou la relèvent en nœud sur le haut de la tête. Elles ne la laissent pendre détachée qu’en cas de maladie de leurs maris, et, si elles deviennent veuves, elles la sacrifient en signe de deuil.
L’habillement des deux sexes, qui ne diffère que par quelques détails, consiste en deux jaquettes de peau de phoque, descendant à mi-cuisse ; celle de dessus est munie d’un capuchon qui recouvre la tête au besoin. Leurs culottes, qui ne viennent que jusqu’au genou, y sont attachées par des courroies, et leurs bottes remontent assez haut pour en recouvrir les nœuds. Les semelles de ces chaussures, taillées dans la partie la plus forte de la peau des morses, sont, ainsi que leurs gants, impénétrables à l’eau. Le capuchon des femmes est beaucoup plus grand que celui des hommes ; mais son ampleur est bien justifiée par son emploi : c’est tout à la fois le maillot et le berceau où leurs enfants vagissent et s’ébattent jusqu’à trois ans au moins.
Les armes de chasse et de pêche des Esquimaux, dans la fabrication desquelles ils font entrer les plus petits fragments de bois jetés par la mer sur leurs côtes, l’ivoire du morse et la corne du narval, sont des témoignages palpables de ce vieil axiome qui fait de la nécessité la mère de l’industrie. Leurs couteaux seuls, fabriqués avec la défense du morse, suffiraient pour témoigner de leur patience : faute de scie, ils doivent dépenser un temps et une peine incroyables pour tailler, aplatir et aiguiser un de ces insuffisants ustensiles, que leur courbure naturelle fait ressembler aux petits sabres qui servent de jouets aux enfants européens.
Ils ont importé de l’Asie l’usage de l’arc et des flèches, ce produit remarquable du génie de l’homme primitif, suivant Condorcet ; mais l’invention de leurs embarcations de voyage et de pêche leur appartient en propre et leur a valu l’approbation des juges les plus compétents. Les unes comme les autres sont en peaux de phoque fortement tendues sur un châssis de bois, d’os ou de fanons de baleine ; mais les secondes, bien connues sous le nom de kayaks, ont excité l’admiration de Cook lui-même.
C’est une nacelle de quinze à dix-sept pieds de longueur sur une largeur de deux au plus, affectant la forme d’une navette de tisserand et percée, dans le milieu de sa partie supérieure, d’un trou circulaire où l’homme qui doit manœuvrer le kayak se glisse et s’assied. Une fois placé, il attache solidement autour de lui, sur les bords de l’ouverture, l’extrémité inférieure de sa tunique de peau imperméable, et, par ce moyen, ne fait plus qu’un avec sa pirogue devenue insubmersible, même dans la mer la plus houleuse. Une seule pagaie, de quatre à six pieds de long, dont l’Esquimau frappe alternativement l’eau à droite et à gauche, lui suffit pour fendre la mer avec une rapidité qui égale ou dépasse peut-être celle de la barque la mieux manœuvrée. La légèreté de cette machine est telle que, lorsque celui qui la monte se trouve en danger d’être pris ou écrasé dans les glaces, il saute sur le premier glaçon et emporte facilement tout l’appareil sur l’épaule ou sous le bras. Le bord du kayak étant à fleur d’eau, le pêcheur y trouve un autre avantage : il peut s’approcher plus aisément, sans être aperçu, de l’objet dont il veut faire sa proie.
Tout son attirail, javeline, lance, harpon est placé devant lui sur le canot ; derrière est une outre, qui tient au harpon par une longue courroie et qui est destinée à indiquer à l’Esquimau la trace du veau marin qu’il a harponné, et à ralentir en même temps la fuite de l’animal blessé.
Dominés, au moral comme au physique, par une nature marâtre, les Esquimaux, ainsi que tous les esclaves, sont moins doux et sociables que flegmatiques et patients. On ne peut les accuser d’être méchants ; mais, entièrement absorbés par le soin de leur nourriture quotidienne, ont-ils le loisir d’être bons ? Ils vivent, et c’est déjà un grand effort de la volonté de l’homme et de son organisme que de vivre dans un pareil milieu.
Jamais, dans les effluves vivifiants d’un beau jour, ils n’ont pu se bercer de rêveries idéales ou d’aspirations élevées : la brise du printemps ne glisse pas sur leurs plages. Ils ne respirent pas le parfum des fleurs ; car autour d’eux il n’en végète aucune qui soit douée du moindre arôme ; mais l’huile de cétacé flatte leur odorat. Ils n’ont ni fruits, ni légumes, ni la moindre plante comestible pour varier ou assaisonner leur nourriture ; mais le sang et la graisse des phoques leur tiennent lieu de potage et de condiments, et ils peuvent se procurer une salade dans la panse du renne et du bœuf musqué. Ils ne peuvent se faire l’idée d’une forêt ; mais qu’ont-ils besoin de frais ombrages ? À la place de bois, les ossements des animaux dont ils mangent la chair leur fournissent les matériaux de leurs ustensiles. Au besoin ils se tailleront un traîneau dans un bloc de glace, ou en fabriqueront un avec des poissons agglutinés et solidifiés par le froid, et, le dégel venu, ce véhicule se changera en provisions de bouche. Dans la neige enfin, dans cette couche glacée, où l’habitant des contrées privilégiées du soleil ne trouve qu’un linceul de mort, ils savent s’édifier un asile, un toit, un lit, où mâle, femelle et petits peuvent savourer la proie du jour et rêver à celle du lendemain.
Eh bien ! même réduit à ces conditions bestiales, l’homme est encore une noble créature ; car il n’en est aucune autre ici-bas qui puisse faire, penser et souffrir tout ce que souffre, pense, exécute un Esquimau.
Il est vrai que les mœurs de ces sauvages se ressentent de l’affreux pêle-mêle où, pendant la plus grande partie de leur vie, la température les retient confinés. Il est vrai que chez eux les relations d’un sexe avec l’autre sont de la plus grossière promiscuité ; que leurs notions de mariage et de paternité ne peuvent guère se traduire dans notre langue que par les mots d’accouplement et de reproduction, et qu’enfin ils prennent, troquent ou prêtent leurs femmes avec une facilité qui eût scandalisé Caton l’ancien lui-même, et soulevé le cœur du divin Platon. Et cependant, au sein de l’antique civilisation de Rome et d’Athènes, ces classiques apôtres du communisme matrimonial n’auraient jamais pu invoquer, à l’appui de leurs systèmes, une aussi bonne raison que les misérables habitants des plages arctiques, qui, sous peine de voir leur vieillesse s’éteindre dans l’abandon et dans la faim, sont obligés, per fas et nefas, de l’entourer d’autant d’enfants qu’ils peuvent.
Si bas placés qu’ils soient sur l’échelle sociale, ils ne sont pas tombés au-dessous du niveau qu’avaient atteint leurs ancêtres ; à ce titre, ils valent certainement mieux que les Indiens qui les ont expulsés de l’intérieur du continent américain et des rivages de sa zone tempérée.
Restes attardés de toutes les migrations qui se sont écoulées sur le sol du nouveau monde avant sa découverte, ou débris dispersés de groupes sociaux brisés sans avoir atteint leur développement normal, les Peaux-Rouges des contrées arctiques forment une des pires variétés qui puisse résulter, dans la race humaine, d’une dégénérescence prolongée de siècle en siècle et d’une léthargie absolue de la conscience.
Ethnologiquement, ils appartiennent à la même famille que les grandes tribus qui peuplaient les versants des Alleghanis avant l’arrivée de la race anglo-saxonne, et ils ont encore des congénères à l’est et à l’ouest des Montages Rocheuses.
Plusieurs tribus de la zone arctique rattachaient même leur origine aux Leni-Lenapés, si célèbres par les belles-fictions de Cooper ; mais leurs générations actuelles, veuves des traditions religieuses et cosmogoniques qui reliaient leurs aïeux au grand tronc asiatique, n’ont gardé de leurs croyances primitives que des pratiques ridicules ou hideuses, antidotes opposés par leur ignorance à leur misère et justifications absurdes de leurs cruautés.
Superstitieux à l’excès, les Indiens assez nombreux qui habitent entre le haut Missouri et le Saskaschawan ont recours à chaque instant aux sacrifices sanglants et se soumettent à d’affreuses pénitences. On en voit se taillader les bras et les cuisses d’incisions qui y laissent d’horribles cicatrices. D’autres, après avoir passé sous la peau de leurs épaules une forte corde de cuir, attachent à cet étrange séton une ou plusieurs têtes de bison et traînent derrière eux ces lourds fardeaux, en psalmodiant des incantations à leur manitou, pour obtenir sa protection dans les combats.
La férocité des Indiens, exercée sur eux-mêmes, ne doit donc pas étonner à l’égard des ennemis qui tombent vivants entre leurs mains ; les tortures qui attendent le captif au poteau de la guerre ne sont pour lui, comme pour ses bourreaux, que les conséquences de sa défaite. À cette heure suprême, il n’a plus qu’une pensée : enflammer la rage de ses ennemis et les défier de lui infliger autant de douleurs qu’il peut en supporter. Ainsi il ira jusqu’à dire à son vainqueur :
« C’est moi qui ai tué ton père ; il était vieux et infirme, et en tout semblable à un vieux chien. Je lui ai coupé le nez et les oreilles et je lui ai arraché les yeux, afin qu’il ne pût ni voir ni entendre le Grand-Esprit. Je lui ai ensuite ouvert le ventre et me suis chauffé les pieds dans ses entrailles fumantes. Toi tu n’es qu’une vieille femme, le fils d’un chien, et moi je suis un grand, un grand guerrier. Ta femme était jeune et belle ; je l’ai vue à mes genoux, me demandant sa vie et celle de ton enfant ; mais, prenant celui-ci par les pieds, j’ai fait jaillir sa cervelle contre un arbre, et en le rendant à sa mère j’ai ri de ses traits bouleversés par l’effroi et le désespoir. Alors, saisissant ses belles et longues tresses, je l’ai envoyée elle-même chercher l’âme de ton enfant sur les terres de chasse des morts, et tu pourrais voir encore sa chevelure flotter au-dessus de mon wigwam. Tu n’es qu’un chien et moi je suis un grand, un grand guerrier !
Tu ne sais pas tourmenter tes prisonniers ; tu n’es qu’un novice et un enfant. Quand tu seras attaché au poteau de mon village, tu y verras des hommes qui ne connaissent pas la pitié, car mon peuple est un grand, grand peuple ! »
On pourrait croire que le paroxysme de la férocité a été atteint dans les tribus où ce chant de mort a été recueilli ; il n’en est rien. Les Mandanes, les Pieds-Noirs, les Assiniboins sont encore loin de la démence furieuse dont font preuve, à l’ouest des Montagnes Rocheuses, certaines peuplades au sein desquelles semblent s’être perpétuées les incohérentes atrocités des temps mythologiques de l’antique Orient.
« Chez les Bollabollas, suivant un témoin oculaire, les chefs possèdent un tel pouvoir que nul n’ose résister à leur volonté, si abominable qu’elle soit, et que tous leurs sujets sont prêts à souffrir les plus cruelles douleurs et même la mort pour satisfaire leurs barbares caprices. Un jour, le chef actuel, se sentant dangereusement malade, fit fusiller un de ses sujets, et ce puissant remède lui rendit aussitôt sa santé et ses forces perdues. D’autres fois ils appellent la religion à leur aide, et, sous prétexte de démence sacrée, commettent les plus hideuses atrocités. Ils rôdent alors dans les bois, broutant l’herbe comme Nabuchodonosor, ou rongeant quelques ossements humains. Obéissant à toutes les impulsions de leurs imaginations dépravées, ils se précipitent au milieu de leurs sujets, enlevant à belles dents, sur les jambes et les bras des premiers venus, de grosses bouchées de chair qu’ils avalent gloutonnement. Les malheureuses victimes de ces attentats n’y opposent jamais la moindre résistance ; seulement on conçoit que la crainte d’être ainsi dépecé vivant porte tout Bollabolla à détaler au plus vite dès qu’il aperçoit son souverain. Un de ces cannibales couronnés venant un jour d’exercer sa prérogative royale à la porte même du fort Vancouver, le malheureux auquel il venait d’enlever d’un coup de dent une portion des muscles de l’avant-bras eut l’irrévérence de ne pouvoir étouffer un grand cri de douleur. À ce cri, un new-found-land appartenant au fort s’élança au dehors, et, peu soucieux des droits de la royauté bollabollienne, prit le parti de l’opprimé, saisit le mollet de sa majesté et lui fit subir la peine du talion. De ce moment, Néron (qu’on ne s’y trompe pas, c’est le chien et non le roi que ce nom désigne) devint un objet de vénération profonde parmi les Bollabollas ; car ils supposèrent que cet honnête animal avait éprouvé le même besoin, cédé à la même impulsion divine que leur chef. »
Toutes les tribus qui errent à l’ouest de Mackensie et du grand lac de l’Esclave sont continuellement occupées à se faire une guerre d’extermination et à exercer des représailles l’une contre l’autre. La soif de la vengeance est la passion dominante de ces sauvages. Il y a une trentaine d’années, des Gros-Ventres et des Pieds-Noirs s’étaient réunis pour chasser le bison pendant l’été au nord-ouest de la rivière Rouge. Mais, fatigués d’une occupation si paisible et trop peu honorable à leurs yeux, les plus jeunes guerriers de ces deux tribus alliées résolurent de faire une incursion sur les territoires des Assiniboins. Après avoir conjuré le grand Manitou par tous les exorcismes les plus puissants, ils partirent, laissant dans leur camp les vieillards, les femmes et les enfants. Leur expédition réussit au gré de leurs désirs. Ils revinrent bientôt en triomphe, chargés de chevelures et d’autres dépouilles opimes ; puis, en arrivant au haut de la colline qui dominait leur campement, ils entonnèrent un chant de victoire pour annoncer leur heureux retour à leurs pères, à leurs épouses et à leurs fils. Mais du sein des huttes nulle voix ne répondait à leurs chants, nul être ne sortait pour accourir à leur rencontre. Le calme et le silence du tombeau planaient sur tout le camp. Ils n’osent se communiquer leurs impressions et leurs craintes, ils précipitent leur marche, ils courent en chantant de plus fort en plus fort… Ils n’avaient pas atteint les huttes que leurs chants avaient cessés. À travers les portes ouvertes gisaient les cadavres mutilés de tous les habitants du camp. Les Assiniboins, guidés par la même infernale pensée qui avait inspiré leurs ennemis, s’étaient déjà vengés. À la vue de cet affreux spectacle, les Gros-Ventres et les Pieds-Noirs jetèrent sur le sol dépouilles, armes et vêtements, puis, revêtant leurs robes de cuir et couvrant leur tête de boue, ils se retirèrent dans les montagnes, où, selon la coutume des anciens Juifs, ils passèrent trois jours et trois nuits à gémir, à pleurer et à se lacérer les chairs.
Dans une autre occasion, un parti d’Assiniboins, ayant attaqué une tribu de Crees, tua un certain nombre de guerriers et emmena captive une de ses femmes. La prisonnière se résigna facilement à son sort et partagea la couche de son nouveau maître, qui du reste se conduisit envers elle en bon mari. Deux ou trois ans après, une nouvelle rencontre eut lieu entre des Assiniboins et des Crees. Parmi ces derniers était le Wolverenne, premier époux de la femme enlevée, qui elle-même se trouvait dans la troupe des Assiniboins. Le combat fut acharné et le succès longtemps disputé. Au nombre des combattants les plus furieux, on remarqua l’Hélène sauvage ; au plus fort de la mêlée, le tomahawk à la main, elle cherchait, appelait, poursuivait son premier époux. Mais le Wolverenne parvint à éviter ses coups ; et lorsque, après avoir vaillamment combattu, il vit les siens en déroute et les Assiniboins triomphants, occupés à scalper les Crees morts ou blessés étendus sur le champ de bataille, il s’enfuit seul dans une direction opposée à celle que prenait le gros des vaincus. Pendant tout un jour le couvert des bois ou des hautes herbes protégea sa course rapide ; enfin, le soir venu, brisé de fatigue et de besoin, il se laissa tomber dans une caverne des montagnes, où il s’endormit d’un profond sommeil qui ne devait jamais finir. Quelques instants après sa femme était debout à ses côtés et le contemplait avec une joie féroce. Depuis le matin elle s’était attachée à ses pas et avait suivi sa piste avec la patience implacable de la haine. Elle tendit lentement son arc, visa longtemps comme pour mieux savourer le meurtre, et enfin décocha une flèche dans la tête du malheureux dormeur. Avant qu’un bref et dernier cri se fût éteint sur ses lèvres, avant que la suprême convulsion de l’agonie eût rendu ses traits à l’immobilité, sa femme s’était précipitée sur lui, l’avait scalpé, et, l’abandonnant sans sépulture aux oiseaux et aux bêtes féroces, elle retournait, en toute hâte, au camp des Assiniboins étaler aux yeux de son nouvel époux le hideux trophée arraché au cadavre de celui qui avait été le compagnon de sa jeunesse. Depuis cette époque, disent les Indiens qui racontent cette sanglante légende, la colline où s’est passée cette scène de meurtre s’appelle la colline du Wolverenne, et bien souvent, lorsque la lune épanche ses lueurs diffuses à travers les brouillards d’automne, on voit de loin les spectres de la femme coupable et de sa victime lutter ensemble au sommet de la montagne.
Si des scènes de ce genre pèsent perpétuellement sur l’esprit des Indiens comme souvenirs du passé ou menaces de l’avenir, comment s’étonner que ceux d’entre eux qui vivent isolés ne puisent dans la rencontre de leurs semblables que des appréhensions ? « Un soir, dit un voyageur moderne, dans notre trajet de la rivière Rouge aux sources du Saskatchewan, étant venu camper en vue d’une hutte d’indigènes, j’envoyai un de nos hommes en reconnaissance. Dans tous les environs il n’aperçut pas d’autre hutte, et encore était-elle déserte ; l’intérieur, dans le plus complet désordre, témoignait de la fuite rapide de ses habitants. Des vêtements, des ustensiles, des débris de toutes sortes, jonchaient confusément la terre, avec des morceaux de bison préparés pour un repas qu’une terreur subite avait visiblement interrompu. Après avoir cherché et appelé à grands cris les fugitifs, notre émissaire, voyant ses démarches vaines, prit un morceau d’écorce fraîche et y traça, à la pointe du couteau, une sorte de carte de visite pour les maîtres de la hutte. Il dessina d’abord un homme avec un chapeau sur la tête et une pipe à la bouche ; ce qui, parmi tous les Indiens, signifie un Européen venu avec des intentions pacifiques ; et quelques autres hiéroglyphes non moins mystérieux, qui pouvaient se traduire par : Pourquoi fuir et vous cacher ? nous sommes vos amis ! Cette épître produisit l’effet attendu ; le propriétaire de la hutte, s’étant hasardé à revenir chez lui au milieu de la nuit, n’eut pas plus tôt déchiffré le lambeau d’écorce, qu’il accourut à notre camp et nous raconta que, nous ayant pris pour un parti de guerriers ennemis, il s’était enfui dans les bois avec sa famille dans un état presque complet de nudité. Ainsi, ces malheureux sauvages, condamnés à ne pas vivre en commun, afin de pouvoir se procurer des moyens suffisants d’existence, sont obligés de fuir à l’aspect de l’homme, comme la brebis devant le loup. »
Il ne faudrait cependant pas juger sur de semblables récits les Crees actuels et les autres tribus de la contrée boisée de la baie d’Hudson, qui s’éteignent dans un marasme gradué. Depuis longtemps déjà l’éclaircissement de leurs rangs et la fréquentation des Européens leur a fait enterrer le tomahawk, et la fameuse danse des guerriers n’est plus qu’une vaine tradition parmi eux. Quelques familles errantes dans de vastes solitudes représentent seules aujourd’hui les anciennes agrégations des Chippewans, des Couteaux jaunes, des Indiens cuivrés, dont les appellations ne vivront bientôt plus que dans les relations de voyages.
Ce sont moins les maladies nouvelles, les besoins nouveaux, l’ivrognerie, l’eau de feu, qui tuent ces sauvages, que la faim, autre résultat du contact des Européens. La grande théorie de Volney sur l’existence des peuples chasseurs se vérifie en eux. Ils disparaissent du sol avec le gibier qui les nourrissait.
Si amorties aujourd’hui que soient leurs passions héréditaires, si pacifiques qu’ils paraissent d’habitude, la faim les entraîne parfois à des crimes atroces. Il y a longtemps déjà que, par le fait des poursuites incessantes des agents de la compagnie des fourrures, il manque chaque année un plus grand nombre d’unités au chiffre de deux cents daims jugé nécessaire par Volney à l’entretien d’une famille sauvage. À certaines époques de l’année, toute espèce de gibier disparaît même entièrement de la zone boisée. Alors, quand l’Indien a dépouillé tous les pans verticaux du terrain de la tripe de roche, sorte de lichen que la faim la plus impérieuse peut seule considérer comme un aliment, il se décide à franchir de longs espaces pour aller mendier à la porte de quelque établissement de la Compagnie un secours que les agents, affamés eux-mêmes, ne peuvent pas toujours lui donner. Alors aussi, dans sa course désespérée, les vieillards, les infirmes, les bouches inutiles de sa famille sont abandonnés par lui aux hasards mortels du désert, si même il n’est poussé à chercher dans leurs veines épuisées une abominable et insuffisante ressource pour ranimer les siennes.
Pendant un hiver récent, un Indien Cree, nommé Visagun, avait pris le parti d’émigrer à la suite du gibier, disparu de ses terrains de chasse, sa femme, son fils de onze ans, deux ou trois enfants plus jeunes et quelques parents, en tout dix personnes, l’accompagnaient.
Leur changement de résidence n’apporta aucun soulagement à leur misère. Aucune pièce de gibier ne fut aperçue ou ne se prit dans leurs trappes. Ils en vinrent à se nourrir de leurs mocassins et de leurs habits de peau, qu’ils faisaient griller sur le feu. Cette ressource aussi s’épuisa. Depuis plusieurs jours ils n’avaient absolument rien mangé, lorsqu’ils entrevirent dans le lointain un troupeau de bisons en marche.
Recueillant alors le peu de forces qui leur restaient encore, les hommes, au nombre de cinq, chaussent leurs raquettes, chargent leurs fusils et se dirigent vers cette apparition si longtemps espérée en vain, laissant les femmes et les enfants sous la tente. Mais ils avaient compté sans leur faiblesse ; leurs jambes amaigries et chancelantes les soutiennent à peine. Visagun et son fils, incapables de continuer la chasse avec leurs compagnons, reviennent à leur campement : des cris affreux ont frappé leurs oreilles ; épouvantés et silencieux, ils se traînent jusqu’à la tente, en soulèvent sans bruit un lambeau et voient dans l’intérieur la femme de Visagun occupée à dépecer un de ses enfants pour en faire cuire les membres palpitants. L’indignation et le désespoir raniment le malheureux chef de famille ; il se relève, tue sa femme et une autre mégère qui l’aidait dans ses exécrables préparatifs, puis, craignant d’être à son tour massacré par les autres Indiens, il s’enfuit dans les bois avec son fils.
Les trois autres chasseurs revinrent les mains vides et épuisés… Que se passa-t-il dans la nuit qui suivit leur retour ? Aucun œil humain n’en a été témoin, et des présomptions seules font soupçonner Visagun et son fils d’être revenus, attirés par la vapeur du sang, et d’avoir hâté la mort de tout ce qui respirait encore dans l’intérieur du wigwam. Assis, à quelques mois de là, à un foyer européen, ils avouèrent qu’ils s’étaient repus des huit cadavres ; mais ils ajoutèrent que la plupart de leurs parents étaient déjà morts naturellement, lorsqu’ils s’étaient déterminés à les manger.
Le voyageur qui nous a transmis ce récit déclare avoir connu plusieurs vieilles femmes qui, dans plus d’une occasion, avaient dévoré leurs enfants, et d’autres encore qui, suivant les rumeurs du désert, avaient assassiné et mangé leurs maris. Il ajoute qu’il faut voir dans ce hideux cannibalisme bien moins le résultat d’une dépravation du cœur ou de l’appétit que celui des nécessités de la conservation personnelle, de l’instinct qui porte la louve à dévorer sa portée à défaut d’autre nourriture.
« J’ai souvent été humilié, dit un de nos illustres contemporains dans une publication récente, de voir les hommes se disputer un morceau de pain comme l’eussent fait des animaux. Mes sentiments ont bien changé à ce sujet depuis que j’ai été personnellement en butte aux tortures de la faim. J’ai reconnu, en effet, qu’un homme, quelles qu’aient été son origine, son éducation et ses habitudes, se laisse gouverner, dans certaines circonstances, bien plus par son estomac que par son intelligence et son cœur. »
Dans cet aveu, arraché par le souvenir de quelques jours de misère à l’une des âmes les plus hautes, à l’une des intelligences les plus vastes de notre Europe moderne, n’y a-t-il pas comme une explication atténuante, comme un témoignage d’imposante pitié, que pourraient invoquer contre les jugements sévères de notre civilisation de malheureux sauvages, abrutis par une dégradation continue et par la tyrannie d’un implacable climat ?
Des traits d’un genre différent prouveraient, du reste, que toute flamme divine n’est pas éteinte en eux. Le courage des femmes Crees, leur dévouement à leurs maris, ont été longtemps célèbres à l’orient des Montagnes Rocheuses. Leur patience, leur douceur, la piété naïve de celles qui sont devenues chrétiennes, ont été signalées par les missionnaires. Bien que les Indiens prennent autant de femmes qu’ils peuvent en nourrir, elles vivent toutes ensembles en bonne harmonie, se partageant sans querelles et sans jalousie les soins du wigwam. Il faut dire aussi qu’aujourd’hui beaucoup d’hommes, et surtout les jeunes, n’en ont qu’une, à laquelle ils semblent vouer autant d’affection et d’égards que le permettent leurs usages et leurs préjugés. L’attachement des Indiens pour leur progéniture est proverbial. L’indulgence que témoignent à l’enfance les tribus dont nous parlons est portée à l’excès.
Jamais le père ne punit ses enfants ; et si la mère, dans un moment d’impatience, vient à frapper d’un coup ou deux un enfant mutin ou désobéissant, elle se met immédiatement à pleurer avec lui. À l’appui de la vivacité du sentiment paternel chez ces sauvages, nous croyons devoir citer le fait suivant, qui, si extraordinaire qu’il soit, a pour garant la grave parole du docteur Richardson.