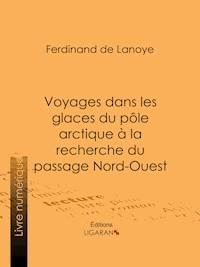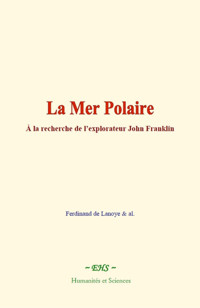
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Englisch
Au printemps de 1853, je fus désigné par l’Amirauté américaine pour commander la seconde expédition que notre gouvernement envoyait à la recherche de sir John Franklin. M. Grinnell, qui avait si libéralement contribué à la première expédition, dont je faisais partie, mit à ma disposition le brick l’Advance, et M. Peabody de Londres, avec cette générosité qui lui a acquis tant de sympathies en Amérique, pourvut abondamment à l’installation de notre navire.
Nous étions dix-sept à bord ; équipage d’élite, s’il en fut jamais ; tous volontaires ; tous hommes énergiques, résolus, comprenant le danger, et préparés à lui opposer un cœur intrépide et un front calme. La seule loi du bord, à laquelle on ne manqua jamais dans tout le cours de notre longue et douloureuse expédition était : obéissance absolue au capitaine ou à son représentant ; abstinence complète de liqueurs fortes ; abstention absolue de tout langage grossier.
Partis de New-York le 30 mai 1853, nous mîmes dix-huit jours à gagner Terre-Neuve, où nous reçûmes l’accueil le plus cordial ; de là nous fîmes voile vers la baie de Baffin. Les sondages, exécutés avec le plus grand soin à l’entrée du détroit de Davis, dans l’axe même de cette baie, donnèrent en moyenne 1900 fathoms (3400 mètres), fait intéressant qui prouve que la chaîne sous-marine, qui s’étend entre l’Irlande et Terre-Neuve, subit une dépression au débouché du courant polaire dans le nord de l’Atlantique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La mer polaire.
La Mer Polaire
À la recherche de l’explorateur John Franklin
Première partie
La Mer Polaire{1}
Voyage effectué par Dr El. K. Kane, à la recherche de Sir John Franklin{2}
Au printemps de 1853, je fus désigné par l’Amirauté américaine pour commander la seconde expédition que notre gouvernement envoyait à la recherche de sir John Franklin{3}. M. Grinnell, qui avait si libéralement contribué à la première expédition, dont je faisais partie, mit à ma disposition le brick l’Advance, et M. Peabody de Londres, avec cette générosité qui lui a acquis tant de sympathies en Amérique, pourvut abondamment å l’installation de notre navire.
Nous étions dix-sept à bord ; équipage d’élite, s’il en fut jamais ; tous volontaires ; tous hommes énergiques, résolus, comprenant le danger, et préparés à lui opposer un cœur intrépide et un front calme. La seule loi du bord, à laquelle on ne manqua jamais dans tout le cours de notre longue et douloureuse expédition était : obéissance absolue au capitaine ou à son représentant ; abstinence complète de liqueurs fortes ; abstention absolue de tout langage grossier.
Partis de New-York le 30 mai 1853, nous mîmes dix-huit jours à gagner Terre-Neuve, où nous reçûmes l’accueil le plus cordial ; de là nous fîmes voile vers la baie de Baffin. Les sondages, exécutés avec le plus grand soin à l’entrée du détroit de Davis, dans l’axe même de cette baie, donnèrent en moyenne 1900 fathoms (3400 mètres), fait intéressant qui prouve que la chaîne sous-marine, qui s’étend entre l’Irlande et Terre-Neuve, subit une dépression au débouché du courant polaire dans le nord de l’Atlantique.
Le 1er juillet nous entrâmes dans la rade de Fiskernaes aux acclamations de la population dano-groenlandaise pour laquelle notre arrivée était un événement.
Grâce à l’influence de M. Lassen, surintendant de la colonie, un chasseur esquimau, âgé de 18 ans, Hans Christian, se joignit à notre expédition. Ce fut une véritable bonne fortune pour nous ; habile à manœuvrer le kayak et la javeline, impassible comme un Indien du far-west, il nous rendit de grands services. Le 16 juillet nous étions au promontoire de Swarte-Huk, et le 27, dans la baie de Melville, au milieu des montagnes de glace (icebergs), qui infestent cette mer et qui lui ont valu des baleiniers le surnom de Trou aux bergs ; les épais brouillards de glace qui caractérisent cette région nous enveloppaient de toutes parts. Le temps devenait menaçant, je fis attacher une amarre à une montagne de glace pour nous empêcher de dériver ; après un rude travail de huit heures j’avais réussi, quand du sommet de notre abri tombèrent sur nous de petits fragments de glace, produisant sur l’eau l’effet de ces larges gouttes de pluie qui précèdent un orage du printemps. C’était un avertissement fort clair ; il n’y avait pas un moment à perdre. Nous étions à peine dégagés, que l’immense iceberg s’écroula avec un fracas terrible.
Après une navigation pénible, le 3 août, délivrés de toute entrave, nous étions à la pointe Wilcox, gagnant les eaux du cap York et nous dirigeant vers le détroit de Smith. Le 6 août, nous doublions l’île Hakluyt, puis le cap Alexandre qui forme, avec le cap Isabelle, l’entrée de ce détroit. Aspect désolé ; ici un triste manteau de neige descendant jusqu’à la mer ; là une sombre ceinture de rochers immenses, dont la sauvage et menaçante grandeur impressionne même nos rudes matelots. Ce sont là les colonnes d’Hercule de la mer polaire.
Le 7 août, nous donnions en plein dans le détroit de Smith ; nous établîmes un cairn à l’île Littleton, et, à notre grand étonnement, nous nous aperçûmes que nous n’étions pas les premiers à chercher un refuge en cet endroit désolé : des Esquimaux s’y étaient établis autrefois.
Jusqu’au 22 août, nous eûmes un temps épouvantable, des tempêtes, des ouragans, qui menacèrent de nous briser sur les rochers ou de nous broyer dans les glaces soulevées ; mais notre brick soutint courageusement ces épreuves, et le 23, par 78° 41′ latitude, nous étions occupés à haler notre brave navire le long d’un banc de glace attaché au rivage. Nous étions dès lors parvenus plus au nord qu’aucun de nos prédécesseurs, excepté toutefois Parry dans son expédition de 1826.
Dès lors, nous faisons fort peu de chemin. Bien que fermes et résolus, mes hommes me semblent incliner à retourner vers le sud pour hiverner. Je les réunis en conseil : un seul, M. H. Brooks, fut d’avis de continuer notre route au nord. Je leur expliquai tous mes motifs pour faire le contraire, je leur développai toutes mes vues, et, je suis heureux de le constater ici, tous mes braves camarades m’approuvèrent et se mirent courageusement à la rude tâche que leur imposait mon programme.
Le 28, le brick se trouvant engagé dans les glaces, je résolus de faire une exploration pour trouver, s’il était possible, un meilleur quartier d’hiver sur la côte. On équipa la baleinière Forlorn-Hope, qui, doublée de tôle, était recouverte d’un prélart faisant office de tente, et avec un équipage de sept hommes, je me lançai à la découverte d’un port d’hivernage. Notre voyage fut rude d’abord ; il nous fallait briser la glace pour avancer : nous faisions à grand-peine sept milles par jour. Au bout de vingt-quatre heures, la glace nous força d’abandonner notre canot, que nous mîmes à l’abri dans un endroit sûr, et nous primes notre traîneau. Nous avancions difficilement, rencontrant à chaque instant sur l’immense plateau de glace où nous étions, des cours d’eau qu’il fallait passer à gué, nous arrêtant la nuit sous des tertres de neige qui recouvraient les rochers ; nous fûmes une fois surpris par la marée et obligés de passer une partie de la nuit debout, soutenant, pour les empêcher de se mouiller, les peaux de buffle qui nous servaient de lit. Le côté comique de notre situation nous aida beaucoup à en supporter l’ennui ; imaginez huit cariatides américaines, dans l’eau jusqu’aux genoux, élevant en l’air ceux de leurs dieux domestiques qui craignent l’humide élément.
Dans notre voyage nous traversâmes un glacier très-étendu. J’eus plusieurs fois l’occasion de mesurer l’élévation des côtes, dont la hauteur moyenne est de 1300 pieds (395 mètres). Le 5 septembre, nous fûmes arrêtés par la plus grande rivière peut-être du Groenland nord. Ce cours d’eau impétueux, écumant, bondissait sur son fond de roche comme un vrai torrent. Il peut avoir trois quarts de mille (1200 mètres) de large ; la marée y remonte à trois milles environ (5000 mètres). Je baptisai cette rivière du nom de Mary-Munturn, d’après une sœur de M. Grinnell. La flore de ses rives était remarquable pour ce pays ; au milieu des mousses et des graminées étincelait la corolle pourpre des lychnis et les blanches pétales des monties, j’y rencontrai même une solitaire hesperis, la giroflée de muraille de ces régions arctiques.
Nous passâmes la rivière à gué, le 6, ayant de l’eau jusqu’à la ceinture ; à sept milles de là, nos observations avec le théodolite nous donnèrent latitude 78° 52′ ; l’inclinaison de la boussole marquait 84° 49′ ; notre longitude était 76° 20′ à l’ouest de Paris.
Nos provisions s’épuisaient. Ne pouvant songer à aller plus loin, je cherchai un point élevé pour faire une dernière reconnaissance. Je n’oublierai jamais l’aspect désolé qui s’offrit à mes regards quand, après une fatigante journée de marche, je me trouvai à une hauteur de 1100 pieds. Ma vue atteignait par delà le 80° de latitude ; à ma gauche, la côte ouest du détroit se perdait à l’horizon ; à ma droite, des terrains primaires s’étendaient en ondulant jusqu’à une masse de couleur profonde et sombre, que je reconnus plus tard comme étant le grand glacier Humboldt ; au delà se déployaient ces terres qui portent maintenant le nom de Washington ; leur promontoire le plus avancé, le cap Jackson, formait un angle de 14° avec le cap J. Barrow, situé sur la côte opposée. Toute cette ligne de côtes formait comme un cirque gigantesque encadrant un océan glacé. À mes pieds, une plaine immense, où les hummocks se dressaient comme les retranchements d’une cité assiégée, où çà et là d’abruptes montagnes de glace surgissaient semblables à d’inébranlables forteresses, tandis qu’au loin, jusqu’aux limites les plus reculées de l’horizon, un entassement d’icebergs accumulés les uns sur les autres, formait un infranchissable rempart.
Nous revînmes sur nos pas ; nos compagnons nous attendaient avec anxiété ; je leur expliquai comment, n’ayant pas trouvé de baie aussi favorable pour l’hivernage que celle où nous étions, j’étais décidé à y rester. Je fis placer l’Advance entre de petites îles qui le mettaient à l’abri de la dérive des glaces. C’est ainsi que notre petit brick, avec huit brasses d’eau sous sa quille, fut pris par l’hiver dans ce havre de Rensselaer, que nous ne devions plus quitter ensemble ! long repos pour notre bon et agile navire ; les mêmes glaces l’y étreignent encore !
À peine installés, nous fûmes avertis par la diminution rapide de la lumière que l’hivernage avait commencé. Nous vîmes d’abord le jour s’éteindre dans les bas-fonds et dans le lit des ravins ; puis les ombres monter graduellement le long des flancs des montagnes, et finir par s’étendre sur la cime blanche des glaciers. Dès le 7 novembre tout était ténèbres autour de nous. Le soleil s’était couché pour cent quarante jours, et nos lampes ne cessèrent de brûler dans l’entre-pont. Les étoiles de sixième grandeur étaient visibles en plein midi. Bien qu’aucun Européen n’eût encore hiverné a une si haute latitude, excepté toutefois au Spitzberg, archipel que les dernières effluves du Gulfstream, douent d’un climat relativement plus doux, l’hiver de 1853-54 se passa pour nous comme tant d’autres s’étaient écoulés pour nos prédécesseurs dans les régions polaires. Voici quel était assez uniformément l’emploi de nos journées :
À six heures du matin, Me