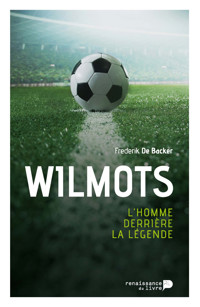
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
17 juin 2002. Sur un terrain lisse comme un billard, quelque part à l’autre bout de monde, Jacky Peeters envoie un centre parfait sur le front de Marc Wilmots. 1-0. Nous sommes au Mondial de football et l’adversaire est l’imbattable formation brésilienne. L’histoire s’écrit... furtivement car l’arbitre Peter Prendergast annule le but. Les Belges accusent le coup, le Brésil l’emporte et deviendra plus tard le vainqueur du tournoi. C’était le goal qui devait couronner la carrière de Wilmots. Le solide attaquant aurait sans nul doute échangé bien volontiers ses vingt-sept buts internationaux contre celui-ci. Wilmots mit fin à sa carrière internationale et raccrocha définitivement ses crampons l’année suivante. Mais l’appel du ballon était plus fort. En-dehors des terrains, il se révéla bien vite un redoutable analyste et un infatigable meneur d’hommes. L’ironie du destin l’entraîne à nouveau au Brésil mais cette fois en tant que coach fédéral d’une équipe nationale belge retrouvée. Dans cet ouvrage, Frederik De Backer s’enquiert de l’homme derrière la légende. Il en profite pour esquisser du même coup trente années de football belge. L’auteur retrouve les moments clés de la vie d’un joueur exemplaire avec une seule question en fil rouge : Qui est Wilmots ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilmots
Frederik De Backer
Wilmots
Renaissance du Livre
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
couverture: Emmanuel Bonaffini
photo de couverture : © xixinxing - fotolia
maquette : cw design
traduction : Marc Van Staen
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
FREDERIK DE BACKER
WILMOTS
L’homme derrière la légende
Traduit du néerlandais par Marc Van Staen
Introduction
Dans les classes des écoles primaires, deux types de garçons se distinguaient : ceux qui jouaient au football et ceux qui choisissaient l’académie de musique. Bon, certains gamins avaient d’autres centres d’intérêt, mais, à vrai dire, nous ne les évoquions que rarement, tant nous avions opté pour ce séparatisme simpliste : les footeux et les musiciens. Entre les deux groupes, un antagonisme résistant s’était formé et, donc, ceux qui ne s’y trouvaient pas rattachés n’avaient tout simplement pas droit au chapitre. Pour apprendre à quelle catégorie j’appartenais, il suffit de préciser que mes talents avaient choisi de s’exprimer plus au bout de mes doigts que sur la courbe de mon coup de pied. Le goût du football ne me vint que plus tard, lors des jeux dominicaux avec les mouvements de jeunesse, chaque semaine pendant deux bonnes heures. La troisième heure s’écoulait à ingurgiter des tonnes de bonbons et à observer avec curiosité la puberté naissante de nos camarades de l’autre sexe. Les filles étaient manifestement maladroites au foot et leur jeu de position laissait à désirer, mais telles n’étaient pas les qualités premières que nous attendions d’elles. Comme je ne baignais pas dans l’abondance de talents techniques, je m’appliquai donc à devenir un honnête défenseur.Je pris peur aux premiers contacts, mais, bien rapidement, je commençai à éprouver le plaisir de voir l’adversaire s’écorcher la jambe sur l’asphalte. Nous allions jusqu’à considérer que, si la blessure ne saignait pas, il n’y avait pas de faute commise.
Voilà ce qu’était le football à cette époque pour moi. Faisant fi des fantaisies techniques et du dribble, je n’étais fasciné que par les joueurs marchant à la mentalité. Des joueurs comme Philippe Albert, Franky Van der Elst et Marc Wilmots. Pas de piètres techniciens, loin de là, mais des sportifs qui tiraient le meilleur d’eux-mêmes moins par des pirouettes de jongleurs que par un engagement physique à toute épreuve. C’étaient des fonceurs, des battants, qui ne s’estimaient satisfaits que lorsqu’ils quittaient le terrain vannés, rompus et qu’ils avaient donné le maximum. Ce genre de joueurs impose le respect, naturellement.
Quand mon éditeur me mit sur la piste d’un ouvrage sur Marc Wilmots, il ne me fallut que peu de temps pour accepter. N’attendez ici aucune forme d’hagiographie. J’éprouve une grande sympathie pour le footballeur, mais, avant tout, il n’en reste pas moins un être humain avec ses imperfections. N’espérez pas non plus une biographie d’historien dans l’acception habituelle du terme, car j’ai l’habitude de vouloir systématiquement sortir des sentiers battus et de rendre les choses plus ludiques, plus futiles, en un mot, plus intéressantes. De même que je me permets régulièrement de m’attarder sur quelques interludes buissonniers. J’espère que l’ensemble plaira. Si cela ne devait pas être le cas, rappelez-vous que, moi aussi, je suis un fonceur. Je vous souhaite une excellente lecture !
FIFA-Belgique 1-0
« Jamais je n’ai insulté quelqu’un comme je l’ai fait ce jour-là entre la 40e et la 43e minute de jeu. J’aurais pu le gifler, cet homme-là. »
Marc Wilmots
Le cuir venait à peine de faire gonfler les filets des buts brésiliens que déjà retentissait le coup de sifflet. Alors que, dans une modeste demeure située sur la frontière entre le Brabant flamand et la Flandre-Orientale, les chips étaient propulsées à travers la salle de séjour, Marc Wilmots se retourna, interdit, le regard plus qu’interrogateur. Partout dans le pays, des cris de joie avaient retenti alors que boissons et nourriture se voyaient éparpillées sur le sol. Des milliers de mamans et de grand-mères, attirées par ces cris sauvages, avaient fait irruption dans les livings, marchant ici sur un débris de verre, là sur une canette dont le contenu s’écoulait lentement sur le tapis. Avant de constater les reliefs étalés sur les sols, elles avaient observé avec curiosité le spectacle de quelques spécimens masculins aux joues marquées des couleurs noire, jaune et rouge. Toute la Belgique avait vu la suite. Le but était annulé. La Belgique, la petite Belgique, avait mis à genoux le Brésil, le grand Brésil, la meilleure nation de l’histoire du football mondial. Mais non ! Le but était annulé. Et tandis que Marc Wilmots avait repris le jeu, de l’autre côté de la planète, tout un peuple se demandait ce qui avait bien pu se passer. Le ralenti le démontrait : il n’y avait rien à siffler. Pas de hors-jeu. Pas de contact avec le défenseur. Rien. Un coup de sifflet incompréhensible, dont personne ne soupçonnait la cause. Personne sauf Peter Prendergast, un enseignant jamaïquain qui, pour agrémenter ses loisirs, arbitrait ce jour-là un petit match de quart de finale de Coupe du Monde.
De quoi se poser des questions sur la compétence du bonhomme de la FIFA, endimanché dans son costume sentant la naphtaline, ayant pris la décision de proposer cet homme pour la direction d’un tel match. Le 5 juin 2002, il avait déjà été sélectionné pour siffler la rencontre Russie-Tunisie et reconnaissons-le, il ne fut pas mauvais. Le penalty sifflé contre Radhi Jaïdi pour une faute contre Dmitri Sytsov était justifié. A priori, on pouvait raisonnablement penser que les Belges n’avaient rien à craindre de cet arbitre. Et pourtant.
Dans le duel qui avait vu s’affronter le Costa Rica et les États-Unis en 2001, celui qui était un des innombrables beaux-fils du prolifique Bob Marley avait déjà marqué le football de deux bourdes manifestes en sanctionnant une faute de main imaginaire et en ignorant, par contre, un penalty flagrant.
Soit. L’arbitrage n’est pas un travail aisé. On est fait pour l’arbitrage ou on ne l’est pas, et cela se vérifie très rapidement. Même jeunes, les futurs arbitres montrent des dispositions. Je me souviens que, dans les cours de récréation, il y avait toujours un gamin, le regard incertain, qui ne demandait pas mieux que de jouer au football, lui aussi. Un jour, il avait eu sa chance, car il faut avouer qu’il avait une bonne frappe. Mais il commit l’improbable en shootant violemment sur l’oreille de « la madame » de cinquième année avec, à la clé, une commotion cérébrale et, également, en guise de dommage collatéral, l’interdiction pour nous tous d’encore pratiquer le noble art à l’école. Depuis ce jour, nous pratiquions le football à l’insu de notre surveillant, et notre petit gars fut désigné comme guetteur pour éviter que Wesley, le pion des « quatrièmes », s’improvise footballeur pour envoyer notre ballon sur les toits des classes. Ce genre de garçon, qui lève le doigt très vite lorsque l’institutrice demande un volontaire pour frotter le tableau, était fait du bois dont on fait les arbitres. Celui qui ne s’y connaît pas en football, observant des sportifs qui ont l’air de prendre du plaisir, peut légitimement se demander ce que fabrique ce bonhomme en tee-shirt fluo. De temps en temps, il sort de sa poche un ridicule carton de couleur qu’il exhibe de manière théâtrale, comme un Mussolini de pacotille. On espère presque qu’il s’étouffe pour de bon dans ses sifflements excessifs. L’arbitre est un personnage tragique, s’essoufflant sur le terrain sans ballon, alors que les joueurs s’amusent à frapper la balle magique pour l’envoyer valser, par une frappe brossée, dans un filet ou, encore, d’un passement de jambes, à donner le mal de mer à leur adversaire. Non, sans ballon, le football ne serait pas aussi plaisant. Et pourtant, les arbitres s’en passent sans problème. Soyons honnêtes, les arbitres sont utiles. Celui qui a assisté un jour à une rencontre de l’Africa Cup en sera le premier témoin. Cette compétition ressemble plus à une convention charcutière qu’à un prestigieux tournoi de football. C’est un miracle si, à chaque match, on ne déplore pas plus de blessés.
Belgique-Brésil, donc. C’était la mi-juin, la période des examens, mais pas un seul étudiant qui n’était planqué devant son poste de télévision sauf, peut-être, un jeune violoniste mal informé ou des enfants brimés par des parents sectaires. Quelques amateurs d’hosties, pétris d’un sentiment de culpabilité. « Étudiez, étudiez ou bien le diable viendra vous châtier. Impies ! » Ces gamins qui ne rigolaient pas aux blagues vaches de leurs congénères, peut-être ne se trouvaient-ils pas devant leur téléviseur ce jour-là, lorsque Wilmots marqua ce but annulé. Mais tous les autres étaient rivés à 8 mm de l’écran, la pupille dilatée et, après l’annulation du but de Wilmots, les larmes abondantes jusqu’à tremper le tee-shirt. À la pause, un bref regard en passant devant le miroir suffisait à comprendre qu’un drame venait de se dérouler. Quelle expérience ! Gosses, nous avions tous expédié un ballon dans une vitre. De notre faute, durant trois semaines, nous ne pouvions plus jouer avec un vrai ballon de football, mais avec une espèce de pelote en mousse, comme expurgée d’un vieux coussin du divan de grand-mère et qui, après quelques averses, en arrivait à peser 2 kg. Le talent consistait alors à envoyer cette éponge improvisée en l’air ou carrément à la tête d’un camarade. C’était l’époque où chaque cartable comportait un essuie permettant de sécher ces attentats humides. Nous n’avions pas de talent. Non pas que la volonté n’y fût pas, mais nous savions que, jamais, nous n’aurions la possibilité de nous pavaner sur l’écran de télé dans une magnifique tenue d’un rouge vif, même si la culotte se trouvait un peu trop haut à notre goût, au-dessus des genoux. Et nous savions aussi que les chaussettes remontées jusqu’au-dessous des genoux, c’était bon pour les fillettes. O.K., dans Braveheart, on assistait à la combinaison de barbes et de muscles avec des cheveux longs et des jupes. Mais cette époque était révolue. Un de mes compagnons de classe avait, un jour, dérobé des affaires dans la garde-robe de sa sœur et s’était affiché, ainsi accoutré, dans la cour de récréation. Nul doute sur l’issue de ce spectacle ! L’insolent se retrouva le soir même dans le bus scolaire avec quelques dents dans un pot de verre.
Kobe, destination inconnue. La cité portuaire japonaise serait donc le havre du duel de nos garçons face au puissant Brésil. Du Japon, nous ne savions pas beaucoup de choses, si ce n’est par l’entremise des albums de Tintin qui nous firent croire un moment que chaque Asiatique était dopé à l’opium et que les rues pullulaient d’hommes agitant dans l’air des sabres aiguisés. Nous ne savions rien de plus si ce n’est que leur cuisine était savoureuse, qu’on pouvait « l’emporter » et la déguster à la maison. Comme si c’était la chose la plus normale du monde. D’accord, nous avions les cornets de frites à emporter, mais un vrai repas ne se mange pas avec une fourchette de plastique dans un morceau de papier sulfurisé enroulé en cornet.
À la veille du Mondial, les usines spécialisées en maquillage avaient fait des fortunes, soumettant leurs employés à un rythme de travail insoutenable. La couleur rouge était particulièrement demandée. Chez l’épicier, au supermarché, au service des pompes funèbres, le rouge était partout. La Belgique se passionnait pour les Diables Rouges. Ils avaient survécu au premier tour, chose que nous considérions déjà comme une vraie performance en soi, et avaient l’insigne honneur (et tâche périlleuse, voire impossible) de rencontrer le Brésil. La meilleure formation du monde.
Un premier sentiment négatif s’insinua lors de l’interprétation des hymnes nationaux. On connaît la musique. L’hymne brésilien est une joyeuse envolée écrite un jour par un musicien qui s’était probablement réveillé le matin même aux côtés de la plus belle femme de Rio. Il avait alors rejeté les draps, fumé un cigare sous les premiers rayons printaniers et puis, dans l’attente du réveil de son amante et d’un second tour d’ébats, il avait composé l’hymne national du Brésil, un air qui pourrait accompagner chaque achat compulsif au distributeur de préservatifs. Un air qui accompagne les jongleurs de ballon. En revanche, la Brabançonne est une marche qui évoque plutôt les jours pluvieux de novembre. Une fanfare trempée par l’averse qui retentit dans l’ambition de maintenir l’intérêt d’une braderie locale. Quatorze bonshommes dans un uniforme bigarré portant fièrement un képi trop petit et se régalant d’une saucisse grillée. Durant l’hymne brésilien, la caméra balayait les visages des stars du ballon rond : Ronaldo, Ronaldinho, Lucio, Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu… Des visages détendus. Aucun stress. Normal, car, en face, c’est la Belgique. Pas de quoi chiffonner leurs magnifiques maillots jaunes. Ronaldo n’avait probablement pas pris la peine de se raser pour regarder Jacky Peeters dans le blanc des yeux.
Quelle différence dans les rangs opposés ! L’interminable Brabançonne s’envola et, au pays, nous nous étions tous levés de nos fauteuils, les visages maquillés de rouge et coiffés d’un superbe casque de Viking sur la tête. La main sur le cœur, nous espérions un match nul au bout du temps réglementaire car défaire le Brésil, nous n’y pensions pas et, donc, une défaite honorable après prolongations suffirait à contenter notre patriotisme. On pouvait presque lire le même espoir sur les visages de nos Diables Rouges. La caméra passait en revue Jacky Peeters, Nico Van Kerckhoven, Johan Walem, Yves Vanderhaeghe, Gert Verheyen, Mbo Mpenza, Daniel Van Buyten, Timmy Simons, Bart Goor, Geert De Vlieger et Marc Wilmots. Les Flamands de l’équipe barbouillaient l’hymne dans tous les tons et, donc, dans une belle cacophonie alors que les francophones ne chantaient pas et regardaient droit devant eux. Tous semblaient avoir la trouille. Tous sauf un : Marc Wilmots. Sûr de lui, il fixait un point indéterminé. Loin devant. Le buste altier d’un empereur romain, la détermination d’un général avant d’être coulé dans le plâtre d’une statue célébrant sa soif de victoires. Ce regard, qui portait loin, était celui d’un Alexandre le Grand. Si le Brésil souhaitait vaincre ce jour-là, il lui faudrait passer sur le corps de Wilmots, le Taureau de Dongelberg.
Marc Wilmots était l’incontestable leader des Diables Rouges. Un leader qui vit donc son but refusé par Peter Prendergast. Et alors qu’en Belgique, un jeune ado, dans une petite maison blanche de ce village sur la Dendre, commençait à ranger et nettoyer les dégâts qu’avait provoqués une joie par trop démonstrative, Marc Wilmots, le meneur de nos footballeurs, reprenait sa position sur le terrain. Plus tard, il s’exprima sur le fait que, ce jour-là, il était clair qu’aucune réalisation ne lui serait accordée : « À ce moment, j’ai su. J’ai compris que c’était foutu. C’était fini. Nous ne pouvions pas poursuivre notre marche en avant. » Certes, ce sentiment d’injustice ressemble à la scie de mauvaise foi d’un gamin qui se retrouve pour la septième fois en prison dans le jeu du Monopoly. Il n’en est pas moins vrai que les mots de Wilmots méritent que l’on s’y attarde.
Car, entre-temps, il est clair – les indices ne manquent pas – que la FIFA est capable de pas mal de choses lorsqu’il s’agit d’argent. L’argent est un moteur qui peut aller jusqu’à déterminer les votes qui décideront du pays d’accueil d’un Mondial. Le nombre d’habitants et leur niveau de vie sont des facteurs importants, car ils optimalisent le potentiel en merchandising ainsi que le résultat des recettes en droits de retransmissions télévisées. En 2002, la Belgique comptait un peu plus de 10 millions d’habitants, tandis que le Brésil en pesait 175 millions. Par ailleurs, le Brésil représente un pays de football incroyablement populaire auprès des fans du monde entier. Lors du Mondial 1998, les joueurs brésiliens tournèrent un spot publicitaire célèbre pour une marque de chips bien connue. À les voir s’amuser à dribbler et jongler dans cet aéroport, on en oublierait presque que cette prestation était rémunérée, et ce, grassement. Par contre, l’équipe nationale belge était tout bonnement invisible en termes de marketing international. Elle ne comportait aucun joueur sur lequel les publicitaires auraient parié un seul kopeck. L’équipe ne comptait pas de stars. On y retrouvait tout au plus quelques bons ouvriers et certains n’hésitaient pas à les traiter d’amateurs. Dans le meilleur des cas, un Diable Rouge avait, pour l’extérieur, le charisme d’un courtier d’assurances, planqué derrière un bureau en aggloméré et cherchant à vous refiler une police foireuse. Un Éric Deflandre, par exemple, s’il n’était pas devenu un footballeur, aurait pu sans souci prétendre à un job de représentant en produits de nettoyage. Bon, on s’imaginait facilement des jeunes garçons comme Ronaldo, Ronaldinho ou Roberto Carlos enfiler leur pyjama-parachute après avoir visionné Bonhommet et Tilapin, tandis que Rivaldo pouvait revendiquer, par une soirée très sombre, une lointaine ressemblance avec Harry Belafonte, mais tout de même… ces gars-là jouaient au football comme personne ! En les voyant à l’œuvre, vous ne pouviez qu’avoir les yeux mouillés devant tant de beauté et de technique footballistiques. Quel contraste avec les ballons désespérés envoyés par nos gars en direction du drapeau de corner ! On achetait la tenue de la Seleção par respect, celui de la Belgique pour faire briller l’argenterie. Bref, autant la FIFA que les revendeurs de tenues sportives avaient tout intérêt à ce que le Brésil reste le plus longtemps possible dans le tournoi. Et c’est ce qui se passa. Magistralement. Le Brésil battit finalement la Belgique par 2-0 après des buts signés Harry Belafonte et Ronaldo.
Six années plus tôt, le 31 mai 1996, le Japon et la Corée du Sud furent choisis pour l’organisation du Mondial 2002. Dans un premier temps, ces deux pays avaient déposé des candidatures séparées. Mais, peu avant que la décision ne tombe, ils avaient décidé d’unir leurs forces. La décision de la FIFA en fut facilitée, car, ensemble, ces deux pays abritaient quelque 170 millions d’habitants. Face à la candidature du Mexique (110 millions d’âmes et, surtout, un niveau de vie bien moins élevé), celle de l’Asie, mine d’or du marketing et continent amateur d’événements d’ordre planétaire, s’imposait à la FIFA. Demandez donc aux dirigeants des plus grands clubs la raison de leur pèlerinage annuel en Asie pour des tournois amicaux généreusement rémunérés ou, encore, à des clubs comme Anderlecht, le Cercle Bruges, le Club de Bruges, le Lierse, Genk ou le Standard la raison pour laquelle ils se sont montrés intéressés quelquefois par des joueurs venant de l’autre bout de la planète. C’est simple. Pour seul exemple, chaque soir, des milliers de Japonais essaient de trouver le sommeil dans un vieux tee-shirt d’Eiji Kawashima datant de sa période du Lierse.
Le Japon et la Corée du Sud, donc. Pour faire sonner et trébucher les yens et les wons. La décision était certes unanime, mais la FIFA est puissante et ses délégués, très convaincants.
Les mêmes critères ont amené la nomination du Qatar en 2022. Le plus naïf d’entre nous aura compris que faire jouer des sportifs de haut niveau, un mois durant, sous une température de 50 °C est une aberration. Très rapidement, des accusations de tricherie furent entendues et répétées. Il faut dire que l’éclosion de projets humanitaires dans les pays africains et sud-américains avant les votes à la FIFA a le don de provoquer ces suspicions logiques. Ainsi, le représentant de la FIFA à la Trinité-et-Tobago, Jack Warner, aurait tout simplement sollicité une somme de 4 millions de dollars au Qatar pour le financement d’un centre éducatif dans son pays. Nicolas Léoz, du Paraguay, fut moins exigeant : il souhaitait être nommé « chevalier ». Jacques Anouma, de la Côte d’Ivoire, et le Camerounais Issa Hayatou auraient empoché chacun 1,5 million de dollars. Il semblerait que pas moins de vingt-cinq officiels de la FIFA eussent été achetés par Mohammed Bin Hamman, un des leaders de l’offre du Qatar. Warner et Bin Hamman furent sanctionnés et bannis de la FIFA. Et le bal des rumeurs et des médisances s’empara de la FIFA et de ses (ex-)officiels. Tout cela ne sentait pas la rose.
Un autre aspect qui ronge la FIFA est celui de la moyenne d’âge de ses dirigeants. Mi-2013, Sepp Blatter, le Néron de la FIFA, décida qu’à l’âge de 77 ans, il souhaitait encore prolonger son règne. En parallèle à la candidature pour sa réélection, la nouvelle se répandit d’un plan permettant, à l’avenir, d’accueillir plus de pays africains et asiatiques lors des Coupes du Monde. Sepp Blatter venait de se trouver quelques soutiens importants.
Le sommet consiste vraisemblablement dans cette nomination du Qatar. Organiser une compétition de top niveau sous une chaleur accablante, dans un pays pétrolier pas du tout intéressé par le football et qui a dû faire turbiner 1,2 million d’ouvriers importés pour construire les infrastructures, et ce, dans des conditions d’attribution pour le moins discutables, tout cela, Blatter ne craignait pas de le faire. Le journal anglais The Gardian se fit l’écho, en septembre 2013, qu’au moins septante des trois cent quarante mille travailleurs népalais avaient péri accidentellement ou à la suite d’attaques cardiaques sur le chantier du site. En février 2014, on cita même le chiffre de trois cent quatre-vingt-deux décès. Pour rappel, lors des Jeux Olympiques de Londres, on ne déplora aucune perte humaine. Zéro. Certes, les footballeurs du Mondial n’auront pas, comme les ouvriers, à s’activer sous un soleil de plomb, sept jours sur sept, douze heures par jour. Mais la perspective de jouer des rencontres de ce niveau sous une température de 50 °C est inquiétante.
Retour en 2002. De mauvaises langues prétendent que Peter Prendergast s’en fut, après le tournoi, profiter des plages de Rio dans un hôtel réservé par la Fédération brésilienne de football. Essayez donc de prouver ce genre de choses. De plus, pourquoi polémiquer ? L’équipe brésilienne ne comptait-elle pas en ses rangs de biens meilleurs footballeurs ? Soyons honnêtes et reconnaissons ce fait évident. Et puis après le but annulé de Marc Wilmots, les Diables devaient encore tenir une heure contre ces diables de canaris. Des Brésiliens qui, par la suite, sortirent du tournoi l’Angleterre, la Turquie et l’Allemagne sans autre forme de procès. Pas des culs-de-jatte tout de même. Et puis, l’arbitrage discutable de Prendergast ne fut pas un acte isolé lors de ce tournoi, sans oublier que, tout au long d’une telle compétition, des dizaines de rencontres se voient entachées de décisions bancales, propices aux discussions.
Malgré tout, ce tournoi de 2002 fut, à bien des égards, symptomatique. Le parcours des Italiens, à lui seul, représente une plaidoirie pour l’usage des images vidéo lors des matchs de football. Lors de pas moins de trois rencontres successives, cinq (5 !) buts furent injustement annulés. Certains Italiens soupçonnèrent que l’équipe de Corée du Sud était avantagée afin d’aller le plus loin possible dans la compétition. On parla de complot et de la complicité de l’arbitre équatorien Byron Moreno. Quelques mois à peine après ce Mondial, en septembre 2002, ce même arbitre fut suspendu pour vingt rencontres après un match stupéfiant du championnat équatorien entre Liga de Quito et Barcelona Sporting Club. Alors que l’on se dirigeait vers un score de 3-2 en défaveur de Liga, l’arbitre jugea bon de prolonger officiellement la rencontre de six minutes. Étrange. Mais plus étrange encore, il siffla la fin de la rencontre treize minutes après la fin du temps réglementaire. Liga de Quito inscrivit encore deux buts aux 99e et 101e minutes. Comme si cela faisait partie d’un plan. Après sa suspension, Moreno marqua encore les imaginations lors d’une autre rencontre. Il y exhiba trois cartes rouges très discutables. Un mois plus tard, il trouva qu’il en avait assez fait et se retira de l’arbitrage. En 2010, il fut arrêté à l’aéroport John F. Kennedy de New York en possession de 6 kg d’héroïne qu’il voulait entrer sur le territoire américain, cachés dans ses sous-vêtements. Il plaida coupable et se retrouva pour deux années à l’ombre d’une cellule US. Qui pouvait faire confiance à ce genre d’homme ? Avec Prendergast, en cet été 2002, la Belgique tenait donc sa théorie du complot. Elle ne méritait peut-être pas la victoire face au Brésil. Peut-être pas. Mais ce but, qui fut annulé, était amplement mérité. Wilmots, surtout, le méritait.
Jef et Jef
« Le football, c’était ma récréation entre l’école et le travail à la ferme. »
Marc Wilmots
On dit souvent que les footballeurs sont constamment mis sous pression. Que chaque semaine, ils se doivent de performer. Et qu’il leur arrive de décharger leur stress dans des clubs à la mode. Mais de quel stress parle-t-on ? De quelle pression s’agit-il ?
Enfants, ils ont rêvé longtemps, un ballon de foot dans les bras en guise de nounours, de tribunes scandant leurs noms. Ils ont eu le fantasme de ballons frappant le piquet et d’envois puissants sur les transversales. Ils ont idéalisé toutes les tenues frappées de leurs noms sur le dos. Ils ont rencontré en rêve les petits garçons, le regard admiratif, leur demandant un autographe chez l’épicier. Et lorsque ces rêves deviennent réalité, lorsqu’un de ces gamins sur un million en arrive vraiment à devoir mettre sa signature sur un contrat multimillionnaire, alors commencent à tomber les mots pression et stress. Alors que, justement, de pression et de stress, il ne devrait plus en être question. Nullement. Un exemple ? Le 8 juin 2012, l’ex-milieu de terrain anderlechtois Charly Musonda fait signer un contrat à ses trois fils, Lamisha, Tika et Charly Jr avec le puissant club de Chelsea. Le club londonien n’était, en fait, intéressé que par Charly Jr, âgé de 15 ans. Lamisha et Tika, âgés respectivement de 18 et 20 ans, sont engagés en même temps et ne devront probablement plus jamais travailler de leur vie. Pression ?
Les grands clubs ont une propension à faire tourner la tête des jeunes joueurs. Ils les séduisent à la force de la couleur de l’argent. Le 24 mars 2012, à 17 ans, Dennis Praet signe une prolongation de contrat à Anderlecht qui le lie au club bruxellois jusqu’en 2015. Le montant de ce contrat ? Huit cent mille euros par an. À 17 ans ! Alors que, cette saison-là, Praet avait participé à sept rencontres en tout et pour tout. Dix-sept ans, sept matchs, 800 000 euros. Sans parler de la prime à la signature. Une rémunération quand même incroyable juste pour apposer un paraphe. Infime tache d’encre sur un bout de papier qui vaut des dizaines de milliers d’euros alors que le joueur n’a pas encore esquissé le moindre geste pour nouer ses lacets. Voulez-vous que nous parlions aussi des primes de victoire, des primes par but marqué, des primes par assist ? La coupe est pleine. Pression ?
Il va sans dire que les footballeurs reçoivent également gratis leurs chaussures à crampons, des vêtements de marque, un appartement ou, encore, une voiture de luxe. C’est un minimum. Les services d’un valet de pisse me semblent pouvoir constituer une probable prochaine étape dans cette escalade vertigineuse.
Nous parlons de la Belgique. Un pays où certains terrains représentent encore un paradis pour les taupes. Que dire alors des clubs du top européen où les excès ne sont plus propices à l’énoncé d’une liste sans commune mesure avec les standards belges. Aujourd’hui, les choses se déroulent de la manière suivante : une puissance européenne identifie un espoir prometteur qui, dans son pays, décime les défenses en équipes de jeunes. Le club envoie un scout pour le suivre sur quelques matchs. Le scout approche le papa de l’étoile montante et lui fait miroiter un avenir étincelant. La fierté paternelle se voit flattée par une telle proposition, renforcée par des promesses financières inespérées. Et puis, on promet un job au papa. Voilà donc une famille qui laisse tout derrière elle, quitte habitation, amis, tout ce qu’elle a construit pour suivre les flonflons tapageurs de la piste aux étoiles. Les autres enfants ? No problem. On leur trouvera un petit job d’employé de bureau ou un truc virtuel. Pour les familles à faibles revenus, celles d’ailleurs qui statistiquement accueillent le plus grand nombre de talents, l’appel est irrésistible. Ces gamins, à qui on refuse la dernière PlayStation, se rabattent sur les plaisirs du football de rue avec les copains du quartier. Des milliers d’heures passées dans une impasse ou sur une place anonyme à envoyer le ballon contre la paroi d’un garage faisant office de goal, à trouver dans les pavés inégaux la source de leur futur équilibre corporel. Au retour au domicile, les genoux en sang sont mieux accueillis que les culottes déchirées qui exigent le remplacement et donc une dépense nouvelle. Comment juger une telle famille lorsqu’elle répond au doux son de la corne d’abondance ?
Vingt ans plus tôt, les choses étaient bien différentes. Marc Wilmots a grandi dans une ferme, entouré de ses aînés, Georges et Claire. Enfant, Marc déplaçait les ballots de foin de 25 kg sur le domaine de son père Léon, à Dongelberg, une commune de l’entité de Jodoigne. Léon Wilmots possédait entre cent et deux cents bêtes sur 80 ha de terrain. Le travail ne manquait donc pas pour le jeune Marc. Debout à 5 h 45 pour se rendre à l’école, il en revenait vers 17 h 30. Moins d’une demi-heure plus tard, il était à l’entraînement qui durait jusqu’à 21 heures. À tout cela s’ajoutait le travail de la ferme pour lequel papa Léon s’avérait un homme exigeant. Quelle que fût la charge de travail exécutée, il trouvait toujours quelque chose à y redire. Ce trait de caractère paternel se trouve probablement à la base du côté travailleur de Marc Wilmots ainsi que de sa détermination. Ce n’est qu’à la fin de sa carrière de footballeur qu’il entendit pour la première fois son père lui dire qu’il était fier du parcours que son fils avait réalisé. En revanche, sa maman a toujours été son plus grand supporter.
Marc n’était pas fait pour les bancs et les livres d’école. Il ne termina pas ses études secondaires. En aurait-il d’ailleurs besoin dans sa vie de fermier ? C’est Marc Druet, un missionnaire de Ninove, qui l’amènera au football. Le père Druet avait passé plusieurs années au Congo belge avant de s’installer à Jodoigne. À 6 ans, le jeune Wilmots se devait de fréquenter les cours de catéchisme en vue de préparer sa première communion, et il appréhendait ce passage obligé. Le père Druet lui fit alors une offre intéressante. Si Marc suivait avec assiduité chaque cours de catéchisme, il lui promettait de jouer une demi-heure au football avec lui après les cours. Le père Druet lui apprit ainsi les fondamentaux : de l’utilisation des deux pieds jusqu’au coup franc avec une frappe enroulée. La base de son futur shoot puissant et flottant. Il lui apprit même les règles de base du poste de gardien de but. Chacun à son tour pouvait tirer au but, puis se placer entre les deux poteaux. Marc Wilmots appréciait ces exercices de gardien de but. Le père Druet poursuivit ainsi ce travail avec son poulain durant trois années. Le samedi soir, il se rendait à la maison des Wilmots pour y suivre, avec Léon et Marc, l’émission Sportschau qui proposait les résumés des rencontres de Bundesliga. De quoi y voir la source de l’attachement de Wilmots pour cette compétition qu’il fréquentera plus tard comme joueur professionnel.





























