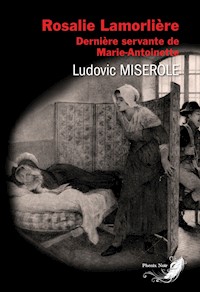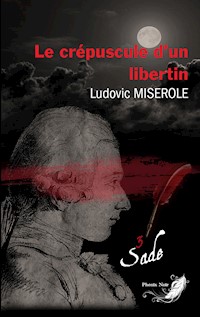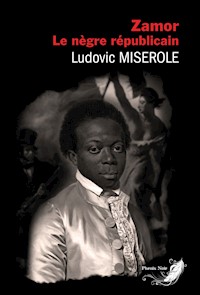
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: IFS
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Zamor... Il n'aura laissé qu'un vague souvenir, un certain malaise même. Enfant indien, on l'arracha aux siens pour l'offrir à la favorite du roi de France, ce pays inconnu et si lointain. Il connut les ors de Versailles et les moulures de Louveciennes à l'ombre de Madame du Barry. Advint la révolution et avec elle l'opportunité de prendre en main sa destinée. Certains choix et certaines amitiés ne seront pas sans conséquences. Celui qu'on appelait "le nègre de la Dubarry" devint alors le nègre républicain portant même le surnom peu glorieux de l'ami Zamor. Mais qui était vraiment Louis-Benoît Zamor ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
« Je me disais en soupirant : qu’ai-je fait ici-bas ? J’étais fait pour vivre, et je meurs sans avoir vécu. Au moins cela n’a pas été ma faute, et je porterai à l’auteur de mon être, sinon l’offrande des bonnes œuvres qu’on ne m’a pas laissé faire, du moins un tribut de bonnes intentions frustrées, de sentiments sains, mais rendus sans effet, et d’une patience à l’épreuve des mépris des hommes. »
Jean-Jacques Rousseau,Les rêveries du promeneur solitaire
MICHEL DE DECKERHISTORIENLAURÉAT DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
AVEC UN Z QUI VEUT DIRE… ZAMOR
Parmi les très rares portraits qui figurent Zamor, le plus émouvant, pour moi, est sans doute celui de Gautier d’Agoty qui nous le montre, négrillon au regard malicieux, présentant une tasse de café à une Jeanne du Barry belle comme un cœur. Cette scène ayant évidemment été croquée à une époque où Zamor n’envisageait pas encore de jouer les justiciers. Zamor ? À l’origine c’était un petit bonhomme à la peau sombre, vendu par sa famille et offert à la dernière maîtresse officielle de Louis le Bien Aimé. Il aurait pu tomber plus mal ! Mais bon, plus les années passeront, moins il supportera d’être le pantin de la belle Jeanne. Pourtant elle ne se privera pas de le gâter, son joujou venu du Bengale ! Elle le fera solennellement baptiser, lui donnera la plus raffinée des éducations et en fera son page préféré. Mais l’époque était aux idées nouvelles et le moment venu, Zamor allait se révolter contre sa marraine. Ludovic Miserole a scrupuleusement observé la montée de la révolte du page à la peau grise qui, un jour, ne voulut plus être « l’esclave de la catin royale », ni sa « chimère humaine » ou son « carlin à deux pattes ». Et lorsque la Révolution éclata, tout acquis aux idées des patriotes purs et durs qui l’avaient endoctriné, Zamor n’épargnera pas celle qui n’avait jamais levé le petit doigt quand il avait été en butte aux insultes ou aux railleries des familiers du château de Louveciennes.
Et, à l’heure du procès de Jeanne, son témoignage sera accablant.
On ne trouve plus trace, aujourd’hui, de la sépulture du « noiraud des Indes » au cimetière de Vaugirard, où il fut inhumé à la sauvette après avoir été retrouvé mort dans la misère noire, au fond de sa soupente parisienne de la rue… Perdue.
Il est vrai qu’on ne trouve plus trace du cimetière lui-même.
Ludovic Miserole, qui a suivi pas à pas Louis-Benoît Zamor, tente de comprendre le comportement de ce personnage qu’il met en scène dans un décor de roman historique, avec quelques superbes battements de cœur en fond sonore. Un roman où l’histoire vraie se fait la part belle si l’on en croit les liasses d’archives que l’auteur a habilement consultées pour ressusciter devant nous « le nègre qui a trahi la du Barry » comme on disait dans les années 1800, quand on ne le raillait pas tout simplement en parlant de « la mise à mort ».
1
La nuit est tombée sur Louveciennes, hameau de cent vingt-quatre feux de Seine-et-Oise. Le Fraternel est d’un calme peu ordinaire, tout comme la place du village où seul un vent de fin de saison fait frissonner le feuillage de vieux marronniers. Le troquet que les bougies inondent d’une lumière jaune, qui pourrait être chaleureuse si l’ambiance n’y était glaciale, ne compte que trois personnes. Deux clients discrets sont assis à une table éloignée de toute fenêtre et tiennent compagnie à une dame robuste, à la gorge pleine et aux hanches épaisses. Elle est installée derrière son comptoir, occupée à lire les dernières nouvelles venant de Paris.
Paris ! Une heure à cheval d’une révolution qui n’en finit pas et qui plonge davantage chaque jour la capitale dans l’horreur. Tout le monde a peur pour sa vie. La calomnie, les dénonciations, voire les accusations parfois fantaisistes n’épargnent personne. Pas même les femmes et les enfants !
Louveciennes, bien que proche de Versailles, semble encore exemptée de toute cette terreur, même si, depuis quelque temps, une certaine agitation se forme autour de la plus illustre habitante que compte la bourgade. Jeanne du Barry, car c’est d’elle dont il s’agit, n’est pas à la noce depuis plusieurs semaines. Quand bien même Louis XV est mort depuis bien longtemps et que son petit-fils, Louis XVI, a été raccourci sur l’échafaud il y a huit mois1, les privilégiés de l’ancien régime n’en sont pas quittes pour autant. La dernière favorite de Louis XV est menacée de toutes parts et ces deux hommes, assis devant leur verre de mauvais vin, n’y sont pas étrangers.
La citoyenne Fayol se doute bien qu’il se trame quelque chose à la table du fond. Elle connaît tous ceux qui franchissent la porte de son établissement. Là-bas, il y a Greive, celui qu’on appelle l’Américain2, un étranger venu d’on ne sait où, mais qui semble avoir conçu contre Madame du Barry une haine aussi violente qu’inexpliquée. Face à lui, de dos, Zamor, l’ancien page de la comtesse que certains surnommaient il y a peu encore, « le Nègre de la du Barry ». Pourtant, nègre, il ne l’est pas vraiment. Sa peau est certes foncée, mais il n’est pas Africain. Il dit venir d’Inde, ce pays lointain où il fut arraché à ses parents pour servir la courtisane d’un vieux roi libidineux. Mais tout cela appartient au passé ; il entend bien prendre sa revanche sur une vie d’humiliation, de servitude et d’esclavage. Il a été offert tel un animal à cette cajoleuse quand il n’avait pas encore huit ans. Dans le bourg, son histoire est sur toutes les lèvres. Surtout depuis que la comtesse l’a chassé de chez elle comme un malpropre. C’était il y a quelques semaines.
Soudain un cri retentit. La tenancière du Fraternel ne peut réprimer un sursaut.
— Ah non ! entend-on hurler.
Zamor s’est levé d’un bond en tapant du poing sur la table. Sa chaise s’en retrouve renversée sur le plancher. Le citoyen Greive, soucieux de ne pas attirer davantage l’attention de la dame Fayol, pose sa main sur celle vengeresse de son ami en lui demandant gentiment de se rasseoir. Le domestique de la Dubarry3, surpris de tant de sollicitude, se retourne afin de suivre le regard de son acolyte. Il peut à cet instant apercevoir la grosse femme qui les regarde, consternée. Embarrassé, Zamor lui sourit avec maladresse puis, tentant de reprendre son calme, lui commande à nouveau du vin. L’argent lève bien des suspicions et les assignats qu’il lui tendra tout à l’heure dissiperont d’éventuelles questions et autres indiscrétions malvenues. Il ramasse sa chaise et jette un coup d’œil en direction de la tenancière qui, sournoisement affairée à transvaser des fonds de bouteilles dans une cruche en terre, semble avoir déjà oublié l’incident qui vient de se produire.
— Il est hors de question que je t’accompagne demain matin, chuchote Zamor sur le ton de la confidence.
L’Américain ne s’attendait certainement pas à une réponse négative et encore moins aussi catégorique.
— Cela ne te ferait pas plaisir de participer à l’arrestation de celle qui se flattait d’être ta maîtresse ? Allons Zamor ! Pense au bonheur de la voir au petit matin, à la sortie du lit, échevelée, ne comprenant pas ce qui lui arrive tout d’abord, pour finalement se rendre compte que sa liberté chérie et ses privilèges illégitimes appartiennent au passé. Je t’offre de t’amender, mon ami.
— Je… je ne sais pas, balbutie Zamor.
— Rappelle-toi de tout ce temps passé à ses côtés, ou plutôt à sa suite, à la servir, l’éventer, lui ôter ses chaussures. Rumine toutes ces brimades, ces gens de la noblesse qui te touchaient la peau, les cheveux, pour apprendre comment quelqu’un comme toi était constitué.
— Je n’oublie pas. Rassure-toi. Je n’oublie pas et n’oublierai jamais.
Greive sent bien l’hésitation dominer son interlocuteur. Zamor est troublé, tiraillé entre l’envie de se venger et une certaine reconnaissance pour ces années où il ne manquait de rien et durant lesquelles l’élégante dépravée lui a inculqué une éducation digne des enfants de la Cour. Il bénéficiait des services de professeurs de français, de géographie, de musique… l’enfant d’alors devait à cette femme un peu de l’homme qu’il était devenu aujourd’hui.
L’Américain ne peut laisser le doute s’emparer de cet allié improbable, mais essentiel à son cruel dessein. Il abat donc sa carte maîtresse. Le dernier atout qui lui fera gagner à coup sûr la partie :
— N’as-tu jamais eu des nouvelles de tes parents durant toutes ces années ?
Touché ! En plein cœur !
Piqué au vif, « le négrillon » comme on l’appelle encore parfois, se remémore la journée qui changea à jamais son destin. Le jour où un capitaine anglais l’avait arraché des bras de sa mère pour l’emmener sur les océans, tel un petit singe exotique qu’on sort de son milieu naturel, afin de satisfaire la curiosité malsaine des Occidentaux. À environ huit ans, Zamor était encore un enfant. Trop jeune pour devenir adulte, mais assez vieux pour souffrir. Il avait entendu les pires horreurs durant les semaines qu’avait duré le voyage. On pensait certainement que cela lui permettrait d’oublier avec plus de facilité sa terre natale et l’innocence qu’il avait dû laisser au port. Mais où se tenait la vérité ? Où se cachaient ces réponses qu’il n’aurait jamais ? Un soir de beuverie, le capitaine anglais lui affirma que sa mère l’avait vendu contre quelques billets, tout heureuse de se faire payer pour avoir une bouche en moins à nourrir. Zamor ne l’avait pas vraiment cru. La femme qu’il connaissait n’aurait jamais fait cela ! En tout cas, il avait tenté de s’en convaincre depuis vingt ans. Vingt longues années durant lesquelles le visage de celle qu’il idolâtrait s’était effacé peu à peu de sa mémoire. Il n’était plus qu’un souvenir fugace, celui d’un sourire bienveillant et d’un sentiment de sécurité perdu à jamais au large des côtes indiennes un matin de 1771.
Greive s’impatiente devant tant d’indécision.
— Viendras-tu ?
Zamor ne souhaite pas fâcher son nouvel ami. Il doit le ménager tout en se tenant à la décision prise à contrecœur.
— Non, George. Je ne viendrai pas, mais je ne serai pas loin. Tu sais que je ne peux m’empêcher de me délecter du mal qu’elle ressentira. Néanmoins, il me faut rester le plus éloigné possible et ne pas trop afficher ma joie si nous voulons poursuivre notre surveillance.
L’Américain, d’abord perplexe, acquiesce. Il est vrai que beaucoup à Louveciennes sont acquis à la cause de l’ancienne maîtresse de Louis XV. Pour preuve, cette pétition rédigée il y a deux mois par cinquante habitants pour voir libérée la catin que lui, George Greive, l’ami de Marat, était pourtant enfin parvenu à faire arrêter. Avec l’aide de son petit club révolutionnaire, Greive se doit de tordre le cou au plus vite, à défaut de les trancher, à ces idées pacifistes qui se répandent dans la ville comme un mal insidieux qu’il faut contenir. Car s’il désire obtenir la confiance du Comité de sûreté générale, Louveciennes doit être un modèle de civisme. Il en va de la bonne marche de ses plans.
1 Le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution à Paris. L’actuelle place de la Concorde.
2 Greive, bien que sujet de la couronne britannique, était à la fois surnommé l’Anglais, mais également l’Américain, en référence à ses voyages outre-Atlantique et son implication dans l’indépendance des États-Unis.
3 Deux orthographes sont admises. Dubarry est employé surtout dans les actes révolutionnaires et par les gens qui n’ont que peu d’estime pour la dame.
2
Même s’il n’est pas parvenu à obtenir la présence de Zamor à ses côtés le lendemain, Greive n’est pas mécontent de la tournure que prennent les événements. Après deux incarcérations avortées au dernier moment, par la faute principalement des habitants, cette fois, la louve de Louveciennes finira bel et bien dans une cage. Nul doute que ses gardiens ne feront preuve d’aucune complaisance. La férocité de Greive et des membres de son club saura mater les plus modérés. Les crocs sont affûtés et le plan d’attaque ne laissera aucune chance à la proie de se défiler. La bête l’ignore encore, mais elle est acculée. Les diamants quitteront bientôt ce cou au creux duquel un roi aimait à se lover pour laisser place à la lunette de la trancheuse républicaine. La haine que Greive porte à la Dubarry n’a d’égal que la noirceur de ses cruels desseins et son amour du sang. Il attend patiemment son heure. Le dénouement est proche.
Il entend frapper. Étrange. Personne ne lui rend jamais visite dans la petite chambre qu’il occupe chez François Renault, propriétaire de l’auberge À la Louve ancienne. Se pourrait-il que Zamor ait changé d’avis ? Greive ne se perd pas en conjectures et se dirige vers la porte qui dissimule sûrement la meilleure façon, pour lui, de terminer cette journée. Hélas, la personne qu’il découvre alors n’a rien à voir avec celui qu’il a laissé au Fraternel. Blache se tient face à lui, toutes dents dehors.
— Bonsoir, l’ami ! Je viens aux nouvelles. On m’a rapporté que vous vous êtes rencontrés, Zamor et toi.
— On ne peut décidément rien te cacher, Jean-Baptiste.
Le sourire de Blache se fait davantage carnassier. L’homme de quarante et un ans jubile. Comment ne pas éprouver du plaisir lorsqu’on vous reconnaît un talent de dissimulation et une faculté d’omniscience incontestée ? Le bonhomme est en effet un espion remarquable et Jeanne du Barry s’en rendra compte bien assez tôt.
— M’offres-tu à boire ou me faut-il descendre chez l’aubergiste qui te sert de propriétaire ?
Greive attire à l’intérieur de sa chambre le visiteur à la voix aussi discrète que celle d’un marchand de poissons. Il observe alentour. Personne. Il referme la porte et fait aussitôt face à cet homme qui se donne beaucoup trop d’importance à défaut d’en avoir vraiment. Mais Greive sait composer avec ce genre d’individu et il a besoin de son témoignage pour le futur procès de la châtelaine.
— Je ne pensais pas te voir ce soir, lui dit l’Américain d’un ton teinté de reproche.
— J’aime être là où on ne m’attend pas. Ce qui, ceci dit, arrange souvent les affaires de mes amis et nuit toujours à celles de mes ennemis.
Blache ne peut s’empêcher de rire bruyamment, réduisant à néant l’espoir de discrétion d’un Greive exaspéré.
— Bon sang ! Ne peux-tu donc te taire ? éructe l’Américain. N’oublie pas que Renault, en plus d’être aubergiste est aussi officier municipal ! Tentons de ne pas rameuter le bourg et faire avorter par la même occasion la réussite de notre entreprise !
Le citoyen Blache, d’abord vexé, se ravise. Greive a raison. Il serait dommage en effet de compromettre tant d’efforts à quelques heures de l’arrestation de celle qu’il a suivie durant des mois. Cette femme, il l’a espionnée par-delà les mers pour enfin s’en revenir d’Angleterre où il donnait alors des cours de français. L’Angleterre ! Terre d’asile de tous ces aristocrates émigrés, ennemis de la jeune République. Ces têtes poudrées qui osent se réunir au grand jour pour porter à la fois le deuil d’un roi, traître à la nation, et aussi entretenir le fol espoir de rétablir privilèges et fortunes en foulant aux pieds les idéaux républicains. Le gros bonhomme s’enquiert d’un rouage important de la machine de guerre contre la Dubarry.
— Alors ! A-t-il perdu de sa tiédeur ?
— De qui parles-tu ? s’étonne Greive.
— Du corbeau qui s’est envolé de sa cage dorée.
Les petites phrases de l’espion ont souvent tendance à choquer, voire à énerver le révolutionnaire sincère qu’est l’Américain. Il faut dire qu’en France, une chose l’étonne : si le changement, l’égalité et la fraternité sont sur beaucoup de lèvres, le chemin qui mène de la bouche au cerveau demeure parfois long et tortueux.
— Si c’est de Zamor dont tu veux parler, ne t’inquiète pas ! Il reste fidèle à nos idées et à nos plans.
— Espérons, l’ami ! Espérons !
— Pourquoi ce ton ? N’oublie pas que si la Dubarry sera dans une geôle demain, on ne pourra que l’en remercier.
— Et n’oublie pas, cher Greive, que sans ma participation au procès relatant les agissements de notre ci-devant4 comtesse à Londres, un pan énorme de ton stratagème s’effondre.
Le locataire de la chambrette pauvrement meublée n’apprécie pas les insinuations du gros homme, tellement bouffi que son embonpoint menace de déchirer un gilet aussi écarlate que le visage de son propriétaire. Greive doit se méfier, il le sait. La colère qui le gagne doit certainement avoir également empourpré un peu ses joues. Il le sent au battement accéléré de sa carotide. Il lui faut se calmer. Il faut ménager cet homme dont la grossièreté et l’arrogance en feraient pourtant s’énerver plus d’un.
On frappe timidement à la porte. C’en est trop. Mais que diable ont-ils tous ce soir ?
Greive regarde Blache dont la surprise se lit sur le visage. L’Américain lui fait signe de se plaquer contre le mur afin de ne pas être vu. Le citoyen s’exécute mollement. Greive s’assure que son invité est parfaitement invisible et immobile avant d’ouvrir la porte.
Un homme à la mine déconfite et aux cheveux hirsutes se trouve devant lui. Salanave ! C’est un des domestiques de la louve qui, tout comme Zamor, est acquis à la cause révolutionnaire. Greive le fait entrer en vérifiant que personne n’a suivi son nouveau visiteur. Il fulmine. À croire qu’il n’y a que lui, ce soir, à faire preuve d’un minimum de prudence.
— Il me fallait vous parler au plus vite.
— Damned ! Cela ne pouvait donc attendre demain ?
Salanave découvre Blache à sa gauche, contre le mur. Il le salue et, essoufflé, tente d’apaiser Greive que tout le monde craint à Louveciennes.
— Excuse-moi George, mais je ne pouvais décemment pas attendre. Ce que j’ai à te confier relève d’une très haute importance.
— Je l’espère pour toi !
Le domestique se fait hésitant. Le regard implorant, il cherche des yeux le citoyen Blache qui, lâchement, préfère regarder le bout de ses chaussures.
— Et bien ? Parle ! lui intime Greive.
Penaud, Salanave tente de justifier sa présence incongrue.
— J’ai cru comprendre que la Dubarry a chargé Morin, son valet de chambre, de cacher certains de ses bijoux et d’autres effets précieux dans sa propriété de Louveciennes.
— Et d’où tiens-tu cela ? demande doucereusement Greive.
— J’ai beau avoir été congédié, j’ai toujours mes entrées au château. Et je puis vous affirmer que des citoyens y partagent nos idées et éprouvent encore une certaine amitié pour moi.
À voir la mine réjouie de ses deux interlocuteurs, Salanave comprend que le courroux de Greive ne s’abattra pas sur lui ce soir. Sa tête est sauve, pour le moment. Les yeux de l’Américain se font brillants, étincelants même. Colère ? Avidité ? Le domestique ne saurait le dire, tout comme il ne pourrait deviner qu’il vient de fournir à Greive une motivation supplémentaire d’anéantir la louve, de la faire souffrir jusqu’à l’agonie avant de l’achever sans la moindre pitié.
La battue peut commencer.
4 Se disait de personnes dépossédées de leur état, de leur qualité, de leur titre, pendant la Révolution française.
3
La nuit est tombée depuis des heures, mais Zamor n’arrive pas à dormir. La chambre qu’il occupe dans une maison de Versailles est pourtant plongée dans une obscurité totale pourtant propice au repos. Zamor attend vainement les yeux grands ouverts que le sommeil s’empare de lui, que des rêves l’invitent à l’oubli et qu’ils dissipent à l’occasion ce sentiment de malaise qui ne cesse de le ronger depuis des semaines.
Demain tout se terminera… ou tout commencera.
Terminée la vie d’esclave ! Place à la liberté, cette inconnue tant désirée, mais crainte aujourd’hui plus que tout. Il doute. La liberté est-elle envisageable sans Madame ? Comment vivre sans elle, sans cet unique repère depuis son arrivée en France ? Sans cette femme qui lui servait de point d’ancrage dans un pays aux us et coutumes si étranges, mais dont il avait pourtant fallu apprivoiser les moindres singularités. Il s’était attaché à elle, même s’il désirait parfois la quitter. Il l’aimait, même s’il l’avait souvent détestée. Madame du Barry, une maîtresse qu’on aime ou qu’on déteste, mais qu’on ne peut toutefois trahir. Du moins l’avait-il cru.
Il se revoit, vingt ans auparavant, sanglotant dans un réduit aménagé pour lui à la hâte, dans les cales sombres et humides du bateau qui l’emmenait vers la France. Il serrait dans sa main, tout comme ce soir, un bout de tissu clair. Un morceau de la robe de sa mère qui s’était déchirée lorsqu’il s’agrippait à elle au moment où on les séparait pour toujours. Il avait crié, hurlé même. Les hommes blancs avaient rigolé. Certains l’avaient même imité en gesticulant de manière désarticulée. Le petit garçon, lui, n’avait pas le cœur à rire devant ces marionnettes avinées dont il ne comprenait pas encore la langue. Ce jeu, si c’en était un, ne l’amusait pas. Il était composé de règles qui lui échappaient et les vainqueurs paraissaient peu enviables. Comment être tenté de ressembler à ces agités au comportement aussi barbare ? Comment envier des hommes qui, sous l’emprise de l’alcool, oublient toute convenance ? Peut-on se vanter d’être supérieur tandis que vos agissements semblent en parfait désaccord avec ce que vous prétendez ? Ces hommes mentaient. Zamor l’avait très vite compris. Lui avait toujours été naturel et sincère chez lui, en Inde. Il ne savait être autrement. Et pourtant…
Il lui avait alors fallu exceller dans l’art du mensonge, de la manipulation et des faux-semblants. L’innocence et l’authenticité avaient laissé place à la corruption et à l’hypocrisie. Oui, l’enfant de dix ans avait choisi ses armes. Elles seraient celles de ses adversaires, celles de ces hommes observés des semaines durant sur les océans du globe, qui faisaient allégeance devant l’autorité tout en lui crachant dans le dos. Ceux-là mêmes qui intriguaient dans le seul but de pouvoir espérer dominer leurs semblables. Oui, il agirait de la sorte pour se faire accepter. Il mettrait sa réelle personnalité entre parenthèses et deviendrait un nouvel homme pour survivre.
La main de Zamor lui fait mal. Il la regarde. Elle semble ne plus lui appartenir. Elle enserre de toutes ses forces le morceau de robe immaculé. Ses doigts engourdis mettent un certain temps à relâcher cette étreinte douloureuse. La vision se fait soudain moins nette. Son poing repose sur la couverture blanche devenue floue et qui entoure d’un halo laiteux la relique maternelle. Il sent des larmes couler de ses yeux noirs. Il ne fait pas bon plonger dans le passé. Zamor le sait, mais il ne peut pourtant s’en empêcher.
Dans quelques heures, à l’aube, sa vie sera à nouveau bouleversée. Il quittera à jamais une seconde femme qui lui est chère. Sa mère indienne doit être morte depuis longtemps. Sa mère française le sera sans nul doute bientôt. Il connaît la ténacité de Greive et, même s’il n’est pas au courant de tous ses sombres desseins, il sent bien que sa haine ne peut mener qu’à la mort de l’ancienne favorite. On a bien guillotiné le roi ! La reine, quant à elle, est emprisonnée à la Conciergerie et chacun le sait : lorsque vous êtes enfermé sous le Palais de justice, votre pied se trouve déjà sur la première marche de l’échafaud. Dans ce pays où tout va très vite et dans lequel on ne mesure pas toujours la portée d’actes souvent irréfléchis, où on assassine ses souverains, que pourrait-il donc bien advenir de l’ancienne maîtresse d’un roi ?
Zamor ne parvient pas à se rappeler le moment précis où il a pris la décision d’aider Greive dans sa funeste entreprise : causer la perte de celle dont il portait encore il y a peu la traîne de sa robe. Une chose est néanmoins certaine. Cette décision résultait d’années de frustration et d’absence de considération. Il ne demandait pas une éducation, des livres ou de beaux vêtements conçus par les meilleures modélistes du royaume. Non ! Tout ce qu’il voulait, c’était un peu de tendresse ou, à défaut, un peu d’attention. Que Madame, par exemple, prenne sa défense lorsqu’il était sujet aux railleries de ces mines blafardes aux têtes poudrées et parfumées dont les rires stridents lui écorchaient les oreilles. Au mieux, il avait eu droit à de l’indifférence. Au pire, à des moqueries encore plus cinglantes de celle qui aurait dû pourtant le défendre telle une mère. Mais trouver le bon mot, la juste formule, la phrase assassine était tellement tentant. Madame du Barry tenait salon et, de fait, tenait également son rang. Celui qu’elle avait eu tant de mal à atteindre et qu’on lui contestait sans cesse. L’arrivée de Marie-Antoinette à Versailles5 n’avait pas arrangé les choses. L’inimitié que lui vouait la dauphine était connue de toute la Cour, aussi Madame du Barry se devait de plaire à sa petite coterie et maintenir, tant bien que mal, l’intérêt qu’on lui portait. Tant pis si Zamor devait en faire les frais. Une fois les portes closes, quand tout le monde était parti et que l’enfant boudait, Madame du Barry, sans rien perdre de sa dignité, le cajolait et lui disait qu’il était aussi beau que l’amour. Mais Zamor n’était pas dupe. Il la savait davantage malheureuse que coupable. En fait, elle ne supportait pas de déplaire. Cette femme était blâmable, mais douée pour se faire aimer. Elle faisait tout pour y parvenir. Les amants, les amis et les ennemis se succédaient dans la vie de la favorite telle une ronde incessante qui pouvait parfois donner le tournis. Ce que Madame redoutait par-dessus tout était la solitude affective.
Tout le monde l’admet aisément, les petits soins entretiennent l’amitié et Madame du Barry était on ne peut plus prévenante. Zamor avait bénéficié lui aussi, des années durant, des bienfaits de sa maîtresse. Il ne compte plus les costumes complets commandés chez madame Lejeune, monsieur Carlier ou auprès des différents fournisseurs de la Cour. Il se souvient en particulier d’un habit de hussard gros de Naples bordé d’un galon d’argent porté avec un bonnet à plumes, un ceinturon et un sabre. Il était magnifique dans cet uniforme et forçait l’admiration des dames qu’il rencontrait. La poupée Zamor faisait alors son petit effet.
Madame offrait, distribuait. Sans être naïve, elle préférait passer sous silence certaines trahisons, dont on lui avait pourtant soufflé mot, afin de ne pas éprouver l’ennui et la tristesse qu’accompagne inexorablement la solitude. Malheureusement pour Zamor, sa maîtresse fut moins conciliante lorsqu’elle réalisa que son petit protégé, celui qu’elle avait fait baptiser, l’avait trahie.
Elle s’était rendu compte du changement de comportement de Zamor. D’abord son audace et son irrespect, hier prétextes à plaisanteries avec les invités, étaient perçus à présent comme provocations et pensées révolutionnaires. D’ailleurs, la femme Couture, femme de chambre de Madame du Barry, avait trouvé à plusieurs reprises des livres de Rousseau et des journaux hostiles à l’ancien régime dans la pièce qu’occupait le domestique. Évidemment, elle n’avait pas tardé à en avertir sa maîtresse. À vrai dire, celle-ci avait bien décelé un regain de défiance, voire de rejet de toute forme d’autorité. Elle ne l’entendait désormais jurer que par Le Contrat social de Rousseau et autres ouvrages contestables des Lumières. Zamor discutait de démocratie, de peuple souverain à l’origine de la vie collective. Hélas, la comtesse n’y prêtait qu’une oreille amusée. Que de chemin parcouru en effet depuis l’arrivée du petit esclave à Versailles ! Dorénavant, l’étranger parlait parfaitement le français et l’illettré d’hier faisait maintenant dans la philosophie, clamant haut et fort que « les peuples se sont donné des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir6 ». Elle aurait encore pu supporter un moment l’irrévérence de son protégé et ses lectures infamantes, mais de là à tolérer la trahison !
Déception, tristesse et colère s’étaient invitées dans son cœur, un matin du mois d’août 1793, à la lecture de l’œuvre de ce Greive qui l’avait prise pour cible7. Certains détails consignés dans ce papier aux relents nauséabonds ne pouvaient être connus que du seul Zamor. Elle l’avait par conséquent convoqué dans le grand salon. Elle se tenait debout devant lui dans une robe peignoir de percale ivoire. Malgré un léger embonpoint et ses cinquante printemps, la châtelaine était encore très belle. Ses cheveux cendrés et bouclés tombaient sur ses épaules. Ses yeux étaient allongés, pas entièrement ouverts. Mais son regard bleu était glacial. Elle lui envoya la prose de Greive à la figure.
— Qu’est-ce que ceci ?
Zamor avait ramassé paresseusement les feuilles de la discorde.
— Une littérature qui, ma foi, semble fort déplaire à Madame la Comtesse.
— Explique-toi !
— Je ne puis vous expliquer ce que je n’ai pas lu.
— Nul besoin de lire ces lignes immondes qui transpirent la haine et l’ambition personnelle. Je sais que tu l’as rencontré.
— Et avec qui me serais-je entretenu, Madame ?
Madame du Barry ne se contenait plus.
— Tu vois très bien de qui je parle. Cet Américain. Ce Greive.
L’instant était grave, mais Zamor avait souri. Ce qui n’avait fait que décupler la colère de sa maîtresse.
— Comment oses-tu ? N’as-tu point reçu une éducation ? Ne t’ai-je point choyé ?
— Sur ce dernier point, Madame, souffrez que je me porte en faux.
La femme fut piquée au vif. Elle fit un pas en direction de Zamor, puis se ravisa. Elle tentait de garder le contrôle d’elle-même et de ses émotions qui l’avaient, par trop de fois, dirigée.
— Vous m’avez choyé comme on dorlote un carlin ou une perruche venue des îles. Tel un animal, vous avez voulu m’apprendre des tours pour épater vos amis. Je suis devenu, au fil des ans, un singe savant à la Cour de Versailles. Le négrillon bien dressé et bien appris. Le bouffon du roi parfois. Que n’auriez-vous fait pour plaire à Sa Majesté, quitte à ridiculiser celui que vous dites avoir choyé comme un enfant ? Puis, le carlin grandissant, il devint encombrant voire sans intérêt. Vous vous en êtes détachée, n’hésitant pas à le laisser ici avec vos gens lors de vos voyages en Angleterre. « À la niche Zamor ! » Je n’existais plus. Et voilà bien longtemps, hélas, que je n’existe plus à vos yeux.
Les yeux d’acier de Madame du Barry s’étaient embués. Colère ou regrets ? Zamor, même aujourd’hui, ne le sait pas. Elle s’était tournée face à la cheminée. Il ne pouvait voir que le dos de cette silhouette immobile, bras allongés, droits et raides, le long du corps. Un imposant silence s’était ensuivi. Puis deux coups à la porte. Madame se racla la gorge et invita d’une voix tremblante l’opportun à entrer. C’était Denis Morin, son valet de chambre. Zamor méprisait cet individu de grande stature âgé de quarante-neuf ans. Il était de tous les secrets, de toutes les confidences. Zamor le détestait, car il l’enviait.
— C’est fait, Madame.
— Merci Morin. Vous pouvez disposer.
Le domestique sortit à reculons et ferma la porte, laissant Zamor face à ses responsabilités. Le petit esclave, devenu un homme de trente et un ans, avait soudain eu peur de comprendre ce qui était en train de se passer.
— Quoi ? Qu’est-ce qui est fait ? Que me cachez-vous ?
Rien. Le silence.
— Mais enfin, répondez ! hurla-t-il d’une voix brisée.
Les épaules de la louve se soulevèrent dans une profonde inspiration.
— Vous trouverez vos effets à la grille du château. Je ne souhaite plus vous voir chez moi, Monsieur.
Le vouvoiement se teinta de la couleur du mépris.
— Vous ne pouvez me jeter dehors comme un malpropre.
— Vous l’avez dit vous-même. L’animal est devenu encombrant et n’a d’intérêt que pour la haine que je lui porte.
La tête de Zamor se mit à bourdonner. Ses membres tremblaient.
— Vous voilà froide comme la mort.
— La faute à qui, Monsieur ? Je vous ai tout donné et pourtant, vous n’avez pas hésité à mordre la main de celle qui vous a nourri et caressé. Vous avez choisi votre camp. Nous n’avons donc plus rien à nous dire.
— Soit. Mais sachez que dorénavant, le clan de vos ennemis sera toujours le mien. Vous me chassez de votre maison et de votre vie ? Très bien. Mais j’y reviendrai par des moyens différents et vous regretterez à ce moment l’humiliation que vous venez de me faire subir.
— Des menaces ?
— Certes non. Vous l’avez dit. J’ai choisi mon parti. Tout comme vous. Mais vous en paierez le prix. Ce que vous avez lu n’est qu’une infime partie des secrets vous concernant et dont je suis le détenteur.
La comtesse fit volte-face.
Elle soutenait le regard de cet enfant qui avait grandi bien trop vite.
— Sortez ! Hors de ma vue !
Zamor ne baissait pas les yeux. Était-ce par défi ou pour inscrire dans sa mémoire le visage de celle qu’il allait quitter ?
— À bientôt, citoyenne !
Les traits impassibles, il demeura immobile quelques secondes, puis s’en retourna en claquant la porte. Morin et bon nombre de domestiques l’attendaient, silencieux, dans le vestibule. Combien d’entre eux avaient espéré ce moment ? Tous des comploteurs ! Il saurait s’en souvenir le temps venu. Il ne les avait pas même regardés. Il avait marché droit devant lui jusqu’aux grilles du château où étaient posés deux sacs. Il ne chercha pas à en vérifier le contenu. Il fallait partir. Partir pour ne pas pleurer. Partir surtout pour ne pas demander pardon.
Il avait été fort, même si les premiers temps, il en avait voulu à Greive d’avoir utilisé des confidences qui l’avaient compromis. Mais, au final, l’Américain n’avait fait que précipiter l’inévitable.
Zamor est ramené au présent de manière soudaine. Un bruit dans la rue, en bas. Il se lève et traverse la pièce pour gagner vivement la fenêtre. On le regarde. Une ombre qui s’enfuit. Un homme. Il a du mal à le distinguer clairement. La lune est pleine, mais l’individu court. Il porte un chapeau. Il claudique et s’appuie sur une canne. Il est donc surveillé ! Mais par qui ?
Voilà des semaines que Zamor poursuit de sa haine la Dubarry et ses gens. Il les guette, les épie. Le chasseur deviendrait-il donc la proie ? L’appui de Greive et des sans-culottes de Louveciennes ne peut le protéger de tout. Zamor détient des secrets susceptibles d’envoyer bon nombre de gens devant Fouquier-Tinville, l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire. Le silence est d’or, paraît-il, mais rien n’est plus précieux que la vie.
5 En mai 1770.
6 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755, Œuvres complètes, « La Pléiade » III.
7 L’égalité controuvée, ou petite histoire de la protection, contenant les pièces relatives à l’arrestation de la du Barry, ancienne maîtresse de Louis XV, pour servir d’exemple aux patriotes trop ardents, qui veulent sauver la république, et aux modérés, qui s’entendent à merveille pour la perdre. Bibliothèque nationale, LB41-763.
4
Deux silhouettes marchent précipitamment dans le parc du château de Louveciennes. L’une d’elles est grande et fine. La seconde, au contraire, petite et plus en formes, fait deux pas tandis que la première n’en accomplit qu’un. Elles se trouvent non loin de la glacière au toit de dalles décroissantes, près du bâtiment où l’on entrepose les outils pour le jardinage et l’entretien du parc. Elles ouvrent la porte et la clarté du jour naissant se fait dans la bâtisse exiguë.
Denis Morin allume une lanterne et se retourne vers Madame du Barry qui, le cheveu ébouriffé, tente de reprendre son souffle. Autour d’eux, tout n’est qu’objets entassés, désordre et poussière. Pourtant, la comtesse et son valet viennent en ce lieu dans un but bien défini : sauver ce qui peut encore l’être. La femme désigne une brouette reposant à même le sol.
— Retournez-la ! Puis saisissez-vous de la pelle contre le mur !
Morin s’exécute. Les gestes sont rapides et précis. Sous la brouette, il aperçoit une corbeille en osier à côté de laquelle se trouve un drap contenant différents objets. Il se penche pour ramasser le linge, mais sa maîtresse l’a déjà attrapé par le bras.
— Un instant, voulez-vous Morin ? Juste un instant.
Le domestique recule d’un pas et laisse Madame du Barry s’agenouiller, avec toute la grâce dont elle est capable, au chevet de ses trésors agonisants. Elle défait délicatement le coupon de lin que la terre a, par endroits, sali. À la lueur de la lanterne posée au sol, la pièce s’illumine, l’orfèvrerie étincelle. La comtesse caresse du bout des doigts un plateau de porcelaine monté en or qu’accompagnent une théière, une bouilloire, un pot au lait, une cafetière et d’autres éléments de vaisselle du métal le plus pur que les mains humaines n’ont jamais travaillé. Elle ouvre la petite malle d’osier. Là, argents et bijoux échapperont, pour un moment encore indéterminé, aux regards des hommes. La terre recouvrira bientôt ces trésors qu’on lui reproche de détenir. Des centaines de louis d’or, des colliers de diamants, des boucles d’oreilles, des rubis, des perles et un portrait, celui du roi Louis XV dans son cadre doré.
Les doigts fins de l’ancienne favorite parcourent ce visage caressé tant de fois, ces lèvres maintes fois embrassées et ces yeux où les siens se sont si souvent plongés. Elle pleure sur ce roi qui l’avait aimée, sur Sa Majesté qui l’avait soutenue contre tous, elle, la fille de peu.
Elle avait vu le jour à Vaucouleurs d’un père qu’elle n’avait pas connu et d’une mère domestique. Les rues de la petite ville de l’Est du royaume avaient été foulées par une autre Jeanne bien plus célèbre, trois cents ans plus tôt. Une pucelle que l’on disait bergère et qui brûla vive sur la place de Rouen à seulement dix-neuf ans. Elle, Jeanne Bécu, arriva à Paris et devint vendeuse dans une luxueuse boutique de mode. Mais elle tomba très vite sous la coupe de Jean du Barry, un intrigant qui comptait utiliser les charmes de cette belle provinciale, rebaptisée mademoiselle Lange, pour asseoir sa situation et s’enrichir de manière fort peu recommandable. La fille n’était pas farouche et facilita la tâche à son nouveau protecteur. Jouant de ses relations, il ne tarda pas à trouver le moyen de lui faire décroiser les jambes et de rencontrer la route du roi qui, charmé, s’empressa de l’installer près de lui, à Versailles. Leur histoire avait été belle, leur amour sincère. Hélas, les jours heureux s’en étaient allés avec le souverain dans un cercueil enseveli à Saint-Denis.
— Ah ! Louis ! Tout était si simple à l’époque, n’est-ce pas ?
Denis Morin peine à entendre distinctement ces mots murmurés, destinés à verbaliser la peine d’une amante nostalgique. Aucune importance. La discrétion du domestique lui aurait fait aussitôt oublier ces paroles qui ne lui étaient pas adressées. La comtesse dépose consciencieusement le portrait du bien-aimé au-dessus des richesses que contient la boîte et en referme délicatement le couvercle.
— Morin, creusez un trou pour ensevelir tout ceci, voulez-vous ! Allez dans ce coin par exemple. Nous y mettrons ensuite des outils pour dissimuler la terre que nous aurons retournée.
— Bien, Madame.
L’homme aux cheveux châtains et au nez pointu8 se dirige vers l’endroit que vient de lui indiquer sa maîtresse. Il retrousse les manches de son habit et donne le premier coup de pelle. Le terrain est meuble. Il n’aura pas trop de peine à accomplir sa tâche. Madame du Barry, inquiète, regarde alentour. Elle a pleine conscience qu’elle demande à son valet de chambre de se rendre complice d’un acte antipatriotique. Mais Morin a insisté et lui a proposé son aide en promettant le silence absolu sur toute entreprise délicate qu’ils commettraient. Les gens qui lui sont encore dévoués se comptent sur les doigts d’une main et elle s’en veut de leur faire prendre tant de risques.
Les coups de pelle cessent. Morin s’empare de la boîte en osier, la dépose au fond du trou qu’il vient de creuser et place au-dessus de celle-ci le linge renfermant la précieuse vaisselle. Après quelques pelletées, et plusieurs objets déplacés afin de masquer cette tombe aux richesses insoupçonnées, il se tourne vers la femme vêtue d’un manteau de robe en dentelle noire. Il la regarde avec un air de conquête, sourire aux lèvres, fier du travail accompli.
— Autre chose, Madame ?
— Oh non, mon cher Morin ! Vous n’en avez fait déjà que trop. Quand je pense que je me suis laissé convaincre de vous faire courir tant de risques.
— Ce ne sont des risques uniquement pour ceux qui ne vous accordent aucune confiance.
— Mais de là à me proposer ces jours derniers de mettre en terre, chez vous, dans votre propre jardin, des choses qui pourraient vous compromettre !
— Ce ne sont que quelques pièces et une boîte en or.
— Une boîte en or sur laquelle figure le portrait de la reine. Comme si l’argent d’une favorite ne suffisait pas à vous perdre et, peut-être, à vous envoyer à la mort ! Vous avez insisté en plus pour y déposer cette boîte d’écaille montée en or à l’effigie de la femme la plus détestée du pays.
Jeanne prend soudain conscience que celle qui figure en deuxième position sur cette liste honnie, c’est… c’est elle ! Reine et favorite se disputent la première place d’un classement motivé par la haine, la violence et le meurtre. Elle espère secrètement que cette soif de sang aura été rassasiée par la mort de Louis XVI, le 21 janvier, et que le peuple de Paris ne s’en prendra pas à deux femmes malheureuses et innocentes. Elle ne peut que se remémorer ce trait d’esprit que tous reprennent inlassablement depuis des années :
France, quel est ton destin,
D’être soumis à la Femelle ?
Ton salut vint d’une Pucelle,
Tu périras par la catin9.
Elle devrait partir, s’emparer de toutes ses richesses qu’elle tente de dissimuler et s’en aller très loin, mais Madame du Barry n’est pas de celles qui s’enfuient. Elle ne s’est toujours rendue en Angleterre qu’avec l’autorisation du Comité et munie de papiers en règle. Des voyages incessants à l’étranger afin de régler au mieux cette affaire de bijoux que l’on avait dérobés chez elle, une nuit de janvier 1791. Elle se trouvait alors à Paris, chez le Duc de Brissac10. Un homme qui lui vouait un amour passionné, sans limites aucunes et que des révolutionnaires ont sauvagement massacré il y a déjà un an. L’horreur avait atteint son paroxysme lorsque cette bande d’égorgeurs était venue jusqu’à Louveciennes et avait jeté, par la fenêtre ouverte du salon, la tête de l’être aimé.
On ne meurt pas de douleur et c’est mieux ainsi, car la femme éplorée aurait été foudroyée sur place. Une nuit comme celle-ci, elle était allée dans son jardin et avait enterré la tête de celui qu’elle adorait, seule avec son désespoir. Triste fin d’un pair de France, gouverneur de Paris et capitaine-colonel des Cent-Suisses de la garde du roi, mis en terre sans les égards dus à son rang et aux services rendus à la Couronne.
— Madame la Comtesse a-t-elle encore besoin de mes services pour ce soir ?
— Non, mon bon Morin. Je crois que nous avons caché tout ce qui pouvait l’être. Êtes-vous sûr de ne point vouloir déposer ici, chez moi, les différents effets que vous avez emportés chez vous ? Cela serait plus raisonnable. Il me semble que vous êtes le gardien de bien plus de trésors que vous ne me l’avez dit tout à l’heure.
Le grand gaillard paraît gêné.
— Je ne souhaitais rien vous dissimuler, Madame. Loin de moi l’idée de vous voler.
Jeanne doit lever toute ambiguïté, et tout de suite.
— Non, non, mon bon Morin ! Ne vous méprenez pas ! Je ne fais que souligner les risques inconsidérés que vous prenez pour moi. Je n’oublierai jamais la gentillesse que vous me témoignez.
— Je suis attaché à la maison du Barry depuis vingt-cinq ans et n’entends pas cesser de vous servir.
— D’autres l’étaient depuis de longues années aussi et n’ont pourtant pas sourcillé lorsqu’il leur a fallu me trahir ou me menacer.
Jeanne prend subitement cet air absent que Morin ne voit que trop ces derniers jours.
Zamor ! Comment a-t-elle pu être aveugle à ce point ? Elle se souvient maintenant combien il était joyeux à cette horrible soirée du 6 octobre 1789 quand le peuple de Paris ramenait, triomphant, la famille royale de Versailles aux Tuileries. Zamor était démocrate, mais un démocrate cesse-t-il d’être reconnaissant ? Doit-il être ingrat, traître et dénonciateur ?
— Rentrons, mon fidèle Morin ! Vous ne me volez pas et n’avez pas volé non plus le sommeil que je vois s’emparer, peu à peu, de vos magnifiques yeux gris.
Denis Morin, fils d’un vigneron d’Auteuil, mais homme de confiance de cette femme apeurée et mélancolique, lève la lanterne jusqu’à sa bouche afin de souffler sur la flamme vacillante. Les deux silhouettes, discrètes mais rapides, traversent à nouveau le jardin sans se douter qu’ils savourent un de leurs derniers instants de liberté.
8 Sur le registre d’écrou de la prison de la Force (Archives de la Préfecture de police), il est dit que Morin, valet de chambre de la Dubarry a une taille de 5 pieds 8 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez pointu, bouche moyenne, menton rond, front haut dégagé, ovale et plein.
9 Anecdotes sur Madame la Comtesse du Barry, Londres, 1776.
10 Louis Hercule Timoléon de Cossé-Brissac, duc de Brissac (1734-1792). Amant de Madame du Barry depuis environ dix ans, il fut égorgé lors du transfert des prisonniers d’Orléans à Versailles.
5
L’aube ne va pas tarder à se lever sur Versailles. Séraphin Dampierre est chez lui, assis devant la cheminée qu’il vient d’alimenter d’une énorme bûche. L’homme de quarante-deux ans est rentré depuis quelques minutes, sans bruit, en prenant soin de ne pas réveiller sa famille qui dort à l’étage. Nicole, son épouse, ne s’offusque pas de ses sorties nocturnes. Il en va ainsi depuis qu’ils se sont mariés, il y aura bientôt quinze ans. Elle ne remet pas en cause la fidélité de Séraphin, nulle crainte à avoir de ce côté-là. D’ailleurs, elle lui voue une confiance aveugle. Séraphin lui a très vite expliqué la raison de ses longues escapades : un besoin.
De nature curieuse, il aime se promener dans les rues de la ville, le soir, une fois que tout le monde est rentré. Il affectionne particulièrement épier les gens chez eux, dans leur intimité, quand ils croient être à l’abri des regards indiscrets sans soupçonner que là, tapi dans l’ombre, un homme scrute leurs moindres faits et gestes, leurs moindres manies. Il fait cela, car il aime le genre humain et cherche à le comprendre davantage. Il se défend d’être immoral. Voir des couples s’étreindre, que ce soit avec amour ou de manière bestiale, très peu pour lui. Ce n’est pas ce qu’il recherche lors de ses promenades. Il souhaite simplement saisir et interpréter certains comportements. Ses semblables le fascinent. Il a tenté de l’expliquer un jour à Nicole. Elle lui avait dit avoir compris. Il savait très bien qu’il n’en était rien, mais il s’était accommodé de cet accord tacite. De toute façon, il ne lui en demandait pas davantage.
Il arrivait parfois à Séraphin de s’attacher à certains des gens ainsi observés. Il revenait alors souvent les voir. Il ne savait pas lire et pourtant, toutes ces personnes lui racontaient des histoires ; grâce à elles, il pouvait laisser vagabonder son esprit. Ici un homme trompé, là une femme malmenée par un mari porté sur la bouteille qui, de fait, levait un peu trop lourdement la main sur son épouse. Là encore, un domestique volant ses maîtres. Les situations étaient souvent cocasses, parfois drôles, mais aussi tragiques.
Il s’interdisait pourtant d’intervenir. C’était une règle qu’il s’était imposée et qu’il n’avait jamais transgressée. Pas même la fois où une mère, dont le mari venait de mourir dix jours plus tôt et qui, de désespoir, le ventre tordu par la faim, avait étreint sa fille d’environ deux ans avant de l’étouffer à l’aide d’un traversin. Il avait regardé les mains de la petite agripper les cheveux de sa maman qui pleurait alors qu’elle ôtait la vie de cette enfant qu’elle aimait pourtant plus que tout. La fillette n’avait pu voir l’immense tristesse de son bourreau comme Séraphin avait été en mesure de la voir. Le paroxysme du désespoir. L’infanticide de l’amour. Après avoir sangloté plusieurs dizaines de minutes sur le corps refroidissant de son bébé, la mère s’était égorgée à l’aide d’un modeste couteau de cuisine. La volonté d’en finir était certaine, mais le geste mal assuré. La jeune femme avait agonisé là, lentement, en serrant contre elle celle dont elle avait abrégé les souffrances pour la soustraire à la faim et à une vie promise à la pire misère.
En rentrant chez lui, cette nuit-là, Séraphin était monté embrasser ses fils. Les temps étaient terribles et incertains, mais il s’était promis alors de tout faire pour ne jamais en arriver à cette extrémité. Lui, le rémouleur de Versailles, aiguiserait autant de couteaux, de ciseaux et toutes lames que ses mains supporteraient afin de pouvoir subvenir aux besoins de cette famille qu’il chérissait tant.
Il n’ira pas se coucher. Tant d’événements se dérouleront aujourd’hui, il en est certain. Ce qu’il a vu cette nuit n’annonce rien qui vaille. Des choses se trament à Louveciennes et ici même, à Versailles.
Soudain, Séraphin entend des bruits de pas dans l’escalier. Ceux de Nicole. Il pourrait les reconnaître entre mille. Légers et délicats, voire aériens. Elle n’a pas pris la peine de s’habiller et apparaît devant son mari dans une fine chemise de coton. Le jour qui se lève révèle les courbes encore belles de son épouse, pourtant mère de trois enfants. Séraphin oublie un instant ses angoisses et ses craintes sur ce nouveau jour, sur cette nouvelle ère qui commence. Elle ne le sait pas, mais Nicole est celle qui l’empêche de sombrer dans la folie. Les hommes lui font peur. Il a beau tenter de les comprendre, il a l’impression de ne plus y parvenir. Ah ! Nicole ! soupire-t-il.
Il quitte sa chaise et prend dans ses bras la femme qu’il aime à en perdre la raison. Séraphin peut sentir le parfum enivrant de sa peau. Il l’embrasse dans le cou, parcourt sa silhouette de ses mains fiévreuses, cherche sa bouche. Son corps tout entier la réclame. Il ne veut qu’elle. Elle et pas une autre. Il la serre contre lui. Dès lors, nul doute possible sur ses intentions. Les baisers se font moins tendres, les caresses fortement insistantes. Abandonnée, Nicole s’offre à son époux. Ses pieds ne touchent plus le sol. Séraphin la porte sur la table. S’allonge sur elle. Sa main droite, impatiente, nerveuse et tremblante descend le long de la jambe de celle qui le désire ardemment. Il remonte la fine chemise. Sa main heurte quelque chose contre la table. Sa canne à pommeau d’argent. Celle que son père lui a offerte avant de mourir et sans laquelle il ne se déplace plus. Cette même canne que Zamor a pu apercevoir tout à l’heure de sa fenêtre.
6
Louveciennes sort peu à peu de sa torpeur. Les cheminées fument à nouveau et les fenêtres s’illuminent sur des rues encore désertes. Enfin pas tout à fait, car Greive se trouve déjà à quelques pas du château de Madame du Barry. Il est assisté de deux gendarmes, du juge de paix, du maire Louis Ledoux ainsi que de plusieurs officiers municipaux. Quelques femmes les accompagnent. Il relit, une dernière fois, l’ordre tant attendu reçu du Comité de sûreté générale.
« Le Comité arrête que la femme nommée Dubarry, demeurant à Louveciennes, sera arrêtée et conduite à la maison de Sainte-Pélagie, à Paris, pour y être détenue par mesure de sûreté générale comme suspecte d’incivisme et d’aristocratie. Les scellés seront mis sur ses effets, perquisition sera faite de ses papiers. »
L’Américain, radieux, regarde le château. Les précédentes tentatives avortées ne sont plus que de mauvais et lointains souvenirs. Cette fois-ci, l’aristocrate croupira en prison et aura droit à un procès. Elle ne lui échappera plus. Le Comité l’a chargé de la capture. Il poursuit sa lecture : « Comme pour l’exécution du présent arrêté le citoyen Greive, qui est autorisé à requérir même la force armée si besoin est ; au surplus, le citoyen Greive fera arrêter et conduire à Paris, pour être fermés par mesure de sûreté générale, dans la maison de la Force, toutes les personnes qui se trouveraient à Luciennes11 chez ladite Dubarry au moment de l’exécution du présent arrêté. »
Voici qui devrait faire plaisir à Zamor. Tous les domestiques qui le toisaient durant toutes ces années – ceux-là mêmes qui n’hésitaient pas à lui jouer de mauvais tours dès que la maîtresse n’était pas là –, tous connaîtront bientôt les geôles de la République. Terminée la vie de château. Finis les privilèges dus à la bonté d’une maîtresse aux comportements antipatriotiques dont ils étaient les témoins silencieux. Plus de nuits installés confortablement dans la douceur de draps de coton ou de flanelle. La paille, sale et grouillante de vermine, suffira à accueillir dorénavant leur noirceur d’âme et leurs rêves insensés de liberté.
Greive plie soigneusement l’ordre du Comité, le place dans la poche de sa veste, prend une profonde inspiration et lance l’ordre de marche, sans même se retourner vers ceux qui l’accompagnent :
— Citoyens ! En route pour servir la liberté, l’égalité et la République, une et indivisible !
Le terrible convoi se met en branle. Les pas résonnent sur le pavé, brisant le silence matinal et douillet de la petite commune jusque-là si calme, où la douceur de vivre s’accordait aux bontés de Madame du Barry.
Greive aperçoit une ombre derrière un des marronniers qui bordent la rue, face au château. Qui cela peut-il être ? Sûrement quelqu’un ayant quelque grief à se reprocher pour se cacher ainsi tel un conspirateur. Il faut en avoir le cœur net et couper court à toute tentative destinée à prévenir la Dubarry. On peut même imaginer le pire ! Cette personne se tient peut-être en embuscade pour attenter à la vie de ces républicains venus faire leur devoir de bons patriotes et tenter de libérer la Dubarry.
Greive presse le pas. Le convoi, imperturbable, suit la cadence imposée. Il se rapproche du suspect. On en distingue la silhouette. Le visage lui semble familier.
Zamor ! Ce n’est que Zamor ! Greive, discrètement, détourne la tête tandis que la petite silhouette tente de mieux se soustraire à la vue de ces hommes en armes.
Le harceleur de la Dubarry ne peut s’empêcher de sourire. Il est donc venu. Plus aucun doute n’est permis quant à la fin de l’histoire, désormais. Plus de volte-face possible. Zamor est, et demeurera, son allié. Il en est certain. Voici une bien belle journée qui commence ! Un des témoins à charge, essentiel à l’agonie de la catin vieillissante, a définitivement choisi son camp. Blache avait tort et lui, l’Américain, l’étranger, avait raison, une fois encore. Il avait tout de suite compris le rôle que pouvait tenir ce petit homme de couleur dans la fin annoncée de l’immonde créature. Ses intuitions ne l’avaient que rarement trompé. Le doute insidieux, pernicieux qui habitait, hier encore, l’esprit « du jouet exotique » de la sournoise cajoleuse, ne l’avait jamais fait douter de l’épilogue heureux de cet épisode qui n’avait que trop duré. Les habitants de Louveciennes auraient beau signer des pétitions, se lamenter sur la perte de celle qui ne manquait pas de les aider en distribuant argent et vivres, rien n’y ferait cette fois. La sinistre procession était en marche. Le tombereau était prêt. La lame affûtée. Le rôle de la victime serait bientôt attribué. Nul besoin d’audition. Elle était toute désignée et ne le savait pas encore. Greive, ce coup-ci, avait tout écrit, tout prévu, tout préparé. Scrupuleusement. Avec la plus grande minutie.
Fermée ! La grille du château est fermée.
Qu’à cela ne tienne ! Greive interpelle sans ménagement le domestique qu’il peut apercevoir de l’autre côté de l’imposant ouvrage de fer. Penaud, celui-ci s’avance vers l’Américain impatient et fébrile.
— Ouvre la porte ! Ordre du Comité !
Le pauvre valet ne demande même pas à voir l’ordre écrit. La présence des gendarmes lui suffit à prendre pour argent comptant ce qui vient de lui être ordonné et à lui faire ouvrir, sans délai, la lourde grille. La petite troupe trépigne et n’attend pas ; elle s’engouffre sans tarder, la porte demi-ouverte, afin de ménager l’effet de surprise. Peine perdue, Madame du Barry, en chemise, intriguée par le bruit et l’affolement de ses gens, se précipite à la rencontre des importuns. Ses pas foulent les graviers de l’allée située entre le mur d’enceinte et le petit étang. Jeanne s’arrête net en apercevant Greive, le sourire carnassier, en tête du convoi.
— Citoyenne ! Nous sommes là par ordre du Comité. Tu es en état d’arrestation !
La châtelaine est abasourdie.
Elle n’en est pas à sa première arrestation, mais cette fois-ci, elle devine qu’il lui sera difficile d’échapper aux griffes du vautour américain. Elle n’a pas même le temps de s’interposer ou d’ouvrir la bouche. Elle n’existe pas. Elle n’est plus rien. Greive la bouscule et entre dans le château sans y être invité. Les deux militaires encadrent la propriétaire des lieux. Nulle hésitation. Il semble que Greive sache où se rendre. Il monte à l’étage et se dirige vers la chambre de la Dubarry. Le lit est encore défait. Les draps froissés jonchent le sol et témoignent de la précipitation avec laquelle la maîtresse de maison s’est levée. Les volets sont toujours clos. À la lueur des chandelles, le mandataire de la République fait quelques pas en direction du secrétaire marqueté en bois de rose. Fermé !
— La clef ? lance-t-il à la femme médusée.
Aucune réponse. Aucune collaboration à attendre. Greive fait un signe de tête à l’un des deux gendarmes qui entourent la prisonnière. Ce dernier s’approche aussitôt du petit meuble et utilise sa baïonnette comme levier. Le secrétaire cède facilement. Le gendarme recule et reprend sa position auprès de la ci-devant comtesse. Greive jubile.
— Tu vois, citoyenne, avec ou sans ton aide, le peuple vaincra.
— Le peuple, monsieur, ne s’abaisserait pas à employer de tels procédés colportant le déshonneur et l’infamie.
— Ah ! Et que connais-tu du peuple ? Car si je te sais experte en caresses et autres contorsions royales, je ne pensais pas qu’il t’arrivait parfois de perdre un peu de ta hauteur pour daigner considérer ce petit monde insignifiant où nous évoluons.
— Vous ne savez pas ce que vous dites. Dois-je vous rappeler que je jouis de l’estime des gens de Louveciennes ? La pétition signée en ma faveur n’en est-elle pas la plus flagrante des preuves ? J’ai fait dans cette ville beaucoup plus de bien que vous n’en ferez jamais dans toute votre vie.
La provocation est explicite. Greive fulmine. Il se rue vers le secrétaire et l’ouvre avec rage. C’est alors que Madame du Barry échappe un instant à la surveillance des deux gendarmes. Elle se précipite vers l’Américain qui brandit déjà les documents trouvés dans le meuble. Elle les lui arrache des mains. Ses gardiens la saisissent par les bras. Les documents lui échappent et jonchent à présent le sol. Greive, tout en soutenant le regard perdu de la citoyenne du Barry, ramasse les pièces tant convoitées12.
— Une objection peut-être ? demande-t-il en souriant.
Jeanne ne répond pas. Elle aurait dû brûler ces papiers avec le reste la nuit dernière. Elle y avait pensé, certes, mais elle ne s’attendait pas à ce que tout aille si vite. Elle n’ignorait pas la ténacité de Greive, mais les autorités révolutionnaires s’étaient montrées cette fois plus promptes que d’ordinaire à suivre les intentions malhonnêtes de ce roquet. L’arrivée de huit nouveaux membres au Comité de sûreté générale, dix jours auparavant, ne devait pas être étrangère à ce revirement aussi soudain qu’imprévisible. Greive aura certainement profité de cette nouvelle composition pour renouveler ses plaintes contre elle.
La panique se lit sur le visage de Jeanne tandis que le triomphe et la satisfaction rendent encore plus arrogant et ignoble celui de l’homme qui la menace. Madame du Barry connaît la cruauté de cet étranger qui n’a d’égal que son incroyable ambition. Pour la première fois peut-être, Jeanne craint pour sa vie.
— Emmenez-la !
— Où me conduisez-vous ?
Greive, d’humeur démonstrative, voire théâtrale, se tape le front de la main droite et lance de manière ironique :
— Suis-je bête ! Tu n’as pas lu l’ordre du Comité. Pour toi, ce sera la prison de Sainte-Pélagie et celle de la Force pour tes gens.
— À Paris ?
— Oui citoyenne. À Paris ! Tu seras ainsi plus proche du Tribunal révolutionnaire pour assister à ton procès, ricane-t-il.
— Quel procès ? Pourquoi ?