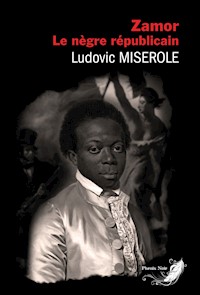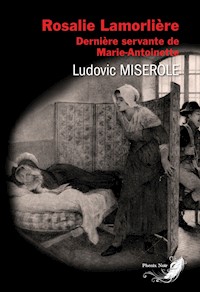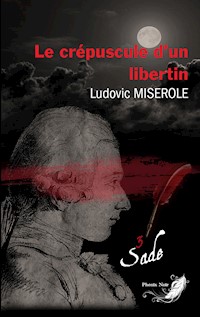Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: IFS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Elle se sait condamnée, victime, comme tant d'autres, de la cruauté des hommes. Ce soir, la belle d'antan vit ses dernières heures. Incapable de bouger, et encore moins d'appeler à l'aide, elle les entend, à la porte, discuter de la façon dont ils vont se débarrasser d'elle. Résignée, elle n'a d'autre choix que de se préparer à l'inévitable en se remémorant les jours heureux partagés avec Maupassant, Massenet, Hugo et tant d'autres, ces fantômes d'une gloire révolue. Et si de son histoire dépendait justement son salut. Et si...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Depuis des années, Ludovic Miserole prend plaisir à raconter le destin de gens ordinaires ayant vécu des choses extraordinaires. Avec La belle de Caux, l'auteur ne déroge pas à cette règle qu'il s'est fixée. Embarquez dans cette nouvelle histoire dans laquelle le devoir de mémoire se fait ressentir à chaque page.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À ma grand-mère, Andréa.
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort : c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. »
Jean d’Ormesson lors de son discours de réception à l’Académie française, le 6 juin 1974
PROLOGUE
Je suis de celles qu’on ne remarque plus, malgré mon imposante stature.
De celles que l’on pourrait penser trop vieilles, parfois négligées, mais toujours, hélas, sans intérêt, comme le sont souvent les dames âgées laissées seules dans un coin. À notre grand désarroi, vous oubliez que, jadis, nous fûmes nous aussi jeunes et pimpantes, à l’image de celles dont vous admirez les courbes parfaites aujourd’hui.
Je suis de ces fardeaux dont on voudrait se libérer sans même prendre la peine d’en connaître l’histoire. Une aberration, si l’on y pense, tant mes souvenirs sont une richesse, un trésor qui vous permettrait de comprendre le monde dans lequel vous évoluez.
Je me languis de pouvoir partager tout cela avec vous.
Alors, écoutez-moi, je vous en prie !
Ne me laissez pas sombrer comme tant d’autres dans l’oubli, ce néant dont on ne revient que trop rarement !
J’ai connu de nombreux anonymes, mais j’ai également eu la chance de croiser d’illustres personnages. À tous, cependant, j’ai porté intérêt. Aucun ne me laissa indifférente. Chacune de ces personnes fait partie de moi désormais. J’entends toujours leurs rires, je sens encore leurs parfums, tout comme il me plaît parfois à me remémorer leurs caresses. Leur cruelle absence ne me les rend que plus présents. La plupart d’entre eux sont partis, depuis bien longtemps, vers un rivage que je m’en vais rejoindre. Je les reverrai bientôt.
Ici, à mon chevet, on hésite, on tergiverse. Dois-je disparaître ou doit-on, au contraire, tenter de me guérir, de me sauver ? Une chose est néanmoins certaine : tous s’accordent sur le fait qu’il faille me dépouiller. Cruelle unanimité au vu des longues années passées à choyer celles et ceux que j’accueillais chez moi, mais les Hommes sont ainsi faits. Je ne le sais que trop. Point d’harmonie, mais toujours de la discorde, sans compassion aucune, ni respect, ces douces notes oubliées sur la partition d’une humanité qui se plaît à se fourvoyer sur les chemins de la cruauté et du profit.
Je les entends au loin.
Je ne sais s’il me reste beaucoup de temps, aussi, permettez-moi de vous narrer mon histoire et d’avoir ainsi la faiblesse de croire que je ne serai pas tout à fait oubliée.
1JADIS
Tout a commencé il y a fort longtemps, en Normandie.
Si j’en crois les bruits qui circulaient à l’époque, notre pays devait être dirigé par un homme dont les préoccupations ne quittaient guère les jupons de jouvencelles ou, en de rares occasions, ceux de femmes plus mûres à la seule condition que leurs talents lui permettent d’échapper un tant soit peu à cette mélancolie dans laquelle il aimait à se plonger. Des inquiétudes, vous vous en doutez, bien éloignées de celles des gens de cette région.
Le Pays de Caux n’est pas réputé pour ses mœurs débridées, loin de là. Au premier abord, ses habitants peuvent paraître parfois, pour ne pas dire souvent, un peu bourrus. Mais, si après vous avoir jaugé par le menu, ils finissent par vous accorder leur confiance et leur amitié, alors vous savez qu’elles sont vôtres pour longtemps. La terre d’ici est battue de temps à autre par les vents marins, arrosée souvent et, disons-le, avec générosité, par des nuages aux formes et couleurs aussi improbables que variées. Mais dans le cas contraire, l’herbe n’y serait pas aussi verte, n’est-ce pas ? Loin d’être hostile, ce pays est, au contraire, jalonné de champs féconds et de gras pâturages où se repaissent, avec mollesse et nonchalance, des bêtes dont la qualité de la viande n’est plus à défendre. Cette terre est mienne et je n’en changerais pour rien au monde. Elle a donné à la France quantité de grands personnages et fut le théâtre d’événements innombrables qui ont marqué l’histoire d’une nation tout entière.
Ma vie est longue, si longue, que vous ne me croirez sans doute pas lorsque j’égrènerai avec vous la liste de mes nombreux souvenirs. Peut-être même me penserez-vous folle ? À cela, je me permets néanmoins de protester. Si j’admets être à l’agonie, je puis cependant vous assurer que tout ce que je m’apprête à vous révéler est la vérité… en tout cas, elle est la mienne.
Le premier homme à être entré dans ma vie est un personnage qui aurait pu être le héros d’un roman d’aventures de ce cher Alexandre Dumas. Un être hors du commun qui, conquis chez moi par ce qu’il nommait « un potentiel », décida de se charger de ma réussite et de mon avenir. Un corsaire disait-on qui, ayant fait fortune, prit sa retraite en ma compagnie. Un homme de la mer devenu un riche propriétaire terrien. Un personnage haut en couleur, au charisme indiscutable. Protestant parmi les catholiques, nanti parmi les moins fortunés, il donna aux gens d’ici, qui lui étaient pourtant si différents, 20 000 francs et les terrains nécessaires pour leur permettre d’élever une église au sein de leur petit village.
Un homme extraordinaire, vous dis-je ! Et quelle belle ironie qu’un protestant volant au secours des catholiques ! À cette seule idée, je suis certaine que La Médicis aurait trépassé une seconde fois. D’autant plus que le capitaine ne s’arrêta pas là. Emporté par une générosité dont lui seul connaissait les limites, il ordonna la construction de plusieurs maisons dans une rue qui, aujourd’hui encore, porte son nom. Toutefois, et ce dans un pur souci d’harmonie d’une rigueur acquise au cours de sa carrière militaire, il exigea que chaque bâtisse sortie de terre réponde à un plan unique pensé par lui. Chacune devait comporter, allez savoir pourquoi, une mansarde.
Les preuves de cette philanthropie légendaire sont légion et pavèrent l’histoire de notre communauté. Notre bienfaiteur prit une part active dans la bataille qui opposait alors notre beau village de Gonneville-la-Mallet à la ville voisine depuis des années. Une querelle de clocher qui dégénéra bien vite quand Criquetot-l’Esneval vit d’un très mauvais œil la volonté de mes concitoyens d’instaurer, à leur tour, un marché. Dans ce pays où un sou est un sou, nos chers voisins multiplièrent les recours administratifs pensant, à tort ou à raison, que ce nouvel événement, à quelques lieues de chez eux, nuirait à leurs petites affaires. Des gens « bien intentionnés » demandèrent même au ministre de l’Intérieur de l’époque d’arbitrer la situation en faveur de Criquetot. La détermination du capitaine fut cependant la plus forte et on nous donna, à l’instar de Criquetot, l’autorisation de posséder notre propre marché.
Notre bonne Gonneville-la-Mallet doit tant à cet homme volontaire et batailleur.
Oh ! La belle ironie du sort ! Je me rends compte que j’ai omis de mentionner le nom de notre protecteur, alors que j’ai à cœur de lui rendre justice en honorant sa mémoire. Il s’appelait M. Gosselin. Pierre Isaac Gosselin.
Au bout de quelque temps, comme un hommage à tous ces services rendus, monsieur Gosselin devint même le maire de notre petite commune. Quel grand jour ! Nous pouvions enfin célébrer ce personnage à qui nous devions tant. Le Sous-Préfet se déplaça en personne pour procéder à l’installation du premier homme à la tête de la municipalité. Les rues de la bourgade résonnèrent de cette liesse populaire où les hourras succédaient aux bravos. On se pressa chez nous des quatre coins du village pour fêter l’événement comme il se devait. J’entends encore le cliquetis des verres, les rires et les félicitations qui ne cessèrent de pleuvoir durant cette merveilleuse soirée, tout comme je me souviens de l’odeur épicée des cigares. Cette soirée fut belle, si belle… elle ne laissait en rien présager du drame qui allait advenir trois années plus tard.
Un matin d’août, à l’heure où les premiers rayons commencent à réchauffer les champs et les demeures, M. Gosselin entra à la maison, portant en son sein un glacial et sinistre projet.
À vous en parler, l’émotion m’étreint à nouveau. Beaucoup culpabilisèrent, et moi la première, mais je vous assure, personne n’aurait été en mesure d’augurer de la suite. J’avais bien remarqué des choses étranges, entendu certaines confidences alarmantes, mais personne ne songea à m’interroger.
Ce jour maudit, j’entendis un bruit sourd rompre le silence. Un bruit terrible, suivi d’une odeur âcre.
C’était un 31 août.
Deux jours plus tard, la presse ne manqua pas de se faire l’écho de cette tragédie. Je me souviens encore mot pour mot de l’article paru à cette occasion dans le Journal du Havre.
Avant-hier, M. Gosselin (Pierre Isaac), maire de Gonneville, s’est suicidé dans son domicile en se fracassant la tête d’un coup de pistolet. Avant d’accomplir cet acte de désespoir, M. Gosselin était sorti, comme à l’ordinaire, pour visiter ses amis. En rentrant chez lui, après avoir acheté un quart de livre de poudre, il fit, de sa porte, un signe à un de ses voisins, pharmacien, qui, le voyant porter la main à sa bouche, pensait qu’il indiquait ainsi l’intention de se mettre à table. L’infortuné, au contraire, annonçait sa funeste résolution qu’aucune cause connue ne saurait expliquer.
Pour tous, cette disparition demeura mystérieuse. Évidemment, les rumeurs allèrent bon train, et ici sans doute plus qu’ailleurs. Elles se plaisent trop souvent à dévaler les rues de ces campagnes où il ne se passe jamais rien. La commune et les alentours ne firent pas exception à ce comportement aussi vieux que le monde est monde. Les ignorants tentèrent de faire illusion, gentiment bien sûr, afin qu’on leur portât un peu de cet intérêt qu’ils s’évertuaient à obtenir, tandis que les commères œuvrèrent comme à leur habitude avec cette méchanceté pouvant parfois inciter au meurtre. Cependant, tous ou presque pleurèrent le commandant, malgré ce geste qui, d’après certains, lui fermait à jamais les portes du Paradis.
Mais Dieu est seul juge, n’est-ce pas ?
Vous entendez ?
Non ?
Vous ne les entendez pas derrière la porte ?
Il semble que tous ne soient pas d’accord sur ce qu’il adviendra de moi. Certains haussent le ton face à ceux qui désirent m’offrir encore un peu de temps. Laissons hurler les charognards, voulez-vous ! Leurs tergiversations me donneront peut-être l’opportunité de poursuivre mon récit avant qu’ils ne viennent s’occuper de moi.
2LATOMBE
Un attroupement s’est formé à la porte de celle dont le sort divise.
Ils ne sont pas nombreux. Six, huit personnes tout au plus, un brin agitées et se faisant face tels des combattants prêts à en découdre. Un rassemblement passionné que deux individus, impassibles, observent de loin.
— Écoute-les s’insulter ! Ils me font marrer, ces gus. Tout ce ramdam pour rien ! Alea iacta est. Qu’ils dégagent !
L’autre ne dit rien. Il ne fait que penser à cette cigarette qu’il crève d’envie d’allumer, mais dont il se passe pour le moment afin de ne pas jeter de l’huile sur le feu. Le simple fait de fumer ici, à sa porte, pourrait être perçu comme de la provocation.
— Elle est condamnée. Il faudrait un miracle pour qu’elle s’en sorte. De toute façon, on sera là à la première heure demain matin. On a un contrat et on compte sur nous pour l’exécuter sans tarder.
Un contrat. Un de plus. Un parmi tant d’autres.
La rançon de la gloire et du travail bien fait.
Net et sans bavures.
3RENCONTRE
Je ne me fais guère d’illusions sur ce qu’il se passera demain. Ainsi, le miracle, s’il a lieu, n’en sera que plus beau. C’est que l’expérience nous rend philosophe malgré nous. Sans doute l’un des rares avantages de ce temps qui file à la vitesse de l’éclair.
Le revers de cette médaille est que, bien souvent, notre âge avancé nous fait également perdre le fil de nos pensées. C’est d’ailleurs ce qu’il m’arrive en ce moment même.
Où en étais-je ?
Ah oui ! Ce cher monsieur Gosselin…
Sa mort nous plongea tous dans une tristesse infinie tout en nous plaçant dans un embarras que nous pensions insurmontable. Qu’allait-il advenir de nous ? Je ne parle pas uniquement de moi, mais aussi des habitants de ce village. Un village que les efforts du défunt étaient parvenus non seulement à dynamiser, mais également à rassembler derrière lui.
Pour ma part, mon sort ne fit guère l’objet de leur sollicitude. J’ai appris bien malgré moi que la compassion s’arrête bien souvent là où débutent les intérêts personnels et ce décès, aussi soudain que terrible, laissait nombre de villageois dans une angoissante incertitude quant à leur santé financière. Qu’allaient devenir maisons et marché ? Que déciderait l’exécuteur testamentaire ? Tant de questions pour lesquelles tout le monde, ou presque, attendait fébrilement des réponses.
Mort vieux garçon, le capitaine, qui avait bravé tant d’océans avant de se muer en propriétaire terrien prospère, n’en laissait pas moins une grande famille derrière lui. La quasi-totalité de ses membres était venue s’installer ici, à Gonneville, à l’ombre de l’enfant prodigue. Des parents et des frères avides de profiter de cette incroyable réussite de l’un de ses représentants. Des frères qui, pour certains d’entre eux, avaient été accompagnés jusqu’à l’autel par cette gloire familiale.
Pour ma part, je passai un temps de mains en mains, tel un fardeau dont on ne sait que faire. Oh, on me rendait bien visite de temps en temps ! Je m’en contentais. En cela, je ne peux pas dire que je fus abandonnée, non. Mais, à chaque fois, on en profitait pour mettre en avant la charge immense que je représenterais pour l’insensé qui déciderait de s’occuper de moi. Les Gosselin n’étaient pas à plaindre. La plupart étaient cultivateurs ou rentiers, mais je crois que ma seule présence était une offense. Elle leur rappelait cette tragédie dont je fus le témoin involontaire. Ce suicide était déjà une honte en soi, mais il les confrontait surtout à leur impuissance d’avoir pu l’empêcher. Une impuissance que certains ne tardèrent pas à qualifier de négligence. Si les reproches succèdent parfois bien vite au deuil, les circonstances peu communes de celui-ci encouragèrent à la démesure.
Puis, un jour, mon horizon s’éclaircit. Contre toute attente, un homme arriva au village avec une idée insensée ancrée dans sa tête garnie d’une barbe claire et fournie. Un grand gaillard, avec une incroyable ambition chevillée au corps : faire de Gonneville-la-Mallet le passage obligé pour tous ces touristes qui, grâce au déploiement des chemins de fer, envahissaient alors la côte normande ! Eh bien, croyez-le ou non, mais il comptait sur moi pour l’aider à concrétiser ce rêve que beaucoup jugeaient absurde.
Je peinais à le croire. On me portait à nouveau intérêt. Mieux ! Il ne faisait aucun doute pour lui que je jouerais un rôle déterminant dans ce projet fou. Devenu propriétaire de l’auberge du village, il devint chef d’orchestre d’une petite équipe à ses ordres. On se mit à dépoussiérer, nettoyer, astiquer sans relâche. Edmond Aubourg, ce doux rêveur, passionné d’art et de faïence, alla même jusqu’à placer sur la façade des assiettes et des plats en quantité. Le nouveau propriétaire ne recherchait nullement la discrétion, bien au contraire.
— L’originalité de cet endroit ferait sa renommée, disait-il. Et toi, ma belle, me lança-t-il, tu feras la mienne.
De cela Edmond était convaincu.
Mais laissez-moi vous parler de lui ! Car, si le temps presse, je me dois pourtant d’être précise afin que me survivent mes souvenirs.
Edmond Aubourg naquit à Fécamp, un port de pêche de la côte normande duquel, pendant des siècles, nombre de marins partirent braver les eaux froides, au large du Canada. Fécamp où des générations de femmes ont attendu, fébriles, le retour des navires aux cales regorgeant de cette morue qui contribuait à la fortune de cette ville tout en nourrissant la tristesse des épouses ainsi délaissées pendant des mois. Certaines ne se relevèrent jamais du veuvage que leur avait imposé une mer déchaînée et avide de corps qu’elle ne leur rendrait jamais. Quantité de naufrages furent à l’origine de trop lourdes tragédies pour toutes celles privées d’époux, et souvent mères. Des veuves éplorées en charge d’enfants, trop nombreux, que beaucoup jugeaient sans jamais le dire.
Edmond lui, n’eut pas à grandir privé de la présence du père. Le sien préféra en effet la sérénité qu’apportait le travail du bois à l’angoisse qu’occasionnait la fureur des océans. Ébéniste aguerri, sculpteur sur bois non dénué d’un certain talent, le père d’Edmond est même, dit-on, l’auteur d’une statue qui orne l’une des églises de Fécamp. Il s’était transporté plus tard à quelques kilomètres de là, sur la côte, à Saint-Jouin, avec sa nombreuse famille, où il ouvrit une sorte de café qui ne tarda pas à acquérir une solide réputation alentour. Edmond fit donc ses armes dans l’établissement du père Aubourg en compagnie de sa jeune sœur Ernestine.
Peut-être avez-vous entendu parler de la belle Ernestine. Une fille d’une beauté remarquable qui ne laissa pas indifférents nombre d’artistes de l’époque. Elle faisait chavirer les cœurs et sa seule présence encourageait les clients à franchir le seuil du commerce paternel. Très vite, se trouvèrent parmi eux des gens de la bonne société de Paris, curieux de voir, de leurs propres yeux, cette étrange personne qui servait les plats les plus succulents de toute la côte d’Albâtre. Je puis vous citer Offenbach, la reine d’Espagne, et Maupassant. Ce dernier rebaptisa même Ernestine, la « Belle Alphonsine » dans son roman Pierre et Jean. Un personnage romanesque, haut en couleur et que beaucoup désiraient connaître pour confronter ainsi la réalité à la légende.
Je n’ai jamais su réellement qui des enfants avait plus tard acquis le premier son auberge. J’aurais tendance à croire, sans parti pris aucun, qu’Edmond fut celui-là, car il était de six ans plus âgé que sa sœur. Ernestine dut d’abord amasser un petit pécule afin de quitter le nid familial et créer son établissement dans la même commune que celui de ses parents. Mais une chose demeure cependant certaine, la réputation de l’un contribua à celle de l’autre. À la mort du père, la fratrie se partagea donc une riche et célèbre clientèle qui ne fit que s’accroître tant et tant que nombreux furent les curieux qui n’allèrent dîner chez l’un et l’autre que dans le but à peine avoué d’y croiser des célébrités, dont monsieur de Maupassant ou Alexandre Dumas, entre autres.
Avant son installation à Gonneville, Edmond avait quitté le nid familial pour s’installer avec sa jeune épouse à Criquetot-l’Esneval. Il y fut cafetier, un temps, avant de devenir aubergiste. De tous les enfants qu’eût le couple, seul Ernest survécut. Quand ils arrivèrent dans notre village, le petit n’avait pas cinq ans.
Hélas, son épouse décéda presque aussitôt. C’était un soir de juin, peu après vingt heures. Marie-Ernestine n’avait pas trente ans, mais avait eu le temps de lui donner deux beaux enfants, un garçon et une fille. C’est la naissance de la petite Marie-Eugénie qui lui fût fatale. Trois semaines à peine après ses couches, Marie-Ernestine rendit son dernier souffle. Une nouvelle fois, je fus le témoin involontaire de cette tragédie.
Le lendemain matin, accompagné de son voisin, l’instituteur Lemesle, Edmond se rendit à la mairie afin de signaler le décès de son épouse. Durant de nombreuses nuits, les pleurs étouffés d’Edmond résonnèrent entre les murs de l’auberge. Rien ne semblait pouvoir le consoler, pas même les jeux ou les babillages de ses enfants, vestiges d’un temps révolu. Cependant, Edmond ne pouvait demeurer seul. Il y avait Ernest, Marie-Eugénie, ses salariés et… moi. Le deuil ne lui avait pas ôté ses rêves. Mieux ! Ils s’étaient renforcés. Edmond Aubourg désirait plus beau, plus grand encore. Une évidence s’imposa alors à lui : il lui fallait une nouvelle épouse ! C’est ainsi qu’un an et demi après la mort de Marie-Ernestine, Edmond épousa en secondes noces Céline Vimont, une orpheline de vingt-cinq ans. Après la méfiance, la nouvelle madame Aubourg fut assez vite acceptée par tous, même s’il n’est jamais évident de jouer les remplaçantes. Elle travaillait dur, comme si elle avait besoin de prouver qu’elle n’était pas là par hasard.
Je l’aimais bien Céline. Elle avait du caractère, ne s’apitoyait jamais sur elle-même et ne ménageait en rien ses efforts afin de concrétiser les désirs de réussite de son époux.
Elle était une excellente cuisinière et répétait à qui voulait l’entendre qu’elle s’était rendue à Paris et avait obtenu le diplôme de cordon-bleu. Ah, ça ! Elle en était fière de ce diplôme. Tous parlent encore aujourd’hui de son fameux poulet Aubourg, une recette qu’elle avait créée et jalousement transmise à sa descendance. Un succulent héritage que l’on continuait à servir il y a peu encore, avant que ne commence ma lente agonie.
Oui, je vais disparaître et ne peux m’y opposer.
Je les ai entendus le dire tout à l’heure.
Pourtant je peine à le réaliser. On ne peut plonger dans l’abîme le témoin privilégié d’une telle époque, la détentrice de tant de souvenirs. Ne suis-je pas la gardienne d’un pan entier de l’histoire de cette famille, de ce village ? Quelqu’un viendra à mon secours. Il ne peut en être autrement. À moins que…
À vrai dire, je suis perdue et oscille entre résignation et espoir.
D’accord, je suis vieille, mais je ne dois pas disparaître.
Dites-leur !
4LARELIQUE
— Reste là et surveille ces gus ! Je vais à la voiture passer un coup de fil à Lionel afin de régler les derniers détails pour demain. Il a préparé le terrain, mais je préfère m’assurer qu’il n’a pas fait de conneries. Je risque d’en avoir pour un moment.
Le colosse n’attend pas l’approbation de son camarade. Paco file déjà vers la sortie tout en prenant soin de contourner les individus qui ne le remarquent même pas tant ils sont occupés à palabrer en querelles inutiles. Car la chose est certaine, ils ne trouveront aucun compromis sur le sort à réserver à celle qui se meurt, seule, silencieuse et digne, derrière cette porte.
L’autre ne tient plus. Le besoin de nicotine est trop fort. Il jette un regard pour s’assurer que Paco est loin, puis s’en va avec empressement dans la direction opposée, en baissant la tête. Le trajet jusqu’au parking de derrière lui semble interminable. Quand enfin il y parvient, il décide de s’éloigner le plus possible du bâtiment afin d’apprécier tranquillement cette satanée cigarette.
La première taffe, longue, avalée avec appétence, est une délivrance qui le fait frissonner. Une deuxième s’ensuit, plus courte, moins profonde. Puis la tête se met à tourner, les paupières se ferment et les lèvres esquissent un sourire béat.
Dans l’apparente quiétude d’un paysage normand, l’homme savoure ce moment qu’il n’espérait plus.
— Monsieur ?
Il sursaute.
— Je vous ai vu tout à l’heure avec votre ami. Vous n’êtes pas d’ici, n’est-ce pas ?
L’homme soupire et examine l’importun. Un septuagénaire apparemment, le cheveu gris, l’œil vif, un rien malicieux. Pas tout à fait le profil d’un mec qui cherche la bagarre. D’ailleurs, il ne se souvient pas l’avoir vu avec les autres en arrivant.
— Non. Je suis en déplacement.
— Pour le travail ou pour elle ? Vous la connaissiez ? demande le normand en désignant du menton le bâtiment au loin.
— Pour le travail, mais je la connais un peu, enfin, ce qu’on m’en a dit.
Intéressé, voire intrigué, le vieux monsieur s’avance.
— Je me présente, Benoît Lafarge.
La main tendue demeure suspendue sans qu’une autre ne vienne à sa rencontre et ne la serre. Surpris, mais guère offensé, l’autre poursuit. La curiosité du vieil homme est plus forte que son attachement aux bonnes manières.
— Je vous demande ça parce que, durant toutes ces années, je ne me souviens pas vous avoir déjà croisé.
Son interlocuteur est quelque peu embarrassé par la remarque. Il tire une nouvelle fois sur sa cigarette et réfléchit. Il ne peut décemment pas révéler la raison qui l’amène ici. Autant se mettre une cible sur le dos. Alors il se défend, comme il le fait toujours, en attaquant.
— Je ne suis pas certain que l’on vous ait présenté chaque personne venue lui rendre visite, si ? D’ailleurs, votre tête ne me dit rien non plus, et pourtant, moi, je ne mets pas en doute votre parole.
Touché ! Le casse-pieds paraît déstabilisé. L’autre célèbre cette petite victoire en lui envoyant les volutes de sa Winfield dans le nez.
— Excusez-moi. Désolé de vous avoir offensé, mais vous comprenez, les moribonds attirent toujours les vautours. Dans cette course perpétuelle après le temps, on néglige trop souvent les vieilles dames, excepté lorsqu’elles agonisent.
Cette fois, la flèche est pour lui et l’atteint sans même que celui qui vient de la décocher ne s’en doute.
— Vous la connaissez depuis longtemps ? lui demande-t-il en jetant son mégot au loin.
— Des années ! À vrai dire, depuis toujours. Elle fait partie de la vie de tant de gens par ici. Elle est là depuis belle lurette ! C’est comme si elle veillait sur chacun d’entre nous depuis toutes ces années. Elle est un repère, un port d’attache. Peu importe ce qui nous arrivait, on savait qu’elle serait là. Vous savez, c’est bien souvent lorsqu’on risque de perdre quelqu’un, ou quelque chose, que l’on mesure à quel point nous y tenions et réalisons le temps gâché à ne pas l’apprécier à l’aune de l’intérêt que nous lui portions. Tout n’est pas terminé. Je l’espère de tout cœur, soupire-t-il.
L’autre, mal à l’aise, ne réagit pas. La crainte de trahir les raisons de sa présence ici le rend prudent. Mais voilà Lafarge qui le relance.
— C’est impossible, n’est-ce pas ?
La question n’en est pas vraiment une. Le normand cherche plutôt à être rassuré.
Peine perdue.
— Elle est très vieille, vous savez. Son état est préoccupant. Les gens ne sont pas optimistes et je ne crois pas aux miracles. Personne ne peut rêver d’éternité, surtout à son âge.
— Il reste de l’espoir. J’en suis convaincu, s’insurge le septuagénaire. Tant qu’on ne m’annoncera pas que tout est terminé, je n’y croirai pas. Regardez ! Cela fait des mois qu’on la dit perdue et pourtant elle est toujours là à se battre. Elle ne peut pas nous le dire, mais je suis certain qu’elle est en train de tout faire pour rester parmi nous. Elle en a vu d’autres. Plusieurs fois, on l’a dite condamnée et, chaque fois, elle a tenu bon en faisant mentir tout le monde. En quoi serait-ce différent cette fois ?
Il ne lui répondra pas. Comment d’ailleurs pourrait-il lui dire qu’il est là justement pour s’assurer qu’elle ne s’en relèvera pas ? Comment avouer que tout est fini et que le sort de celle pour qui il semble se faire tant de soucis est déjà scellé ? Demain matin, tout sera terminé. S’il est là avec Paco, c’est qu’on les a payés pour cela.
— Tenez ! dit Lafarge en cherchant dans sa serviette. Je vais vous montrer à quel point elle était belle autrefois. Tous venaient la voir : Monet, Maupassant, André Gide, Sartre. On dit même que Sissi a fait le déplacement lors d’un voyage en Normandie. Regardez !
Et M. Lafarge de sortir de son sac un album photo revêtu d’une couverture de cuir brun. Les gestes sont lents et empreints d’infinies précautions, comme s’il s’agissait d’une sacro-sainte relique.
L’autre observe par-dessus son épaule, espérant apercevoir Paco pour pouvoir déguerpir vite fait. Mais, hélas, personne ne vient ! Il décide donc de faire contre mauvaise fortune bon cœur et feint un air intéressé qui, il en est certain, ne fera guère illusion. Tout occupé à ouvrir avec la plus grande délicatesse la première page de son vieux grimoire, Benoît Lafarge ne le remarque même pas.
— Tenez ! Là, c’est Paul Aubourg et elle, avec une partie du personnel. Elle était belle n’est-ce pas ?
Lafarge n’attend pas une réponse qui lui paraît évidente et poursuit.
— Voyez comme cette salle était magnifique parée de toutes ses faïences ! Et là, c’est la salle d’armes. Épées, sabres, lances et boucliers des siècles passés. Tant de pièces, parfois uniques, que les Aubourg ont collectionnées au fil des années. Certaines lui ont été offertes.
Les pages se tournent une à une, avec le même cérémonial. Le silence devant certaines photographies se fait religieux. L’émotion ressentie par M. Lafarge est palpable.
D’abord amusé, voire un brin moqueur, l’homme s’apprête à allumer une autre Winfield, mais son geste est suspendu. Il range la cigarette dans son paquet. Contre toute attente, le vieux monsieur est parvenu à aiguiser sa curiosité.
— Elle est incroyablement belle avec ses deux panneaux de Monnet dans le fond, n’est-ce pas ?
— Quoi ? Ces peintures, là, vous voulez dire que c’est Monet qui les a peintes ! Ce ne sont pas des copies ?
— Bien sûr que non ! Des copies…, répond l’homme au veston d’un air dépité. Laissez-moi vous raconter deux ou trois petites choses concernant celle pour qui vous et moi sommes ici ce soir. Parfois, les apparences sont trompeuses. Je vous le concède, on peine à réaliser sa beauté d’antan, tout comme on ne se doute pas le moins du monde du succès qu’elle remportait jadis auprès des personnes les plus célèbres de son temps. Elle doit certainement beaucoup aux Aubourg qui l’ont recueillie lorsque tous l’avaient délaissée, mais sans elle, croyez-moi, ils n’auraient pas construit le petit empire qui a fait leur renommée.
Un instant, le fumeur oublie ses cigarettes, Paco et même le contrat. Plus rien ne compte exceptées les paroles de Benoît Lafarge dont il s’abreuve en consultant le catalogue d’une vie prête à s’éteindre.
Lui revient alors en mémoire son enfance sur laquelle il ne s’attarde que rarement afin de ne pas rouvrir d’anciennes blessures. Il pense à sa grand-mère chez qui il aimait à se réfugier dès qu’il le pouvait. Une femme sans le sou, mais qui lui aurait pourtant tout donné juste pour être en mesure d’entrevoir un sourire chez ce petit-fils aux traits tristes et trop sérieux pour un garçon de son âge. Il la voit, les cheveux ondulés, pardon, crantés comme elle se plaisait à dire. Un mouvement capillaire savamment étudié que seuls des bigoudis de toutes les couleurs parvenaient à sculpter sous un filet bleuté. Il sent tout à coup l’odeur de fraise et de rhubarbe, mijotant dans de grands fait-tout. L’immense jardin du grand-père, disparu dans un accident de voiture, donnait encore à chaque saison les confitures et les conserves pour les mois à venir. Un héritage végétal qu’entretenait jalousement sa veuve. Il l’entend encore, sa mamie, l’adorée, l’absente, rouler les R comme le font toujours quelques rares Flamandes d’un âge avancé dans cette région que l’on appelle aujourd’hui Les Hauts de France.
Chaque retour dans le Nord le ramène à elle et à cette enfance écorchée que sa mémoire s’est efforcée d’effacer en partie. Depuis son décès, il n’est jamais retourné devant sa maison. Il en est incapable. Le refuge d’antan, ce point d’ancrage a disparu avec elle.
Il n’a jamais dit à sa grand-mère combien elle était importante pour lui, combien il comptait les jours qui le séparaient des vacances scolaires qu’il demandait sans cesse de passer chez elle, à peine à sept kilomètres de chez ses parents. Non, il ne lui a jamais dit. Il s’en veut pour ça, tout en sachant qu’il n’y peut rien. Dans cette famille, on ne disait pas des choses pareilles. On ne les dit toujours pas d’ailleurs. Personne ne lui avait appris à exprimer ses émotions. Tout cela est venu bien plus tard. Beaucoup trop tard. Inutile de penser à faire des câlins ou de chaleureuses embrassades. Sa bouche était une passoire à sentiments, quant à ses bras, ils ne servaient qu’à parer les coups d’un père que l’alcool rendait trop souvent violent.
Si seulement on lui avait appris !
Si seulement cette famille n’avait pas été une famille de taiseux ! Peut-être bien que les choses auraient été différentes. Beaucoup de choses…
— Vous voyez, monsieur. Ce n’est pas parce qu’on est vieille que l’on ne mérite pas un minimum d’intérêt et de respect.
Les yeux embués, le petit-fils enfermé dans ce corps de bonhomme cherche un peu de contenance en allumant une énième cigarette. Enfin, il consent à répondre, brièvement, juste ce que la passoire à sentiments de son enfance lui autorise, muselant avec soin le bouleversement qui s’est opéré en lui.
— Je vois monsieur Lafarge. Je vois.
5ENFAMILLE
Excusez-moi… Oui, je vous prie de m’excuser pour cette faiblesse dont je ne suis pas coutumière. Croyez-moi ! Je ne suis pas de ces fragiles ou égoïstes qui aiment à importuner les étrangers avec ses problèmes. Je vous l’ai dit, on n’est pas comme ça par ici. Il me faut accepter mon sort, m’y résigner, mais je me refuse à quitter ce monde sans vous avoir livré la part la plus importante de mes souvenirs.
Edmond et Céline, mes sauveurs…
Très peu de temps après leur mariage, les pleurs d’un nouveau-né se mirent à retentir entre les poutres de l’auberge.
J’étais en joie et ce bonheur ne cessa de croître. Car, en ces temps bénis, plus le petit Paul grandissait et plus la renommée de l’établissement dépassait les bocages du plateau pour franchir très vite les portes de Paris. La chose était incroyable ! Imaginez ! On parlait de nous jusqu’à Londres. Inexorablement donc, les horsains se mêlèrent très vite aux Cauchois. On vantait notre cuisine dans les nombreux guides. Le Conty