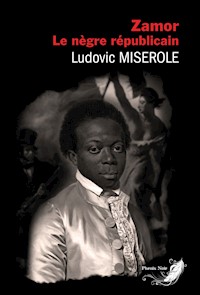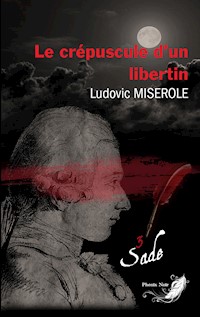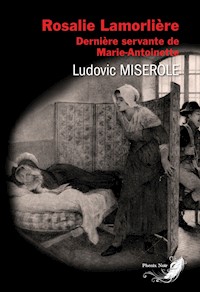
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: IFS
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Un destin ! Celui d'une petite provinciale, fille de cordonnier, qui va croiser celui de la Reine Marie-Antoinette au détour des couloirs sombres et malodorants de la Conciergerie. Une fille du peuple qui rencontrera et assistera les puissants d'hier et les parvenus d'une France qui se cherche. Tous, ou presque, mourront. Elle, la survivante, apportera son témoignage bien plus tard. Relation inestimable pour bon nombre d'historiens qui, pourtant, n'ont jamais essayé de connaître Rosalie Lamorlière.
Premier ouvrage d'une saga historique en deux tomes " Rosalie Lamorlière - Dernière servante de Marie-Antoinette " fait état du témoignage inestimable de celle qui la connut le plus intimement, et fut au coeur des affres de la Cour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
MICHELLE SAPORIHISTORIENNE
LES TROIS NAISSANCES DE ROSALIE
Rosalie Lamorlière, la dernière servante de la Reine Marie-Antoinette à la Conciergerie, est née trois fois.
Une première, le 19 mars 1768 à Breteuil, de modestes parents picards. Rien à dire a priori, que de très commun sur cette existence destinée à se fondre dans l’obscurité de celle du peuple de la campagne.
Une deuxième, d’abord lorsque Lafont d’Aussonne, un des tout premiers historiens de Marie-Antoinette, entreprend de rechercher tous les témoins qui avaient assisté aux dernières heures de sa vie. À la Conciergerie, Rosalie est employée comme cuisinière des concierges ; à ce titre, elle est autorisée à porter de temps à autre directement son repas à la prisonnière : moments privilégiés, précieux, où l’échange d’un regard, d’un mot, d’une gentillesse, toutes ces choses banales en temps ordinaire, prennent une dimension dantesque à quelques heures de l’échafaud. Si madame Richard tenait la première place à la Conciergerie, la femme du concierge étant la grande patronne des lieux, et si la femme Harel occupait une position de choix, ayant été sélectionnée officiellement par les autorités révolutionnaires pour servir de femme de chambre à la Reine, Rosalie est parmi les derniers dans la hiérarchie du personnel à la Conciergerie. Elle est de celles que personne ne considère si ce n’est celle qui précisément lui prend le verre des mains, assoiffée de tendresse plus encore que d’eau.
Pourtant cette fille de peu pourrait bien être un monument précieux pour un historien. Lafont d’Aussonne le devine, lui qui se met à la recherche de Rosalie, devenue entre-temps une dame âgée, vieillissant dans son dernier domicile au n° 38 rue des Fossés Saint Victor et bientôt aux Incurables. En confiant au lettré d’Aussonne ses souvenirs, Rosalie, qui ne sait ni lire ni écrire, naît aux yeux du monde quand paraissent en mai 1824 les Mémoires secrets et universels des malheurs et de la mort de la Reine de France dans lesquels d’Aussonne explique les circonstances de leur rencontre : « La Providence a conservé Rosalie. Une dame d’un très grand mérite me parlait de sa droiture, de son dévouement, de son affliction en ces jours affreux, et m’en parlait après un laps de temps de vingt-neuf années. Cette dame la croyait morte, et regrettait une si grande perte pour moi… Le hasard le plus étonnant me fit, quelques mois après, découvrir ses traces. J’ai retrouvé Rosalie, pauvre, honnête et laborieuse au sein de la capitale. Je l’ai trouvée fidèle à la mémoire de la Princesse Auguste, qu’elle servit durant soixante et seize jours. Elle m’a raconté les choses les plus secrètes et les plus inconnues. » C’est ainsi que Lafont d’Aussonne recueille le récit inappréciable de la dernière servante sur la veuve Capet.
Que faut-il penser de sa véracité ? La question est d’importance puisqu’il s’agit d’un des rares témoignages que nous possédons sur les derniers jours de Marie-Antoinette. Lafont d’Aussonne a-t-il retranscrit fidèlement les propos de la servante de la Reine ou a-t-il été tenté de les remanier pour servir son projet, tenant plus de l’hagiographie que de la biographie ? L’homme n’en était pas à son premier monument poétique et historique élevé à la mémoire des compagnes du Roi. Après un premier essai, en 1814, sur l’Histoire de Madame de Maintenon, fondatrice de Saint-Cyr, il s’était attaché, en 1820, à reconstruire l’image de Marie-Antoinette d’Autriche, Reine de France dans Le Crime du 16 octobre ou les Fantômes de Marly. Connu pour son royalisme éprouvé, Lafont d’Aussonne eût dû faire l’unanimité de sa famille politique quant à sa présentation de l’image de la Reine martyre. Bizarrement, il n’en fut rien : « Mon Livre parut, écrit-il, dans un temps qui me semblait propice… On était dans l’erreur. Loin d’être protégé par ceux-là qui devaient tant chérir la gloire de la Reine, mon livre fut persécuté sous leurs yeux. » À la vérité, Lafont d’Aussonne fut de son vivant un personnage équivoque, très controversé et adepte lui aussi de la controverse.
En 1824, le comte de Robiano publie un petit livre intitulé Marie-Antoinette à la Conciergerie, rédigé notamment par un abbé Gillet. Ils y annoncent que la Reine aurait reçu à la Conciergerie la communion de la part de l’abbé Magnin, introduit dans la prison par l’industrieuse charité d’une pieuse marchande, mademoiselle Fouché. Ce fait fut nié bruyamment par Lafont D’Aussonne, qui accusa l’abbé Magnin et mademoiselle Fouché de mensonge dans deux petits livrets : La fausse communion de la Reine soutenue au moyen d’un faux. Nouvelle réfutation appuyée sur de nouvelles preuves (1824) puis Mémoire au Roi sur l’imposture et le faux matériel de la Conciergerie (1825). La polémique sur ce point fit rage tout au long du XIXe siècle (les Goncourt par exemple appuyèrent la version de Lafont d’Aussonne), et ne se calma qu’avec le suivant. Pour contrer Lafont sur ce point épineux qui provoquait la division parmi les « amoureux » de Marie-Antoinette, il fallait faire douter de la fiabilité historique de ses écrits ; les souvenirs de Rosalie furent entraînés dans le soupçon global que firent poser sur Lafont d’Aussonne les partisans de la réalité de la communion. Plus encore, Rosalie devint l’enjeu d’un débat entre les opposants des deux thèses. Dans ses Mémoires et souvenirs (1888) le baron Hyde de Neuville raconte que l’abbé Magnin contre-attaqua et fit faire une enquête dépêchant deux émissaires auprès de Rosalie le 20 juin 1825, un certain Dubois, ancien employé à la Grande Poste et Tardieu, ancien négociant avec mission de lui faire désavouer Lafont d’Aussonne. La pauvre Rosalie dut paraître au parloir de l’hospice pour subir un véritable interrogatoire, en présence et sous l’œil sévère de la dame supérieure de la maison. Leurs questions-réponses n’ayant pas abouti, quatre jours après ce fut un certain La Villette qui revint à la charge (peut-être de la police, car il en fit un rapport à la Préfecture). Rosalie qui ne voulait qu’une chose, qu’on la laissât tranquille, fit concernant la communion toujours cette même réponse : « pas impossible, mais difficile »… et sur ce point, nous en sommes toujours là.
Aujourd’hui que les passions religieuses sont apaisées et si on confronte le récit de Rosalie avec les documents officiels, nous confirmons l’avoir trouvé « toujours, dans ses points les plus importants, absolument conforme à la vérité », comme le disait déjà avant nous, le très éminent et respectable conservateur des Archives nationales, Émile Campardon, en 1863. Littérateur fleuri, irréconciliable avec l’ennui, Lafont d’Aussonne n’en a pas moins respecté les confidences de la vieille dame qui d’ailleurs les confirma par la suite à une autre personne venue à sa rencontre : madame Simon-Viennot.
Autant Lafont d’Aussonne fut critiqué, autant madame Simon-Viennot fut respectée. C’est en 1838 que Barbe-Henriette Simon-Viennot publie son Marie-Antoinette devant le XIXe siècle qui connaît un succès immédiat, réédité, rien que pour cette seule année-là, trois fois de suite. Contrairement à son prédécesseur, madame Simon-Viennot fait l’unanimité quant à l’objectivité de son approche, et jusqu’à aujourd’hui ; en 2006, dans Histoire d’historiennes, Nicole Pellegrin estime qu’elle « tente d’empêcher la construction d’une légende noire » de Marie-Antoinette par un « travail qui se situe en dehors de la réaction royaliste ». Les confidences que lui répéta Rosalie, les mêmes quasiment que celles faites à Lafont d’Aussone, ne firent l’objet d’aucune contestation et finalement, comme le dit Mathurin Lescure, dans La vraie Marie-Antoinette, ce que son ouvrage « renferme de plus intéressant, c’est une conversation de l’auteur avec Rosalie Lamorlière. »
Désormais, Rosalie, « cette bonne fille qui donna à la Reine son dernier bouillon », fut bénie par les partisans de la royauté ; il en fut qui préférèrent s’imaginer pour elle une fin plus heureuse que la triste réalité découverte par nos deux historiens. C’est ainsi qu’en 1854, dans Yvon le Bretou ou Souvenirs d’un soldat des armées catholiques et royales, le vicomte Walsh aime à laisser croire que Rosalie aurait passé la mer, rejoignant l’Amérique avec un noble étranger, parent du grand Washington, qui lui aurait donné sa main et sa fortune avant de s’empresser de l’arracher aux dangers la menaçant en France. Et Walsh affabule sur cette femme qui aurait servi la Reine à la Conciergerie et qui peut-être ne fut pas une simple employée, mais une comtesse de l’ancienne Cour, déguisée ! Démarche totalement romanesque qui n’offre guère d’intérêt, comparée à celle de l’auteur du livre que vous tenez entre vos mains et qui sait, de sa belle plume, nous transporter vers Rosalie à partir de son vécu réel.
Enfin, l’humble Rosalie que les hasards de la vie entraînèrent à accompagner les derniers instants d’un mythe, ne serait-elle pas quelque peu en passe d’en devenir un elle-même, quand on sait qu’elle constitue un des personnages principaux du célèbre manga japonais La Rose de Versailles et de son adaptation animée en 1979, Lady Oscar. Ici aussi, Rosalie, jeune fille pauvre travaillant chez Rose Bertin, la modiste de la Reine, est en réalité la fille de madame de Polignac et lors de l’emprisonnement de la Reine elle se fait volontairement attacher à son service pour adoucir ses derniers jours. De Walsh au manga, il est entendu que la noblesse d’âme de Rosalie ne peut que révéler la noblesse de sang : on verra ici notre auteur éviter complètement cet écueil et ce lieu commun, préférant s’attacher à montrer Rosalie telle qu’elle, sans qu’elle y perde rien, bien au contraire.
L’effort conjugué de Lafont d’Aussonne et Viennot nous a légué un témoignage éternel sur les derniers moments de la Reine, rendant tout aussi éternelle celle par qui il nous arrivait. Pas un livre, depuis on les compte par centaines, qui n’ait parlé de Rosalie pour évoquer le récit du passage de la Reine à la Conciergerie. Incontournable et cependant inconnue Rosalie. Jusqu’à ce qu’un jour de printemps, dans ce splendide cimetière parisien du Père-Lachaise, un jeune promeneur s’arrête devant une tombe. Dessus est gravé Delamollière. Ce patronyme l’interpelle, il le connaît bien, attiré depuis longtemps par une certaine Rosalie d’un nom approximatif, tout emplie de choses vues et entendues auprès d’une Reine déchue. Il s’approche, quelle n’est pas sa surprise de constater une inscription rappelant la demoiselle en question ! À l’instant, Rosalie naît une troisième fois. Et, quelle naissance ! Car, hormis les quelques mots disséminés par-ci, par-là, dans ces récits sur Marie-Antoinette, de la vie de Rosalie devenue célèbre, on ne savait rien, et l’historien Lenotre pouvait écrire d’elle : « Nous n’avons point à présenter Rosalie Lamorlière : la pauvre fille n’a pas d’histoire. » C’était sans compter sur Ludovic Miserole ! De ce moment, persévérant et opiniâtre, notre ami n’a cessé de chercher Rosalie partout où elle avait respiré, obstiné à renverser des montagnes d’archives pour trouver le détail, puis un autre et encore un autre qui allaient, petit à petit, laisser apparaître la figure vraie de cette femme. Car, ne nous y trompons pas, si notre auteur a finalement choisi de faire revivre Rosalie sous la forme d’un roman historique, il n’a guère inventé. Oui, je vous l’assure, Rosalie avait bien une sciatique ; il eût été fort commode d’imaginer un mal de gorge ou que sais-je, de rein. Mais non, Ludovic Miserole s’y est refusé : c’eût été trahir sa Rosalie. Et, tout est à l’avenant, tiré d’un travail laborieux s’agissant de reconstituer l’itinéraire d’une femme du peuple au XVIIIe siècle. Rosalie elle-même était convaincue que sa vie offrait peu d’intérêt : à Simon Viennot qui lui demande un entretien pour une importante affaire, elle répond : « Moi, je n’ai point d’affaire. »
Dans les pages qui suivent, Ludovic Miserole sait nous montrer à quel point chaque existence est unique et mérite qu’on s’y arrête pour peu qu’elle trouve quelqu’un capable de la sentir. Ici, nous sommes gâtés, car rarement un auteur ne fut autant habité par son sujet : il a su magnifiquement mêler les fins de vie de deux femmes, de la plus humble à la plus illustre, et éclairer à nouveau du regard de Rosalie, devenu le sien, une période de notre histoire à laquelle nous revenons sans cesse.
Michelle Sapori, historienne, est l’autrice de :
Rose Bertin, ministre des modes de Marie-Antoinette, Paris, Institut Français de la Mode et Éd. du Regard, 2003, 318 p.
Rougeville, de Marie-Antoinette à Alexandre Dumas. Le vrai chevalier de Maison-Rouge, Éditions de la Bisquine, 2016, 377 p.
1
En ce mois d’août 1847, la canicule s’est installée. L’air est devenu si étouffant que rares sont les Parisiens qui osent affronter le soleil. La capitale vit au ralenti.
Pourtant, et malgré ses quatre-vingts ans, Rosalie Lamorlière brave le danger en faisant son entrée dans une des cours intérieures de l’Hospice des Incurables. Elle est venue ici précisément parce qu’elle était certaine de n’y trouver personne. Car qui serait assez fou pour venir ici, dans cet espace de verdure, par endroits jauni ?
Autour d’elle, les hauts murs des bâtiments austères empêchent la moindre bise de circuler. Et ce ne sont pas les rares bancs disposés en cercle, sous le feuillage des quelques arbres plantés là, qui pourraient inciter les pensionnaires à y tenir assemblée.
La chaleur ne fait pas peur à la vieille dame. Depuis la Conciergerie, où elle était employée sous la révolution, elle a appris à l’apprivoiser. En août 1793 d’ailleurs, l’atmosphère y était irrespirable. À chaque inspiration, on avait le sentiment de se brûler les poumons.
Assise à l’ombre d’un marronnier, Rosalie se souvient de ce jour de l’été 1793, tout aussi suffocant. Elle n’avait alors que vingt-cinq ans. Un homme s’était présenté avec l’idée saugrenue de sauver la prisonnière la plus impopulaire du pays ! Ses armes ? Un bouquet d’œillets, une volonté de fer et une once de folie. Au début on aurait pu croire à une plaisanterie, mais Marie-Antoinette s’était prise au jeu du doux rêveur. Elle, qui jusque-là refusait toute tentative d’évasion, s’était finalement laissé convaincre par ce chevalier de l’ordre de Saint-Louis.
La vieille dame ne peut se défaire de ses souvenirs qui la hantent comme un mauvais rêve depuis plus de cinquante ans… Chaque nuit, elle revoit ces images et se réveille en nage, dans son lit étroit de l’Hospice des Incurables, où elle a été placée par la Duchesse d’Angoulême1 afin de récompenser sa conduite, son dévouement et sa discrétion.
Vingt-cinq longues années à vivre ici, accompagnée de son mal incurable : une sciatique ancienne dont elle n’arrive à se défaire2.
Depuis son arrivée dans l’établissement, Rosalie demeure en retrait. Une ombre qui passe et que l’on ne remarque pas. Une femme discrète et mystérieuse préférant le silence aux confidences, la retenue à toute forme d’intimité.
La vieille dame espère que la mort viendra la délivrer bientôt.
— Mademoiselle, on demande à vous voir.
Rosalie sursaute. Elle n’avait pas entendu Sœur Félicité faire son entrée dans la cour.
— Vous devez vous tromper, ma Sœur. Je n’attends personne.
— Et pourtant une certaine Hélène Grancher désire s’entretenir avec vous.
— Que me veut-elle ?
— Je ne sais pas.
Contrairement à d’habitude, aujourd’hui l’accent belge de Sœur Félicité3 ne parvient pas à amuser Rosalie.
— Je n’y suis pour personne !
— Demanderiez-vous à une religieuse de mentir ?
— Je ne veux aucune visite.
— N’êtes-vous pas lasse de demeurer seule, à longueur de journée ?
— Non !
— Alors ? Que dois-je dire à cette madame Grancher ?
— Rien.
La religieuse s’éloigne, laissant Rosalie à ses interrogations. La vieille dame en a assez d’être un objet de curiosité pour tous ces écrivains et journalistes qui cherchent le moindre détail sur les derniers jours de la Reine à la Conciergerie. Cette madame Grancher doit être une de ceux-là ; une curieuse ou une passionnée qui désire solliciter ses souvenirs. Ces soixante-seize jours à servir Marie-Antoinette avant sa montée à l’échafaud résument pour beaucoup l’existence de Marie-Rosalie Delamorlière4 et la résumeront encore certainement pendant bon nombre d’années. Étrange destinée d’être immortalisée aux yeux des Français pour avoir effectué, de manière consciencieuse, son métier de servante ! Rosalie désire demeurer tranquille, ici, près du puits de la cour Saint-Louis. Une construction pas très haute faite de pierres grisâtres. Sur la margelle, trois longs piquets de fer ont été recouverts peu à peu par une clématite envahissante.
— Mademoiselle Lamorlière !
Étonnée, la vieille dame se retourne. Une femme de taille moyenne lui sourit. Le visage est rond, à peine ridé malgré des cernes marqués. Les cheveux bruns sont relevés en un chignon parfaitement attaché. Elle doit avoir quarante ans environ.
C’est certain. Cette personne vient parler des jours funestes de 1793. Le simple fait de l’avoir appelée Lamorlière est un signe des plus révélateurs. Sait-elle seulement la véritable identité de la patiente qu’elle vient visiter dans cet hospice ? En ces temps terribles, il était préférable d’ôter de son patronyme tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une particule. De même pour les prénoms. Mieux valait éviter toute connotation antirévolutionnaire. Mademoiselle Marie-Rosalie Delamorlière avait ainsi laissé place à cette Rosalie Lamorlière, servante dans l’antichambre de la mort. Une jeune fille au service d’Antoinette, dernière Reine de France.
— Je suis bien celle que vous recherchez.
Hélène considère ce beau visage sur lequel le temps ne semble avoir aucune prise. La vieille dame s’impatiente. L’autre le devine.
— Je suis infirmière. Je rends visite aux malades dans divers endroits de Paris.
— Je me porte bien, vous savez.
— Vraiment ? Alors pourquoi vous trouvez-vous aux Incurables ?
Mademoiselle Delamorlière sourit.
— Une vieille sciatique qui ne veut plus me quitter. Nous nous sommes habituées l’une à l’autre durant toutes ces années.
— Une amitié bien contraignante, dites-moi.
— Douloureuse, mais fidèle. Mais n’est-ce pas, madame, de la Conciergerie que vous vouliez me parler ?
L’infirmière paraît gênée. La vieille dame est perspicace.
— Au hasard d’une de mes nombreuses lectures, j’ai appris votre présence ici en 1836. J’ai donc pensé que vous y étiez peut-être encore.
— Vous êtes donc venue ici pour rien, madame. Je n’ai plus rien à révéler sur ces sombres années. J’ai tout dit.
— Je le sais. Mais j’ai lu vos témoignages et je voulais vous rencontrer. Ma démarche peut vous paraître cavalière et je vous prie de m’en excuser. J’admets que si la curiosité était une vertu, je serais assurément une des femmes les plus respectées du royaume.
— Hélas madame ! La concurrence est rude et la place manquerait aux Tuileries pour toutes les vertueuses de votre genre.
Rosalie l’invite à prendre place à ses côtés. Si elle est résolument décidée à ne rien raconter, la présence d’Hélène peut néanmoins lui apporter un peu de distraction en ce lieu qui en est tellement dépourvu. Et puis elle est parvenue à piquer sa curiosité. Pourquoi désire-t-elle se plonger dans le passé et, qui plus est, dans une des périodes les plus sombres que la France ait connues ?
— Vous êtes donc une lectrice assidue.
— Depuis mon plus jeune âge, je dévore les livres d’Histoire.
— Comme je vous envie ! Je ne sais pas lire.
— Je suis désolée.
— Il ne faut pas. Je me console en me disant que je ne suis pas la seule.
— Certes, mais…
— Alors ! Qui êtes-vous, madame Grancher ?
La brutalité de la question décontenance Hélène. L’infirmière est venue pour soutirer quelque confidence à la vieille demoiselle et la voici prise à son propre piège.
— Que vous dire ?
— Eh bien parlez-moi de vous. Je ne sais jamais rien de la vie des gens qui veulent connaître la mienne. Avouez que ce n’est pas juste.
— Vous avez raison.
— Alors cette fois-ci, on fera l’inverse. Je ne vous adresserai la parole qu’en échange de la vôtre.
— Bien… Par quoi voulez-vous que je commence ?
— Comme vous voulez.
L’infirmière hésite.
— Je suis née à Paris, à la fin du siècle dernier.
— La Terreur vous a donc épargnée.
— Mes jeunes années ont été relativement confortables, loin des soucis liés au manque d’argent ou de pain sur la table.
— Madame, vous avez bien de la chance.
— Oui, mes parents ont tout fait pour me préserver.
Rosalie se tourne vers son interlocutrice, sourcils froncés, la voix tremblante.
— Et puis ? N’est-ce pas là dans l’ordre des choses ? Encore faut-il avoir les moyens d’y parvenir.
Madame Grancher s’étonne et tente de corriger ce qui s’apparente d’ores et déjà à de la maladresse.
— Nous n’étions pas pauvres, il est vrai. Pour autant cela ne nous a jamais empêchés de connaître notre bonheur et de l’apprécier. Fille unique, j’ai été choyée et ma famille a mis un soin tout particulier à parfaire mon éducation. Je suis donc entrée très tôt en institution religieuse et je n’en suis sortie qu’à l’âge de vingt ans.
— Vous avez donc été bien longtemps éloignée des tourments de votre temps. Et qu’avez-vous fait en sortant ?
— Mon père m’a fait épouser un instituteur, plus âgé que moi. Nous avons eu deux enfants.
— Vos proches semblent avoir pris beaucoup de décisions à votre place.
L’infirmière semble surprise.
— Ils ne voulaient que mon bien.
— Évidemment. Et quels sont les prénoms de ces deux innocents ?
— Mon fils s’appelle Valérien. Il est né très vite après notre mariage et ma fille Claire est venue au monde trois ans plus tard.
— Valérien, dites-vous ? Voilà, ma foi, un prénom étrange et original.
— Oui. C’est le nom d’un sénateur romain, proclamé empereur par ses troupes. C’est Joseph, mon mari, qui l’a choisi. Hélas, j’ai appris plus tard qu’il fut aussi à l’origine de persécutions chrétiennes.
— Personne n’est parfait.
Hélène ne comprend pas. Les deux livres qu’elle avait lus montraient une Rosalie douce et sensible. Rien à voir, a priori, avec cette femme froide, voire cynique.
— Sans doute a-t-il souhaité ne retenir que le côté glorieux du personnage. Qui peut lui en vouloir ? se défend-elle.
— Quel âge avez-vous ? demande sans ambages la vieille dame.
— Vous êtes toujours si directe, mademoiselle ?
— Oui, c’est un principe. À mon âge, on ne s’encombre plus de fioritures, on va à l’essentiel.
— J’ai cinquante-deux ans !
— Vraiment ? Je vous en donnais quarante tout au plus.
Le ton s’est fait plus doux. Rosalie ne semble plus sur la défensive.
— Je suis flattée et vous retourne le compliment.
Pour la première fois depuis le début de cet entretien, Rosalie semble gênée.
— Vous connaissez donc mon âge ?
— En 1836, l’historienne venue vous voir vous donnait à peine cinquante ans.
— Mes impressions sur cette dame se voient donc confirmées. Elle était gentille. À l’époque, j’allais avoir soixante-neuf ans.
— Eh bien, mademoiselle, permettez-moi de vous dire que le temps qui passe ne semble en rien altérer la beauté de vos traits.
Voilà des années qu’on ne l’a complimentée. Cette infirmière a l’art de la mettre en confiance. Pour la faire parler ou par sympathie ? La pensionnaire de l’hospice plonge son regard dans celui de sa visiteuse comme pour tenter d’y déceler ses intentions. La brutalité de ses questions est son arme favorite.
— Et votre mariage ? Est-il heureux ? surenchérit-elle.
— Il le fut.
— Les premières années passent toujours trop vite, n’est-ce pas ?
— Non. Ce n’est pas de cela dont il s’agit.
Remarquant l’air abattu de madame Grancher, la vieille dame comprend son erreur.
— Je suis navrée.
— Joseph est décédé peu après la naissance de Claire. Mais vous ne pouviez pas savoir. Tandis qu’il revenait d’une de ses longues flâneries dominicales le long de la Seine, un carrosse le heurta non loin du Palais Royal. On m’avoua plus tard que des témoins pensaient avoir aperçu les armoiries des Orléans sur l’une des portières, mais, à la différence de mes enfants, je n’y ai jamais vraiment cru. Vers le milieu de la matinée, on vint m’annoncer sa mort sans la moindre compassion. Valérien se tenait près de moi et s’accrochait à ma robe alors que sa sœur était dans mes bras. Sous le coup de la douleur, j’ai failli lâcher Claire. Je n’avais pas même trente ans et je me retrouvais veuve avec deux enfants à élever.
Rosalie ne quitte pas l’infirmière du regard. Elle est partagée par le regret de l’avoir questionnée sans ménagement et le soulagement de la savoir sincère. Sur ce point, on ne peut pas tromper la vieille servante. La détresse a toujours fait partie intégrante de sa vie, et ce, dès son enfance. N’a-t-elle pas vu mourir sa sœur de huit ans, puis sa mère. Rosalie ne comprend que trop les gens qui souffrent. Elle est des leurs. Et puis, avec tous ceux qu’elle a vus mourir pendant la révolution… la vieille dame s’est aguerrie.
— Vous vous êtes donc décidée à aider votre prochain, madame l’infirmière.
— Mon éducation n’y est pas étrangère et il me fallait subvenir aux besoins de ma famille.
— Mais pourquoi rendre visite aux malades ?
— Après le décès de Joseph, je n’avais guère le temps de me laisser aller à mon chagrin. La religion m’avait toujours été d’un grand secours et je comptais sur elle, pour me venir en aide une fois encore. Aussi, dès le lendemain, je prenais la route du couvent où j’avais grandi.
— La foi peut panser bien des plaies, mais rarement nourrir le fidèle.
Le pas lourd, une religieuse pénètre dans la cour, interrompant ainsi la discussion entre les deux femmes.
— Le dîner va être servi. Allez, mesdames ! Au réfectoire ! s’exclame la Sœur venue chercher les quelques malades qui se sont hasardées à sortir et que Rosalie n’avait pas remarquées.
— Mon Dieu ! Je n’ai pas vu le temps passer. Je vais devoir vous laisser et ne pas abuser plus avant de votre temps, s’excuse Hélène.
— Je n’aurai donc pas toutes les réponses vous concernant. Mais vous me les donnerez lors de votre prochaine visite, n’est-ce pas ?
Cette question de Rosalie, qui résonne plus comme une requête, fait soudain oublier à madame Grancher l’accueil mitigé ressenti dès les premiers instants.
— Avec joie, mademoiselle.
— Laissez-moi vous raccompagner, lance une dame, d’un ton sévère.
Cette voix ! Rauque et railleuse ! Rosalie la reconnaît. C’est la veuve Sartine ! Une femme assez forte, à la poitrine imposante et aux hanches tout aussi remarquables. Rosalie ne dit mot et prend un bonbon dans sa poche. Veut-elle le manger ? L’offrir à Hélène ? Madame Sartine se rue vers la main suspendue, attrape la sucrerie et l’avale sans même la croquer. Hélène, d’abord surprise, se lève enfin pour prendre congé. Madame Sartine et elle s’éloignent laissant les pensionnaires se rendre au réfectoire. La grosse dame marche à petits pas. La beauté des traits de l’ancienne servante fait place à ceux plus grossiers d’une brune aux yeux noirs, visage ridé et joues tombantes. L’importune ne perd pas une seconde.
— Vous ne devriez pas perdre votre temps avec cette vieille folle.
— Ses propos m’ont pourtant paru des plus sensés, s’étonne Hélène.
— C’est précisément en cela qu’elle est dangereuse. D’ailleurs tout le monde ici l’a compris et nul ne se hasarde à lui adresser la parole.
Hélène Grancher s’arrête.
— Mais pourquoi ?
Le bras tendu vers la double porte en chêne, madame Sartine fait signe à l’infirmière de l’accompagner vers la sortie de l’Hospice. Elles marchent d’un pas lent, sans cesser toutefois la conversation.
La Sartine s’explique.
— Dès son arrivée ici, elle s’est isolée ne parlant jamais à personne, répondant à peine aux civilités. Cette femme est étrange, abandonnée de tous. Pour preuve, sa fille n’est venue la voir qu’une seule fois, il y a de cela treize ans.
Sa fille ?
Les questions se bousculent alors dans la tête de l’infirmière. Elle n’a jamais rien lu qui mentionne son existence ! Hélène préfère cependant garder le silence pour ne pas interrompre la Sartine.
— Seuls les curieux lui rendent des visites intéressées. La Conciergerie. Toujours la Conciergerie. À bien y penser, il est probable que cet événement soit le point de départ de sa démence.
— Je pense pour ma part que cette dame est bien intéressante et je compte revenir lui rendre visite très prochainement.
— Je vous le déconseille.
Le ton se veut ferme.
— Je…, mais…
— Ai-je été assez claire ?
Hélène reste sans voix. La lourde porte se referme derrière elle.
Les mots de cette femme résonnent encore dans l’oreille de l’infirmière.
Rosalie a donc une fille. Qui fut son mari ? Et pourquoi les deux femmes sont-elles en désaccord ? Pourquoi mademoiselle Lamorlière refuse-t-elle obstinément de parler de la Reine à celles demeurant ici avec elle ? Et que signifie cette volonté d’isolement ?
La curiosité d’Hélène laisse place à un sentiment de malaise.
Pourquoi cette grosse bonne femme essaie-t-elle de la dissuader de revoir Rosalie ?
1 À madame Simon-Viennot qui vient la voir le 1er décembre 1836, Rosalie déclare devoir son placement dans cette maison à madame la Duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI et Marie-Antoinette. Cette faveur est accompagnée d’une pension de 200 francs que la vieille dame perd suite à la révolution de juillet 1830.
2 Archives de l’Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris, cote 1Q1-1. Le registre d’entrée de l’hospice des incurables fait état de l’arrivée de Marie-Rosalie Delamorlière, sous le numéro 199, à la date du 24 mars 1824 sur présentation de M. le Baron Richard d’Aubigny, membre du conseil.
3 Entrée aux Incurables en 1840, à l’âge de 36 ans et décédée le 30 juillet 1854. Archives de l’APHP, Incurables K1, registre des employés de 1814 à 1863.
4 Aux archives communales de Breteuil, dans l’Oise, on apprend que le véritable nom de Rosalie est Marie-Rosalie Delamorlière, née le 19 mars 1768 du légitime mariage de François Delamorlière, cordonnier et de Marie-Charlotte Vaconsin. Elle est baptisée le même jour.
2
Voilà une semaine qu’Hélène Grancher ne cesse de penser à la pensionnaire de la rue de Sèvres. Elle a donc sollicité sans plus attendre un entretien avec Sœur Agnès.
Rosalie Lamorlière ne la laisse pas indifférente, mais les obstacles pour parvenir jusqu’à elle, s’amoncellent. La religieuse saura sans doute les faire tomber et répondre, par la même occasion, à bon nombre de questions restées en suspens depuis sa première visite.
L’attente se fait longue. Le couloir est silencieux. L’a-t-on oubliée ?
Hélène, immobile, fait antichambre et a tout le loisir de contempler le mobilier de cet espace sous voûte. Décoration plus que spartiate : un banc pour chaque porte, soit quatorze pièces de bois exactement.
Dix heures vingt. Mais que fait-elle ?
Une nonne d’une quarantaine d’années se présente enfin devant madame Grancher.
— Suivez-moi ! Sœur Agnès va vous recevoir.
Encore un peu de patience. La demoiselle à l’accent belge va peut-être la conduire à la vérité. Sœur Félicité la précède, lui ouvre la porte et s’en va.
Hélène, pour une raison qu’elle ignore, demeure immobile. Sa curiosité ne suffit pas à lui faire franchir le seuil.
Et si les réponses qu’elle obtenait la décevaient…
Tout à coup, une voix nasillarde résonne.
— Entrez !
Le ton n’incite guère à la désobéissance. Ce n’est pas une invitation, mais un ordre. L’infirmière ne peut que s’exécuter, laissant derrière elle ses doutes.
Face à elle, debout et lui tournant le dos, une frêle silhouette regarde par l’immense fenêtre. Madame Grancher observe la pièce dans laquelle elle vient de pénétrer. Il y règne une austérité comparable à l’endroit que l’infirmière vient de quitter. Une imposante table de chêne est placée entre la religieuse et elle, seules deux chaises y font face à un siège un peu plus haut dont le dossier semble recouvert d’une tapisserie usée jusqu’à la corde. Contre le mur de gauche, une bibliothèque bien garnie, mais poussiéreuse. Sur le mur opposé, deux banquettes au cuir craquelé.
— Que voulez-vous ?
— Vous poser des questions sur mademoiselle Lamorlière.
Toujours immobile, mains derrière le dos, Sœur Agnès regarde les pensionnaires qui commencent à se rendre dans la cour. Hélène considère cette femme si menue dans son habit de laine bleu-gris. Comme toutes les Sœurs de Charité, la jupe de sa tenue comporte neuf plis sur l’arrière et est fendue d’une poche de chaque côté. La cornette de coton blanc amidonné est immobile.
— Marie-Rosalie Delamorlière. Évidemment ! Toujours elle. Vous êtes infirmière m’a-t-on dit.
— On vous aura bien renseignée.
— Vous l’êtes moins quant au nom de la pensionnaire que vous venez visiter. Son nom de baptême est Delamorlière, précisément celui qui fut inscrit sur le registre d’entrées lors de son arrivée.
La Sœur se décide enfin à se tourner vers son interlocutrice.
Le visage ridé est sévère. Les yeux sont clairs et pourraient être beaux s’ils n’étaient presque cachés par des paupières tombantes et posés sur des poches flasques rougies et fripées. Le haut de son habit, une chemise simple de la même matière que la jupe, est recouvert d’un rabat en coton blanc croisé sur la poitrine. Elle porte à la taille une ceinture noire à laquelle est attaché un chapelet très long en buis qui se termine par une pièce d’ivoire formée de deux visages. Hélène peut y voir d’un côté une tête de mort et de l’autre le visage du Christ, symboles de la mort et de la Résurrection.
— Pourquoi vous intéresser à elle en particulier ? Vos visites pourraient faire le plus grand bien à d’autres dames charmantes présentes en ces murs.
Les obstacles ne seront pas si aisés à franchir finalement.
— Je n’en doute pas, car ce sont, à peu de choses près, les mots employés par l’une d’elles, la semaine dernière.
— À mon avis, une dame de bon sens que vous devriez écouter.
— Je n’y manquerai pas… quand le moment sera venu. Pour l’heure, je désire apprendre à connaître mademoiselle Delamorlière, répond l’infirmière en insistant bien sur la première syllabe.
Hélène Grancher est bien décidée à ne pas se laisser impressionner.
— Grand bien vous fasse, mais n’espérez pas le faire par mon intermédiaire. Et si le fait de découvrir quelques faits sensationnels sur une Reine défunte explique ces entretiens, vous feriez mieux de passer votre chemin.
— J’en prends acte. Mais croyez-moi, ma Sœur, cette curiosité malsaine que vous redoutez, ne motive en rien ma démarche. Mes visites lui font même plaisir, je crois.
— Plaisir, dites-vous ? Un bien grand mot pour un péché qui n’en a pas le nom. Cet établissement est régi par des règles et j’entends les faire respecter.
— Cela est tout à votre honneur et je ne souhaite pas aller à l’encontre de l’une d’entre elles. Voilà pourquoi j’ai rencontré la Mère Supérieure, un peu plus tôt dans la matinée.
— Qu’avez-vous fait ?
Pour la première fois, le visage de sœur Agnès s’empourpre. La religieuse paraît désarçonnée.
— Loin de moi l’intention de vous contrarier. J’ai visité bien des établissements et quantité de malades. Pourtant, de ma vie durant, jamais on ne m’avait fait comprendre avec autant d’insistance que mon aide n’était pas la bienvenue. Mais les injonctions de l’une de vos pensionnaires n’y feront rien.
— Qui ? Le nom de cette personne, je vous prie ?
— Une femme assez forte avec en permanence la goutte au nez. La semaine dernière, elle a tenté de me dissuader de revoir mademoiselle Delamorlière, la traitant même de pauvre folle.
— Ce qui n’est pas faux en soi.
— Son discours m’a pourtant paru empli de bon sens. Et quand bien même ! Supposons ! Les fous n’ont-ils pas droit à une once de charité chrétienne ?
— Madame Sartine a simplement voulu vous épargner de trop grandes désillusions et vous éviter de vous faire perdre votre temps, par pure charité chrétienne.
— Trop aimable, vraiment. Mais je compte bien continuer à venir la voir et sachez que votre Supérieure n’y voit aucun inconvénient. Sa fille l’a déjà abandonnée, je ne compte pas ajouter à son chagrin.
Sœur Agnès n’en croit pas ses vieilles oreilles.
— Sa fille ? Mère Isabelle vous en a parlé ?
— Oh non ! Elle ne m’a rien dit sur notre amie que je ne savais déjà. Mes questions sont demeurées là encore sans réponses.
— Alors qui ?
— Madame Sartine, encore, la semaine dernière, en me raccompagnant à la porte.
La religieuse tente avec beaucoup d’effort de contenir sa colère.
— N’en parlez à personne ! La malheureuse n’aurait pas dû. Personne n’est au courant. Mademoiselle Delamorlière n’en a jamais soufflé mot à quiconque, et il n’est pas de notre autorité de nous immiscer dans la vie passée de nos pensionnaires.
L’infirmière ne peut s’empêcher de penser que la religieuse doit certainement lui cacher beaucoup d’autres choses.
— Si tel est le cas, comment avez-vous su que Rosalie avait une fille, ma Sœur ?
— Le voile n’est pas un rempart contre la curiosité. Je suis religieuse, je n’en suis pas moins femme. J’ai moi aussi mes petites faiblesses.
Le tête-à-tête est soudain interrompu par le bruit de pas lourds et rapides sur le carrelage du couloir. La voix rauque se fait entendre alors que la grosse bonne femme n’a pas encore franchi la porte du bureau.
— Sœur Agnès ! Ma Sœur ! Vous ne devinerez jamais ! Cette infirmière ne cesse de demander…
Surprise, et à la fois amusée, Hélène se retourne et sourit à madame Sartine qui, bouche bée, renifle sur le pas de la porte.
— Bien le bonjour, madame Sartine. Toujours cette goutte au nez, je vois.
L’incompréhension se lit sur le visage rougi de la pensionnaire qui, interdite, cherche Sœur Agnès du regard.
— Eh bien Solange ! Reprenez votre souffle ! Madame Grancher est ici pour s’entretenir avec mademoiselle Delamorlière. Est-ce cela que vous veniez m’annoncer ?
— Oui, je…
Sœur Agnès reprend :
— Vous tombez à pic, nous parlions justement de vous.
— Vraiment ?
Le visage de madame Sartine se fait rubicond.
— Je croyais pouvoir vous faire confiance.
Le ton employé par la religieuse suinte le reproche.
— Mais vous pouvez. Savez-vous que Rosalie demande à voir cette femme ?
— Peu m’importe. Dorénavant, et en accord avec Mère Isabelle, madame Grancher viendra quand elle le souhaitera. En respectant les règles de l’établissement, cela va sans dire. Mais dites-moi Solange, je pensais vous avoir demandé expressément de ne rien révéler sur l’existence de la fille de mademoiselle Delamorlière. Et j’apprends que vous en avez fait part à madame Grancher la semaine dernière.
— Je tentais juste de dissuader Madame de revenir la voir. Mais promis ! Je ne dirai plus rien d’autre, sauf si vous m’y autorisez.
— Il y a donc d’autres choses que vous savez, madame Sartine ? s’étonne Hélène Grancher.
Le regard furieux, la religieuse ordonne d’un mouvement de tête à la veuve Sartine de s’en aller sur le champ.
La Sartine, honteuse, voudrait disparaître dans les lames du parquet. Elle s’empresse d’obéir à Sœur Agnès et tourne les talons en marmonnant à l’adresse de cette trop envahissante madame Grancher :
— Non, madame. Elle a une fille. Voilà tout !
***
Un peu plus tard dans la journée, au nord de la capitale, de l’autre côté de la Seine, une femme assez grande, mince, vêtue d’une robe montante gris perle, prend place sur un banc du jardin des Tuileries et ouvre une gazette. Sous le soleil éclatant du mois d’août, elle va pouvoir se laisser aller à son occupation favorite : la lecture des faits divers qu’une grande ville comme Paris ne manque pas d’offrir à des lecteurs avides de morbides indiscrétions. Depuis quelques jours, une histoire, une seule, est sur toutes les lèvres : l’assassinat de la Duchesse de Choiseul-Praslin perpétré par son époux.
Le peuple en a frémi d’horreur, les femmes en rêvent encore, de vieux soldats en pleureront longtemps. Oui, elle est morte hachée, tailladée, estropiée comme pas un criminel ne meurt aujourd’hui sous le fer du bourreau, comme pas une brebis sous le couteau du boucher.
Ne cherchez pas l’assassin au-dehors. L’hôtel était bien clos, et l’écume du bagne est innocente de ce meurtre.
Ceci est un acte d’autorité domestique. C’est la justice telle que l’a faite un maître de maison.
Cette femme avait donc commis un de ces crimes que la dignité d’un chef de famille dérobe aux lois et punit dans les ténèbres ?
Non. Son âme n’était que pureté et la vertu seule allait à sa fierté.
Pour n’avoir pas trouvé grâce devant son maître, cette femme l’avait donc affligé de sa stérilité ?
Non. Neuf fois elle avait été mère et la fécondité de son cœur égalait celle de ses entrailles.
Alors le meurtrier ne savait pas ce qu’il faisait ? Il était fou ?
Que nenni ! Cet homme administrait l’héritage de ses pères avec prudence.
C’était donc un monstre ?
Sa mansuétude était notoire. Il soulageait les malheureux et accueillait les étrangers avec grâce. Il n’eût pas tué un moucheron.
Et c’est lui qui a assassiné, laborieusement assassiné sa femme, n’étant ni fou ni méchant ? Qu’était-il donc ?
Un mari. Un homme qui ne pouvait souffrir les airs dominateurs de sa femme, et se disait que le maître absolu c’était lui. Quand l’époux est digne de commander, que la femme soit soumise, Dieu le veut ; mais lui commandait impérieusement parce qu’il était mari ; mari et duc ; duc et sot.
Race fine et vaillante, voici votre héritier prenant pour devise de ses travaux de chaque jour et inscrivant en lettres de sang sur votre écusson : « La poule ne doit pas chanter devant le coq ».
Nous jetons le cadavre de l’assassin comme un reproche à tous les pouvoirs et leur disons : « Le reconnaissez-vous ? Celui-ci est un des vôtres. »5
Marie, perplexe, ferme le journal. Les enfants qui jouent près d’elle, les amants qui paradent dans leurs plus beaux habits, là pourtant, juste devant ses yeux, elle ne les voit pas. Elle est soucieuse. Elle peut entendre un murmure parcourir les rues de Paris. Un de ceux annonçant, à qui sait tendre l’oreille, la gestation et la délivrance prochaine d’un cri des plus puissants. L’orage gronde et semble pouvoir éclater à tout moment. Marie en est convaincue. L’industrialisation naissante s’est accompagnée de revendications multiples, mais légitimes qui ne semblent pourtant pas trouver écho aux Tuileries. Les femmes, ces descendantes des tricoteuses de 1789, revendiquent « la réglementation définitive des rapports de l’homme et de la femme ». Les spéculations boursières entraînent faillites et banqueroutes. Des ministres, tels Teste et Cubières, se voient mêlés à des scandales politico-financiers. Et la duchesse de Praslin, cette pauvre femme, se fait assassiner à coups de couteau par son mari, pair de France ! Marie est persuadée que ce sang versé vient entacher un peu plus encore le prestige de la noblesse et indirectement celui de la famille royale.
Elle dévore les revues historiques et déguste chaque article des journaux achetés un sou, le long des quais. Pour les personnes avisées comme elle, sachant lire entre les lignes, l’année qui s’annonce promet d’être terrible. Des députés réformistes, soutenus par la presse, organisent à Paris et dans plusieurs villes de province, des banquets où chaque convive est censé payer son déjeuner, bravant ainsi l’interdiction du droit de réunion. L’appétit de réformes est fédérateur et l’on sert précisément en plat principal, l’élargissement du droit de vote à satiété. Marie aimerait bien assister, ne serait-ce qu’une fois, à l’un d’eux, mais Antoine, son mari, l’en a toujours empêchée. Ils tiennent tous deux une bijouterie spécialisée dans le doré et sont devenus de véritables petits bourgeois. Monsieur Lacroix6, fils de charpentier, n’entend pas anéantir le travail de toute une vie pour assouvir la curiosité citoyenne de son épouse.
— Ne pouvez-vous donc faire attention ?
Marie tourne la tête et aperçoit Désiré s’excusant avec maladresse auprès d’un vieillard moustachu apparemment mécontent d’avoir été bousculé par cet homme à la jeunesse insolente. Ce doux rêveur devait encore avoir la tête ailleurs. Sans doute était-il occupé à penser à la prochaine toile qu’il allait exécuter. Antoine, son père, voit d’un très mauvais œil cet intérêt soudain pour les arts. Voilà bientôt un an qu’il prend des cours de peinture en délaissant un peu plus chaque jour le travail à la bijouterie. Il n’est plus sûr qu’il prenne un jour la relève et cela a le don de l’agacer au plus haut point. Tant d’efforts, de sacrifices et de dur labeur balayés d’un coup de pinceau. Le père refuse obstinément les rêves du fils et ne désespère pas de le ramener sur le chemin de la raison. Marie, pour sa part, est fascinée par ce jeune homme d’à peine vingt ans7. Elle considère toutes ses fantaisies avec indulgence et va jusqu’à s’en amuser.
Qu’il avait grandi le petit Désiré ! Si tout le monde l’appelle par son premier prénom Adolphe, Marie lui préfère le second qui représente tant à ses yeux. Désiré, comme l’est cet enfant qu’elle ne portera jamais. Le jeune homme est le portrait d’Antoine si ce n’est ce visage un peu plus dur révélant le caractère un brin sanguin de l’artiste. Le corps est mince et athlétique. Marie l’admire. Elle ne cesse de répéter à qui veut l’entendre que son Désiré aurait certainement pu servir de modèle aux sculpteurs de l’antiquité. Il fait sa fierté bien qu’il soit toujours célibataire. Étrangement, elle ne lui connaît aucune aventure. Dans quelques semaines, Antoine et elle fêteront leurs noces de muguet. Marie revoit le petit Désiré, alors âgé de sept ans, portant le coussin lilas à bordures dorées sur lequel étaient disposés les anneaux entrelacés. Malgré son manque de maturité, Marie avait réussi à se faire accepter par le jeune garçon et l’avait élevé comme s’il était le sien. Le jour de ses noces, la nouvelle épouse était radieuse et brillait de mille feux.
Certaines mauvaises langues, par jalousie ou par dépit, n’avaient pas hésité à se rendre à la mairie du sixième arrondissement afin d’assister au mariage « du beau bijoutier et de sa devanture sur pattes ». Leur union, qui n’avait de clandestin que le nom, avait donc enfin été officialisée au grand dam des femmes du quartier. La petite vendeuse avait uni sa vie à celle de son patron, une année à peine après la mort de la première épouse8. Elle s’est trouvé une famille. L’employée modèle a anéanti les derniers espoirs des multiples prétendants. Ah ! Que de cœurs brisés en ce 17 septembre 1835 ! Celui de Marie n’a attendu qu’une seule petite semaine avant de saigner à son tour.
L’ascension sociale n’est pas sans quelques marches ratées ici et là. Certes, Marie trébuche de temps à autre, mais, avec le temps, elle a appris à le faire avec beaucoup de dignité. Elle comprend d’autant plus ce que Louise, la première épouse d’Antoine, avait dû ressentir quand elle attendait désespérément la moindre caresse de l’époux infidèle. Mais là où Louise Lacroix s’était montrée indulgente et discrète, Marie avait décidé de montrer à toutes ces dames en mal d’amour qu’Antoine était à elle. Chasse gardée ! Circulez !
— Vous voyez, je suis à l’heure.
Marie ne peut s’empêcher de sourire à cet homme aux cheveux châtains mi-longs. Il est essoufflé, complètement débraillé.
— Regarde-toi ! Rentre ta chemise et recoiffe-toi ! On te dirait évadé de Charenton.
— Oui je suis fou. Fou de colère. Lisez !
Désiré lui tend un exemplaire du Charivari, le journal satirique républicain.
— Ouvrez la troisième page !
— Quoi ? Encore une représentation de Louis-Philippe en poire, peut-être ?
Marie tourne la première page du journal et lit le titre en gros caractères : les ronds de jambe de Madeleine Lange émoustillent le Tout-Paris. Elle n’ira pas plus loin. Elle referme immédiatement la page et pose les feuilles froissées sur le banc.
— N’est-ce pas cette fameuse danseuse dont père s’est entiché ?
— En effet !
— Je vous préviens, s’il vous déshonore publiquement, je le tue !
Marie n’est pas choquée. Son Désiré, elle le connaît. Ses réactions, parfois violentes, pourraient en désarçonner plus d’un, mais elles ne se résument qu’à des mots prononcés haut et fort sans qu’aucune action ne les suive. Elle parvient toujours à le raisonner, car elle sait tenir une place particulière dans ce cœur qui s’embrase bien vite.
— Tu dois le respecter.
— Comment faire puisque lui-même ne respecte rien ni personne ?
— Ceci ne te concerne en rien. C’est entre lui et moi. S’il m’avait été donné de connaître mon père, je l’aurais aimé quoi qu’il fasse. J’ai grandi seule, après avoir été abandonnée par ma mère. Je ne connais pas l’identité de l’homme qui m’a conçue. Profite de la chance que je n’ai jamais eue.
À ces paroles, Désiré se calme un peu et prend place aux côtés de la bijoutière. Marie sait maîtriser la colère du fougueux jeune homme, mais elle ne sait composer avec l’insolence dont il se montre parfois capable.
— Justement. Pourquoi ne pas reprendre contact avec votre mère ? N’est-elle pas la seule famille qu’il vous reste ?
— Laissons cela, veux-tu ? Nous en avons déjà maintes fois discuté.
— Un arbre ne peut vivre sans racines.
— Te voilà botaniste à présent.
— Je ne plaisante pas. Vous venez vous-même de déclarer qu’il faut respecter ses parents.
— Cesse ce petit jeu, Désiré ! Je reconnais bien là les façons de ton père.
Piqué, le jeune homme n’est pourtant pas décidé à rendre les armes.
— Grand-Mère a vécu un moment important de l’Histoire. Aujourd’hui, elle est un passage obligé pour les biographes de Marie-Antoinette. Ce serait du gâchis de ne pas comprendre qu’elle deviendra un personnage incontournable pour l’histoire de France, mais qu’elle l’est aussi de la vôtre.
— Elle n’est pas ta grand-mère.
— En vous mariant à Antoine Lacroix, elle l’est devenue et vous m’avez toujours empêché d’aller la voir. Je respecte cette demande, mais avoue ne pas la comprendre.
— Rentrons !
Dans l’omnibus qui les emmène vers le passage Bourg l’Abbé, tous deux demeurent silencieux. Marie regarde par la portière. Des enfants, heureux, se promènent tenant la main de leurs parents. Leurs rires résonnent comme de fausses notes pour cette femme dont l’enfance n’a été que silence.
— Mère, nous sommes arrivés.
Désiré descend le premier et tend la main à la dame en robe gris perle. Elle s’en empare sans toutefois y prendre appui et saute avec légèreté sur le pavé. Après quelques pas, ils pénètrent tous deux dans le passage et marchent d’un pas lent sous la verrière cintrée. L’horloge indique un peu plus de midi.
Marie aperçoit une femme portant une robe sombre qui se tient au niveau de l’escalier A. Malgré la chaleur, elle porte un bonnet en vieux point de Venise, d’où pas un cheveu ne dépasse. À cette heure, la malheureuse cliente a dû trouver porte close. Son visage ne lui est pas familier. Il ne s’agit pas d’une habituée.
— Bonjour. Je suis Hélène Grancher. Pourrais-je vous entretenir quelques instants ?
5 Article composé d’extraits de Pathologie du mariage par madame de Casamajor, Paris, 1847.
6 Antoine Lacroix, né le 3 nivôse an 8, à 11 heures du soir, au 21 rue de Ménilmontant à Paris. Fils de Pierre Lacroix et de Marie-Jeanne Debrou, son épouse. Archives départementales de Paris.
7 Adolphe Désiré Lacroix, né le 14 janvier 1828 à Paris. A.D.P.
8 Louise Éléonore Gambier décède le 6 novembre 1834, à l’âge de trente-quatre ans. A.D.P.
3
Madame Darmon s’est isolée dans la cour Gamard et s’apprête à lire un article des plus croustillants. Cette femme, pourtant d’une timidité maladive ne marchant que la tête baissée et les épaules rentrées, se délecte d’histoires scabreuses en tout genre. Et ces dernières semaines, toute sa reconnaissance va à une danseuse sans scrupule nommée mademoiselle Lange. Par presse interposée, elle lui amène un peu de distraction en ce lieu qui en est si cruellement dépourvu.
Elle entend des bruits de pas et s’empresse de mettre sous elle le journal. Sœurs Félicité et Philomène arrivent accompagnées de quelques pensionnaires désirant profiter des dernières belles journées de ce mois de septembre. Personne n’a remarqué la présence de Rosalie, assise derrière un forsythia, les yeux rivés sur le cadran solaire.
— Oh, ce n’est que vous ! J’avais peur de voir apparaître Sœur Agnès.
— N’ayez crainte, madame Darmon ! Le cinquième cavalier de l’Apocalypse est encore dans son antre.
Sœur Philomène étouffe maladroitement un rire porcin.
— Sœur Félicité ! Voyons ! Si elle vous entendait ?
— Je compte alors sur vous pour venir fleurir ma tombe. Mais sur quoi êtes-vous donc assise, madame Darmon ? Est-ce là un journal que vous tentez de dissimuler avec votre maladresse habituelle ?
— Comment ?
Sœur Félicité hausse un peu la voix pour se faire entendre de cette pensionnaire aux oreilles défaillantes.
— On lit la presse ?
— Oui, je…
— Montrez-moi ! Hâtez-vous !
Sœur Félicité saisit les pages froissées et oppose à l’air coupable de la dame son sourire le plus rassurant.
— Ah ! Mademoiselle Lange !
Après un moment de silence, des murmures parcourent la cour.
— Chut ! Moins de bruit ! Je vais vous faire la lecture. Asseyez-vous !
La religieuse parcourt rapidement la une.
Elle hésite.
— Finalement, je ne sais si je vais pouvoir.
La déception se lit sur les visages de celles qui se sont approchées.
— Nous sommes suspendues à vos lèvres. Allez-y ! Nous ne tenons plus, insiste une des vieilles pensionnaires assises là.
C’est que justement ma bouche n’oserait prononcer certains de ces mots empreints d’érotisme. Cette femme surpasse toutes les courtisanes.
Cela, au contraire, ne fait qu’attiser la curiosité des vieilles dames.
— Dites-nous de quoi il en retourne au moins enfin ! insiste l’une d’entre elles.
— Très bien. Donnez-moi deux minutes que je termine !
Sœur Philomène, peut-être pour connaître également son petit moment de gloire, est sur le point de dévoiler un petit secret.
— Mesdames ! Connaissez-vous le véritable prénom de Sœur Agnès ?
Sœur Félicité quitte momentanément sa lecture. Elle fait un clin d’œil à son amie et esquisse un sourire avant de replonger tête baissée dans les feuilles du journal de madame Darmon.
— Et bien, elle s’appelle en fait Madeleine.
Les vieilles dames se mettent à parler entre elles de cette révélation aussi inattendue qu’incroyable. Sœur Agnès porterait le prénom d’une prostituée qui, à l’aide de ses cheveux, essuya les pieds du Christ après les avoir lavés.
Sœur Félicité est obligée de les rappeler à l’ordre.
— Silence mesdames ! On se croirait dans une volière. Et avec tant de bruit, vous ne pourrez pas entendre ce que j’ai à vous dire.
Le silence se fait aussitôt.
— Madeleine, la danseuse, est à nouveau enceinte.
— Oh ! Cela doit bien faire son troisième enfant, lance une dame.
— Ce n’est pas mentionné, mais vous semblez bien au fait de tout ceci, madame Darmon. Il est simplement dit que l’identité du père n’est pas certaine.
— Vous parlez d’une nouvelle ! Pour les précédents non plus, nous ne savons rien du nom de ces agités.
— Oui, mais là, on avance deux pistes possibles. Un certain Gustave D. ou Antoine L. Affaire à suivre donc…
Les affres de la danseuse sont devenues secondaires. L’intérêt des pensionnaires est tout à Sœur Agnès. Cette Madeleine au goût bien rance.
— Moi, je suis sûre qu’elle mange des pâtisseries en cachette dans sa chambre. Elle n’arrête pas de s’isoler là-bas, et ce, plusieurs fois par jour. À croire que toutes les Madeleine se ressemblent. Seul l’objet de leur gourmandise varie.
— Vous avez raison, madame Darmon. Je m’en suis aperçue. D’ailleurs, avez-vous remarqué qu’elle se caresse le poignet dès qu’une envie l’assaille ?
— Eh bien, Sœur Félicité, on pourrait se demander la raison pour laquelle elle a pris le voile, car si l’on se réfère à la petite manie dont vous venez de parler, la tentation chez elle paraît être quotidienne.
Quelqu’un vient ! On renifle. Tout le monde se tait. L’identité de celle qui s’approche ne fait aucun doute.
— De quoi riiez-vous à l’instant ?
— Nous parlions de madeleines. En avez-vous déjà mangé, madame Sartine ?
— Ma Sœur, je ne pensais pas qu’une chose aussi insignifiante pouvait déclencher de tels rires chez de vieilles femmes. À moins que celles-ci ne soient folles.
— Eh bien, j’ai ri à gorge déployée, madame. Me traiteriez-vous d’aliénée ? lui répond la religieuse.
Madame Sartine, d’habitude si loquace, semble désarçonnée. Elle réalise une nouvelle fois que sa méchanceté pourrait être prodigieuse si elle était accompagnée de la rapidité d’esprit de Sœur Félicité. Mieux vaut ne pas s’attarder et accomplir la mission dont on l’a chargée.
— Avez-vous vu mademoiselle Lamorlière ? demande la Sartine.
— Je suis là.
Rosalie se tient debout, droite et digne à côté du forsythia. Les femmes, surprises, se regardent. Le fait qu’elle ait entendu les moqueries n’est pas grave. Tout le monde sait que Rosalie est la discrétion incarnée. Mais il faudra se montrer prudentes à l’avenir. Derrière l’arbuste aurait pu se trouver une madame Sartine ou autre Sœur Agnès.
— Madame Grancher souhaite vous revoir. Sachez aussi que Sœur Agnès n’y tient pas.
— Je vois encore qui bon me semble. Si l’infirmière me demande, je serai heureuse de la rencontrer.
— Soit. Mais cela contrariera beaucoup Sœur…
— J’ai bientôt quatre-vingts ans, madame Sartine. Pensez-vous que l’on puisse encore interdire à une dame de mon âge de voir qui elle veut ? Même ma sciatique ne m’a que rarement empêchée de faire ce que je désirais.
La cloche retentit. Les deux femmes se jaugent longuement devant l’assemblée muette.
— C’est l’heure du repas !
À ces mots de Sœur Philomène, les pensionnaires de l’hospice se lèvent mollement. Madame Sartine, lèvres serrées, se retourne et, d’un pas rageur, se dirige vers le réfectoire, suivie, à distance, de ses compagnes d’infortune.
***
Voilà cinq bonnes minutes que monsieur Anquetin9 tente de renvoyer chez lui ce jeune homme à l’apparence quelque peu bohème. Le portier des Incurables a reçu l’ordre de ne laisser entrer aucun curieux désirant voir mademoiselle Delamorlière. Celui-ci insiste plus que de coutume et hausse même la voix. Des passants se sont même arrêtés pour profiter du spectacle. Mon Dieu ! Sœur Agnès, sans doute alertée par ce tohu-bohu, se dirige vers la loge du gardien.
— Anquetin ! Que se passe-t-il ? tempête Sœur Agnès.
— Ce monsieur ordonne qu’on le laisse entrer. Il veut voir mademoiselle Delamollière.
— Il ordonne !
Sœur Agnès pousse le quinquagénaire pour voir à quoi ressemble cet effronté. Un jeune homme, apparemment bien fait, tape du pied sur le pavé. Il aperçoit la religieuse…
— Ma Sœur, s’il vous plaît ?
Ces immenses yeux noisette, ces lèvres charnues… Sœur Agnès se gratte l’avant-bras gauche.
— Faites-le entrer !
Anquetin, dubitatif, s’exécute.
— Suivez-moi, monsieur !
Adolphe suit la petite silhouette dans la grande cour de l’hospice. La Sœur grise10 se dirige vers une porte déjà ouverte, à droite de la chapelle. Elle fait signe au visiteur de la suivre puis ils empruntent l’escalier qui débouche sur un couloir interminable garni de bancs. Sœur Agnès traverse une pièce aux immenses fenêtres et prend place dans un important siège à accoudoirs. Elle invite, d’un geste d’une grande délicatesse, le jeune éphèbe à s’asseoir face à elle.
— Merci de me recevoir, lui dit-il reconnaissant.
— Je vous en prie. Vous sembliez si déterminé que je désirais connaître les raisons d’une telle énergie.
Madeleine, la femme, mains sous la table, ne peut s’empêcher de se caresser la manche.
— Je désire voir mademoiselle Delamollière.
— Doucement monsieur ! Toute personne désirant s’adresser à une de nos pensionnaires doit d’abord s’entretenir avec moi.
— Eh bien soit ! Que voulez-vous savoir ?
— Vous devez sans doute évoquer mademoiselle Delamorlière.
— Non. Il s’agit bien de Delamollière.
— Ma foi, voilà donc beaucoup de patronymes pour une seule personne.
— Pardon ?
— Nous connaissons cette demoiselle sous deux noms : Delamorlière, qui est son nom de baptême et Lamorlière. Ce dernier date de la période révolutionnaire et a été repris dans quelques ouvrages de gens curieux. Et voici que vous l’affublez d’un troisième. Puis-je connaître son origine ?
— Il me vient de ma mère : Marie-Rosalie Delamollière11, épouse d’Antoine Lacroix.
La religieuse ne dit mot. Cet Adonis serait donc le petit-fils de cette… Cela fait des années que personne ne s’inquiète plus de la malheureuse et voilà qu’en quelques semaines, tout le monde demande à la voir.
— Jeune homme, votre grand-mère nous cause bien du souci.
— Vraiment ?
— Hélas, je crains que vous ne soyez venu pour rien. Elle refuse les visites et ne souhaite parler à personne. D’ailleurs, elle ne parle jamais de vous.
— Tenteriez-vous de me dissuader de la rencontrer ?
— Je ne fais que vous exprimer une volonté de sa part.
— Sachez ma Sœur, que je suis un jeune artiste bénéficiant d’appuis sérieux et de mécènes influents. Certains d’entre eux ne sont pas inconnus à cet établissement et à son bon fonctionnement. Un refus de votre part serait fâcheux pour cette maison.
Ce n’est plus sa main qui lui caresse la manche sous la table, mais son poing.
— Dois-je voir ici une forme bien maladroite de chantage ?
— Oh non, ma Sœur ! Je respecte trop votre habit pour cela. C’est justement pour cette raison que je souhaite vous épargner bien des ennuis.
Que répondre ? En plus d’être beau, cet homme a du caractère et de l’esprit. La caresse sur le bras se fait insistante, voire douloureuse.
Sœur Agnès devrait résister, mais Madeleine capitule.
— Très bien. Allez-y ! Vous trouverez madame Delamorlière au réfectoire. Le bâtiment sur votre gauche en sortant. Je ne vous raccompagne pas.
— Je vous remercie.
— Auriez-vous toutefois l’amabilité de revenir me voir, votre entretien terminé ? J’aimerais savoir si cela s’est bien passé et ce qu’elle aura consenti à vous dire.
La question étonne d’abord Adolphe Désiré Lacroix, mais il y consent, trop heureux de pouvoir enfin rencontrer sa grand-mère.