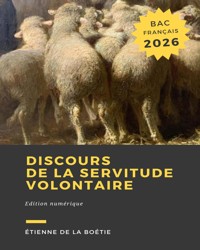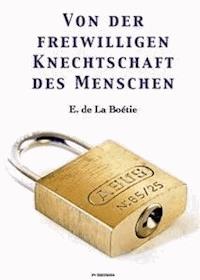Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Découvrez un trésor littéraire avec cette compilation des œuvres emblématiques de la littérature française. Ce recueil rassemble dix chefs-d'œuvre qui ont marqué les esprits à travers les siècles, offrant une immersion dans des univers variés et passionnants.
Pierre Corneille : "Le Menteur" (1644)
Plongez dans une comédie pleine de quiproquos avec Dorante, un menteur invétéré, dont les mensonges entraînent des situations hilarantes.
Alfred de Musset : "On ne badine pas avec l'amour" (1834)
Une pièce poignante qui explore les complexités de l'amour et les jeux dangereux des sentiments.
Arthur Rimbaud : "Cahier de Douai" (1870)
Les premiers poèmes du prodige Rimbaud, révélant déjà son génie et sa vision poétique unique.
Abbé Prévost : "Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut" (1731)
Une histoire d'amour tragique et passionnée entre le chevalier des Grieux et Manon Lescaut.
Honoré de Balzac : "La Peau de Chagrin" (1831)
Un conte philosophique sur le désir, la puissance et les limites de la volonté humaine.
Colette : "Sido" (1930)
Un hommage émouvant à la mère de Colette, rempli de souvenirs d'enfance tendres et nostalgiques.
Colette : "Les vrilles de la vigne" (1908)
Des récits courts où Colette explore les thèmes de la nature, de la féminité et de la liberté avec une prose poétique.
Étienne de La Boétie : "Discours de la servitude volontaire" (1577)
L'auteur livre une réflexion profonde sur la nature de la liberté et de la soumission. Par cette œuvre, il se penche sur l’incompréhensible phénomène par lequel les peuples acceptent volontairement leur servitude sous le joug d’un tyran.
Bernard Le Bouyer de Fontenelle : "Entretiens sur la pluralité des mondes"
Cette œuvre pré-scientifique de
Bernard Le Bovier de Fontenelle introduit des idées novatrices sur l’univers et la place de l’homme dans celui-ci. Avec des arguments fondés sur les découvertes de Copernic, Kepler et Galilée, l’auteur invite ses lecteurs à une exploration intellectuelle captivante, tout en rendant la science et les découvertes astronomiques compréhensibles pour un large public.
Françoise de Graffigny : "Lettres d’une Péruvienne"
Ce roman épistolaire nous plonge dans les réflexions d’une jeune péruvienne, Zilia, capturée et emmenée en France par les Espagnols. À travers ses lettres, elle raconte son émouvante expérience d’exil, sa rencontre avec la culture occidentale et ses interrogations face aux différences culturelles.
À PROPOS DES AUTEURS
Étienne de La Boétie (1530-1563) était un philosophe et écrivain français, principalement connu pour son œuvre Discours de la servitude volontaire. Jeune prodige de la pensée politique, il s'interroge sur la soumission des peuples aux tyrans et sur les mécanismes de la servitude. Son travail a influencé les penseurs des Lumières et continue d'alimenter la réflexion sur la liberté et la politique. Malgré sa mort prématurée à 33 ans, son héritage intellectuel demeure essentiel.
Pierre Corneille (1606-1684) est un écrivain français considéré comme l'un des plus grands auteurs de théâtre du XVIIe siècle. Il est surtout connu pour ses tragédies telles que "Le Cid" (1637) et "Horace" (1640) qui l'ont établi comme l'un des principaux auteurs de son époque. Il était également un poète talentueux et ses pièces sont remarquables pour leur langage poétique et leurs personnages complexes. Les pièces de Corneille ont eu une grande influence sur le développement de la tragédie classique française et son impact se ressent dans les œuvres de nombreux auteurs ultérieurs. Malgré les critiques et les controverses tout au long de sa carrière, les pièces de Corneille restent populaires et sont encore jouées aujourd'hui.
L'Abbé Prévost (1697-1763) est un écrivain et romancier français du XVIIIe siècle connu pour ses romans d'aventure et d'amour. Né à Hesdin dans le nord de la France, il rejoint l'ordre des Jésuites à l'âge de 16 ans mais quitte bientôt l'ordre pour devenir soldat. Après avoir combattu en Espagne et en Italie, il retourne en France pour poursuivre une carrière littéraire. Il publie en 1728 son premier roman, "Mémoires et aventures d'un homme de qualité", qui connaît un grand succès. Son roman le plus célèbre, "Manon Lescaut" (1731), est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature française. Cette histoire d'amour tragique entre un jeune homme idéaliste et une courtisane vénale a inspiré de nombreux artistes et a été adaptée en opéra et en ballet.
L'Abbé Prévost a également écrit d'autres romans, tels que "Cleveland" (1734) et "Histoire d'une Grecque moderne" (1740), ainsi que des essais et des traductions. Il a été élu à l'Académie française en 1746. Malgré ses succès littéraires,
l'Abbé Prévost a connu des difficultés financières tout au long de sa vie et a été contraint de fuir la France pour éviter la prison. Il est mort à Courbépine, en Normandie, en 1763.
Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757) était un écrivain, philosophe et académicien français. Il est surtout célèbre pour son œuvre Entretiens sur la pluralité des mondes, où il rend accessibles les avancées scientifiques de son époque. L'un des précurseurs de la vulgarisation scientifique, Fontenelle a su allier rigueur intellectuelle et esprit de dialogue. Ses écrits ont eu une grande influence sur le développement de la pensée scientifique en France et en Europe au XVIIe siècle.
Madame de Graffigny (1695-1758) était une romancière et dramaturge française du XVIIIe siècle. Elle est surtout connue pour son roman épistolaire Lettres d’une Péruvienne, qui critique les conventions sociales et les rapports entre les cultures. Actrice importante des salons littéraires, elle a écrit de nombreuses pièces de théâtre et œuvres littéraires, abordant souvent des questions sociales et politiques. Son travail a été apprécié pour son esprit et sa réflexion sur la condition féminine et les différences culturelles.
Honoré de Balzac est un écrivain français. Romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur, il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française. Il est un maître du roman français, dont il a abordé plusieurs genres, du roman philosophique avec Le Chef-d'œuvre inconnu au roman fantastique avec La Peau de chagrin ou encore au roman poétique avec Le Lys dans la vallée. Il a surtout excellé dans la veine du réalisme, avec notamment Le Père Goriot et Eugénie Grandet.
Arthur Rimbaud (1854-1891) est un poète français du XIXe siècle, célèbre pour ses écrits visionnaires et ses expériences littéraires audacieuses. Né à Charleville-Mézières, il commence à écrire de la poésie à un jeune âge et se lie d'amitié avec le poète Paul Verlaine. Leur relation tumultueuse a inspiré certains de leurs écrits les plus célèbres. Rimbaud est notamment connu pour ses recueils de poésie, "Les Illuminations" (1886) et "Une saison en enfer" (1873), qui ont influencé de nombreux artistes et écrivains après lui. Il a arrêté d'écrire de la poésie à l'âge de 21 ans et a vécu le reste de sa vie en Afrique, où il a travaillé comme marchand d'armes. Il est mort en 1891 à l'âge de 37 ans.
Alfred de Musset (1810-1857) est un poète, dramaturge et romancier français célèbre pour ses œuvres romantiques. Né à Paris, il a commencé à écrire de la poésie dès son plus jeune âge. En 1832, il rencontre George Sand, une écrivaine française célèbre, avec qui il a une relation tumultueuse qui a inspiré certaines de ses œuvres les plus célèbres. Parmi ses pièces de théâtre les plus connues, on peut citer "Les Caprices de Marianne" (1833) et "On ne badine pas avec l'amour" (1834). Alfred de Musset a été élu à l'Académie française en 1852, mais sa santé mentale s'est détériorée à la fin de sa vie et il est décédé en 1857 à l'âge de 46 ans.
Sidonie Gabrielle Colette, née en 1873 en France, fut une icône littéraire intemporelle. Connue sous le nom de
Colette, elle brilla par sa plume unique et sa rébellion subtile. Ses œuvres emblématiques, dont "Claudine à l'école" et "Gigi", captivèrent le public du début du 20e siècle.
Colette n'était pas seulement une auteure, mais une femme audacieuse qui bouscula les conventions sociales. Son art saisissant et son regard perspicace sur la condition féminine lui ont valu une place permanente dans le cœur des lecteurs du monde entier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1884
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
10 œuvres du bac français 2026
Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1563)
Pierre Corneille, Le Menteur (1644)
Abbé Prévost, Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (1731)
Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes (1757)
Françoise de Graffigny, Lettres d'une Péruvienne (1758)
Honoré de Balzac, La Peau de chagrin (1831)
Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour (1834)
Arthur Rimbaud, Cahier de Douai (1919)
Colette, Les vrilles de la vigne (1908)
Colette, Sido (1930)
DISCOURSDE LASERVITUDE VOLONTAIRE
Étienne de La Boétie
– 1563 –
INTRODUCTION
DANS sa brève existence de trente-deux ans, si La Boétie eut le temps de composer plusieurs opuscules, fort divers d’allure et de ton, il ne put en publier aucun. Montaigne lui-même, héritier des papiers de son ami disparu, imprima, dès 1571, les vers latins ou français de La Boétie et ses traductions de Xénophon et de Plutarque, mais il ne jugea pas à propos de divulguer ni le Discours de la Servitude volontaire, ni les Mémoires de nos troubles sur l’édit de janvier 1562, dont Montaigne confesse formellement la paternité à La Boétie, mais à qui il trouvait « la façon trop délicate et mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d’une si malplaisante saison ».
Ainsi, l’histoire de l’œuvre de La Boétie débutait sur une double obscurité : Montaigne, qui imprimait les ouvrages de son ami ne pouvant soulever aucune difficulté, se taisait au contraire délibérément, sur tous ceux qui pouvaient prêter à controverse ; et ce silence offrait de la sorte, au contraire, matière à commentaires dont on ne devait pas se priver. Essayons d’expliquer ce que Montaigne a fait et comment il a compris son devoir : le commentaire de l’œuvre même de La Boétie s’ensuivra naturellement.
LE DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Étienne de La Boétie naquit à Sarlat, le mardi 1er novembre 1530. Son père, lieutenant particulier du sénéchal de Périgord, mourut prématurément. Il fut élevé par son oncle, curé de Bouillonnas : c’est à celui-ci « qu’il doit son institution et tout ce qu’il est et pouvait être », comme il le rappelle plus tard, à son lit de mort. Où cette institution eut-elle lieu ? Probablement dans la famille même, à Sarlat, où le souffle de la Renaissance se faisait sentir, à l’instigation de l’évêque, le cardinal Nicolas Gaddi, parent des Médicis et véritable humaniste, dont le logis était voisin de celui de La Boétie. On ignore également où ces études se firent, peut-être à Bordeaux ou à Bourges. En tout cas, elles s’achevèrent à Orléans, où La Boétie prit son grade de licencié en droit civil, le 23 septembre 1553, et acquit dans un milieu aussi docte que généreux l’information juridique nécessaire à un futur magistrat.
Son précoce mérite ouvrit avant l’âge à La Boétie les portes du Parlement de Bordeaux. Le 20 janvier 1553, des lettres-patentes du roi Henri II autorisaient Guillaume de Lur, conseiller, à résigner « son état et office en ladite cour », en faveur de Maître Étienne de La Boétie, qui n’avait alors que vingt-deux ans et quelques mois. L’âge requis était vingt-cinq ans. Aussi, le 13 octobre suivant, quelques jours seulement après la délivrance du diplôme de licencié, le roi octroyait de nouvelles lettres-patentes, pour pourvoir La Boétie à l’office de conseiller et y joignait des lettres de dispense, permettant au jeune homme d’occuper sa charge. Le postulant était admis à l’exercice de sa fonction et prêtait serment le 17 mai 1554, toutes chambres assemblées. Il n’avait alors que vingt-trois ans et demi, et l’exception, flatteuse assurément, n’était pas exceptionnelle. Elle rapprochait ainsi, dès l’origine de leurs relations, deux noms qui devaient se joindre davantage : Guillaume de Lur, sieur de Longa, docte humaniste qui allait venir au Parlement de Paris, et Étienne de La Boétie, humaniste lui aussi non moins fervent et qu’agitaient déjà, si l’on en croit Montaigne, de nobles ambitions.
« C’est, dit celui-ci, au chapitre XXVIII du livre I de ses Essais, à l’endroit où il parle pour la première fois de l’opuscule de La Boétie, dix-huit ans après sa perte, c’est un discours auquel il donna le nom : De la Servitude volontaire ; mais ceux qui l’ont ignoré l’ont bien proprement depuis rebaptisé : Le contre un. Il l’écrivit par manière d’essai, en sa première jeunesse, n’ayant pas atteint le dix-huitième an de son âge, à l’honneur de la liberté contre les tyrans. Il court piéçà ès mains des gens d’entendement, non sans bien grande et méritée recommandation : car il est gentil et plein tout ce qu’il est possible. Si y a il rien à dire que ce ne soit le mieux qu’il pût faire, et si, en l’âge que je l’ai connu plus avancé, il eût pris un tel dessein que le mien, de mettre par écrit ses fantaisies, nous verrions plusieurs choses rares et qui nous approcheraient bien près de l’honneur de l’antiquité. Car, notamment en cette partie des dons de nature, je n’en connais nul qui lui soit comparable. Mais il n’est demeuré de lui que ce discours, encore par rencontre, et crois qu’il ne le vit onques puis qu’il lui échappa, et quelques mémoires sur cet Édit de janvier, fameux par nos guerres civiles, qui trouveront encore ailleurs leur place. C’est ce que j’ai pu recouvrer de ses reliques, outre le livret de ses œuvres, que j’ai fait mettre en lumière ; et si suis obligé particulièrement à cette pièce, d’autant qu’elle a servi de moyen à notre première accointance car elle me fut montrée avant que je l’eusse vu, et me donna la première connaissance de son nom, acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous, si entière et si parfaite, que certainement il ne s’en lit guère de pareille. »
Ainsi s’exprime Montaigne dans la première édition de son œuvre : il maintient et confirme tout ce qu’il a dit du caractère de La Boétie et de son œuvre, et se corrige pourtant sur un point, mettant seize au lieu de dix-huit quand il déclare : « Mais oyons un peu parler ce garçon de dix-huit ans. » Il est manifeste que Montaigne rajeunit La Boétie, pour donner moins de portée à son œuvre, que les événements ont singulièrement accentuée, et pour qu’on ne s’y méprenne point, il se dédit d’imprimer la Servitude volontaire, qui commençait à être connue.
Montaigne s’en explique et dit clairement comment les choses se passèrent. « Parce que j’ai trouvé que cet ouvrage a été depuis mis en lumière, et à mauvaise fin, par ceux qui cherchent à troubler et à changer l’état de notre police, sans se soucier s’ils l’amenderont, qu’ils ont mêlé à d’autres écrits de leur farine, je me suis dédit de le loger ici. Et afin que la mémoire de l’auteur n’en soit intéressée en l’endroit de ceux qui n’ont pu connaître de près ses opinions et ses actions, je les avise que le sujet fut traité par lui en son enfance, par manière d’exercitation seulement, comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres. Je ne fais nul doute qu’il ne crût ce qu’il écrivait, car il était assez consciencieux pour ne mentir pas même en se jouant, et sais davantage que, s’il eût à choisir, il eût mieux aimé être né à Venise qu’à Sarlat ; mais il avait une autre maxime souverainement empreinte en son âme, d’obéir et de se soumettre très religieusement aux lois sous lesquelles il était né. Il ne fut jamais un meilleur citoyen, ni plus affectionné au repos de sa patrie, ni plus ennemi des remuements et nouvelletés de son temps : il eût bien plutôt employé sa suffisance à les éteindre qu’à leur fournir de quoi les émouvoir davantage ; il avait son esprit moulé au patron d’autres siècles que ceux-ci. »
Ainsi s’exprime Montaigne et les faits viennent confirmer ce qu’il en dit. Comme on le voit, c’est contre son gré et sans son assentiment que l’œuvre de La Boétie vit le jour. Bientôt elle fut publiée. Dix ans après la mort de La Boétie, en 1574, un long fragment était inséré, sans commentaire, d’abord en latin (Dialogi ab Eusebio Philadelpho cosmopolita, 2e dialogue, p. 128-134 et peu après en français (Le réveille matin des Français, 2e dialogue, p. 182-190), un recueil dans lequel il n’était pas malaisé de reconnaître la main de François Hotman. L’esprit de polémique était plus manifeste encore dans les Mémoires de l’Estat de France, rassemblés en 1574 par Simon Goulard, un pamphlétaire huguenot qui insérait le texte entier de l’œuvre de La Boétie, discrètement accommodé à l’usage qu’on en prétendait faire.
La curiosité du lecteur était désormais attirée sur cette œuvre. Maintes fois elle fut réimprimée dans le recueil de Simon Goulard, Mémoires de l’Estat de France, qui reparut plusieurs fois sous des formes diverses, mais toujours avec le même titre, qui donnait un texte accommodé, par endroits, aux aspirations de l’heure présente, et qui a subsisté jusqu’au XIXe siècle. Les contemporains n’en ignoraient pas moins, encore, l’œuvre précise de La Boétie, et les esprits curieux se préoccupaient toujours d’en posséder quelque copie exacte. C’est ainsi qu’Henri de Mesme et Claude Dupuy, qui tous les deux furent des amis de Montaigne, avaient fait transcrire et possédaient dans leurs papiers une copie de la Servitude volontaire. Un troisième érudit, Jacopo Corbinelli, vit un de ces manuscrits en 1570, le lut avec grand plaisir et le trouva écrit « in francese elegantissimo », ce qui donne une date certaine et apporte un renseignement précieux (Rita Calderini dei-Marchi, Jacopo Corbinelli et les érudits de son temps, d’après la correspondance inédite Corbinelli-Pinelli (1566-1587), Milan, 1914, p. 191).
Ce témoignage de Corbinelli sert à prouver que l’œuvre de La Boétie est bien de lui, qu’elle fut composée à l’époque et dans les circonstances qu’on lui attribue et il n’y est point fait d’allusion à Henri III, mais à Charles IX, qui régna pendant quatorze ans, alors que les troubles ensanglantaient chaque jour davantage la France et fournissaient des occasions naturelles à des interprétations erronées.
Un peu plus tard, les copies de La Boétie se multiplièrent, reproduisant toujours le texte de Claude Dupuy ou d’Henri de Mesme, qu’on trouve notamment dans les manuscrits français 17, 298 (Séguier) et 20, 157 (Sainte-Marthe). À mesure qu’il se répand, le Discours de la Servitude est mieux connu et mieux apprécié. Dans son Histoire universelle (édition de Ruble, t. IV, p. 189), Agrippa d’Aubigné cite nommément La Boétie parmi « les esprits irrités qui avec merveilleuse hardiesse faisaient imprimer livres portant ce qu’en d’autres saisons on n’eût pas voulu dire à l’oreille ». Et le même Agrippa d’Aubigné, dissertant de nouveau Du devoir naturel des rois et des sujets, montrerait s’il l’eût fallu, « par le menu, comment la vengeance de cette foi violée les a poussés à remettre en lumière le livre de La Boétie touchant la Servitude volontaire. » (Œuvres de d’Aubigné, éd. Réaume et de Caussade, t. II, p. 36 et 39.)
Et ce témoignage est confirmé par un autre contemporain, Pierre de L’Estoile : « Pour la dernière batterie furent publiés en ce temps (1574) les Mémoires de l’estat de France, imprimés in-8, en trois volumes, à Genève, en Allemagne et ailleurs, qui est un fagotage et ramas de toutes les pièces qu’on y a pu coudre pour rendre cette journée odieuse… avec tout plein de notables traités, comme celui de la Servitude volontaire, qui, n’ayant été imprimé, y tient un des premiers lieux pour être bien fait, pour être faits, car, quant à la vérité de l’histoire,… on n’en peut faire aucun état, ce qui était toutefois le plus recherchable. Mais ayant été lesdits Mémoires trop précipitamment mis sur la presse n’ont pu éviter le nom de fables à l’endroit de beaucoup, au lieu de celui d’histoire. » (Registre journal de Pierre de L’Esloile (1574-1589), publié par H. Omont. Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris, 1900, p. 6).
Tel est le témoignage d’un contemporain sur ce « fagotage » sincère mais sans critique qui tendrait, si on s’en tenait là, à faire de La Boétie un pamphlétaire et un polémiste, écrivant sous l’inspiration du moment et mettant au jour ce qui était composé depuis longtemps, et publié avec l’intention de troubler davantage les esprits. La vérité est tout autre, est-il besoin de le dire ? Écrit en pleine jeunesse, à une date qu’on ne saurait préciser, par suite d’une correction malencontreuse de Montaigne, mais qui ne peut osciller qu’entre la seizième et la dix-huitième année de son âge, c’est-à-dire vers 1548, remanié sans doute et complété vers 1550 ou 1551, alors âgé de vingt ans environ, dans toute l’ardeur d’un esprit généreux et convaincu, La Boétie ne pouvait qu’exhaler la sincérité de ses aspirations. Faut-il s’étonner qu’elles fussent à la fois doctes et libérales, ce qu’elles étaient, alors que La Boétie put retoucher son œuvre et se mêler pour un temps au savant milieu de Ronsard, de Du Bellay, de Baïf ? S’il était moins réputé, l’entourage ordinaire de La Boétie n’en était pas moins remarquable, dans une famille essentiellement de judicature, — sa mère était une Calvimont et sa femme une de Carie, — également réputée dans la jurisprudence et dans les lettres. Ainsi encadré, dans cet entourage savant, La Boétie, vaquant d’abord avec réserve aux obligations de sa charge, ne pouvait que s’abandonner à son penchant naturel d’humaniste ardent et généreux.
C’est ainsi que se formait cet esprit spontané, concentré dans ses aspirations, qui éclatait dans ses élans, avec la vivacité d’un cœur franc et noble. Il s’abandonnait à son inspiration, lui donnant la vivacité, la netteté de l’expression, la laissant, comme elle d’origine, généreuse et décousue. Pour y trouver un ordre naturel et logique, il suffit d’y suivre, sans esprit préconçu, l’argumentation de La Boétie. Bien entendu, il y mêle sans cesse des réminiscences classiques, surtout dans la pensée, car, s’il s’en imprègne, il sait lui donner le tour de la pensée antique, se l’assimile, la traduit avec un réel sentiment de l’humanisme qui soutient la générosité de son œuvre.
Bien des fois on a étudié dans le détail l’esprit qui inspire la Servitude volontaire. Nul ne l’a fait par le menu, ni avec plus de méthode, que M. Louis Delaruelle dans son étude sur l’Inspiration antique dans le « Discours de la Servitude volontaire » (Revue d’histoire littéraire de la France, 1910, p. 34-52). Tout y est antique en effet, l’inspiration comme la forme : sobre, nette et ferme, que l’idée suscite et pare de son goût. « Mais, comme l’a dit fort ingénieusement Prévost-Paradol, malgré ce commun éloignement, — de Montaigne et de La Boétie, — pour toutes les apparences d’excès, il y avait en La Boétie une certaine ardeur d’ambition et un penchant à intervenir dans les affaires humaines, qui manquaient à Montaigne. Il avait plus de confiance, ou, si l’on veut, il se faisait plus d’illusion sur la possibilité de donner à l’intelligence et à l’honnêteté un rôle utile dans les divers mouvements de ce monde. Montaigne nous avoue que son ami eût mieux aimé être né à Venise qu’à Sarlat ; plus explicite encore dans une lettre au chancelier de L’Hospital, il regrette que La Boétie ait croupi « ès cendres de son foyer domestique, au grand dommage du bien commun. Ainsi, ajoute-t-il, sont demeurées oisives en lui beaucoup de grandes parties desquelles la chose publique eût pu tirer du service et lui de la gloire ». On croirait volontiers entendre dans ce regret le murmure de La Boétie s’exhalant après sa mort par cette bouche fraternelle : mais lui-même enlevé, comme Vauvenargues devait l’être un jour, à la fleur de l’âge, a laissé échapper en mourant ce que Vauvenargues avait répété toute sa vie : « Par aventure, dit-il à Montaigne, n’étais-je point né si inutile que je n’eusse moyen de faire service à la chose publique ? Quoi qu’il en soit, je suis prêt à partir quand il plaira à Dieu. »
Entre cet espoir et ce regret, c’est toute la distance qui sépare la Servitude volontaire des Essais. Jeune et ardent, La Boétie croyait l’avenir ouvert devant lui et voulait surtout servir le bien commun, tandis que Montaigne, en se sentant instruit par l’expérience, n’avait pas gardé son illusion sur l’humanité. Devant la leçon des faits, La Boétie avait perdu sa confiance généreuse : il croyait moins spontanément à la franchise naturelle du genre humain et servait moins volontairement son utopie. La vie et le contact des hommes eussent fait leur œuvre naturelle et attiédi son ardeur comme elles eussent tempéré son impulsion. C’est pour cela que Montaigne, modéré et assagi par l’âge, s’essaie à rajeunir La Boétie pour prêter moins d’importance à son action. Loin de la surfaire, il l’atténue, adoucissant son acte, préférant laisser son langage sans écho plutôt que de lui prêter une portée excessive et injuste. Là est l’unique raison de son attitude : c’est pourquoi il a préféré se taire que livrer à des commentaires injustifiés et excessifs la Servitude volontaire d’abord, et ensuite le Mémoire sur l’Édit de janvier 1562. Malgré les risques auxquels l’exposait le silence de La Boétie, il aime mieux laisser sa pensée inconnue que permettre qu’on la travestisse : il savait que le temps finirait par la mettre au jour sous son véritable aspect. Et on ne saurait dire que ce calcul ait été trompé, puisque l’œuvre entière de La Boétie a été imprimée sans que Montaigne l’ait laissé fausser.
C’est pourquoi Montaigne laissa le langage de La Boétie ce qu’il était à l’origine : hardi et vigoureux, peu porté vers les innovations de tout genre, comme devait l’être celui d’un futur magistrat, sans sympathie pour les téméraires, même généreux. Déjà on connaissait depuis quelque temps, plus ou moins ouvertement, ce fier langage tout plein du culte de la liberté et de l’exécration de la tyrannie. Ce qui en était le danger, c’était le souffle loyaliste et spontané qui mettait en belle place l’éloge du monarque parmi les récriminations contre la tyrannie, et le récit des méfaits du tyran. Il s’agissait d’ailleurs, sous la plume de La Boétie, d’un personnage abstrait, réminiscence antique qui ne comportait nulle allusion directe, parce que les rapprochements qui pouvaient y être faits ne concordaient ni dans l’esprit ni dans l’application immédiate et prochaine.
Malgré l’apparence, cette inspiration loyaliste persistera dans le langage de La Boétie et on retrouvera ce sentiment, ce langage même, quand il reprendra la plume pour parler plus posément et d’un sens plus rassis. L’élan de sa nature libérale l’entraîna jusqu’à pousser spontanément ces accents éloquents qui se prolongent ainsi, après quatre siècles, avec une conviction si forte. Il donna de lui-même et sans préméditation cette forme noble et entraînante à des pensées que d’autres avant lui avaient envisagées, que d’autres avaient exprimées, avec moins d’enthousiasme sans doute, mais avec une logique suffisante, de Philippe Pot à Michel Geissmayer, apôtres l’un et l’autre de la liberté humaine et de l’égalité religieuse. Ces sentiments, d’autres auraient pu les manifester, mais il leur aurait manqué assurément l’entraînement, sinon la conviction. Poussé par la générosité de sa nature, gagné par son cœur ardent et mobile, La Boétie se laisse aller à ce mouvement magnanime et noble qu’il eût exprimé sans doute d’original dans des vers latins serrés et concis, s’il avait voulu exprimer des sentiments plus précis et moins déclamatoires. Mais, dans la fougue de son zèle et de son caractère, il laisse parler sa langue naturelle et pousse sans effort un cri d’indignation éloquente qui résumait tout un passé d’enthousiasme et de conviction.
MÉMOIRE TOUCHANT L’ÉDIT DE JANVIER 1562
Pour être complet, le recueil des opuscules de La Boétie publié par Montaigne, en 1571, manquait donc de deux ouvrages dont la paternité ne saurait faire de doute : le Discours de la Servitude volontaire, et le Mémoire touchant l’Édit de janvier 1562. On a déjà vu comment la Servitude volontaire fut divulguée ; on va savoir pourquoi nous pensons avoir découvert le Mémoire sur l’Édit de janvier et quelles raisons nous déterminent à le lui attribuer formellement.
Montaigne confesse avec netteté avoir eu en mains, après la mort de La Boétie, la Servitude volontaire, dont nous savons en détail le sort, et aussi « quelques Mémoires de nos troubles sur l’Édit de janvier 1562 ». Ce sont les termes mêmes de Montaigne, et il ajoute : « Mais quant à ces deux dernières pièces, je leur trouve la façon trop délicate et mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d’une si malplaisante saison ». Ceci était écrit le 10 août 1570, à une heure où les Réformés s’étaient déjà maintes fois soulevés et se montraient particulièrement turbulents, à la veille de la paix de Saint Germain qui les ménageait beaucoup.
Par scrupule, Montaigne laissa donc inédits les deux opuscules de son ami, mais tandis que la Servitude volontaire voyait le jour, les Mémoires sur l’Édit de janvier demeurèrent inédits : Montaigne les signala sans que les contemporains semblent s’être préoccupés de leur existence. Il est vrai que cet ouvrage n’agitait pas une question toujours brûlante comme le précédent, et que, traité d’une plume moins juvénile, il devait être de sens plus rassis. De sorte que, si on ne pouvait ignorer que ces Mémoires avaient été composés, on ne savait jusqu’à ce jour quel sort ils avaient eu. Les publicistes du temps ayant dédaigné cette œuvre, il fallait la rechercher dans les manuscrits inexplorés et tâcher de l’y découvrir. C’est ainsi que nous avons procédé. Après quelques incertitudes, le manuscrit no 410 de la bibliothèque Mejane, à Aix-en-Provence, nous a paru pouvoir contenir la solution de la question posée. C’est un recueil factice relié en parchemin, de trente-six pièces, les unes originales, les autres en copie du temps, presque toutes concernant des événements du xvie siècle antérieurs à 1575. L’une d’elles, fo 131-164, porte le titre : Mémoire touchant l’Édit de janvier 1562. C’est, comme on le voit, à une très légère différence près, le titre même indiqué par Montaigne, et encore convient-il de remarquer que le mot troubles, dont s’est servi Montaigne, s’il ne se trouve pas dans le titre même du manuscrit, y est employé dès la première ligne. Cette coïncidence, déjà forte en elle-même, méritait qu’on s’y arrêtât et qu’on essayât de la confirmer.
L’examen y réussit assez vite. À lire ces pages serrées et pressantes, bien que le copiste trop souvent inintelligent ou inattentif ne nous ait pas conservé le texte dans sa pureté originelle, on se convaincra aisément qu’elles émanent d’un humaniste maître de sa pensée et de sa langue, habile à développer l’une comme à écrire l’autre. Dans l’argumentation et dans le style, on retrouve, quoique avec moins d’éclat, les procédés déjà employés dans la Servitude volontaire : énumérations destinées à convaincre ; raisons éloquentes dont l’exposé est souligné par la force de l’expression ; sobre emploi des figures qui éclaire la démonstration sans l’affaiblir. Ne sont-ce pas des traits de ressemblance avec le Contr’un, plus nerveux, sans doute, et plus généreux dans la forme que les Mémoires sur l’Édit de janvier, inspirés par le même amour de la liberté et de la justice, prêchant le respect de la tolérance avec une conviction plus contenue, mais non moins profonde ?
Évidemment, toutes ces analogies n’ont qu’une valeur relative : on les souhaiterait plus directes, plus probantes. Mais d’autres constatations viennent souligner ces traits, les accentuer. On constate encore, à la lecture, que ces pages sont d’un magistrat du sud-ouest, évidemment d’un conseiller au Parlement de Bordeaux. Il parle maintes fois de la Guyenne, de notre Guyenne, de ce qui s’y fait, de ce qu’on y pense, et les rares exemples qu’il invoque sont tirés de cette région, qu’il plaint et dont il s’occupe avec une sympathie manifeste. Si ces cas sont trop rares, à notre gré, ils n’en sont pas moins caractéristiques. Magistrat, l’auteur penche pour l’exercice de la justice : c’est à elle qu’il veut qu’on fasse appel, il demande qu’elle décide et que le pouvoir administratif exécute. Il sait que, malgré ses écarts, malgré l’intolérance de nombre de ses membres, l’équité des Parlements offre plus de garanties que celle des officiers administratifs : avec elle la répression est plus mesurée, d’ordinaire, plus égale et moins sujette à écarts. Déjà, La Boétie en avait fait l’expérience quand il accompagna, en octobre 1561, Burie, lieutenant du roi à Bordeaux, quand celui-ci vint en Agenais, pour calmer les passions religieuses trop excitées. La Boétie avait essayé alors de faire triompher le bon sens et il est naturel que plus tard, préconisant une mesure générale, pour établir la concorde dans le pays, il ait songé au moyen expérimenté par lui-même.
C’est apparemment dans les derniers jours de cette année 1561, que La Boétie rédigea son mémoire. Elle avait été, cette année, pleine d’événements. À la mort de François II (5 décembre 1560), Catherine de Médicis avait pris en main le pouvoir, comme régente de son fils mineur Charles IX, et se sentant trop faible entre les partis en présence, elle essayait aussitôt de louvoyer, ménageant tantôt Condé et Antoine de Navarre, tantôt supportant les Guise et Montmorency. Cette indécision de la reine se fait sentir sur toute l’administration du royaume. Les États généraux, convoqués à Orléans quand François II trépassa, deviennent aussitôt plus pressants. Le Tiers-État revendique nettement, par la voix de l’avocat bordelais Jean Lange, des réformes politiques et religieuses. Il s’entend avec la Noblesse pour attaquer le Clergé, qui, lui, maladroitement se défend par la violence. Les trois ordres avaient été réunis pour faire face au déficit du trésor royal ; mais la question religieuse s’impose à eux, et désormais c’est elle qui primera les autres.
Ce n’est pas ce qu’eût souhaité la Régente, qui manifestement reléguait alors la question religieuse à la suite de la question dynastique et s’efforçait de maintenir la tranquillité, pour tirer les finances de la royauté et la royauté elle-même du grand embarras où elles se débattaient. Une première fois, le 19 avril 1561, un édit de tolérance vint donner à chacun la liberté des prêches privés et libérer les détenus pour cause de religion ; et ce premier pas dans la voie d’une indulgence intéressée mécontente les catholiques, sans satisfaire les réformés. Les prêches se multiplièrent, les auditeurs devinrent turbulents, Paris se troubla et il en fut de même de bien des provinces du royaume. L’audace des réformés, leur esprit de suite alarmèrent les hommes judicieux qui jusque-là s’étaient montrés sans prévention contre le culte nouveau. La reine s’en émut à son tour, et, d’elle-même, par un coup d’autorité plus affecté que réel, elle promulgua, le 11 juillet, un édit qui défendait les prêches et revint brusquement un an en arrière, à François II, et aux prescriptions de l’ordonnance de Romorantin.
Les réformés ne se méprirent pas sur cette mesure et sentirent tout ce qu’elle avait de précaire. Ils agirent avec la même constance, agitant chaque jour davantage les provinces, tandis qu’à la cour la royauté se débattait dans les mêmes difficultés. En se séparant, les États généraux d’Orléans s’étaient ajournés au 1er mai 1561. Ils ne purent se réunir à Pontoise que le 1er août suivant, et là, le Tiers-État et la Noblesse, marchandant avec le prince, cherchent à obtenir quelque chose de son autorité, en échange des sacrifices qu’ils consentent pour sauver les finances. Le Clergé, lui, est occupé aux vaines discussions théologico-ergoteuses du colloque de Poissy, car on s’est avisé, après une séance générale à Saint-Germain (27 août), pour essayer de rapprocher momentanément les adversaires religieux, de rassembler dans une réunion théologique des prélats catholiques et des pasteurs protestants. Dans ce synode, on discute pendant tout le mois de septembre ; on ergote de plus en plus âprement, à mesure que disparait l’espoir de voir l’Église catholique se réformer elle-même pour se rapprocher de ses ennemis.
On s’étonne maintenant d’une confiance si naïve ; mais il ne faut pas oublier que le dogme catholique n’était pas fixé alors comme il l’a été depuis. Le concile de Trente, qui devait le formuler, convoqué en décembre 1545, subit tant d’interruptions et d’arrêts, qu’en 1561 les mesures qu’on attendait de lui n’avaient pas encore été prises. Dans ces conjonctures, tous se croyaient permis de chercher les moyens de calmer les troubles et chacun en proposait. Naturellement le colloque de Poissy n’avait abouti à aucune solution doctrinale et l’entente avait été si mal établie que parfois les réformés se gourmèrent entre eux aussi vivement qu’ils combattaient les catholiques. Le seul résultat pratique, encore fort incertain, fut la déclaration du Roi du 18 septembre, « sur le fait de la police et réglement qu’il veut être tenu entre ses sujets », et qui, en interdisant le port des armes, donna quelque calme, mais, d’autre part, enhardit les réformés, en suspendant quelques pénalités édictées à leur endroit.
La Guyenne se ressentait naturellement de toutes ces irrésolutions. Déjà, en mai 1560, la publication de l’édit de Romorantin, qui remettait aux évêques la connaissance du crime d’hérésie, avait amené de grands troubles, surtout au pays d’Agenois. Il en fut de même dans toutes les circonstances qui touchaient à ces questions irritantes. Cependant, à la mort de François II, la Guyenne et Bordeaux étaient relativement calmes. On se réunissait un peu partout, avec ou sans armes ; les calvinistes se tenaient cois et bon nombre d’entre eux avaient fait profession de fidélité au nouveau roi. Dès le 18 janvier 1561, le Parlement de Bordeaux avait écrit à la Régente pour lui signaler la multiplication des hérétiques dans son ressort et se plaindre de leurs excès, surtout en Saintonge et dans l’Agenois. Pour veiller sur ces derniers, qui semblaient les plus graves, le lieutenant du Roi Burie avait eu ordre de se rendre à Agen, et Monluc vint l’y rejoindre. Mais les réformés se continrent, sentant que la violence n’était pas de saison et pouvait nuire à leur cause. D’ailleurs, ils pouvaient se répandre en manifestations moins tumultueuses, et, soit au second synode des églises réformées, à Poitiers le 10 mars 1561, soit à l’assemblée des trois états de la province de Guyenne, le 25 mars, il leur avait été loisible de manifester leurs aspirations autrement qu’en troublant le pays.
Les troubles éclatèrent surtout vers la fin de septembre, quand des raisons plus immédiates vinrent s’ajouter aux préoccupations confessionnelles. Des lettres patentes du 22 septembre établirent une imposition extraordinaire de 5 sols par muid de vin, exigée pendant dix ans, et dont le produit était destiné au paiement des dettes de la couronne et au rachat du domaine royal aliéné. Cette mesure fiscale fut surtout ressentie en Guyenne, province viticole, et qui faisait un commerce important de ses produits. On s’efforça de transiger, on réussit à racheter la taxe, mais cette préoccupation avait accru le mécontentement des esprits. C’était précisément l’heure où l’on essayait d’appliquer les mesures indulgentes de la déclaration royale du 18 septembre, consécutive au colloque de Poissy et aux États généraux de Pontoise. Un souffle de libéralisme et de tolérance se faisait sentir à travers les esprits ; les plus sensés songèrent à s’accommoder de cette situation, quitte à l’améliorer ensuite. C’est à bon droit que, pour cette politique, on avait choisi Burie qui n’était pas fanatique et savait juger par lui-même, sans parti pris, du mal et du remède. Suspect aux énergumènes des deux camps, sa loyauté n’en était pas moins foncière, et il voulait la faire prévaloir.
Pourtant, pour cette mission conciliante, Burie voulut emmener La Boétie avec lui et il en demanda l’autorisation au Parlement, le 21 septembre. Tous deux s’en allèrent de conserve à Langon, à Bazas, à Marmande, mais c’est à Agen surtout que leur habileté eut l’occasion de s’exercer. Les réformés s’y étaient emparés du couvent des Jacobins, et n’en voulaient pas déloger. Burie les y contraignit, poussé à cela par La Boétie, « combien qu’il ne se souciât pas beaucoup de la religion romaine », ainsi que le remarque Théodore de Bèze, qui a rapporté le fait.
Mais c’était là pure question d’équité, d’autant qu’en même temps, Burie accordait aux calvinistes l’église Sainte-Foix de la même ville, pour y célébrer leur culte. Il leur défendait non moins formellement de s’emparer désormais de tout autre édifice catholique, et ce sous peine de la mort, et décidait que, partout où il y aurait deux églises, la principale resterait aux mains des catholiques, et que l’autre serait remise aux protestants, mais que là où il n’y en aurait qu’une seule, les deux cultes s’y célébreraient tour à tour, sans se combattre. C’était, par avance, comme un essai d’une des principales dispositions que l’Édit de janvier allait bientôt proclamer.
La Boétie eut-il part à la détermination de Burie, que Théodore de Bèze rapporte ? Après avoir lu le mémoire qui suit, on n’en doutera assurément pas. Ce sont les mêmes sentiments qui inspirent celui qui a écrit et celui qui aurait agi de la sorte. Mais cette tolérance exceptionnelle n’était pas pour se faire admettre des contemporains. Dans la pratique, trop de motifs devaient venir la traverser. Devant cette condescendance, la Réforme prenait de l’audace, soit à la cour, soit dans le pays, et, là où ses adeptes étaient en nombre, ils résistaient ouvertement aux magistrats, d’autant mieux que la régente semblait pencher en leur faveur. Ils s’organisaient militairement et chassaient un peu partout, dans le sud-ouest, les moines de leurs couvents, comme à Agen, à Condom, à Marmande ou à Bazas, brisant les statues et renversant les tabernacles. Ils assassinaient aussi les gentilshommes soupçonnés de leur vouloir du mal, tels que le baron de Fumel. Il est vrai que, là où les catholiques étaient demeurés en force, comme à Cahors, le dimanche 16 novembre 1561, les huguenots furent traqués et massacrés sans merci. Il est fait allusion à cette tragédie, dans le Mémoire, preuve qu’il est postérieur à l’événement. Mais quelle en fut l’occasion précise ? S’il est aisé de le situer après décembre 1561, il l’est beaucoup moins d’en marquer positivement la date.
Le Parlement de Bordeaux était fort excité contre les fauteurs de désordre et les circonstances ne lui manquaient pas de sévir contre eux, malgré Burie qui paraît mieux garder son sang-froid. Est-ce à propos de quelque incident de ce genre que le Mémoire fut présenté au Parlement ? Il se peut ; il se peut aussi que l’occasion de sa composition fut, lorsque la cour de justice eut à désigner quelques-uns de ses membres, pour venir à Saint-Germain examiner, avec le conseil privé, quelle conduite devait être tenue à l’endroit des réformés. L’inquiétude des catholiques était manifeste devant l’attitude de la régente, qui ménageait chaque jour davantage les dissidents, et l’Espagne entretenait ouvertement, contre Catherine de Médicis, l’opposition de ses sujets. Celle-ci, pour mieux se défendre à l’occasion, parut faire alliance avec les religionnaires, dont les églises étaient bien organisées, et qui lui avaient promis, dit-on, au besoin, un secours de 50.000 hommes. C’est alors que la Reine reprit l’idée d’un nouveau colloque pareil à celui de Poissy, à cette différence près que les gens de robe s’y trouvaient mêlés aux théologiens, dont l’intransigeance avait fait échouer le premier.
Les Parlements durent désigner chacun deux membres, — Bordeaux choisit le premier président de Lagebaston, le conseiller Arnaud de Ferron et l’avocat général de Lescure, — pour se réunir dès le 3 janvier 1562, au château de Saint-Germain. Les membres de l’assemblée étaient au nombre d’une vingtaine, en outre du conseil privé, et on y délibéra aussitôt, non pas sur le point de savoir « laquelle des deux religions était la meilleure, mais si les assemblées devaient être permises ». C’est bien la question qu’examine l’auteur du Mémoire ci-dessous. Comme L’Hospital, il voulait plus de liberté aux prêches, mais à condition que les réformés se montrassent soucieux de la loi et rendissent les églises prises par eux. On discuta beaucoup encore. Les parlementaires se seraient montrés assez volontiers tolérants ; mais les membres du conseil privé n’étaient pas disposés à entrer dans cette voie, et, stimulés par les résistances catholiques, s’opposaient aux mesures trop libérales. Enfin, le 17 janvier, la Reine promulgua l’Édit de janvier, qui refusait l’autorisation d’élever des temples, mais suspendait les mesures pénales contre les novateurs et leur concédait la liberté des prêches et du culte, seulement de jour et hors des villes, à la condition de ne prêcher que « la pure parole de Dieu ».
Pour assurer désormais l’exécution du nouvel édit, il ne lui manquait plus que l’enregistrement des Parlements. Au lieu de le présenter au seul Parlement de Paris, comme c’était la coutume, le Chancelier présenta en même temps l’Édit de janvier à toutes les autres cours du royaume, qui s’empressèrent de l’accueillir, sauf le Parlement de Dijon qui s’y refusa. Plus sage le Parlement de Bordeaux l’enregistra sans retard, et dès la fin de janvier, l’édit y était publié officiellement, tandis que le Parlement de Paris résista jusqu’au 5 mars. Pendant ce temps, Catherine de Médicis, tout en pressant les magistrats, avait essayé de remettre en présence les théologiens et réuni à Saint-Germain, le 27 janvier, une autre conférence de prêtres catholiques et de pasteurs protestants destinés à discuter, en présence des membres du conseil privé, de quelques points controversés, tels que le culte des images, celui des saints et le symbole de la croix. Pas plus que le colloque de Poissy, celui-ci n’aboutit : pendant une quinzaine de jours on argumenta inutilement, moins pour se convaincre que pour ne pas se laisser entamer. Certes, il était naturel qu’il en fût ainsi et cette tentative montra, une fois de plus, la vanité d’un pareil dessein. Mais elle montra aussi combien d’esprits sagaces et positifs venaient aisément à de semblables illusions et s’y tenaient accrochés. On ne saurait s’étonner, après cela, qu’un magistrat comme La Boétie, humaniste et libéral, ait essayé lui aussi de ce moyen inattendu et en ait pesé si attentivement les inconvénients et les avantages.
Après l’enregistrement de l’édit à Bordeaux, le Parlement continua à montrer ses sympathies catholiques, soit en condamnant sévèrement les réformés qui lui étaient livrés, soit en éludant les prescriptions de l’édit nouveau. Il est vrai que la turbulence des religionnaires a augmenté, et, croyant le succès possible, ils se contraignent moins dans leurs prétentions. La Guyenne entière est troublée. Burie lui-même, si pondéré par nature, sent seul le danger et y fait face. Pour y parer, il est aidé de Blaise de Monluc, dont la personnalité vigoureuse commence à s’imposer partout. Tous deux, Burie et Monluc, ensemble ou séparément, opèrent dans tout le pays en faveur de l’autorité royale, et si l’un se montre impitoyable, l’autre fait preuve d’une énergie inaccoutumée. D’abord, le meurtre du baron de Fumel est vengé ; Cahors apaisé ; le Quercy, le Rouergue, l’Agenois visités. Tout y est à feu et à sang et la situation presque sans issue si Monluc n’eût été sans faiblesse. Il bat les huguenots à Targon, prend Monségur, Duras, Agen et Penne, complète ses avantages par des exécutions impitoyables et achève son succès par le combat de Vergt (9 octobre 1562), qui, en ruinant les troupes huguenotes en Guyenne, permet de mieux protéger cette province et améliore singulièrement l’autorité royale.
C’est sans doute peu avant cette issue, en juillet ou en août précédent, que le Mémoire suivant a été composé. Le Parlement sait ces événements si graves et y cherche des remèdes. Parfois, il tient des séances à ce destinées, par exemple une réunion solennelle le 13 juillet, en présence de Burie et de Monluc, pour examiner la situation et en dégager les conséquences. Serait-ce en pareille occurrence que l’auteur du Mémoire communique son œuvre ? Les renseignements sont trop rares pour qu’on puisse répondre avec précision. Mais si les circonstances de la composition sont mal définies, la date ne saurait l’être, car le Mémoire contient à cet égard des indications qu’on trouve plus loin. Il faut le dater du milieu de 1562. Un an plus tard, La Boétie trépassait en pleine force, et ces derniers mois semblent n’avoir été employés par lui qu’à des besognes professionnelles, à l’exercice de son office de magistrat. — Du 26 juin 1557 au 21 mai 1563, on a trouvé et publié vingt-deux arrêts du Parlement de Bordeaux, au rapport d’Étienne de La Boétie. Deux seulement sont de 1563, du 7 et du 21 mai.
Ce qui nous surprend le plus aujourd’hui, en lisant le Mémoire, c’est de voir qu’on ait pu croire à des procédés si chimériques. Depuis plus de trois siècles que l’Église catholique a fixé le dogme et établi la discipline, nous acceptons ou nous refusons cette limite, mais nous ne la discutons pas, parce qu’elle ne saurait être affaire du moment et des circonstances. Il n’en était pas de même alors, et des gens sensés purent croire faire œuvre méritoire en essayant d’accommoder les desseins permanents de la religion aux intérêts transitoires de la politique. On va voir comment l’auteur du Mémoire l’a pensé faire. À coup sûr, sa bonne foi était d’autre espèce que celle de la Régente, qui commençait à appliquer cette maxime de diviser pour mieux régner, et essayait de s’appuyer alternativement sur l’un des deux cultes, jusqu’à ce qu’elle fût assez forte pour les dominer tous les deux. Ce calcul, d’ailleurs, ne fut de mise que peu de temps, car, au moment où l’Édit de janvier était promulgué, le concile de Trente reprenait ses séances, le 18 janvier 1562, avec la ferme intention de pousser à bout la besogne dont il était investi. Il s’y donna avec ardeur, si bien qu’en dépit des obstacles, deux ans plus tard, le 26 janvier 1564, le pape Pie IV confirmait par une bulle les décrets du concile et attribuait exclusivement au Saint-Siège l’interprétation de ces décisions théologiques. Rome parlait et sur ce point il n’y avait qu’à la suivre, sous peine d’hérésie, tandis que toutes les discussions avaient pu se produire jusque-là en pleine liberté.
C’est ce qu’on ne saurait oublier en lisant les pages suivantes. Généreux et naïf, l’apôtre de l’Édit de janvier eût souhaité que l’accord entre réformés et catholiques eût des bases solides et raisonnables, fondées sur de mutuelles concessions. Il voit les vices du clergé, de l’Église, cherche de bonne foi à les amender, discute des sacrements, des images, de la vénération des saints, avec le désir manifeste de réussir à concilier des antinomies, à les rendre tolérables, sinon à les fondre. Il veut que l’Église ancienne s’améliore et que la nouvelle soit moins ardente à combattre ; que les charges financières se partagent mieux et que les individus se montrent plus modérés ; et, pour dominer les passions, que la justice, avisée mais sans faiblesse, impose à tous le respect de la chose publique. Tel est aussi, à quelques différences près, l’idéal, plus ou moins sincère, qu’on trouve dans le langage de quelques hommes prudents du temps, L’Hospital, du Ferrier, Jean de Monluc par exemple.
En parlant comme eux, avec plus de loyauté, semble-t-il, que quelques-uns, La Boétie montre ses qualités personnelles : une forme plus nette, une argumentation plus pressante, une certaine chaleur d’âme qui anime la pensée sans lui souffler la force de conviction qu’un raisonnement plus serré lui eût sans doute apportée. On jugera à la lecture de ces pages, plus éloquentes que logiques, quels sont leurs mérites et leurs défauts. C’est d’un homme de sens et d’expérience, ce mémoire, d’un esprit qui sait analyser une situation et raisonner une politique ; et si l’écrivain est un peu long par endroits, il a un style net et ferme, et s’entend à concentrer un argument dans une phrase vigoureuse. Il ne devait pas y avoir alors beaucoup d’hommes ainsi maîtres de la langue et capables de la manier avec cette sûreté et cette sobriété dans le ton grave.
Quant au texte, on s’est contenté de suivre le manuscrit, sans en garder l’orthographe et sans prétendre respecter les inadvertances d’un scribe peu intelligent ou inattentif, qui, écrivant sans doute rapidement et sous la dictée, perd souvent le fil de la pensée de son auteur. Ce qu’on a voulu surtout, à présent, c’est donner l’impression d’une œuvre suivie, qui a l’allure, la tenue littéraire, en même temps qu’en fournir un texte acceptable. Pour cela on a essayé de suppléer aux quelques lacunes, peu nombreuses d’ailleurs, par des mots ajoutés entre crochets et qui éclairent, quand on l’a pu, les obscurités de la pensée ou de la langue. On aura ainsi un texte précis où la critique verbale pourra s’exercer utilement et s’employer à l’établir tel qu’il fut composé à l’origine1.
DISCOURSDE LASERVITUDE VOLONTAIRE2
D’avoir plusieurs seigneurs aucun bien je n’y voi :Qu’un, sans plus, soit le maître et qu’un seul soit le roi,
ce disait Ulysse en Homère, parlant en public. S’il n’eût rien plus dit, sinon
D’avoir plusieurs seigneurs aucun bien je n’y voi…3
c’était autant bien dit que rien plus ; mais, au lieu que, pour le raisonner, il fallait dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d’un seul, dès lors qu’il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il est allé ajouter, tout au rebours,
Qu’un, sans plus, soit le maître, et qu’un seul soit le roi.
Il en faudrait, d’aventure, excuser Ulysse, auquel, possible, lors était besoin d’user de ce langage pour apaiser la révolte de l’armée ; conformant, je crois, son propos plus au temps qu’à la vérité. Mais, à parler à bon escient, c’est un extrême malheur d’être sujet à un maître, duquel on ne se peut jamais assurer qu’il soit bon, puisqu’il est toujours en sa puissance d’être mauvais quand il voudra ; et d’avoir plusieurs maîtres, c’est, autant qu’on en a, autant de fois être extrêmement malheureux. Si ne veux-je pas, pour cette heure, débattre cette question tant pourmenée, si les autres façons de république sont meilleures que la monarchie, encore voudrais-je savoir, avant que mettre en doute quel rang la monarchie doit avoir entre les républiques, si elle en y doit avoir aucun, pour ce qu’il est malaisé de croire qu’il y ait rien de public en ce gouvernement, où tout est à un. Mais cette question est réservée pour un autre temps, et demanderait bien son traité à part, ou plutôt amènerait quant et soi toutes les disputes politiques.
Pour ce coup, je ne voudrais sinon entendre comme il se peut faire que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n’a puissance que celle qu’ils lui donnent ; qui n’a pouvoir de leur nuire, sinon qu’ils ont pouvoir de l’endurer ; qui ne saurait leur faire mal aucun, sinon lorsqu’ils aiment mieux le souffrir que lui contredire. Grand’chose certes, et toutefois si commune qu’il s’en faut de tant plus douloir et moins s’ébahir4 voir un million de millions d’hommes servir misérablement, ayant le col sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais aucunement (ce semble) enchantés et charmés par le nom seul d’un, duquel ils ne doivent ni craindre la puissance, puisqu’il est seul, ni aimer les qualités, puisqu’il est en leur endroit inhumain et sauvage. La faiblesse d’entre nous hommes est telle, [qu’]il faut souvent que nous obéissions à la force, il est besoin de temporiser, nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Donc, si une nation est contrainte par la force de la guerre de servir à un, comme la cité d’Athènes aux trente tyrans, il ne se faut pas ébahir qu’elle serve, mais se plaindre de l’accident ; ou bien plutôt ne s’ébahir ni ne s’en plaindre, mais porter le mal patiemment et se réserver à l’avenir à meilleure fortune.
Notre nature est ainsi, que les communs devoirs de l’amitié l’emportent une bonne partie du cours de notre vie ; il est raisonnable d’aimer la vertu, d’estimer les beaux faits, de reconnaître le bien d’où l’on l’a reçu, et diminuer souvent de notre aise pour augmenter l’honneur et avantage de celui qu’on aime et qui le mérite. Ainsi donc, si les habitants d’un pays ont trouvé quelque grand personnage qui leur ait montré par épreuve une grande prévoyance pour les garder, une grande hardiesse pour les défendre, un grand soin pour les gouverner ; si, de là en avant, ils s’apprivoisent de lui obéir et s’en fier tant que de lui donner quelques avantages, je ne sais si ce serait sagesse, de tant qu’on l’ôte de là où il faisait bien, pour l’avancer en lieu où il pourra mal faire ; mais certes, si ne pourrait-il faillir d’y avoir de la bonté, de ne craindre point mal de celui duquel on n’a reçu que bien.
Mais, ô bon Dieu ! que peut être cela ? comment dirons-nous que cela s’appelle ? quel malheur est celui-là ? quel vice, ou plutôt quel malheureux vice ? Voir un nombre infini de personnes non pas obéir, mais servir ; non pas être gouvernés, mais tyrannisés ; n’ayant ni biens ni parents, femmes ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux ! souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d’une armée, non pas d’un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son sang et sa vie devant, mais d’un seul ; non pas d’un Hercule ni d’un Samson, mais d’un seul hommeau, et le plus souvent le plus lâche et femelin de la nation ; non pas accoutumé à la poudre des batailles, mais encore à grand peine au sable des tournois ; non pas qui puisse par force commander aux hommes, mais tout empêché de servir vilement à la moindre femmelette5 ! Appellerons-nous cela lâcheté ? dirons-nous que ceux qui servent soient couards et recrus ? Si deux, si trois, si quatre ne se défendent d’un, cela est étrange, mais toutefois possible ; bien pourra-l’on dire, à bon droit, que c’est faute de cœur. Mais si cent, si mille endurent d’un seul, ne dira-l’on pas qu’ils ne veulent point, non qu’ils n’osent pas se prendre à lui, et que c’est non couardise, mais plutôt mépris ou dédain ? Si l’on voit, non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d’hommes, n’assaillir pas un seul, duquel le mieux traité de tous en reçoit ce mal d’être serf et esclave, comment pourrons-nous nommer cela ? est-ce lâcheté ? Or, il y a en tous vices naturellement quelque borne, outre laquelle ils ne peuvent passer : deux peuvent craindre un, et possible dix ; mais mille, mais un million, mais mille villes, si elles ne se défendent d’un, cela n’est pas couardise, elle ne va point jusque-là ; non plus que la vaillance ne s’étend pas qu’un seul échelle une forteresse, qu’il assaille une armée, qu’il conquête un royaume. Donc quel monstre de vice est ceci qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve point de nom assez vilain, que la nature désavoue avoir fait et la langue refuse de nommer ?
Qu’on mette d’un côté cinquante mille hommes en armes, d’un autre autant ; qu’on les range en bataille ; qu’ils viennent à se joindre, les uns libres, combattant pour leur franchise, les autres pour la leur ôter : auxquels promettra-l’on par conjecture la victoire ? Lesquels pensera-l’on qui plus gaillardement iront au combat, ou ceux qui espèrent pour guerdon6 de leurs peines l’entretènement de leur liberté, ou ceux qui ne peuvent attendre autre loyer des coups qu’ils donnent ou qu’ils reçoivent que la servitude d’autrui ? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de la vie passée, l’attente de pareil aise à l’avenir ; il ne leur souvient pas tant de ce qu’ils endurent, le temps que dure une bataille, comme de ce qu’il leur conviendra à jamais endurer, à eux, à leurs enfants et à toute la postérité. Les autres n’ont rien qui les enhardie qu’une petite pointe de convoitise qui se rebouche7 soudain contre le danger et qui ne peut être si ardente qu’elle ne se doive, ce semble, éteindre par la moindre goutte de sang qui sorte de leurs plaies. Aux batailles tant renommées de Miltiade, de Léonide, de Thémistocle, qui ont été données deux mille ans y a et qui sont encore aujourd’hui aussi fraîches en la mémoire des livres et des hommes comme si c’eût été l’autre hier, qui furent données en Grèce pour le bien des Grecs et pour l’exemple de tout le monde, qu’est-ce qu’on pense qui donna à si petit nombre de gens comme étaient les Grecs, non le pouvoir, mais le cœur de soutenir la force de navires que la mer même en était chargée, de défaire tant de nations, qui étaient en si grand nombre que l’escadron des Grecs n’eût pas fourni, s’il eût fallu, des capitaines aux armées des ennemis, sinon qu’il semble qu’à ces glorieux jours-là ce n’était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses, comme la victoire de la liberté sur la domination, de la franchise sur la convoitise ?
C’est chose étrange d’ouïr parler de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent ; mais ce qui se fait en tous pays, par tous les hommes, tous les jours, qu’un homme mâtine8 cent mille et les prive de leur liberté, qui le croirait, s’il ne faisait que l’ouïr dire et non le voir ? Et, s’il ne se faisait qu’en pays étranges et lointaines terres, et qu’on le dit, qui ne penserait que cela fut plutôt feint et trouvé que non pas véritable ? Encore ce seul tyran, il n’est pas besoin de le combattre, il n’est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, mais que le pays ne consente à sa servitude ; il ne faut pas lui ôter rien, mais ne lui donner rien ; il n’est pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent ou plutôt se font gourmander, puisqu’en cessant de servir ils en seraient quittes ; c’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d’être serf ou d’être libre, quitte la franchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. S’il lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l’en presserais point, combien qu’est-ce que l’homme doit avoir plus cher que de se remettre en son droit naturel, et, par manière de dire, de bête revenir homme ; mais encore je ne désire pas en lui si grande hardiesse ; je lui permets qu’il aime mieux je ne sais quelle sûreté de vivre misérablement qu’une douteuse espérance de vivre à son aise. Quoi ? si pour avoir liberté il ne faut que la désirer, s’il n’est besoin que d’un simple vouloir, se trouvera-t-il nation au monde qui l’estime encore trop chère, la pouvant gagner d’un seul souhait, et qui plaigne la volonté à recouvrer le bien lequel il devrait racheter au prix de son sang, et lequel perdu, tous les gens d’honneur doivent estimer la vie déplaisante et la mort salutaire ? Certes, comme le feu d’une petite étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois, plus il est prêt d’en brûler, et, sans qu’on y mette de l’eau pour l’éteindre, seulement en n’y mettant plus de bois, n’ayant plus que consommer, il se consomme soi-même et vient sans force aucune et non plus feu : pareillement les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les sert, de tant plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout ; et si on ne leur baille rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien, sinon que comme la racine, n’ayant plus d’humeur ou aliment, la branche devient sèche et morte.
Les hardis, pour acquérir le bien qu’ils demandent, ne craignent point le danger ; les avisés ne refusent point la peine : les lâches et engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien ; ils s’arrêtent en cela de le souhaiter, et la vertu d’y prétendre leur est ôtée par leur lâcheté ; le désir de l’avoir leur demeure par la nature. Ce désir, cette volonté est commune aux sages et aux indiscrets, aux courageux et aux couards, pour souhaiter toutes choses qui, étant acquises, les rendraient heureux et contents : une seule chose est à dire9, en laquelle je ne sais comment nature défaut aux hommes pour la désirer ; c’est la liberté, qui est toutefois un bien si grand et si plaisant, qu’elle perdue, tous les maux viennent à la file, et les biens même qui demeurent après elle perdent entièrement leur goût et saveur, corrompus par la servitude : la seule liberté, les hommes ne la désirent point, non pour autre raison, ce semble, sinon que s’ils la désiraient, ils l’auraient, comme s’ils refusaient de faire ce bel acquêt, seulement parce qu’il est trop aisé.
Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens et paternels ! Vous vivez de sorte que vous ne vous pouvez vanter que rien soit à vous ; et semblerait que meshui ce vous serait grand heur de tenir à ferme vos biens, vos familles et vos vies ; et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient, non pas des ennemis, mais certes oui bien de l’ennemi, et de celui que vous faites si grand qu’il est, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a autre chose que ce qu’a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon que l’avantage que vous lui faites pour vous détruire. D’où a-t-il pris tant d’yeux, dont il vous épie, si vous ne les lui baillez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de vous ? Les pieds dont il foule vos cités, d’où les a-t-il, s’ils ne sont des vôtres ? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous, que par vous ? Comment vous oserait-il courir sus, s’il n’avait intelligence avec vous ? Que vous pourrait-il faire, si vous n’étiez recéleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue et traîtres à vous-mêmes ? Vous semez vos fruits, afin qu’il en fasse le dégât ; vous meublez et remplissez vos maisons, afin de fournir à ses pilleries ; vous nourrissez vos filles, afin qu’il ait de quoi soûler sa luxure ; vous nourrissez vos enfants, afin que, pour le mieux qu’il leur saurait faire, il les mène en ses guerres, qu’il les conduise à la boucherie, qu’il les fasse les ministres de ses convoitises, et les exécuteurs de ses vengeances ; vous rompez à la peine vos personnes, afin qu’il se puisse mignarder en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs ; vous vous affaiblissez, afin de le rendre plus fort et roide à vous tenir plus courte la bride ; et de tant d’indignités, que les bêtes mêmes ou ne les sentiraient point, ou ne l’endureraient point, vous pouvez vous en délivrer, si vous l’essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre.
Mais certes les médecins conseillent bien de ne mettre pas la main aux plaies incurables, et je ne fais pas sagement de vouloir prêcher en ceci le peuple qui perdu, longtemps a, toute connaissance, et duquel, puisqu’il ne sent plus son mal, cela montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc par conjecture, si nous en pouvons trouver, comment s’est ainsi si avant enracinée cette opiniâtre volonté de servir, qu’il semble maintenant que l’amour même de la liberté ne soit pas si naturelle.