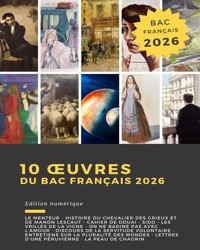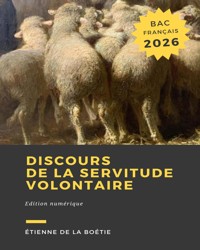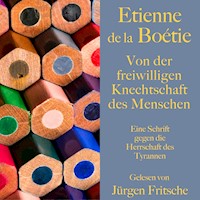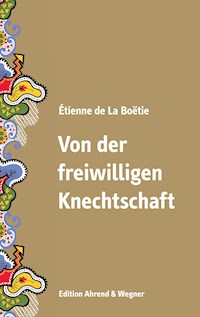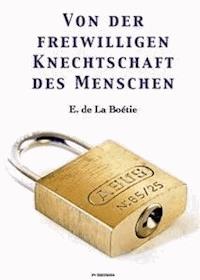1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Éditions Synapses
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Le Discours de la servitude volontaire est un court réquisitoire contre l'absolutisme qui étonne par son érudition et par sa profondeur, alors qu'il a été rédigé par un jeune homme. Étienne de La Boétie nous démontre que, contrairement à ce que beaucoup s’imaginent quand ils pensent que la servitude est forcée, elle est en vérité toute volontaire. Combien, sous les apparences trompeuses, croient que cette obéissance est obligatoirement imposée. Pourtant comment concevoir autrement qu’un petit nombre contraint l’ensemble des autres citoyens à obéir aussi servilement ? La puissance subversive de la thèse développée dans le Discours ne s’est jamais démentie. Même s’il serait anachronique de la qualifier d’anarchiste, cette thèse résonne encore aujourd’hui dans la réflexion libertaire sur le principe d’autorité.
Cette édition présente deux transcriptions de l'ouvrage : en français moderne et l'original en ancien français.
Édition intégrale avec table des matières interactive.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Étienne de La Boétie
© 2019 Éditions Synapses
Avant-propos
Un mot, frère lecteur, qui que tu sois, et quelles que puissent être d’ailleurs ta position ici-bas et tes opinions personnelles ; car, bien que d’ordinaire et proverbialement parlant, tous les frères ne soient pas cousins, toujours est-il qu’en dépit de la distribution si bizarrement faite dans ce monde des titres et des calomnies, des décorations et des emprisonnements, des privilèges et des interdictions, des richesses et de la misère, il faut bien, malgré tout, reconnaître que, pris ensemble (in globo), nous sommes tous naturellement et chrétiennement frères. Lamennais l’a dit et prouvé, en termes si éloquents, si admirables, que jamais, non jamais, cette tant maudite machine qu’on appelle presse, ne pourra trop les reproduire.
Ne pense donc pas que ce soit pour t’amadouer que je débute ainsi, dans cet avant-propos, en t’apostrophant du nom de frère. La flatterie n’est pas mon fort et bien m’en a déjà cuit de ma franchise, dans ce siècle de duplicité et de mensonges. Bien m’en cuira peut-être encore d’ajouter au livre, qui n’est pas mien, et que j’entreprends, trop témérairement sans doute, de rajeunir pour donner un plus libre cours aux vieilles, mais indestructibles vérités qu’il renferme.
Je voudrais pouvoir te faire comprendre tout mon embarras dans l’exécution de ce dessein que j’ai médité longtemps avant d’oser l’accomplir. Je suis déjà vieux, et n’ai jamais rien produit. Suis-je plus bête que tant d’autres qui ont écrit des volumes où l’on ne trouve pas même une idée ? je ne le crois pas. Mais sans avoir jamais reçu d’instruction dans aucune école, ni aucun collège, je me suis formé de moi-même par la lecture. Heureusement, les mauvais livres n’eurent jamais d’attraits pour moi, et le hasard me servit si bien que jamais aussi, d’autres que les bons ne tombèrent sous ma main. Ce que j’y trouvai me rendit insupportables toutes les fadaises, niaiseries ou turpitudes qui abondent dans le plus grand nombre. J’ai pris du goût pour ces moralistes anciens qui ont écrit tant de bonnes et belles choses, en style si naïf, si franc, si entraînant, qu’il faut s’étonner que leurs œuvres, qui pourtant ont eu leur effet, n’en aient pas produit davantage. Le nouveau, dans les écrits du jour, ne m’a plu, parce que, selon moi, ce n’est pas du nouveau, et qu’en effet, dans les meilleurs, rien ne s’y trouve qui n’ait été déjà dit et beaucoup mieux par nos bons devanciers. Pourquoi donc faire du neuf, quand le vieux est si bon, si clair et si net, me disais-je toujours ? Pourquoi ne pas lire ceux-là ; ils me plaisent tant à moi ; comment se fait-il qu’ils ne plaisent de même à tout le monde ? Quelque fois il m’a pris envie, par essai seulement, d’en lire quelques passages à ces pauvres gens qui ont le malheur de ne pas savoir lire. J’ai été enchanté de cette épreuve. Il fallait voir comme ils s’ébahissaient à les ouïr. C’était pour eux un vrai régal que cette lecture. Ils la savouraient au mieux. C’est qu’à la vérité, j’avais soin de leur expliquer, aussi bien qu’il m’était possible, le vrai sens caché parfois sous ce vieux langage malheureusement passé de mode. Telle est l’origine de la fantaisie qui me prend aujourd’hui.
Mais combien de fois, tout résolu que j’étais dans ce dessein, j’ai dû abandonner l’œuvre, parce qu’en effet, je m’apercevais à chaque pas que je gâtais l’ouvrage, et, qu’en voulant badigeonner la maison, je la dégradais. Aussi, lecteur, tu ne me sauras jamais assez de gré de ma peine dans l’exécution d’un travail si ingrat où je n’ai persisté que par dévoûment, car j’ai l’intime conviction que le mets que je t’offre est bien inférieur, par cela seul que je l’ai arrangé à ton goût. C’était pour moi un vrai crève-cœur semblable à celui que doit éprouver un tailleur qui, plein d’enthousiasme et d’engoûment pour ces beaux costumes grecs et romains que le grand Talma a mis en si bonne vogue sur notre théâtre, est obligé, pour satisfaire à la capricieuse mode, de tailler et symétriser les mesquins habillements dont nous nous accoutrons. Encore celui-là nous en donne-t-il pour notre argent ; il fait son métier pour vivre, et moi je n’ai entrepris cette fatiguante et pénible transformation que pour ton utilité. Je ne regretterai ni mon temps, ni ma peine, si j’atteins ce but qui est et sera toujours mon unique pensée.
Au lieu de m’étendre si longtemps sur ce point où la bonne intention suffisait, ce me semble, pour justifier le téméraire méfait, j’aurais dû te parler, me diras-tu peut-être, du mérite de l’auteur dont je viens t’offrir l’antique enfant drapé à la moderne : Faire son apologie, vanter ses talents, prôner ses vertus, exalter sa gloire, encenser son image, c’est là ce que font chaque jour nos habiles de l’Institut, non envers leurs confrères vivants, car l’envie les entre-dévore, mais envers les défunts. C’est la tâche obligée de chaque immortel nouveau-né pour l’immortel trépassé, lors de son entrée dans ce prétendu temple des sciences où viennent s’enfouir plutôt que s’entre-nourrir les talents en tous genres, et qu’on pourrait appeler à plus juste titre le campo santo1* de nos gloire littéraires. Mais serait-ce à moi, chétif, d’imiter ces faiseurs de belles phrases, ces fabricants d’éloges de commande qu’ils débitent si emphatiquement ? Ce n’est pas que je n’eusse un plus beau thème qu’eux, car je pourrais, en deux mots, te faire le portrait de mon auteur, et te dire en style non-académique, mais laconien : « Il vécut en Caton et mourut en Socrate. » Mais entrer dans d’autres détails, je ne le pourrais, et quel que fut l’art que je misse à te parler de ce bon Estienne de La Boétie, je serais toujours fort au-dessous de mon sujet. Je préfère donc te le faire connaître en te rappelant tout simplement ce qu’en a dit-on tant bon ami Montaigne dans son chapitre : de l’Amitié, et en reproduisant ici, par extrait, quelques-uns des lettres où ce grand génie, ce profond moraliste, ce sage philosophe nous dit les vertus de sa vie et le calme de sa mort. J’espère qu’après avoir lu ces extraits 2**, tu me seras gré de m’être occupé de rajeunir l’œuvre de La Boétie, que tu seras même indulgent pour les imperfections et que je t’offre de très grand cœur. Fais-lui néanmoins bon accueil, plus pour l’amour de toi, que de moi-même.
Ton frère en Christ et en Rousseau,
Ad Rechastelet.
1. * C’est ainsi qu’on nomme ordinairement les cimetières dans presque toute l’Italie. Celui de Naples est remarquable par sa singularité. Il est composé de 366 fosses très profondes. Chaque jour on en ouvre une, on y jette pêle-mêle, après les avoir dépouillés, les cadavres de ceux qui sont morts la veille, et le soir cette fosse est hermétiquement fermée pour n’être plus r’ouverte que le même jour de l’année suivante. Ceux qui ont assisté à cette réouverture assurent que, durant cette période, le terrain a entièrement dévoré les cadavres ensevelis et qu’il n’en reste plus aucun vestige.
2. ** Pour les rendre plus compréhensibles, il m’a fallu aussi les transformer en langage du jour. C’est un sacrilège ! diront quelques-uns ; et comme eux je le pense. Mais est-ce ma faute, à moi, si notre langue a perdu cette franchise et cette naïveté qui jadis en faisaient tout le charme ? Redevenons meilleurs, et peut-être retrouverons-nous pour l’expression de nos pensées une façon plus naturelle et plus attrayante.
Transcription en français moderne (19e siècle)
Homère 1 raconte qu’un jour, parlant en public, Ulysse dit aux Grecs :
« Il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres ; n’en ayons qu’un seul. »
S’il eût seulement dit : il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres, c’eût été si bien, que rien de mieux ; mais, tandis qu’avec plus de raison, il aurait dû dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d’un seul, dès qu’il prend ce titre de maître, est dure et révoltante ; il vient ajouter au contraire : n’ayons qu’un seul maître.
Toutefois il faut bien excuser Ulysse d’avoir tenu ce langage qui lui servit alors pour apaiser la révolte de l’armée, adaptant, je pense, son discours plus à la circonstance qu’à la vérité 2. Mais en conscience n’est-ce pas un extrême malheur que d’être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré et qui a toujours le pouvoir d’être méchant quand il le voudra ? Et obéir à plusieurs maîtres, n’est-ce pas être autant de fois extrêmement malheureux ? Je n’aborderai pas ici cette question tant de fois agitée ! « si la république est ou non préférable à la monarchie ». Si j’avais à la débattre, avant même de rechercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je voudrais savoir si l’on doit même lui en accorder un, attendu qu’il est bien difficile de croire qu’il y ait vraiment rien de public dans cette espèce de gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps 3 cette question, qui mériterait bien son traité à part et amènerait d’elle-même toutes les disputes politiques.
Pour le moment, je désirerais seulement qu’on me fit comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d’un Tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que de le contredire. Chose vraiment surprenante (et pourtant si commune, qu’il faut plutôt en gémir que s’en étonner) ! c’est de voir des millions de millions d’hommes, misérablement asservis, et soumis tête baissée, à un joug déplorable, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni chérir puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes ! Contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Si donc une nation, enchaînée par la force des armes, est soumise au pouvoir d’un seul (comme la cité d’Athènes le fut à la domination des trente tyrans 4), il ne faut pas s’étonner qu’elle serve, mais bien déplorer sa servitude, ou plutôt ne s’en étonner, ni s’en plaindre ; supporter le malheur avec résignation et se réserver pour une meilleure occasion à venir.
Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de l’amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre propre bien-être pour accroître l’honneur et l’avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d’être aimés ; tout cela est très naturel. Si donc les habitants d’un pays trouvent, parmi eux, un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves réitérées d’une grande prévoyance pour les garantir, d’une grande hardiesse pour les défendre, d’une grande prudence pour les gouverner ; s’ils s’habituent insensiblement à lui obéir ; si même ils se confient à lui jusqu’à lui accorder une certaine suprématie, je en sais si c’est agir avec sagesse, que de l’ôter de là où il faisait bien, pour le placer où il pourra mal faire, cependant il semble très naturel et très raisonnable d’avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré tant de biens et de ne pas craindre que le mal nous vienne de lui.
Mais ô grand Dieu ! qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce vice, cet horrible vice ? N’est-ce pas honteux, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais ramper, non pas être gouvernés, mais tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ? Souffrir les rapines, les brigandages, les cruautés, non d’une armée, non d’une horde de barbares, contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, mais d’un seul ; non Mirmidon 5* souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles, mais à peine foulé le sable des tournois ; qui est inhabile, non seulement à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la moindre femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards les hommes soumis à un tel joug ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul ; c’est étrange, mais toutefois possible ; peut-être avec raison, pourrait-on dire : c’est faute de cœur. Mais si cent, si mille se laissent opprimer par un seul, dira-t-on encore que c’est de la couardise, qu’ils n’osent se prendre à lui, ou plutôt que, par mépris et dédain, ils ne veulent lui résister ? Enfin, si l’on voit no,n pas cent, non pas mille, mais cent pays, mille villes, un million d’hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, sans ménagement aucun, les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves : comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ? Mais pour tous les vices, il est des bornes qu’ils ne peuvent dépasser. Deux hommes et même dix peuvent bien en craindre un, mais que mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme ! Oh ! Ce n’est pas seulement couardise, elle ne va pas jusque-là ; de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquière un royaume ! Quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de couardise ne peut rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la langue refuse de nommer ?…
Qu’on mette, de part et d’autre, cinquante mille hommes en armes ; qu’on les range en bataille ; qu’ils en viennent aux mains ; les uns libres, combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ravir : Auxquels croyez-vous que restera la victoire ? Lesquels iront plus courageusement au combat, de ceux dont la récompense doit être le maintien de leur liberté, ou de ceux qui n’attendent pour salaire des coups qu’ils donnent ou reçoivent que la servitude d’autrui ? Les uns ont toujours devant leurs yeux le bonheur de leur vie passée et l’attente d’un pareil aise pour l’avenir. Ils pensent moins aux peines, aux souffrances momentanées de la bataille qu’aux tourments que, vaincus, ils devront endurer à jamais, eux, leurs enfants, et toute leur prospérité. Les autres n’ont pour tout aiguillon qu’une petite pointe de convoitise qui s’émousse soudain contre le danger et dont l’ardeur factice s’éteint presque aussitôt dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle 6, qui datent de deux mille ans et vivent encore aujourd’hui, aussi fraîches dans les livres et la mémoire des hommes que si elles venaient d’être livrées récemment en Grèce, pour le bien de la Grèce et pour l’exemple du monde entier, qu’est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non le pouvoir, mais le courage de repousser ces flottes formidables dont la mer pouvait à peine supporter le poids, de combattre et de vaincre tant et de si nombreuses nations que tous les soldats Grecs ensemble n’auraient point élevé en nombre les Capitaines 7 des armées ennemies ? Mais aussi, dans ces glorieuses 8 journées, c’était moins la bataille des Grecs contre les Perses, que la victoire de la liberté sur la domination, de l’affranchissement sur l’esclavage 9.