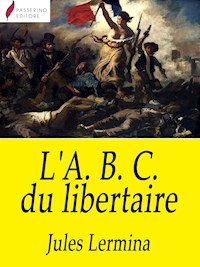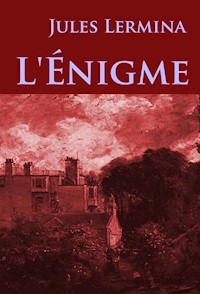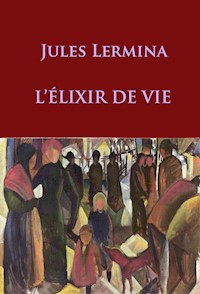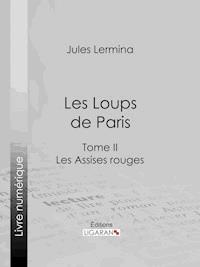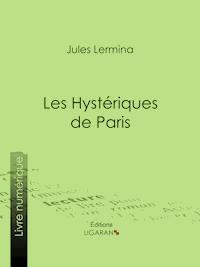Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au moment précis où sonnaient cinq heures, un matin du mois d'avril 1825, un petit vieillard, d'apparence falote, enveloppé d'une redingote puce à collet, coiffé d'un chapeau à larges bords d'où s'échappait une maigre queue roussâtre, sortit de la rue de Valois, leva le nez en l'air pour prendre le vent; puis, à pas courts, mais hâtifs, en homme qui a besogne faite, s'engagea dans le dédale de rues."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Au moment précis où sonnaient cinq heures, un matin du mois d’avril 1825, un petit vieillard, d’apparence falote, enveloppé d’une redingote puce à collet, coiffé d’un chapeau à larges bords d’où s’échappait une maigre queue roussâtre, sortit de la rue de Valois, leva le nez en l’air pour prendre le vent, puis, à pas courts, mais hâtifs, en homme qui a besogne faite, s’engagea dans le dédale de rues qui, à cette époque, faisait de la place du Carrousel un véritable labyrinthe, puis sur le pont Royal, sans même jeter un regard sur le magnifique panorama de la Seine, estompée, sous le soleil matinal, d’un brouillard blanchâtre, et, ayant franchi le fleuve, tourna à gauche sur le quai Voltaire.
Comme il approchait de la rue de Beaune, il ralentit sa marche, se glissa le long du mur et avança la tête, regardant la rue dans toute sa longueur avant d’y pénétrer, affaire d’habitude ou d’instinct.
Tout était parfaitement calme. Avant-garde du faubourg Saint-Germain, les rues qui touchaient au quai n’étaient guère plus animées le jour que la nuit. En tout temps, ce fut un coin de province : cette rue de Beaune, qui portait au XVIIe siècle le nom de rue du Pont-Rouge, compte plus d’une maison séculaire ; on y voyait encore, il y a quelque soixante ans, une des façades de la caserne des mousquetaires, et la maison à laquelle s’adossait en ce moment notre personnage – M. David Davidot, nom banal d’un être d’apparence banale – était celle-là même où, le 30 mai 1778, était mort l’immortel Voltaire. Les fenêtres en étaient restées fermées pendant trente ans et ne s’étaient rouvertes que pour montrer le minois de la célèbre baronne de Champi, dont la beauté fit fureur au commencement du siècle.
Entre ces hôtels grands-seigneurs, une maison se blottissait, portant le numéro 6, haute et étroite, avec sa porte-cochère au cintre bas, sculpté de coquilles, ses fenêtres garnies de carreaux verdâtres encadrés de blanc, demeure calme, d’allures plus que modestes, pareille à ces enfants de simple mise auxquels on a permis de s’asseoir entre d’autres enfants plus riches et qui se font tout petits pour ne pas être remarqués. À droite, un haut mur la séparait d’un jardin voisin, aux arbres peut-être séculaires et dont les premières feuilles caressaient ses angles avec une sorte de pitié commisératrice.
Sans doute occupée par quelques locataires besogneux, satisfaits de ses boiseries vieillottes et de ses carrelages rouges, c’était cette maison que M. Davidot regardait, comme si, au moment de s’aventurer jusqu’à son domicile, il eût tenu à s’assurer que tout y était en bon ordre. Beaucoup ont cette curiosité, qui n’est au fond que la peur de l’inconnu.
Justement, cette façade, d’ordinaire semblable à cette heure matinale, à un visage aux yeux clos, était éclairée : au premier étage, juste au-dessus de la porte, une des fenêtres était ouverte, et une silhouette se découpait sur le fond de la chambre, au douteux reflet jaune, silhouette de femme, sinon d’enfant, tant, sous la lueur vague du matin, elle apparaissait fine et mince.
Elle se penchait en dehors, offrant à la bise un peu fraîche ses cheveux noirs, dont les boucles voletaient, et justement elle regardait attentivement du côté du quai, sans doute attendant quelqu’un.
– Hum ! murmura Davidot, le joli mari fait encore des siennes. Il me peine de causer, en apparaissant, une fausse joie à la pauvrette, et pourtant il faut bien que je rentre.
De fait, dès que M. Davidot se fut décidé à franchir le trottoir, la jeune femme eut un brusque mouvement comme pour s’élancer au-devant de l’arrivant, puis, reconnaissant son voisin – car des trois fenêtres du premier étage l’une, la plus proche du quai, appartenait au logis de M. Davidot – elle eut un geste de déconvenue qui pourtant se fondit en un salut amical, compliqué d’une sorte d’appel.
La maison n’avait pas de portier : chaque locataire avait son passe-partout, si bien que nul ne remarquait le plus souvent les allées et venues des retardataires.
Davidot se hâta d’ouvrir la petite porte bâtarde percée dans la cochère, franchit un vestibule peint d’ocre jaune, sur lequel s’échancrait la baie de l’escalier, large, à rampe de fer.
Il avait remarqué le geste de la jeune femme et avait compris que, tout en désirant un autre absent, elle n’était pas indifférente à sa propre arrivée.
Il franchit lestement les marches. Sur le carré, deux portes. Devant l’une d’elles, ouverte, il trouva la jeune femme, qui lui dit vivement :
– Je vous demande pardon, mais j’ai dû entrer chez vous cette nuit : votre mère se plaignait beaucoup…
– Elle a beaucoup souffert ? demanda M. Davidot, dont le visage eut une contraction douloureuse.
– Elle dormait mal… on eût dit qu’elle faisait de mauvais rêves… J’ai essayé de la calmer… Elle parlait, elle parlait !… Elle est beaucoup plus paisible maintenant.
Disant cela, elle tendait à M. Davidot la clef que celui-ci lui remettait tous les soirs, quand il partait pour ne plus revenir qu’au matin.
En ce temps-là, il existait entre les divers locataires d’une même maison une sorte d’intimité, qui a disparu dans nos immenses caravansérails, mais dont on retrouve encore la trace dans les quartiers populaires. Rien ne semblait plus naturel, si on avait chez soi quelque malade, que de prier le voisin de lui rendre au besoin les menus services réclamés par son état.
M. Davidot, obligé par ses occupations – lesquelles ? nul ne le savait ni n’avait songé à le lui demander – de s’absenter toutes les nuits, n’était pas sans inquiétude sur le sort de sa mère, septuagénaire impotente, qui somnolait toute la journée, mais parfois était tirée de sa torpeur par des crises nerveuses, se traduisant par une loquacité incohérente et des accès de larmes.
– Je vous remercie de tout mon cœur, dit M. Davidot d’un accent de sincère reconnaissance. Est-ce que la crise a été longue ?
– Dix minutes, un quart d’heure…
– Et, fit Davidot avec une certaine hésitation, elle a beaucoup parlé ?… Vous avez entendu ?…
– Rien que des mots sans suite, interrompit la jeune femme. C’était comme un délire… Elle ne savait pas elle-même ce qu’elle disait…
Davidot se mordit les lèvres ; malgré l’affirmation précise de sa voisine – que démentait d’ailleurs la fin de sa phrase – il devinait que sa mère avait fait allusion à d’anciens souvenirs, qui toujours la hantaient, souvenirs terribles et navrants que le fils eût désiré effacer à jamais.
Il hésita, comme s’il eût voulu continuer à interroger la jeune femme. Puis, se ravisant, il plia les épaules et ouvrit sa porte.
Dans la chambre, qu’éclairait une veilleuse, la mère dormait maintenant dans le grand lit qui occupait plus de la moitié de la pièce ; son visage, au ton ivoirin, était calme, la respiration régulière ; les yeux, normalement clos, témoignaient de la quiétude reconquise. Sur les traits longs, assez forts, les rides, fortement creusées, semblaient sculptées dans la pierre. Cette femme n’avait jamais dû être belle ; mais on devinait que, sous cette enveloppe, usée par les années et la souffrance, subsistaient encore des énergies contenues.
Son fils se tint debout devant elle ; il la regarda longuement, puis il se pencha et doucement l’embrassa au front. Était-ce une illusion ? Mais il sembla qu’au contact de ses lèvres – à peine posées – la vieille femme endormie eut un mouvement de recul.
Il se redressa un peu pâle. Il passa vivement ses deux mains sur son visage et revint sur le carré.
La jeune femme était rentrée chez elle ; mais sa porte était restée ouverte. Peut-être se doutait-elle que son voisin reviendrait.
En effet, M. Davidot heurta du doigt, et, sur l’autorisation donnée, il entra, restant d’ailleurs sur le seuil.
– Encore une fois, madame Alise, je viens vous remercier. Du reste, c’est la dernière nuit que je passe hors du logis, du moins de façon régulière, et, désormais, ma mère ne sera plus seule.
Celle qu’il venait d’appeler madame Alise était une femme d’une vingtaine d’années, très brune, les cheveux courts et frisés, presque à la mode des garçons. Jolie ? Non peut-être, mais intéressante par une vivacité de physionomie due spécialement à de petits yeux noirs d’un rare éclat. La bouche était grande ; les lèvres, un peu trop fortes et très rouges, semblaient faites pour le rire qu’autorisaient des dents d’une blancheur éclatante, et pourtant elles avaient, aux commissures, le pli des larmes. L’ensemble était gracieux, presque enfantin ; taille et corsage d’éphèbe.
Comme, aux derniers mots de son voisin, Alise répondait par de vagues félicitations, M. Davidot reprit, adoucissant sa voix, naturellement un peu rauque :
– Mon Dieu, madame, je vais sans doute vous paraître bien indiscret ; mais vous vous êtes toujours montrée si bonne pour moi, pour ma mère, qu’il me peine, oui, il me peine beaucoup de vous voir du chagrin…
Alise se redressa d’un mouvement sec :
– Qui vous dit que j’aie du chagrin, fit-elle avec une sorte de colère.
– Voyons, madame, j’ai presque soixante ans : je pourrais être votre grand-père. Il ne faut pas m’en vouloir. Sincèrement, je voudrais pouvoir vous rendre service à mon tour. Je sais que vous souffrez… Et tenez, en ce moment même, vous vous tenez à quatre pour ne pas pleurer…
Alise se mit à sangloter, cachant son visage dans ses deux mains.
Davidot se rapprocha, et, paternisant encore sa voix :
– C’est votre mari… M. Clairac… Ne vous fâchez pas !… Je vois bien qu’il passe toutes ses nuits dehors, et vous restez là toute seule à l’attendre… Voyons, est-ce que vous ne connaissez personne qui puisse le raisonner ? Il est jeune, lui aussi, il est ardent… Mais, avec de bons conseils, on l’amènerait, j’en suis sûr, à renoncer à cette fatale passion. Ah ! le jeu… le misérable jeu !…
À ce mot, deux fois répété, Alise avait brusquement relevé la tête, dardant ses yeux noirs sur les yeux du vieillard avec une expression d’ineffable angoisse :
– Je vous demande encore pardon, balbutia-t-il.
– Mais non, parlez… je vous en prie, je vous le demande très sérieusement… Vous disiez que la passion… du jeu…
– La pire de toutes, certes… Cependant j’ai vu qu’on s’en pouvait guérir… surtout quand, comme votre mari, on n’est guère heureux…
La jeune femme lui posa la main sur le bras :
– Voyons… regardez-moi bien en face… Vous dites que mon mari joue !
– Ne le saviez-vous pas ?…
– Il me le disait bien, fit Alise avec un énigmatique sourire… Mais est-ce bien vrai ?…
– Certes…
– Comment le savez-vous ?
M. Davidot hésita.
– C’est mon secret que vous me demandez là ; mais je suis votre débiteur : je dois m’exécuter. Seulement, je vous en prie, ne me trahissez pas. Je sais que votre mari joue, parce que, presque toutes les nuits, je le vois… Oui, je le vois risquer tout ce qu’il possède, tantôt beaucoup, tantôt des sommes insignifiantes, dans une maison de jeu… où je suis moi-même employé.
– Vous ne mentez pas… vous me jurez…
M. Davidot regardait la jeune femme, dont la physionomie s’était subitement éclairée. Il ne comprenait pas. Il s’expliquait donc bien mal pour qu’elle parût ainsi presque joyeuse ?
– Mais vous ne savez donc pas ce qu’est le jeu ? reprit-il vivement. Cela mène à toutes les dégradations… Tenez, je vous le dis, il est temps, grand temps que quelqu’un – qui ait autorité sur votre mari – se préoccupe de le sauver… Si vous saviez, en dehors de la misère qui vous attendrait – car, je le sais, vous n’êtes pas riches – si vous saviez quels dangers présentent les fréquentations auxquelles on est exposé en ces enfers…
– De mauvaises femmes ? demanda Alise, redevenue inquiète.
– Il s’agit bien des femmes !… Celles qu’on trouve en ces endroits-là sont de celles qu’une jolie et honnête personne comme vous n’a pas à redouter… On s’occupe bien de ces créatures ! Ce sont les hommes qu’il faut craindre, cette tourbe de bandits bons à tout faire, de dévoyés, en quête de hasards ou de crimes… Et, cette nuit même, je le voyais causer presque intimement avec certain malandrin…
– Cette nuit, s’écria Alise… Alors, cette nuit, Gaston a joué…
– Depuis onze heures jusqu’à la fermeture de la maison.
– Ah ! mon Dieu !… que je suis heureuse ! Dites, dites-le encore ! C’est bien vrai ?… vous l’avez vu… vu !
Elle avait saisi les deux mains du vieillard et les pressait dans les siennes, toutes frissonnantes.
Quant à M. Davidot, il passait par toutes les phases de l’ahurissement et ne pouvait plus articuler un mot.
Mais la jeune femme avait repris :
– Vous ne me comprenez pas… vous croyez que je deviens folle… Eh bien ! non. Je suis heureuse, oui, vous me donnez une joie qui me paie au centuple des services que j’ai pu vous rendre… Pourquoi ?… Eh bien, parce que je suis jalouse… et que je meurs, entendez-vous bien ? je meurs de ma jalousie…
Et, avec une volubilité passionnée, impatiente de toute contradiction, elle continuait :
– Vous me dites qu’il joue… Qu’est-ce que vous voulez que cela me fasse ? Il est jeune, il est fier, il ne veut demander à personne les ressources qui lui manquent et que sa famille – car il est de grande famille – lui refuse injustement. Je comprends, j’excuse son entraînement : il est né pour la richesse, pour le luxe… S’il ne s’agissait que de moi, je ne crains pas les privations, allez ! Mais lui, vous ne le connaissez pas ! M. de Clairac est né pour être prince… et que puis-je lui demander, moi, sinon de m’aimer… de m’aimer fidèlement ?… Chaque nuit, alors que je l’attendais, je subissais d’affreuses tortures… je me sentais devenir méchante, cruelle… S’il me trompait, s’il en aimait une autre !…
Les yeux d’Alise étincelaient, et Davidot contemplait avec une sorte de stupeur cette subite métamorphose qui de l’enfant apparent avait fait jaillir cette femme, vibrante de passion, cette possédée d’adoration égoïste qui ne voyait rien au-delà de son amour.
Il avait dit la vérité : au Palais-Royal, à la table de passe-dix, où l’enchaînait son métier provisoire de tailleur – de coupeur de bourse – eût-on dit quelque cinquante ans auparavant, il voyait défiler, en une fantasmagorie macabre, toutes les variétés de la folie humaine. Il y eut, après l’Empire, une étrange explosion de la pensée ou plutôt de l’initiative comprimées qui se traduisit en une véritable névrose. Celle de la fin du XVIIIe siècle, toute cérébrale, toute de logique et se ruant à l’excès, ne saurait être comparée à celle-ci, dont la cause première résidait dans l’abaissement des âmes sous le niveau du despotisme et de la persécution intellectuelle. Les révoltes intimes se révélèrent par une exacerbation des passions brutales, des amours violentes, emportées jusqu’au crime, des rages d’enrichissement subit ; jamais les luttes corps à corps avec le hasard – il semblait que ce fût le seul moyen de parvenir – ne se déchaînèrent avec plus d’intensité. Les officiers arrachés à l’armée, subitement sevrés de l’excitation des guerres à outrance, les gentilshommes ruinés que repoussait la coalition des bénéficiaires de cour, les petits bourgeois que travaillait l’ambition politique, tous cherchaient une issue à des énergies inactives. Les maisons de jeu racolaient les pires de ces dévoyés, qui demandaient au tapis vert et à ses capiteuses émotions un aliment à des appétits irraisonnés que nulle jouissance normale n’assouvissait.
Le 113 du Palais-Royal a laissé dans l’histoire l’écho d’un chiffre qui résume une époque ; mais combien d’autres repaires ! Les uns, désignés par des numéros, le 129, le 154, puis le 9, dite maison des Arcades, où les femmes n’entraient qu’à minuit et où les brûleurs – c’était le mot consacré – jouaient, au creps ou au trente-et-un, des parties de deux cents louis et plus.
À côté, le bal dit du Prix-Fixe, dénommé en outre d’une qualification argotique difficile à transcrire, le Pince… moral et sentimental, où courtisanes de toutes les catégories – de la pire, surtout – battaient l’estrade autour des tables, quêtant un louis ou un écu. De ces divers endroits les portes étaient assiégées par des femmes en quête d’aventures, habiles à deviner les gagnants et à les entraîner au café Borel ou aux Aveugles, où le punch avait bientôt raison de toute velléité d’avarice. Souvenirs perdus, comme celui de la chambre des blessés, attenante à la plupart des maisons de jeu et où les décavés avaient le droit de dormir sur un canapé jusqu’au matin.
Le jeu, tout-puissant, ne se contentait pas du quartier général du palais : il envahissait, comme une peste, Paris tout entier.
De la place Vendôme, il s’étendait, ramifiant ses tentacules, aux rués Grange-Batelière, Quincampoix, Dauphine. Sur le boulevard du Temple, on connaissait la maison dite de Paphos, et ce n’était pas assez que le gentilhomme avarié, que l’employé infidèle, que le tripoteur véreux fussent, chaque soir, attirés, fascinés par le monstre aux yeux d’or : on ouvrait toutes larges aux ouvriers les portes du Saint-Paul, au faubourg Saint-Antoine. L’honnête Restauration espérait étouffer dans cette boue toutes les oppositions, toutes les revendications.
Il y eut en effet une épouvantable décadence de consciences, une chute dans le vice dont l’âme française subit longtemps le contrecoup. M. Davidot ne philosophait pas si profondément ; mais, quand cette femme inconsciente s’écriait : « Que m’importe que mon mari joue ! » le croupier se rappelait les faces hâves et désespérées, les poings contractés, les yeux injectés de sang ; il entendait les détonations sourdes, qui révélaient un décavage complet et déshonorant, et, avec un frisson, il se souvenait de ce jeune homme, aux longs cheveux noirs, au regard ardent, aux lèvres méchantes qu’il avait vu, presque toutes les nuits, se battre rageusement contre la fortune, associer à ses intérêts les pires exploiteurs, tricheurs ou moins encore. Il avait noté un à un, par curiosité, et puis aussi par sympathie pour cette jeune femme qui lui avait promis de veiller sur sa mère, les stigmates de honte qu’il voyait un à un se creuser sur ce front jeune et déjà flétri.
Il avait poussé un cri d’alarme sincère, désintéressé, et voici que cette pauvre petite femme, loin de s’émouvoir du danger brutal, imminent auquel son mari était exposé, se déclarait heureuse, rassérénée…
Maintenant, elle se calmait, ou du moins cherchait à se donner l’apparence du sang-froid.
– Mon mari est un honnête homme : je ne crains rien de lui. Je comprends vos inquiétudes, mais je ne les partage pas. Il n’est pas, je suppose, le seul gentilhomme qui joue. Je ne vous remercie pas moins de vos bons avis ; j’en profiterai… D’ailleurs, mon mari m’aime, et il suffira d’un mot…
À ce moment, on entendit la porte-cochère qui tournait sur ses gonds.
Alise s’écria :
– C’est lui… Allez, allez vite ! Merci, merci encore !
Et Davidot se hâta de traverser le palier et de rentrer chez lui. Sa mère dormait toujours. Il s’étendit sur un fauteuil, ainsi qu’il faisait tous les matins, hocha la tête plusieurs fois, répondant à des pensées vaguement formulées dans son esprit et finalement s’endormit.
La jeune femme avait couru vers l’escalier, se penchant sur la rampe pour voir plus vite si elle ne s’était pas trompée.
Elle entendit un double pas, puis des voix qui chuchotaient :
– Ah ! fit-elle avec désappointement, il n’est pas seul.
– Comment ! tu es debout, à cette heure-ci ? fit une voix brusque, un peu fatiguée, jeune pourtant.
– Mais… mon ami… j’avais entendu la porte et je venais…
– N’importe… entrons. Monsieur, un de mes amis, a bien voulu m’accompagner. Nous avons à causer. Va dans ta chambre ; nous nous tiendrons dans le petit salon.
Le mari, car c’était bien le jeune vicomte Gaston de Clairac, ne songeait même pas à l’embrasser.
L’autre, l’intrus, se tenait derrière lui, assez embarrassé de son personnage ; mais Clairac se hâta de l’introduire, tandis qu’Alise, un peu choquée d’abord, mais tout heureuse du retour de son mari, se hâtait d’avancer un siège, non sans jeter à la dérobée un regard sur le visiteur intempestif qui lui volait une de ses plus chères joies.
Peu sympathique d’ailleurs. Très grand, d’une maigreur problématique, le visage creux, d’ossature saillante, avec, en plein front, une cicatrice qui coupait ses sourcils grisonnants et touffus.
Le costume n’ajoutait aucune séduction à cette physionomie. L’homme était sanglé dans une longue redingote serrée à la taille et retombant en jupe plissée sur le pantalon à la houzarde, que terminaient d’énormes souliers aux talons hésitants. Le cou, noueux, disparaissait dans une cravate dure comme un carcan. L’homme s’était découvert, et, dans ce mouvement, Alise avait vu deux choses : les mains noirâtres, velues, cordées de muscles, et le chapeau, épave douloureuse de naufrages sociaux, le poil rouge et hérissé, comme d’un félin irrité. Les mains l’effrayaient un peu ; le chapeau lui fit pitié, d’autant qu’elle distinguait maintenant les plis luisants et les avaries des bottes.
Clairac était, lui, vêtu avec une recherche qui ne témoignait pas d’un goût parfait. La redingote de drap puce, surmontée d’un formidable collet arrondi, laissait entrevoir le liseré d’un gilet jaune et la tache fâcheuse d’une cravate andrinople – car c’est là une antique dénomination récemment renouvelée – sur laquelle tranchait un bout imperceptible de linge blanc. Le pantalon, s’étrécissant vers le pied, était de Casimir verdâtre, à côtes. La botte, assez fine, était garnie de faux éperons.
Cependant le visage était particulièrement intéressant : front plat, poli, bien découvert sous les cheveux, d’un châtain foncé, rejetés en arrière et tombant bouclés au bas de la nuque, les yeux assez grands, légèrement bridés aux tempes, avec – toujours hésitant – un regard de myope ; ni barbe ni moustaches, les lèvres minces et rageuses, le menton fuyant, les maxillaires trop larges.
Ensemble bizarre qui appelait à première impression le qualificatif de joli garçon, mais qui, à plus lent examen, troublait de je ne sais quelle indéfinissable inquiétude. Était-ce manque de quelque caractère spécial, excès de tel autre ? L’intelligence faisait-elle défaut ou bien le sens moral ? Un chiromancien eût remarqué la phalangette du pouce, large, enfer de hache, arrivant à la phalangine de l’index.
Presque gai d’ailleurs, comme se souvenant d’un devoir inaccompli, il toucha Alise à la taille, gentiment :
– Ma chère, je te présente un de mes amis, M. de Vaucroix, un ancien émigré, comme était mon père, et qui, comme moi, ne peut obtenir justice de cette cour d’intrigants et d’égoïstes.
Vaucroix eut un signe de tête protecteur pour confirmer l’appréciation :
– Mille pardons, madame, fit-il d’une voix de basse qui sentait quelque peu le gargarisme alcoolique, de me présenter à pareille heure ; mais je demeure fort loin d’ici, et mon cher ami Clairac a bien voulu m’offrir une hospitalité de quelques heures… Cependant, si je vous dérange…
Cette voix ronflait d’une préciosité singulière ; il vibrait en comédien et modulait ses paroles en un chant enroué.
Alise éprouvait à l’entendre une impression bizarre, inexpliquée ; les sens se confondant parfois en des analogies fatales, elle éprouvait un sentiment de retrait, presque de répulsion, comme si elle se fût trouvée en face d’un animal répugnant.
Pourtant elle fit un effort pour vaincre cette antipathie instinctive – que justifiait à tout dire l’apparence de l’individu – et, se contraignant au sourire :
– Mon mari sait que j’aime qui il aime, reprit-elle vaillamment. Vous êtes chez vous… Gaston, ne prendrais-tu pas quelque chose… du café ?
Gaston consulta l’émigré du regard ; il n’y eut pas d’opposition.
– C’est cela : dispose deux tasses sur ce guéridon, puis va prendre du repos… dans ta chambre.
Alise sentit des larmes monter à ses yeux. D’ordinaire quand son mari rentrait, quelque heure qu’il fût, ces premières minutes étaient toutes d’effusion ; elle les attendait comme payement des angoisses subies. Cet étranger lui volait une de ses plus chères joies.
– Mon ami, dit-elle doucement, je te jure que je n’ai pas sommeil.
Clairac eut un geste d’impatience :
– Faut-il que je m’explique plus clairement, dit-il presque brutalement.
– Non, non, dans un instant, je vous laisse…
– Charmante femme, dit Vaucroix quand elle fut sortie.
– Oui, fit Clairac avec désinvolture, mais née de petites gens… Une erreur de jeunesse, mon cher… presque une mésalliance !
Il disait cela, les mains dans ses poches, debout devant la cheminée, à laquelle il s’adossait.
Le petit salon, comme on appelait la pièce où se trouvaient les deux hommes, justifiait médiocrement son titre par un mobilier d’une simplicité presque sévère. Au fond, auprès de la fenêtre, un grand bureau, de forme dite à cylindre, acajou à ferrures de cuivre doré, des fauteuils et des chaises de crin noir, tressé en dessins plus brillants que le fond, représentant un vase plein de fleurs ; les dossiers et les bras, en acajou plein, courbé au feu. Sur la cheminée, un buste vague, aux yeux morts, Homère ou Hippocrate au choix du vendeur, entre deux vases de bronze adornés de têtes de sphinx. Dans le cadre haut et blanc de la glace en deux morceaux, une carte glissée de biais et représentant une de ces charades royalistes dans lesquelles on retrouvait, dans les contours d’un bouquet, les profils du roi Louis XVI, de la reine et du fils mort au Temple. En un coin, un secrétaire, dont la planche abaissée montrait les tiroirs aussi incommodes que multiples.
Sur le plancher, un tapis aux teintes usées.
Vaucroix avait examiné tout cela du coin de l’œil, en homme d’expérience pour qui rien n’est indifférent.
– Il y a longtemps que vous êtes marié ? demanda-t-il.
– Cinq ou six ans… quelque temps après la conspiration Berton.
– Oui, je me souviens… il y avait du Bonaparte là-dessous. Ces gens ne doutaient de rien… Heureusement qu’on a mis bon ordre à leurs fantaisies. Gens peu estimables en somme…
Clairac eut une grimace qui pouvait passer pour un sourire approbatif.
– Vous me paraissez sévère, cher ami : la Restauration n’a point si bien tenu ses promesses…
– Possible ! prononça l’ultra, mais on ne conspire pas contre le roi !
Il disait cela majestueusement, le torse rejeté en arrière, en grand seigneur qui n’admet pas la discussion sur certains articles de foi.
Alise rentra ; elle disposa un plateau sur le petit guéridon à galerie de cuivre, puis fureta un instant, comme si elle eût attendu un mot amical qui la retînt. Mais, impassible, Clairac tapotait du bout des doigts le marbre de la cheminée.
– Je suis là, dit alors Alise en montrant la chambre voisine. Si tu as besoin de moi !…
– C’est peu probable, riposta Clairac. Le mieux que vous ayez à faire est de dormir… L’insomnie ne vous sied pas, ma chère. Vous avez le teint d’une malade.
– Méchant, fit-elle en souriant et en le menaçant gentiment du doigt ; tu n’entendras parler de moi que quand tu m’appelleras…
Elle adressa un demi-salut à l’étranger, à qui elle en voulait un peu de lui voler ainsi une heure d’intimité, mais elle comprenait que Gaston avait des soucis – d’argent sans doute – et devait traiter d’affaires sérieuses avec cet inconnu, qui pourtant avait si peu l’air d’un capitaliste.
Mais elle aimait trop son mari, elle avait en lui une confiance trop absolue pour discuter ses actes, même dans le for de sa conscience.
Tout ce qu’il faisait était bien fait.
Dès qu’elle fut rentrée dans sa chambre, Gaston quitta sa pose indolente et, se tournant vers Vaucroix, qui, très calme, regardait fixement le bout de ses bottes malades :
– Causons, dit-il brusquement. Nous voici l’un en face de l’autre, et il convient de nous expliquer nettement. Voici assez longtemps que vous… rôdez autour de moi. Je ne voudrais pas vous blesser, mais j’appelle les choses par leur nom. Au jeu, sous les galeries du Palais-Royal, j’ai maintes fois surpris vos yeux posés sur moi. Vous m’épiez ou bien… je ne sais pas… Toujours est-il que, cette nuit, je vous ai nettement abordé. J’étais, je l’avoue, en disposition fâcheuse… la mauvaise fortune semble s’acharner après moi… et peu s’en est fallu que je ne vous cherchasse querelle…
– Ce qui eût été une double sottise, interrompit l’autre, d’abord parce que j’ai eu quelques duels qui n’ont pas été positivement favorables à mes adversaires…
– Cette raison me touche peu… je ne suis pas un novice…
– Je le crois… aussi veux-je insister particulièrement sur le second point… Vous eussiez eu grand tort de me traiter en ennemi… car je vous veux beaucoup de bien.
– C’est ce que vous répondîtes au premier mot que je vous adressai.
– Je vous dis : J’attendais que vous vinssiez à moi… Je cherche un homme d’énergie… je vous supposais tel… et j’ai quelque idée que je ne me suis pas trompé. Vous avez paru comprendre que nous étions faits pour nous entendre… notre causerie nous a amenés jusqu’à votre porte, et me voici chez vous, tout prêt à vous être utile… à charge de revanche.
Tout cela était dit d’un ton de père noble, un peu matamore, un peu gouailleur aussi, mais en somme conscient de sa valeur et des services qu’il se sent en mesure de rendre, le cas échéant.
– M’être utile ? fit Clairac en parcourant du regard l’accoutrement de son interlocuteur. M’est avis que vous ne semblez guère en situation de me tirer des embarras où je me débats…
Vaucroix haussa les épaules :
– Quand un loup a faim, la meilleure rencontre qu’il puisse faire est celle d’un autre loup non moins affamé que lui… l’instinct de l’un complète l’instinct de l’autre… Tenez, ne philosophons pas. Venons aux faits. Je vous ai dit qui j’étais : Hubert de Vaucroix, de noble famille bourguignonne… ayant fait de tout, ayant aimé, bataillé, chouanné même, ayant tout désiré, peu possédé, encore moins conservé, main ouverte et conscience large… s’étant sacrifié pour son roi, qu’il révère jusque dans son ingratitude… peu fait d’ailleurs pour les mièvreries de cour, bras solide et alerte… cherchant fortune… Voilà… Et vous ?
– Je n’ai pas dix écus dans ma poche.
– Peste, dix écus… c’est une somme ! Mais, quand je dis : Et vous ?… cela signifie : Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? Où allez-vous ? Je cherche un homme… Êtes-vous cet homme ?… J’attends !
– Bah ! un interrogatoire en règle… Soit ! Qui je suis ?… Un niais, un fou, qui peut-être dix fois déjà a tenu la fortune dans sa main et n’a pas su la retenir… un énergique qui s’irrite de ne point rencontrer l’obstacle brutal contre lequel il pourra s’escrimer des poings et des dents… qui s’épuise en luttes stériles et n’amasse que de la haine contre tous et contre lui-même. Ah ! si je n’avais pas commis une première sottise…
– Votre mariage, fit Vaucroix en baissant la voix.
– Eh ! oui, une histoire romanesque, stupide… On m’avait sauvé la vie… je me suis montré reconnaissant… on m’adore… et moi, je sens que je glisse toujours plus bas, toujours plus profondément dans l’ornière misérable… Et dire qu’il suffirait d’un hasard, d’un coup de fortune pour que je remontasse au rang qui m’appartient !… Que me faudrait-il ? Quelques centaines de louis, et je jure Dieu que j’irais loin. Mais je me heurte à la malchance persistante, odieuse… Chaque jour ce sont nouvelles désillusions, nouvelles humiliations… Ah ! qu’elle vienne donc, cette chance… par n’importe quels moyens… et comme je me vengerai ! En attendant, je suis seul, rivé à cette médiocrité qui me tue, embourgeoisé dans cette vie plate et idiote qui m’étouffe… Ah ! si vous saviez…
Vaucroix écoutait attentivement, comme un dilettante qui étudie chaque note d’une mélodie déjà entendue.
En fait, il trouvait Clairac bavard et déclamateur ; pour son compte, il était beaucoup plus pratique et ne se payait guère de phrases.
– En un mot, dit-il simplement, pour sortir d’embarras vous êtes prêt à tout…
Il avait accentué brièvement, nettement les deux dernières syllabes.
Clairac le regarda ; sans doute, dans les yeux de Vaucroix, il trouva le sens des mots prononcés, car il eut un léger frisson et répéta :
– À tout…
Les deux hommes se turent : ils venaient de beaucoup parler…
Mais Vaucroix n’entendait pas laisser tomber la conversation : la comparaison des loups était exacte, et il avait longues dents.
– Vous êtes orphelin, dit-il, mais non sans parents.
Clairac eut un geste d’insouciance, presque de mépris.
– Oui, oui, reprit Vaucroix. Votre famille ne prend guère souci de vous ; certains cousins fort riches ne daigneraient pas vous venir en aide… Quant à l’héritage de votre tante !…
– Comment ! vous savez ?…
Sans paraître avoir entendu la question, Vaucroix continua :
– Vous n’y pouvez guère compter… on vous tient rigueur de je ne sais trop quelles peccadilles… Bref, c’est là quelque chose comme un et peut-être deux millions qui vous couleront entre les doigts…
Clairac serra les poings :
– Deux millions, répéta-t-il… La vieille folle me hait !
– Eh, eh ! point si folle, puisqu’elle a su des débris de sa fortune compromise par l’infâme Révolution reconstituer un fort beau gâteau…
– Et elle ne dépense pas le dixième… le centième peut-être de son revenu…
– Que voulez-vous ?… les vieillards sont gens bizarres… Cette comtesse de… de ?… aidez-moi donc : je n’ai pas la mémoire des noms…
– Comtesse de Versannes, la propre sœur de mon père…