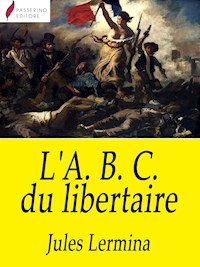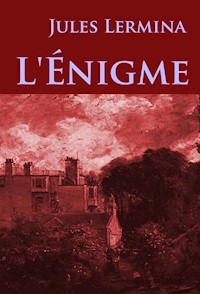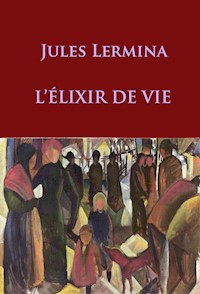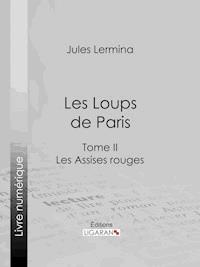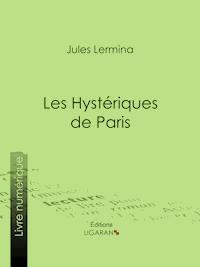1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Fin du XVe, début du XVIe siècle, la conquête des mers par l’Espagne et le Portugal. Un homme ressort de cette période, Magellan. Discret, courageux, tenace, réfléchi, très intelligent, il a un défaut, il ne sait pas communiquer avec les autres. Après moult aventures, péripéties diverses et passionnantes, il arrivera au but de son existence: la découverte du détroit qui porte son nom. Ce texte va au delà du document historique, vous le lirez comme un passionnant roman d’aventures. Epilogue - L'abbé Dantès Encore dix ans plus tard, Edmond Dantès vit ses derniers jours. Il est depuis des années sur l'île de Monte-Cristo, dans la solitude et le dénuement le plus complet, à pleurer son fils et à se repentir "d'avoir voulu tout courber à sa volonté" plutôt que "d'avoir employé sa fortune immense au soulagement des misérables". Sur le point de mourir, il jette à l'eau une bouteille avec son testament et le plan de la cachette de son trésor… |source pastichedumas|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SOMMAIRE
CINQUIÈME PARTIE L’ABBÉ DANTÈS
SIXIÈME PARTIE LE TRÉSOR D’EDMOND DANTÈS
|1| LE SERMENT DU NIHILISTE
|2| ZEMLIA I VOLIA
|3| NOËL HOUDAS
|4| LE TRAÎTRE
|5| L’AUTEL SANGLANT
|6| VIE POUR VIE
|7| LE SERMENT DE MICHAÏL
SEPTIÈME PARTIE LE RESSUSCITÉ
|1| CONDAMNATION À MORT
|2| PAUVRE SERGE
|3| PRINCE, ROI OU EMPEREUR
|4| POTOLEFF EST PERPLEXE
|5| LE MONTE-CRISTO
|6| LE CLUB DES TERRE-NEUVE
|7| LE COMPLOT
|8| FLIRTATION À LA RUSSE
|9| L’AMOUR PROPOSE…
|10| LA FIOLE DE CRISTAL
HUITIÈME PARTIE LE TESTAMENT MYSTÉRIEUX
|1| MARTHE ET JULIETTE
|2| LES RÊVES DE NOËL
|3| MARCHÉ INTERROMPU
|4| LA FEUILLE DE PAPIER BLANC
|5| À L’ŒUVRE
|6| COMME ON SE RETROUVE !
|7| LE MUTILÉ
|8| LES ÉMOTIONS DE POTOLEFF
|9| L’IMPRÉVU
|10| UN AIMABLE MAGISTRAT
|11| COUPS DE COUTEAU
|12| L’ARRESTATION
|13| UNE LETTRE
|14| L’AVEU
|15| MIGUELA
|16| LA CONFESSION
|17| LE MORIBOND
|18| LA FEUILLE PERDUE
|19| INNOCENT !
|20| BORGIA S’AMUSE
|21| ENTRE HONNÊTES GENS
|22| LE MORCEAU DE PAIN
|23| LE NUMÉRO 15 DES ALLÉES DE MEILHAN
|24| ALI L’ESCLAVE
|25| BENEDETTO
|26| OÙ VONT-ILS ?
|27| CE QUI REMPLACE UN PASSEPORT
|28| PARTIES D’ÉCARTÉ
|29| CATACLYSME
NEUVIÈME PARTIE LA RÉSURRECTION DE MONTE-CRISTO
|1| UNE IDYLLE SUR LES TOITS
|2| LA TOMBE ENTR’OUVERTE
| À L’ÉPERON D’OR
|4| LE CLUB DES TERRE-NEUVE
|5| PRINCE ET RAJAH
|6| LA MISSION DE VALENTIN
|7| ENTRE BANDITS
|8| OÙ BENEDETTO EST ÉMU
|9| PARTIE DE PIQUET
|10| EN CHASSE
|11| CE QUE SAVAIT LA FOLLE
|12| STRATAGÈME
|13| FAUSSE PISTE
|14| LE DERNIER EXPLOIT DE BENEDETTO
|15| JUSTICE ! LIBERTÉ !
Série : Jules Lermina
|5-9| LE FILS DE MONTE-CRISTO
JULES LERMINA
LE FILS DE MONTE-CRISTO
tomes |5-9|
ROMAN
Paris, 1881
Raanan Éditeur
Livre 1270 | édition 1
raananediteur.com
CINQUIÈME PARTIE L’ABBÉ DANTÈS
Il y avait maintenant cinquante ans de cela…
Un demi-siècle.
Une nuit, un homme abordait sur un roc solitaire…
Et là, loin de tout regard humain, il fouillait le roc à coups de pic…
Tout à coup il poussa un cri de triomphe…
Le secret lui était livré…
Des richesses immenses, incalculables s’offraient à ses regards…
Et cet homme se redressait, jetant ses regards aux quatre coins de l’horizon.
Et il s’écriait :
— Ô vous dont l’infamie m’a plongé pendant quatorze années dans un obscur cachot où ma pensée aurait dû s’éteindre, où mon cœur aurait pu se paralyser… Vous dont je ne connais pas encore le nom, prenez garde. Dantès est sorti de sa tombe ! et les morts qui ressuscitent châtient durement les vivants !
De qui donc parlait-il ?
Il ne le savait pas encore. Jeune, confiant, plein d’espérance en l’avenir, Edmond Dantès, aimé de la belle Catalane, Mercédès, revenait tout joyeux à Marseille sur le Pharaon, appartenant à l’armateur Morrel.
Dantès allait obtenir le titre tant désiré de capitaine…
Il allait poser sa main loyale dans la main de Mercédès…
Quand tout à coup, au milieu du repas des fiançailles, des soldats étaient venus l’arrêter…
L’arrêter ! lui ! quel crime pouvait-il avoir commis ?…
On lui dit qu’il avait été dénoncé comme ayant porté des lettres à Napoléon, alors relégué à l’île d’Elbe… il était accusé de complot…
En vain, le malheureux se débattit… en vain, interrogé par un magistrat, M. de Villefort, il lui prouva son innocence…
Edmond Dantès, arraché aux bras de sa fiancée, arraché à tout ce qui était sa vie et son bonheur, avait été plongé vivant dans ce sépulcre qui a nom le château d’If.
Et là, pendant quatorze années, quatorze siècles, le malheureux avait gémi et pleuré. Et cependant il n’était pas seul à souffrir. Un autre prisonnier était là, l’abbé Faria, qu’on disait fou parce qu’il avait offert de payer sa liberté de millions, et tous le croyaient insensé, sauf un seul… Edmond Dantès…
Et le vieillard, reconnaissant, lui avait livré le secret du trésor caché autrefois par les Spada dans les cavernes de l’île de Monte-Cristo, rocher perdu sur la vaste Méditerranée.
Ce n’était pas tout, le vieillard avait donné à son jeune compagnon un autre trésor, la science, la force morale, la puissance de la volonté…
Et maintenant, maître du trésor des Spada, fort de sa science et de sa volonté, Dantès ne songeait plus qu’à ceci…
Savoir ce qu’était devenu son vieux père…
Savoir ce qu’était devenue sa fiancée…
Se venger de ceux qui l’avaient enveloppé dans une trame horrible dont le vieux Faria, par un miracle d’intuition, avait peu à peu démêlé les fils…
Et Dantès, que les longues années de captivité avaient rendu méconnaissable, riche de richesses dont le chiffre lui était presque inconnu, était descendu de son rocher et était rentré dans la vie…
Il était allé à la maison de son père…
Son père était mort… mort de misère, mort de faim !…
Sa fiancée, Mercédès… était mariée à un autre…
Et quel était cet autre ?…
Trois hommes avaient formé l’atroce complot qui avait coûté à Dantès quatorze années de sa jeunesse…
L’un se nommait Danglars… c’était un rival de vanité qui aurait voulu obtenir le titre de capitaine que l’armateur Morrel allait accorder à Dantès…
Le second était un ivrogne, plus faible que méchant, un cabaretier nommé Caderousse, qui avait laissé faire…
Le troisième se nommait Fernand Mondego. C’était un pêcheur des Catalans qui aimait Mercédès, et qui avait lancé la dénonciation sous laquelle Dantès avait succombé…
Et c’était ce Fernand qui avait épousé Mercédès.
Seulement, il s’était affublé aujourd’hui du titre de comte de Mortcerf.
Caderousse, toujours misérable, tenait une auberge au pont du Gard.
Quant à Danglars, le comptable de navire était devenu un des premiers banquiers de Paris…
Il restait encore un ennemi, le plus lâche, le plus infâme peut-être.
C’était ce magistrat, ce Villefort, qui ayant la conviction de l’innocence de Dantès l’avait cependant livré aux horreurs de la captivité…
Et pourquoi avait-il fait cela ?
Parce que Dantès, en se défendant, en expliquant qu’il avait reçu à l’île d’Elbe des lettres dont il ignorait le contenu, avait prononcé le nom de Noirtier, le père de M. de Villefort…
Et pour que ce nom ne fût pas prononcé, pour que sa situation à lui, magistrat, ne fût pas compromise par une indiscrétion, Villefort n’avait pas hésité à commettre une épouvantable forfaiture…
Il avait envoyé un innocent au château d’If…
Et là, il avait donné ordre qu’on l’oubliât…
On l’avait oublié pendant quatorze années…
Tels étaient les crimes que Dantès avait à punir…
Était-il un châtiment trop cruel pour ces cruautés inhumaines ?…
Ces trahisons, ces lâchetés odieuses ne méritaient-elles pas la peine du talion ?…
Dantès s’était interrogé, et sa conscience lui avait dit d’aller en avant…
Se substituant à Dieu, il s’était érigé en justicier.
Il était allé à ces hommes ; l’un après l’autre, il les avait pris à la gorge, il les avait frappés…
Mais, de quelle terrible façon !…
Danglars, d’abord, le banquier… il l’avait ruiné, précipité dans la honte et le désespoir… et un jour était venu où le millionnaire avait connu les tortures de la faim… pourtant Dantès lui avait fait grâce…
Fernand, le pêcheur ! Oh ! comme il le haïssait celui-là ! Il avait revu Mercédès devenue comtesse de Mortcerf… et d’abord il avait voulu lui tuer son fils !… mais la mère avait supplié, s’était courbée aux genoux de Dantès, devenu le comte de Monte-Cristo… et Monte-Cristo avait eu pitié de l’enfant… mais non du père…
Fernand Mondego, avons-nous dit, s’appelait maintenant le comte de Mortcerf…
Par quelles infamies avait-il conquis ce titre, et aussi un poste à la Chambre des pairs ?…
Par un attentat monstrueux… Ayant capté la confiance d’Ali, pacha de Janina, il l’avait livré à ses ennemis, qui l’avaient tué. Ce n’était pas tout. Fernand s’était emparé de la fille de son bienfaiteur, Haydée, et l’avait vendue à un marchand turc.
À celui-là, Monte-Cristo ne pouvait, ne voulait pas faire grâce…
Et un jour, en pleine Chambre des pairs, une effrayante accusation était venue souffleter l’orgueilleux Mortcerf…
Tout son passé s’était dressé devant lui… la trahison de Janina lui avait été jetée à la face… il avait nié, s’écriant qu’on mentait…
Alors la fille d’Ali, Haydée, s’était avancée… et avait produit toutes les preuves accusatrices…
Fernand Mondego, comte de Mortcerf, était à jamais déshonoré…
Le misérable, sachant que le coup venait de Monte-Cristo avait couru chez lui, pour le provoquer…
Alors Monte-Cristo lui avait dit :
— Fernand, regarde-moi bien en face, et comprends pourquoi tu es déshonoré, et pourquoi tu vas mourir… je m’appelle Edmond Dantès…
Et l’infâme, foudroyé, s’était enfui… Une heure après, il appuyait un pistolet contre sa tempe et se faisait sauter la cervelle.
Restait le plus coupable de tous, ce Villefort, qui avait agi d’après le plus bas et le plus honteux des mobiles.
Ce magistrat n’avait aucune raison de haine contre Dantès qu’il ne connaissait pas et dont jamais il n’avait entendu prononcer le nom.
Il l’avait frappé insouciamment, insouciamment il l’avait oublié quatorze ans… Monte-Cristo vint, comme l’ange du châtiment.
Et ce châtiment fut le plus terrible…
Mme de Villefort, créature perverse, pour assurer un héritage à son fils, tua, autour d’elle, par le poison dont Monte-Cristo lui avait enseigné les foudroyants effets…
Et Villefort, le magistrat impeccable, acquit la sinistre révélation de ces crimes, cela au jour même où une épouvantable catastrophe le frappait.
Criminel endurci, sacrifiant tout à ses intérêts d’ambition, il avait enterré vivant un enfant… né de ses amours adultères avec Mme Danglars.
Or cet enfant n’était pas mort, il avait été sauvé par un Corse, Bertuccio, qui avait assisté, la nuit, à la lugubre scène de meurtre et avait arraché le malheureux enfant à la tombe qui déjà s’était refermée sur lui.
Mais cet enfant, né du crime, avait les instincts les plus pervers.
Et un jour, Monte-Cristo l’avait retrouvé au bagne de Toulon. Il se nommait Benedetto.
Il avait aidé à son évasion et Benedetto avait assassiné Caderousse, l’aubergiste du pont du Gard.
Et Benedetto, traduit aux assises, avait trouvé en face de lui, qui ? Son père, le procureur du roi, Villefort.
À voix haute, à la face de tous, il l’avait accusé de tentative de meurtre, et Villefort, terrassé par la vérité, s’était enfui et avait couru chez lui…
Chez lui, Villefort avait trouvé sa femme empoisonnée, et avec elle son fils, le seul être qu’il aimât en ce monde…
À ce moment terrible, Monte-Cristo s’était avancé vers lui… et à lui, comme à Fernand, comme à Danglars, il avait dit son véritable nom : Edmond Dantès !
Villefort avait poussé un formidable éclat de rire… il était fou…
Et l’œuvre de vengeance était accomplie…
Monte-Cristo restait seul debout sur les ruines amoncelées…
Il était riche, si riche que nul ne pouvait lutter avec lui ; il était tout-puissant, il était maître, il était roi, ayant pour royaume l’humanité tout entière.
Et cependant une invincible tristesse l’envahissait…
Il était seul.
C’était alors que la douce Haydée avait placé sa main dans la sienne…
Puis, un jour, elle avait murmuré à son oreille :
— Espère… tu revivras en moi… je suis mère !
À son enfant, qui était tout son avenir, il avait donné le nom d’Espérance…
Et voici qu’Haydée était morte…
Voici qu’Espérance était mort…
Épouvantable retour de la destinée !…
―――
Dix ans s’étaient écoulés depuis cette nuit sinistre, où le comte de Monte-Cristo, dont les cheveux avaient tout à coup blanchi, avait emporté dans ses bras le fils bien-aimé…
Par une sombre nuit d’automne, alors que de larges nuages noirs couraient à l’horizon, alors que le vent froid sifflait…
Un homme était seul, debout, sur le plus haut rocher de l’île de Monte-Cristo…
Au bout de cinquante années, il y était revenu.
Cet homme, c’était Edmond Dantès…
Il y avait tantôt dix ans maintenant qu’il vivait sur ce rocher perdu, masse qui semblait faite d’écroulements…
Et sur laquelle était tombé le grand écroulé, Monte-Cristo…
Les jours avaient succédé aux jours, les nuits avaient suivi les nuits, et Monte-Cristo était resté seul, n’entendant jamais une voix humaine, écoutant la nature, qui, parfois, chante l’hymne de vie, parfois lance la menace de mort…
Rarement – et pourtant quelquefois – une barque, chassée par la brise, venait pendant quelques heures s’amarrer aux rives de l’île…
Alors Monte-Cristo se cachait, et tapi derrière une roche, il regardait ces hommes, insouciants, hardis contrebandiers, souvent évadés de la vie sociale.
De loin, il les voyait rire, il devinait sur leurs lèvres des paroles joyeuses…
Et lui, qui n’avait plus un sourire, qui n’avait plus une joie, portait la main à son cœur pour l’empêcher d’éclater…
Une fois, il y avait près de deux ans de cela, un cutter, solidement gréé, avait fait voile vers le rocher.
C’était étrange. Car, cette fois, ce n’était point le courant ou la tempête qui l’entraînait vers cette solitude. Un homme, à l’avant, pointait sa longue-vue sur le rocher.
On aborda.
Dissimulé dans une anfractuosité, Dantès vit descendre plusieurs hommes qu’il ne connaissait pas, et qui, cependant, soigneusement, longuement, fouillèrent l’île dans tous les sens…
On se souvient peut-être que, bien longtemps auparavant, Ali et Bertuccio, sur l’ordre du maître, avaient fait sauter les grottes, derniers vestiges de ce qui avait renfermé le trésor des Spada.
Il vit ces hommes s’arrêter à cet amas de pierres amoncelées, sonder, frapper du pic et de la pioche.
Il comprit et eut un haussement d’épaules.
C’étaient des aventuriers qui cherchaient si, de ces trésors, il ne restait pas encore quelque chose.
Ils restèrent là plusieurs jours, soulevant des pierres énormes, creusant.
Monte-Cristo savait bien qu’ils ne trouveraient rien.
Cependant il eut la curiosité de s’approcher d’eux, sans qu’ils le vissent.
Il les entendit causer entre eux.
Ils se disputaient : l’un d’eux avait tracé des plans et soutenait que le trésor devait se trouver là. Et il appuyait le doigt sur un point précis.
— Mais, s’écria l’autre, n’avez-vous pas entendu dire que cette île était habitée…
— En effet, des matelots assurent avoir vu quelquefois, au coucher du soleil, sur le haut de ces rochers, une forme humaine, de haute taille, drapée dans des vêtements noirs.
— Peut-être était-ce une illusion d’optique…
— Non. Ces hommes sont sûrs de leur fait. Et comme ce sont des Italiens qui l’ont vu, et que dans ces cerveaux-là les idées religieuses se mêlent à tout, ils appellent le solitaire l’abbé de Monte-Cristo.
— Nous ne l’avons pas rencontré, et pourtant nous n’avons pas laissé un seul coin inexploré…
— Peut-être est-il mort…
— Grand bien lui fasse. En tout cas, il ne nous eût été d’aucune utilité, évidemment… car s’il eût connu l’existence de ces trésors – ou plutôt si ces trésors avaient existé – il ne serait pas resté seul, mourant de faim, sur cet îlot ravagé !…
— Parbleu ! s’écria un des compagnons, puisque nous sommes contraints de nous retirer sans avoir rien découvert, du moins je veux que si jamais l’abbé de Monte-Cristo, vivant ou mort, revenait ici, il nous fût favorable… Comme les anciens, faisons un sacrifice aux dieux inconnus…
— Que veux-tu dire ?
L’autre avait réuni toutes les provisions qui leur restaient, pain, fruits, quelques bouteilles de vin, et avait placé tout cela sur un rocher bien en vue. Puis, avec la lame de son poignard, il avait gravé sur la pierre ces mots :
— À l’abbé de Monte-Cristo.
Ils étaient partis, et leurs voiles s’étaient effacées à l’horizon.
Monte-Cristo s’était approché de la roche où l’inscription était gravée et avait secoué la tête :
— Pauvres fous ! murmura-t-il, l’abbé n’exaucera pas votre vœu ! non, il n’est plus à Monte-Cristo de trésor fait d’or et de pierreries. Sur ces pierres nues, il n’est plus qu’un seul trésor, et celui-là, je le garde…
Puis il avait jeté à la mer les provisions abandonnées…
Accablé sous la lourdeur de son désespoir, cet homme avait fait un serment.
Ayant possédé tant de millions qu’à peine il en avait su le nombre, ayant pu satisfaire tous ses caprices – fussent-ils ceux d’un roi – ayant vu que tout se pouvait acheter et que tout se payait…
Monte-Cristo avait juré de ne plus toucher à rien de ce qui se pouvait acquérir avec de l’argent…
Les hommes qui étaient venus cherchaient un trésor…
Eussent-ils creusé le sol jusqu’aux profondeurs… eussent-ils bouleversé le sol, ils n’eussent pas trouvé un écu…
Ici Monte-Cristo était plus pauvre que le plus misérable des mendiants…
Depuis dix ans, pas la plus petite pièce de monnaie n’avait souillé ses mains… De quoi vivait-il ?
De racines, de quelques misérables baies qui poussaient sur les ronces, et de l’eau pure qui, du ciel, tombait dans le creux des roches…
Mais, avait-il dit, il possédait un trésor… ici même, dans cette île.
Au soir où nous le retrouvons, Monte-Cristo, dont la tête couverte de cheveux blancs comme la neige opposait son front pâle au souffle glacé de la brise du nord, redescendit lentement de la crête sur laquelle il s’était tenu longuement debout.
Puis, sans hésiter, suivant un étroit sentier de la falaise, il parvint sur une espèce de plate-forme.
Il se pencha, courbé, presque agenouillé sur le sol.
Puis, de ses deux mains, il saisit une lourde pierre qui tourna sur elle-même, et en se déplaçant laissa voir un trou béant.
Monte-Cristo descendit.
Il y avait là des degrés taillés dans la pierre fruste.
Cette ouverture avait échappé à toutes les recherches. Il fallait le pied d’une gazelle pour atteindre au sommet où cette roche mouvante était située. Et vingt hommes eussent-ils tenté de l’ébranler sur sa base qu’elle fût restée immobile.
Si le pic et la pioche avaient attaqué sa base, le sol se fût écroulé, écrasant le secret qu’il couvrait.
Monte-Cristo la referma en la touchant du doigt.
Puis il descendit l’escalier qui tournait sur lui-même, laissant à peine place pour le passage d’un homme.
Au bout de quelques minutes, il parvint dans une cavité, de forme carrée, taillée à plein dans le vif du granit.
Il avait conservé cette faculté maîtresse acquise jadis au prix de tant de souffrances.
Pour lui, il n’était pas de nuit…
Dans l’obscurité la plus profonde, il voyait aussi clairement qu’au soleil de midi.
Et il marcha droit jusqu’au fond de cette crypte, à un endroit où la voûte s’arrondissait.
Là, se trouvait un sarcophage de marbre…
À deux places… un lit de pierre où quelqu’un dormait et où la place d’un autre était marquée.
Celui qui dormait, semblait vivre encore dans la nuit… c’était Espérance.
En vérité, c’était miracle que cette jeunesse qui paraissait éternelle.
On eût dit que le sang courait encore sous cette peau vive, sous ces veines bleuâtres.
Le vivant était plus pâle que le mort.
Monte-Cristo posa la main sur la main de son fils :
— Espérance, dit-il d’un ton grave, Espérance, est-ce que le jour n’est pas venu ?…
Il y eut un long silence.
Puis, était-ce une réalité ? était-ce un de ces jeux du hasard qui parfois troublent l’imagination – il sembla qu’un souffle passât dans l’air, il sembla que les lèvres du mort s’agitaient.
Et dans ce souffle, et sur ces lèvres, il y eut un mot prononcé :
— Viens !
Monte-Cristo eut un sourire large, ineffable.
— Je le savais, murmura-t-il.
Son visage se transfigurait, ses cheveux blancs avaient des reflets d’auréole.
— Je viens, mon fils, dit-il encore. Attends… il faut que j’achève ma tâche…
Il tira de sa poche un cahier de parchemin, sur lequel des lignes étaient tracées. Et, pensif, appuyé au cercueil de marbre, il lut à voix basse.
Voici ce qui était écrit :
« CECI EST MON TESTAMENT.
« Que ceux qui trouveront cet écrit le lisent avec sang-froid.
« Qu’ils se tiennent en garde contre les surprises de l’imagination.
« L’homme qui va mourir, et qui inscrira tout à l’heure son nom au bas de ces lignes, a été plus puissant que les plus puissants de la terre.
« Il a souffert, comme jamais homme n’a souffert, il a aimé comme jamais homme n’a aimé…
« Il a haï comme nul ne saura haïr.
« Souffrances, amour et haine, tout est passé, tout est oublié, tout est mort en lui.
« Il a tué en lui jusqu’au souvenir.
« N’en conservant plus qu’un seul, celui d’un enfant adoré qu’il a perdu et auprès duquel il a voulu mourir.
« Seul, et n’entendant plus un seul bruit de la terre qui pût faire diversion à sa douleur.
« Cet homme a tout su, et cependant il ignore le secret de la mort.
« Cet homme a possédé des richesses si énormes que nul souverain n’aurait pu lutter avec lui.
« Et cet homme va mourir, mourir d’épuisement et de misère…
« Il l’a voulu ainsi…
« Pourquoi a-t-il fait cela ?
« Pour se punir.
« Longtemps il a douté, aujourd’hui il a compris… il a pris la mauvaise voie. Il a voulu tout courber à sa volonté, il a été le justicier implacable et le glaive dont il a frappé les coupables s’est retourné contre lui et l’a blessé au cœur…
« L’homme est sur cette terre pour accomplir une mission sociale…
« Celui qui va mourir a accompli une mission égoïste…
« Il se courbe, il se repent.
« Possédant des millions, alors que tant d’hommes meurent faute d’un morceau de pain, il se repent de ne pas avoir employé cette fortune immense au soulagement de ces misérables.
« Il se repent et il meurt…
« Seul au monde, nul n’est ni ne peut être son héritier.
« Et cependant, celui qui tout à l’heure se couchera dans ce sépulcre, plus pauvre que le plus pauvre des parias, possède quelque part des sommes fabuleuses, six cents millions peut-être.
« Tout cela est en lingots d’or et en pierreries… quelque part.
« Devait-il désigner lui-même l’homme auquel il léguait cette arme de vie ou de mort ?… non, il ne le pouvait pas.
« Quoiqu’il ait scruté les consciences, quoiqu’il ait lu dans les cœurs, il doute. Le plus honnête peut devenir coupable, quand il se sait tout-puissant.
« Il ne s’est pas reconnu le droit de détruire ces richesses.
« Elles existent, cachées.
« Il les lègue au hasard, à ce que les hommes, ceux qui croient, appellent la Providence.
« Le hasard portera ce testament, le hasard le remettra entre les mains d’un homme… Qui sera-t-il ?
« Quand cet homme choisi par la fatalité aura jeté les yeux sur la feuille blanche qui accompagne cet écrit, peut-être croira-t-il qu’il n’a plus qu’à étendre la main pour s’emparer des millions.
« Non pas !
« Il est une première épreuve que je lui veux imposer.
« Et cela, en raison de mon expérience même.
« Si l’abbé Faria m’avait laissé à résoudre une énigme pareille à celle que je lègue aujourd’hui à un inconnu…
« Si, dans sa confiance extrême qu’il avait en moi, il ne m’en eût dit le mot, de telle sorte que je n’eusse plus qu’un pas à faire pour saisir la force énorme qu’il voulait mettre entre mes mains…
« Alors qui sait ?
« Dantès fût resté peut-être l’homme d’illusion et d’espérance qu’il avait été.
« N’ayant pas entre les mains la puissance de la vengeance implacable, il eût pensé seulement à refaire sa propre vie…
« Il aurait renoncé à punir…
« Il aurait sinon oublié, tout au moins dédaigné ceux qui lui avaient fait tant de mal.
« Il n’aurait pas eu l’audace de se poser en justicier…
« Et, s’étant refait une existence nouvelle, au bout du monde peut-être, il ne serait pas aujourd’hui le plus malheureux, le plus désespéré des hommes…
« Donc, à celui qui tiendra entre les doigts la feuille blanche par laquelle se pourra résoudre l’énigme de six cents millions,
« Je dis, moi, comte de Monte-Cristo :
« Prends garde.
« J’ai voulu te donner, – par la difficulté des recherches – par l’effort de conscience et d’intelligence qui te sera nécessairement imposé, le temps de réfléchir, le temps de méditer.
« Peut-être aussi te décourageras-tu ?
« Pour moi, je te le souhaite. Jette cette feuille blanche au feu.
« Si le rêve ne se réalise pas, reviens à la réalité, à la vérité, à la vie normale et saine de l’homme qui ne demande qu’à son propre travail et à sa propre énergie les bienfaits d’une existence modeste ou riche.
« En voyant t’échapper ces richesses, souviens-toi que, de les avoir possédées, je suis mort désespéré.
« Moi, le millionnaire, je voudrais aujourd’hui recommencer ma vie et être le commissionnaire du port de la Joliette, attendant du soleil qui luit et du passant qui vient, le pain de chaque jour.
« Que si, au contraire, tu réussis à résoudre le problème…
« Si ces millions tombent dans tes mains…
« Aie défiance de toi-même…
« Ou plutôt non !
« Prends courage et pense à faire le bien. Ah ! c’est une grande force et une puissance incalculable que celle de l’argent.
« Elle peut tout pour le mal… mais aussi pour le bien.
« Regarde autour de toi, millionnaire, mon héritier.
« Vois combien de membres de l’humanité, tes frères et les miens, souffrent, se désolent, gémissent accablés sous les rigueurs d’une injuste destinée…
« Vois les nations opprimées, vois les peuples écrasés…
« Et alors, si tu es véritablement un homme, si tu es digne de ton nom, s’il y a en toi autre chose que des désirs égoïstes et des appétits mesquins…
« Alors tu peux employer tes énergies à réparer les grandes injustices humaines, alors tu peux remettre sur sa base la pyramide qui chancelle, alors tu peux contraindre les méchants à plier devant toi…
« Non à ton profit, mais au bénéfice de tous…
« Voilà mon dernier rêve… je n’ose dire ma dernière volonté, car je n’ai plus le droit de vouloir.
« Mais sache-le, je ne te lègue ces millions que pour le bien.
« À toi donc, inconnu, qui que tu sois, salut et que la justice éternelle te vienne en aide.
« Fait par moi, sain de corps et d’esprit, le 25 février 1865.
« EDMOND DANTÈS, comte de MONTE-CRISTO. »
Monte-Cristo eut un singulier sourire.
— Celui qui trouvera cela devra avoir en partage et la patience et l’intelligence, murmura-t-il. Ah ! pauvre abbé Faria, ton trésor, décuplé par moi, tombera-t-il en de plus dignes mains ?
À ce moment, il éprouva une sorte de faiblesse et porta sa main à son cœur.
— Oui, Espérance, dit-il tout bas. Me voici. Encore quelques instants, je viens.
Il prit auprès de lui une sorte de fiole, creusée dans un morceau de cristal, qui devait résister à tous les chocs.
Puis ayant roulé le testament, il l’introduisit par le goulot que refermait un bouchon de même nature, hermétiquement soudé.
Il se redressa, remonta l’escalier, toucha la pierre qui tourna sur elle-même.
De nouveau il se trouva sous le ciel…
On eût dit qu’à cette heure solennelle la nature se taisait, comme dans l’attente. Monte-Cristo descendit la pente du roc et arriva au bord de la mer.
Là, il souleva la fiole au-dessus de sa tête.
Et l’ayant fait tournoyer, la lança de toute la force de son bras…
Elle décrivit une large parabole…
Puis il y eut un choc sec…
Le secret du trésor de Monte-Cristo était livré à la mer.
Puis, pensif et sans regarder derrière lui, il revint au point de départ.
Encore une fois la pierre se referma sur lui…
Maintenant, en descendant les marches, il se sentait faiblir…
Il chancelait et dut se soutenir aux anfractuosités de la roche…
Mais son visage resplendissait d’une joie sublime…
Il prit dans sa main un petit flacon contenant une liqueur d’un rouge vif.
Il la contempla longuement.
— Ceci est le repos ! dit-il. Ceci est l’expiation…
Mais soudain il tressaillit et ces mots s’échappèrent de ses lèvres :
— Ai-je bien le droit de mourir ?…
Monte-Cristo porta-t-il à ses lèvres le flacon qui était pour lui la suprême délivrance ?…
L’avenir nous l’apprendra…
SIXIÈME PARTIE LE TRÉSOR D’EDMOND DANTÈS
|1| LE SERMENT DU NIHILISTE
Avant de raconter les terribles scènes qui vont suivre, il nous est nécessaire de les faire précéder de quelques rapides explications.
D’abord se pose cette question : qu’est-ce qu’un nihiliste ?
Tout le monde sait qu’il a pour origine philologique le mot latin nihil, qui signifie : rien.
Donc, il semble que tout homme désigné par ce mot ait pour théorie, pour mission acceptée, consentie, la destruction de tout ce qui est.
Est-ce la vérité ? Cherchons.
Le mot a été lancé dans la circulation par le romancier Tourgueniev qui, dernièrement, est mort à Paris.
Pour lui, c’était un terme de dédain. Les révolutionnaires russes l’ont relevé et s’en sont paré comme jadis ceux qui en Flandre résistaient au despotisme espagnol, ayant été traités injurieusement de gueux, s’emparèrent du nom et l’arborèrent comme le drapeau de leurs revendications.
En vérité, le nihiliste équivaut à celui que nous appellerions en France le socialiste. Son but est le même. Tous deux veulent l’affranchissement des classes malheureuses et souffrantes, la diminution, sinon l’abolition de la misère, la meilleure répartition de la richesse nationale, l’alliance économique entre tous les peuples, la glorification du travail.
Est-ce là un programme de criminels ?
Oui, ces gens ont pu être appelés nihilistes, parce que de tout ce qui est oppression, tyrannie, inégalité, exploitation de l’homme par l’homme, ils veulent que rien ne subsiste…
Dans ce pays où les classes élevées sont toutes-puissantes, où le pauvre n’est qu’un paria, où la toute-puissance d’un homme domine les consciences et peut disposer des existences et de l’honneur de tous les citoyens, est-ce donc un forfait que d’essayer de secouer ce joug de fer ?…
Les nihilistes rêvent aussi l’émancipation de la femme. En quel sens ? Il faut savoir qu’en Russie, jusqu’à ces dernières années – car déjà des victoires sociales ont été remportées – les pères avaient tout droit sur leurs filles, et que c’était le principe autocratique qui pesait sur ces malheureuses auxquelles il était défendu de chercher à s’instruire.
Le nihiliste a lutté, par tous les moyens, même les plus terribles, même les moins avouables. C’est qu’aussi, ainsi que le dit Stepniak, arrivait à ses oreilles la complainte navrée du paysan Russe, pleine de gémissements et de lamentations, où semblent s’être concentrés tant de siècles de souffrances. Il le voyait lui-même, mourant de faim, brisé à la peine, éternel esclave des classes privilégiées, qui travaillait, travaillait sans trêve, sans espérance de rachat…
Le nihiliste osa ce que bien peu auraient eu le courage d’entreprendre : il descendit dans le peuple – selon l’expression consacrée – c’est-à-dire que des hommes intelligents, instruits, se résignèrent à endosser le rude sayon du paysan, ses sabots d’écorce ; il abandonna les villes où il avait ses aises, son luxe, ses habitudes, et il se mit à parcourir la Russie, travaillant avec les ouvriers et aussi leur portant la bonne parole de régénération et d’avenir.
Enfin les autocrates tâchèrent d’enrayer le mouvement en condamnant ces missionnaires du progrès à l’exil, à la prison, à la mort, aux tortures de la Sibérie. Qu’importait ! pour un qui tombait, dix autres le relevaient…
C’étaient le prince Krapotkine, le riche Cosaque Obuchoff, l’officier Léonidas Chiko, le colonel Demetrius Rogaceff, Bogolubott, Véra Zassulitch…
La lutte devenait plus ardente et plus terrible. Des deux côtés, on ne reculait devant aucune extrémité. À la potence, on répondait par l’explosion, au meurtre légal par l’assassinat politique. Certes, rien n’est plus navrant que ces combats sociaux dans lesquels chacun des adversaires ne peut assurer sa victoire que par la mort de son ennemi.
Mais, dans cette lutte, quel épouvantable rôle joué par la police et les bourreaux !
Jamais la férocité de la répression, en aucun pays, n’a atteint ces proportions atroces. À lire les récits qui nous sont parvenus, on croirait rêver.
L’emprisonnement solitaire est si étroit, si absolu que les uns s’étranglent avec leur mouchoir, se coupent la gorge avec un morceau de verre, à moins qu’ils ne meurent de la phtisie ou ne deviennent fous comme la malheureuse Betia Kamenskaia.
Dans un sinistre procès, sur 193 inculpés 73 se suicidèrent ou devinrent fous pendant les quatre ans que dura l’instruction !
C’est, d’ailleurs, le système de la police, de laisser pourrir les détenus en prison, jusqu’à ce que l’un d’eux, brisé, vaincu, se décide à faire des aveux. Dans leur désespoir et pour forcer leurs geôliers à se relâcher de leur impitoyable sévérité, par crainte de l’opinion publique, ils organisent parfois ce qu’on a appelé les grèves de la famine.
Bals hantés par le rebut de la population, musettes bruyantes, cabarets borgnes, sinon aveugles, bouges sans nom, maisons hospitalières immatriculées à la police, entre autres la légendaire Patte-de-Chat, ainsi étaient peuplées les rues limitrophes du vaste carré qui s’étendait du boulevard de Courcelles aux confins de Clichy.
Aujourd’hui, comme par un coup de baguette, toute une ville nouvelle a surgi. Si nos pères se réveillaient, ils n’en pourraient croire leurs yeux. Là où l’immondice semblait fixé pour l’éternité, où les baraques titubantes branlaient au vent, où la chanson d’un ivrogne se cadençait en hoquets, ou des ruelles boueuses zigzaguaient entre des monceaux de choses, dédaignées des biffins les plus aguerris… des voies droites, claires, se sont ouvertes, bordées d’hôtels élégants qui semblent de jeunes statues en toilettes de bal. L’air sent le patchouli et la verveine. Les tourelles, les pignons, les loggie arrêtent l’œil du passant, l’accrochant comme des enseignes de gentil luxe et de coquettes jouissances.
Sur les détritus évadés des tombereaux nocturnes, l’avenue de Villiers a étendu son tapis blanc, qui semble une fourrure. Là où des vitres sales laissaient à peine deviner le sourire vénal des pierreuses, des rideaux de soie, barbelés de dentelles, montrent la spirituelle frimousse d’une gente demoiselle, qui a remplacé le casse-poitrine par le kummel et égrène des louis d’or, quand ses ancêtres femelles geignaient pour des sous.
Rue Prony, rue Fortuny, rue d’Offemont, ces noms sonnent joyeusement à l’oreille et éveillent en l’esprit des profanes des idées de capitons doucereux sur lesquels s’ébat l’amour fantaisiste. L’amour et l’art se sont emparés de cette Corinthe nouvelle : et l’orgue de barbarie de Fualdès s’est tu, aux accords plaqués des sonates ou aux sauteries rythmées des opérettes.
Les hôtels sont des nids, d’où s’envolent à toute heure, au froufrou des robes qui glissent comme des ailes, des anges emmitouflés de velours, de peluches, de faille, de cachemire. C’est là que la gomme s’est créée et que le dieu de l’insouciance a tué le pschutt du néant. Vie à part, faite de névroses et de lassitudes.
À l’angle de la rue d’Offemont et de l’avenue de Villiers, une serre dont les vitraux laissent apercevoir des plantes exotiques que cachent parfois les lames bouillonnées des stores de soie carminée, forme une sorte de cap, au-dessus d’un balcon de pierre. En levant les yeux, on aperçoit le vitrail spacieux d’un atelier. En entrant dans la rue on voit se développer l’hôtel aux allures anglaises, avec son sous-sol protégé par une grille aux lances bronzées.
Le perron de trois marches porte le visiteur à la porte large qui s’ouvre sur un vestibule, haut, dallé de marbre, peuplé de statues nues et souriantes, qui lui donnent la bienvenue. Les tentures de Caramanie lourdes et hirsutes, s’élèvent devant lui et lui montrent les salons qui ressemblent à des musées, le fumoir tout de bambou tressé, la salle où le billard s’accroupit, comme un monstre aux jambes d’ébène et au dos verdâtre.
Le laquais, correct, précède. Une dernière portière se soulève. Une porte s’ouvre, et dans un éblouissement de lumières, tombant des lustres, accrochées aux cristaux, rebondissant dans les méplats de l’argenterie ciselée, la salle à manger apparaît, merveille de confort, où l’on s’attarde dans les jouissances énervantes de la chère délicate et pimentée.
Il est neuf heures.
Une buée chaude remplit l’atmosphère de la haute pièce dont les murs disparaissent sous les faïences rares.
Le comte Serge Soïloff, l’amphitryon, est à demi-renversé dans son fauteuil de chêne, la coupe haute au niveau de l’œil.
À sa droite, Miguela, la belle, l’ardente Miguela, fille des Espagnes, aux cheveux d’un roux fauve, à la gorge robuste et impatiente du satin qui l’emprisonne.
À sa gauche, Soline, la grande artiste au profil sculptural, la comédienne adorée dont la voix a des pouvoirs circéens.
Lui faisant face, Noël Houdas, le médecin ou plutôt le physiologiste dont les travaux ont épouvanté l’Académie routinière, le chimiste qui semble un alchimiste.
Noël, lui aussi, a deux compagnes à ses côtés. Leurs noms ? Demandez-les aux échos du turf, des premières, des raouts et des ventes de charité. Jolies filles, point bégueules, ayant le mot vif et le baiser prompt.
Mais, là-bas, au pied de la vaste cheminée où flambent des arbustes, quelle est cette forme vague ? En vérité, on doute que cela soit un homme.
Le visage disparaît sous un large bandage noir qui enserre la mâchoire. Les cheveux roux se dressent comme des pointes électrisées. Un bras manque, l’autre est coupé au coude et se perd dans une manche vide. Des jambes, l’une n’est plus qu’un moignon tranché au genou. L’autre n’a point de pied. Cela est affalé dans un fauteuil bas, ne remue point et se tait.
C’est Yvan Boboff, le moujik, dont le corps a sauté en éclats dans une explosion de nitroglycérine. C’est un reste d’homme évadé du fer et du feu.
Le comte Serge parle :
— Eh bien ! mes toutes belles, s’écrie-t-il, vous ne riez plus, vous ne chantez plus ! D’honneur, quel mauvais génie vous hante ! Le caviar n’était-il point à votre goût et le champagne vous affadit-il le cœur ?
Il rit, et à belles dents.
Car c’est un mâle superbe que le comte Serge.
Grand, bien découplé, il porte haut sa tête fine et pâle, au front blanc couvert de boucles brunes, aux moustaches effilées, à la barbiche Henri III incessamment tordue sous ses doigts de femme.
Miguela appuie son menton sur ses deux mains, boudeuse.
— Si vous croyez que vous êtes gai, ce soir, avec vos histoires de sang et de mort !…
— Le fait est, ajoute Soline, que vous m’avez brisé les nerfs…
— Et toi, Houdas, reprend Serge en s’adressant à l’ami qui lui fait face, est-ce que d’aventure tu es aussi petite-maîtresse que ces dames ?
— Moi ! s’écrie Houdas, j’ai bien dîné, je digère.
— À la bonne heure : la digestion est la seule excuse du silence. Mais, chères amies, ajouta-t-il en se tournant successivement vers ses deux voisines, mes récits valent-ils jamais les atrocités que rêvent vos cerveaux en fièvre ! Eh bien ! oui… j’ai vu mes camarades, mes compagnons déchiquetés par des baïonnettes, j’ai vu Sorewitz, mon meilleur ami, se tordant au milieu des poutres enflammées que les soldats du czar bien-aimé faisaient tomber sur lui, j’ai vu Branikowitch, un enfant – quinze ans à peine – chassé dans les rues de Wilna par des sbires qui le traquaient comme une bête fauve, s’attachant à ne le point tuer, pour qu’il expirât de fatigue et de désespoir, et de fait, il est tombé d’un seul coup, après trois heures de chasse… poussé comme une masse… Ce sont là aménités d’empereur. Mais encore une fois, si jamais les femmes deviennent bourreaux, elles sauront inventer bien d’autres tortures…
— Après tout, fit Miguela dont les yeux lancèrent un rayon, vous avez peut-être raison.
— Certes ! et raison encore lorsque, bronzé, aciéré au feu des infamies moscovites, je suis devenu, moi, le comte Serge Soïloff, l’impassible et implacable spectateur des monstruosités humaines… Tenez ! voyez Yvan !
Et le comte se tourna vers le débris humain qui, sous la lueur du foyer, semblait un échappé effroyable des pagodes indiennes.
— Voyez Yvan ! il a voulu venger ses frères assassinés… Il a combiné des machines effroyables qui, un jour, ont éclaté… bras, jambes, maxillaires et dents ont sauté en l’air… et le voilà comme moi, impassible et inébranlable… Du diable si maintenant il songe à s’émouvoir… un coup de canon éclaterait dans cette chambre qu’il ne tournerait même pas la tête.
— Mais enfin, s’écria Soline avec impatience, vous n’avez été, que je suppose, ni brûlé comme Sorewitz, ni couru dans les rues d’une ville comme Branikowitch, ni déchiqueté comme Yvan… et votre impassibilité est faite, il me semble, des souffrances des autres…
— Vous croyez ! eh bien ! moi, mes toutes belles, j’ai tout simplement été… mort !
— Mort !
— Mon Dieu, oui, aussi mort qu’on peut l’être… et enterré par-dessus le marché !…
— Quelle plaisanterie ! fit Soline en haussant les épaules.
— Une plaisanterie ! eh bien ! avouez, exquise tragédienne, que vous avez, vous aussi, l’impassibilité facile… Tenez, Houdas va vous narrer l’histoire… elle en vaut la peine, je vous jure…
— Voyons, docteur, dit Miguela, vous ne vous ferez pas complice de ses hâbleries…
Houdas était, lui aussi, un superbe échantillon de la race humaine. Solide, les épaules larges, la tête énorme attachée au torse par un cou puissant, le crâne couvert d’une forêt de cheveux tordus dans tous les caprices d’une frisure naturelle et excessive, les narines ouvertes, les lèvres sensuelles, des yeux grands et vivaces, Noël Houdas représentait le type que Millet a imaginé pour son Vercingétorix.
Peut-être lui manquait-il quelque peu de ce qu’on nomme la distinction. Il était puissant, carré, fort, avait le rire sonore et la voix éclatante :
— Mort, archimort, enterré à six pieds, dans une boîte de chêne cerclé d’acier… tel était mon ami Serge Soïloff, lorsque j’ai eu l’honneur de faire sa connaissance…
— En léthargie, alors ! s’écria Soline.
— Point du tout… parfaitement éveillé, et, je dois le dire, en plein sang-froid… car deux minutes à peine s’étaient écoulées depuis notre rencontre que nous causions tous deux et fort agréablement, je vous jure…
— Allons ! interrompit Miguela ; puisque c’est une histoire… subissons-la…
— Oh ! fort courte ! reprit Houdas. Je dois vous avertir tout d’abord que M. le comte Soïloff est, ou plutôt a été, un parfait nihiliste…
— Oh ! oh ! fi ! l’horreur ! s’écrièrent les quatre femmes avec de petits cris d’effroi.
— Et qu’il avait conspiré contre son très gracieux czar et père avec Branikowitch et les autres… Comme il appartenait à une grande famille, on l’avait enfermé dans la forteresse de Wilna, le réservant à la potence…
— La potence ! un gentilhomme !
— Le czar a des idées égalitaires, reprit gravement Houdas. Ceci dit, je dois, pour la clarté de mon récit, vous énoncer un principe ou plutôt un axiome : c’est qu’il n’est pas de brutes, si brutes qu’elles soient, qui soient aussi brutes que les brutes qu’on emploie en Russie comme agents subalternes…
— Mais il me semble qu’en France… commença Miguela.
— Pardonnez-moi d’être ou de paraître chauvin. Mais toute comparaison est impossible. Un agent russe a ce double vice d’être stupide et lâche à la fois… lâche devant ses supérieurs auxquels il ne se permettrait jamais d’adresser, non pas un avis, mais une observation, si humblement formulée fût-elle… stupide, en ce que sa soumission à ceux qui le commandent est telle, son admiration pour la prétendue infaillibilité de ses chefs est si absurde, qu’il exécute passivement, avec la discipline d’une machine dont on a poussé le bouton conducteur, les ordres donnés, si inouïs, si absurdes qu’ils puissent lui paraître… le maître a dit : cela suffit, cela répond à tout…
— Le préambule est long, murmura Soline.
— Soit, mais nécessaire… sans quoi mon histoire, notre histoire, devrais-je dire, vous paraîtrait trop invraisemblable…
— Nous en avons entendu bien d’autres…
— Je ne crois pas… mais ne m’interrompez plus, sinon je n’en aurai jamais fini… Car il faut que je vous explique un point spécial…
Soline, nerveuse au dernier point, battait la nappe de sa coupe mousseline, tant et si bien qu’elle en avait cassé le pied. Mais sans s’émouvoir, elle en avait pris une autre et persévérait dans son système d’extermination des cristaux.
— Il y a trois ans, moi, Noël Houdas, tirailleur de la science, honni de la Faculté, mais peu soucieux de ses colères, j’avais la passion du travail et de l’observation… Un grand seigneur russe me proposa d’aller étudier dans son pays l’étrange affection qui s’appelle la fièvre des steppes. J’y consentis, et après maintes excursions, je revins à Wilna. Mon protecteur, mon patron était le gouverneur de la province ; et sur ma demande, en vue de certaines études spéciales, il m’avait attaché au service des prisonniers… Maintenant, toutes les expositions sont finies… j’entre dans l’aventure elle-même.
— Enfin ! soupirèrent les femmes.
— Voici la distribution de la comédie : Le comte Serge, prisonnier et à la veille d’être pendu ; Noël Houdas, médecin de la forteresse, et comme comparses les agents en question, crétins de la plus belle venue. Un décès s’était produit. Je rédige mon rapport. Le locataire du cachot numéro 37, un cachot à deux mètres sous terre, justement voisin de celui qu’occupait le comte Serge, était mort de la fièvre putride. Bon. Me voilà tranquille. J’ai fait mon devoir ; et comme il était tard, je vais me coucher. Le lendemain matin, je parcourais, selon mon habitude, les dédales de la forteresse, quand je rencontre un des surveillants, un des idiots en question.
« — Eh bien ! lui demandai-je, l’enterrement a eu lieu !…
« — Oui, barine (un terme de respect). Et ça n’a pas été sans peine.
« — Comment ! sans peine !
« Et riant malgré moi, je réplique :
« — Ah çà ! je suppose qu’il n’a pas fait de résistance.
« — Excusez, il en a fait beaucoup.
« Je regarde mon imbécile. Il parlait très sérieusement. J’avoue que je n’y comprenais rien. J’étais absolument certain que mon homme était mort ; et toute velléité de révolte était inadmissible.
« À ce moment précis un gardien supérieur s’approche de moi, le bonnet à la main :
« — Le docteur sait-il que le numéro 37 est mort ?
« — Si je le sais ! parbleu, puisqu’il est enterré…
« — Enterré ! le docteur fait erreur ! à telle enseigne qu’il est étendu raide dans son cachot et qu’il commence même à sentir furieusement mauvais…
« Toujours à cent lieues de deviner la vérité, je cours après l’homme qui m’avait parlé tout à l’heure et qui par discrétion s’était éloigné dès qu’il m’avait vu en causerie avec son supérieur :
« — Mais, misérable, m’écriai-je, as-tu oui ou non enterré le mort ce matin ?
« — J’ai obéi à l’ordre donné par le gouverneur… Et tenez, je l’ai encore sur moi…
« Il fouilla dans sa poche graisseuse et en tira un papier plié.
« Je regarde, et qu’est-ce que je vois ?
« — Ordre de mettre en terre le prisonnier occupant la cellule numéro… 36 !!!
« Je bondis, j’interroge, je cherche… et qu’est-ce que j’apprends ?
« Le numéro 36 était occupé par le comte Serge Soïloff. Les agents étaient entrés dans son cachot avant l’aube, l’avaient trouvé plongé dans un profond sommeil.
« Avant qu’il eût eu le temps de reprendre ses sens, on l’avait empoigné, allongé dans une bière en chêne que devaient fermer des cercles en fer.
« À ce moment, dans l’étourdissement du premier réveil, il avait poussé quelques exclamations à peine articulées.
« Les misérables l’avaient forcé à se taire, à coups de pied, à coups de poing ! Ils avaient l’ordre de mettre en terre le numéro 36. Toute protestation était inutile…
« Et tandis que le malheureux vivant cherchait à se débattre, à crier, à s’évader, les stupides brutes l’avaient écrasé sous le couvercle de la bière, l’avaient cerclé, emporté sur leurs épaules… et en dépit des cris rauques qui s’échappaient de la boîte funèbre, l’avaient enfouie dans la terre…
Les femmes poussèrent des exclamations terrifiées.
Le comte Serge riait.
— Quand je compris l’horrible vérité, je sentis mes cheveux se hérisser sur mon front. Mon premier mouvement fut d’assommer l’imbécile, criminel par stupidité soumise. Je ne le fis pas. Une réflexion subite avait traversé mon cerveau.
« Le comte Serge Soïloff était condamné à mort.
« L’exécution devait avoir lieu le lendemain.
« S’il était mort, ce n’était qu’une avance de vingt-quatre heures.
« Mais s’il était encore vivant !
« Je connaissais les boîtes de chêne dans lesquelles on enfermait les cadavres. Faites à la hâte, en raison du bas prix alloué à l’ouvrier, elles étaient mal jointes, présentaient des fissures. L’homme pouvait – c’était folie que de l’espérer – respirer, vivre.
« Si je donnais l’éveil, si j’appelais du secours, qu’arriverait-il ?
« On allait déterrer le mort… prématuré, et dès le lendemain, une corde de chanvre achevait l’œuvre interrompue…
« Tenter de le sauver… maintenant, c’était le tuer !
« Une pensée me frappa.
« Et comme l’agent m’examinait, inquiet peut-être :
« — Vous avez obéi à l’ordre donné, lui dis-je, vous avez bien fait. Seulement, maintenant, songez au numéro 37.
« Quelques minutes après, je lui remettais le rapport nécessaire.
« Ainsi, le gouverneur, par un lapsus, avait donné ordre d’enterrer un vivant. Les Russes n’avaient pas hésité.
« Et moi j’eus le courage d’attendre que la journée fût écoulée. J’eus l’épouvantable patience de montrer un visage calme, parce que je voulais agir seul la nuit.
« Quand le couvre-feu eut sonné, quand je fus certain que nul ne pouvait me voir, je me dirigeai vers l’enclos où l’on enterrait les prisonniers. J’y étais allé souvent. La place m’était connue. Je ne pouvais me tromper. L’avant-dernière fosse était celle qui recelait le comte Serge !… Mais allais-je donc le trouver vivant ? Après vingt heures d’enfouissement !…
« Je n’entrerai pas dans les détails. Puisque le comte Serge est là, devant nous, heurtant sa coupe à la mienne, c’est que je suis arrivé à temps ; c’est que, creusant furieusement avec une bêche que j’avais soustraite, j’avais mis la bière à découvert ; c’est qu’avec un ciseau j’avais fait sauter le couvercle de la bière, que j’avais soulevé dans mes bras un corps raidi, inerte ; c’est que j’étais convaincu que j’arrivais trop tard, quand après une minute d’exposition à l’air glacé de la nuit, le comte s’agita puis se redressa et dit :
« — Ouf ! qu’il fait bon respirer !
« Comment je le fis évader du cimetière, comment il parvint à franchir la frontière, ce sont là des détails qui importent peu. Mais ce qui est acquis, c’est que M. le comte Serge Soïloff a été mort et dûment enterré…
— Et que sans vous, mon cher Houdas, la plaisanterie de nos brutes moscovites aurait eu des résultats définitifs…
Il y eut un instant de silence.
Dans un récit de cette nature, ce ne sont pas les mots mêmes qui frappent l’imagination, mais bien les idées qu’ils réveillent, les tableaux qu’ils évoquent. La pensée de ce vivant, étouffé dans une bière, oppressait les auditeurs.
— Eh bien ! s’écria Serge à voix haute, comme pour secouer cette torpeur, me comprenez-vous maintenant, chères et belles amies, quand je vous affirme que rien ne peut plus troubler ma quiétude ?… Comme l’homme d’Horace, l’univers peut s’écrouler autour de moi. Que m’importe ? Impassible je suis, impassible je reste. Qui a été frappé de la foudre rit des violences humaines. Et je jure, par le néant d’où je sors et où je retournerai, que pas un événement, quel qu’il soit, ne saurait briser la cuirasse de flegme qui par trois fois enserre ma poitrine…
À ce moment, la porte s’ouvrit et un laquais s’approcha, présentant au comte Serge un plateau sur lequel se trouvait une enveloppe fermée.
Il la prit, et la tenant dans sa main, il continuait à parler :
— J’ai baisé la mort sur les lèvres, et la mort a glacé mes nerfs et mes sens et ma conscience. Je ne crains même plus que le ciel tombe. À sa chute, je répondrais par : Que m’importe !
Tout en disant ces choses, il avait négligemment déchiré le papier de l’enveloppe.
Ce n’était pas un billet qui s’y trouvait renfermé, mais un objet étrange, brillant, de cuivre…
Cela avait la forme d’un disque, monté sur une poignée-bijou, petit et cerclé. Le disque avait d’un côté trois pointes, de l’autre deux…
Et quand le comte Serge vit cela, il se dressa, poussa un cri terrible.
— Qui vous a remis cela ? cria-t-il d’une voix tonnante.
— Une dame, commença le laquais.
Mais sur le seuil de la salle étincelante de lumière, une forme parut et une voix prononça ces deux mots :
— Zemlia i volia !
|2| ZEMLIA I VOLIA
Ces quelques syllabes avaient retenti graves et presque solennelles. Zemlia i Volia ! Terre et Liberté ! Le mot de ralliement des socialistes…
Le comte Serge était debout, pâle, s’efforçant en vain de garder sur ses traits la marque d’indifférence qu’il savait tout à l’heure y être si bien attachée.
Celle qui avait parlé avait fait un pas dans la salle.
C’était une femme d’assez haute taille, enveloppée tout entière dans une sorte d’ulster, de couleur brune, tombant jusqu’à ses pieds.
Elle se tenait droite, le visage toujours calme sous son voile, immobile et impassible en apparence, la main glissée dans sa poche.
Telle elle était apparue aux voyageurs du railway, telle maintenant elle se dressait à la porte de la salle étincelante de lumières.
— Que voulez-vous ? s’écria Serge d’une voix étranglée. C’est en vérité une étrange audace…
Il n’insista pas.
La jeune femme, d’un geste lent, avait détaché son voile et l’avait rejeté sur son épaule.
Il y eut des exclamations de surprise.
Cette femme était adorablement belle, mais de quelle beauté étrange et saisissante ! Elle était blanche de la blancheur de marbre. Ses traits fins semblaient avoir été ciselés par un de ces patients orfèvres qui sacrifient de longs mois à la perfection d’une œuvre attendue.
Il est des perfections qui défient toute description. Le nez fin, aux narines délicates, surmontait une bouche aux lèvres roses, dessinées d’un trait hardi et exquis à la fois.
Les yeux s’ouvraient larges, vivants, ayant aux prunelles un miroitement singulier, décuplant la profondeur du regard.
Les cheveux, d’un blond slave, collés aux tempes, relevés par un nœud caressant la nuque, eussent fait envie, tant ils étaient épais et lourds, à la plus belle des reines de la mode.
Et certes il fallait que cette tête fût admirable, pour que, malgré l’accoutrement plus que simple de cette bizarre créature, Miguela et Soline, expertes en beauté, eussent laissé échapper un cri de surprise.
Houdas, lui aussi, s’était à demi-dressé, l’œil ardent, la bouche tordue en un sourire de convoitise…
Était-ce donc la beauté de cette femme qui avait encore produit ce miracle inattendu ?…
Yvan, le débris humain, le mutilé, saisissant les béquilles qui s’appuyaient à son siège, s’était soulevé, et dressé sur le moignon de jambe qui remplaçait le pied absent, il se soutenait presque de toute sa hauteur, et sous le bandeau noir qui cerclait son visage, ses yeux étincelaient…
Le comte Serge avait laissé échapper un nom.
— Véra ! avait-il murmuré.
Puis il y avait eu un long silence.
La jeune femme avait promené sur les convives ses regards lents et lourds.
— Mon cher comte, dit Miguela en ricanant, je crois qu’il s’agit d’affaires de famille et que le mieux est de vous laisser le champ libre.
Elle s’était levée, imitée par Soline qui, sans le vouloir, se sentait secouée par un étrange frisson…
Quant à Houdas, il n’avait pas bougé, absorbé dans sa contemplation extatique.
— Restez ! dit Véra d’une voix brève. Il le faut, je le veux !
Le comte eut un tressaillement de colère :
— Nul n’a droit de commander ici, commença-t-il…
— Nul, excepté moi, interrompit Véra. Je veux que ces femmes entendent ce que j’ai à vous dire, comte Serge… Je veux que, si vous êtes devenu un lâche, votre lâcheté éclate aux yeux de tous… pour que des âmes les plus corrompues le mépris jaillisse sur vous !
Le comte faisait de véritables efforts pour se contenir : ses dents mordaient la chair de ses lèvres que des gouttelettes de sang rougissaient.
— Comte Serge, reprit Véra, Netchaïeff est mort…
Il ne répondit pas.
— Comte Serge, dit encore la pauvre femme, Lavidoff a été torturé et a expiré sous le bâton.
Même silence.
— Comte Serge, Dimitri Jelechowitch a été traîné, attaché à un fourgon, sur la route de Tobolsk… Il n’est pas mort… il est fou !
Et se tournant vers les deux femmes :
— Ces hommes sont les intimes amis, les frères du comte Serge !
Soïloff eut un éclat de voix terrible :
— Eh ! que m’importe ! s’écria-t-il. Ah ! tu crois, démon, que tu pourras me ressaisir !… Non ! non !
Et avec une sorte de colère fiévreuse qui semblait grandir à chaque instant :
— Écoutez, vous qu’elle prend comme témoins… écoutez ce que cette femme veut de moi !…
Les bras croisés, la tête légèrement renversée en arrière, Véra écoutait.
— Il y a cinq ans de cela, j’étais jeune, j’étais fou ! oui, fou ! Car c’est stupidité que de combattre, à forces inégales, le colosse moscovite ! Mais alors j’écoutais ceux qui me parlaient de sacrifices, de dévouement… Mon âme s’exaltait à cette pensée que le crime doit être châtié… Qui m’avait mis cette fièvre au cerveau ?… Cette femme ! Oh ! ajouta-t-il avec un ricanement ironique, ne vous avisez pas de croire qu’elle fut ma maîtresse… Elle ! Mais est-ce que les femmes de sa sorte ont des sens, ont un cœur ?… Insensée ! Elle est uniquement possédée de l’idée de la régénération humaine… Ha ! ha ! Véra, ma maîtresse !… Je me suis tordu à ses pieds, dans les convulsions d’amour, je me suis traîné devant elle comme un esclave !… Savez-vous ce qu’elle m’a répondu… cette Véra Kleonoff ! Elle m’a proposé le mariage… le mariage nihiliste…
« Vous ne savez pas ce qu’est cela… les noces nihilistes ?… On se réunit dans une taverne… on a pour témoin des hommes qui ont tué hier ou qui tueront demain… On entend une voix qui vous dit :
« — Que celui d’entre vous qui renoncera à la Révolution soit maudit !
« Mariage qui n’astreint à aucun devoir, qui laisse les époux libres de leurs corps, n’unissant que leurs consciences…
« Et j’ai consenti… parce que j’aimais cette femme ! parce que je voulais, en sacrifiant ma vie, s’il le fallait, obtenir de sa bouche l’aveu d’amour que toujours elle m’avait refusé…
« Alors, elle m’a dit :
« Combats d’abord pour la cause… et attends !
« Ce que j’ai fait alors… ah ! je ne m’en souviens plus… J’ai été espion, j’ai été bourreau, je me suis ravalé aux plus honteuses compromissions…
Il éclata de rire :
— J’ai été enterré vivant ! Eh bien ! quand je suis allé à cette femme… en lui disant : « J’ai tenu mon serment ! À ton tour ! » Elle m’a répondu par ces seuls mots que vous avez entendus tout à l’heure : Zemlia i Volia, terre et liberté… formule maudite qui est toute sa vie à elle… formule qui nous a liés, comme ce symbole étrange qu’elle m’a fait remettre d’abord, le disque à cinq branches des nihilistes…
Et il regardait avec un rire irrité le bijou de cuivre ciselé.
Il le jeta sur la table, loin de lui, au milieu des cristaux qui tombèrent.