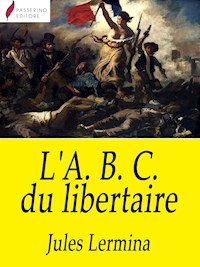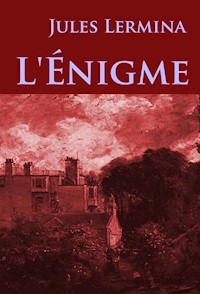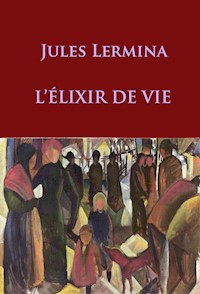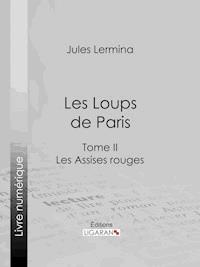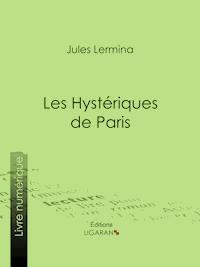1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Fin du XVe, début du XVIe siècle, la conquête des mers par l’Espagne et le Portugal. Un homme ressort de cette période, Magellan. Discret, courageux, tenace, réfléchi, très intelligent, il a un défaut, il ne sait pas communiquer avec les autres. Après moult aventures, péripéties diverses et passionnantes, il arrivera au but de son existence: la découverte du détroit qui porte son nom. Ce texte va au delà du document historique, vous le lirez comme un passionnant roman d’aventures. Troisième partie - Les aventures de Fanfar Ce troisième volume n'est en fait qu'une très longue parenthèse. Le deuxième tome s'était terminé sur le sauvetage du comte de Monte-Cristo et de son fils par un colon français, Fanfar, qui les avait amenés dans son domaine... Quatrième partie - La revanche de Benedetto Douze ans après les aventures en Algérie de la deuxième partie, Monte-Cristo et son fils vivent à Paris. Haydée est morte. Le livre s'ouvre sur une lettre du comte à Espérance, dans laquelle, déplorant son propre caractère dominateur et orgueilleux, Monte-Cristo annonce à son fils qu'il s'en va, afin de le laisser prendre son indépendance...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SOMMAIRE
TROISIÈME PARTIE LES AVENTURES DE FANFAR
PREMIER ÉPISODE CAÏN
|1| L’ATTAQUE
|2| CE QUE SAVAIT PIERRE LABARRE
|3| PENSÉES FRATERNELLES
|4| VILLAGE DES VOSGES
|5| DU PASSÉ DE FRANÇOISE
|6| OÙ L’INVASION PASSE
|7| LA MÉTAIRIE D’OUTREMONT
|8| ENFANTS DANS LES TÉNÈBRES
DEUXIÈME ÉPISODE GUEULE-DE-FER
|1| AU SOLEIL D’OR
|2| CONNUS ET INCONNUS
|3| DEUX PLACES, S.V.P.
|4| MAITRE ET VALET
|5| ENTREZ, ENTREZ, MESSIEURS
|6| LES IDÉES DE ROBECCAL
|7| PIERRE LABARRE
|8| PREMIÈRE RENCONTRE
|9| CLOISONS TROP MINCES
|10| LA RECONNAISSANCE D’UN MARQUIS
|11| PAUVRE BOBICHEL
TROISIÈME ÉPISODE LES HÉROS DU DROIT
|1| FRANCE – 1824
|2| LA MARQUISE
|3| LES DRAMES DU VEAU SAUTÉ
|4| CHASSE À L’HOMME
|5| CHEZ UN REVENANT
|6| CINETTE ! CINETTE !
|7| À GREDIN, DOUBLE GREDINE
|8| MACHIAVEL ET CIE
|9| FONDS PERDUS
|10| FORS L’HONNEUR
|11| FACE À FACE
|12| À LÉIGOUTTE
|13| AU NID
|14| SUPRÊME EFFORT
|15| LE PROCÈS
|16| CRISE
|17| L’AUTOPSIE
|18| DE CHARYBDE EN SCYLLA
|19| COURT, MAIS À MÉDITER
|20| À TOUS CEUX QUI AIMENT FANFAR
QUATRIÈME PARTIE LA REVANCHE DE BENEDETTO
|1| UNE LETTRE DE MONTE-CRISTO
|2| ESPÉRANCE
|3| QUE FERA-T-IL ?
|4| EN AVANT !
|5| JANE ZILD
|6| COUP DE FOUDRE
|7| COMMENT ON SE RETROUVE
|8| CATASTROPHE
|9| UN COUP DE RÉVOLVER
|10| VIVRA-T-ELLE ?
|11| LE SECRET DE JANE
|12| CARMEN
|13| M. DE LARSANGY
|14| ÉTERNELLE CHANSON
|15| IL FAUT LES SAUVER !
|16| LES FEMMES S’EN MÊLENT
|17| SUR LA PISTE
|18| ESPÉRANCE DÉSESPÉRÉ
|19| À L’IMPASSE DES ÉPINES
|20| OÙ COUCOU DEVIENT PACHA
|21| CARMEN TIENT PAROLE
|22| LE GUET-APENS
|23| ALERTE !
|24| UNIS DANS LA MORT
|25| LE SPECTRE
|26| LE MARTYR
|27| LE FAKIR
|28| DJEDDAR LE YOGHI
|29| RÉSURRECTION
Notes
Série : Jules Lermina
|3-4| LE FILS DE MONTE-CRISTO
JULES LERMINA
LE FILS DE MONTE-CRISTO
Tomes |3-4|
ROMAN
Paris, 1881
Raanan Éditeur
Livre 1269 | édition 1
raananediteur.com
TROISIÈME PARTIE LES AVENTURES DE FANFAR
PREMIER ÉPISODE CAÏN
|1| L’ATTAQUE
Vers le milieu du mois de décembre 1813, un homme suivait au trot de son cheval la route qui, traversant la Forêt-Noire, conduit de Vieux-Brisach à Fribourg.
Ce personnage semblait encore dans la force de l’âge : il était vêtu d’une longue redingote brune, relevée sur les genoux ; sa culotte, de même couleur, se serrait sur des guêtres de cuir fermées par de courtes courroies à boucles d’acier. Il portait la poudre, et ses cheveux, ramenés en arrière, pendaient sur le collet de son habit en queue courte fixée par un ruban noir.
Le soir venait, et l’obscurité grandissait rapidement, épaississant les ténèbres qui semblent peser éternellement sur le Schwartzwald.
À quelques lieues de Fribourg, un massif isolé de collines et de rochers se dresse tout à coup : on l’appelle Kaiserstuhl, le Trône de l’empereur. La pierre est noire, le basalte émerge du sol en masses énormes, le trachyte à la teinte vitreuse jette dans l’ombre des reflets grisâtres et revêt des formes étranges. Les pins s’accrochent aux fissures, laissant pendre leurs longues branches qui ressemblent à l’inculte chevelure d’êtres gigantesques, les bouleaux dressent, droits comme des fantômes amaigris, leurs troncs dépouillés. Au bruit des branches dénudées qui se heurtent sous l’âpre souffle du vent d’hiver, se mêle le râle sourd du torrent qui roule à travers les pierres, tandis que monte dans l’air l’odeur chaude et balsamique de la résine.
Pierre Labarre, serviteur de confiance du marquis de Fougereuse, se hâtait et pressait de toute la vigueur de ses jambes un peu affaiblies par la fatigue, le cheval qui hésitait et dont souvent le sabot se heurtait aux troncs d’arbres faisant obstacle sur la route étroite. À vrai dire, c’était moins une route qu’une sorte de fissure pratiquée entre les rochers par une commotion souterraine.
Des deux côtés, la montagne se dressait à pic, avec ses murs lisses et sombres.
— Vite ! Margotte ! murmurait Pierre. Vite ! on nous attend… et nous apportons de bonnes nouvelles.
L’animal semblait comprendre, et sans peur de la nuit, accélérait son trot régulier.
Et toujours l’ombre se faisait plus épaisse, le vent soufflait plus âpre, la voix des torrents roulait dans le silence, plus sonore et plus mystérieuse…
Tout à coup Pierre tressaillit.
Il passait alors au pied du mamelon sur lequel se dressaient jadis neuf tilleuls énormes, réduits à huit aujourd’hui par un coup de foudre qui a déraciné l’un des antiques centenaires.
À ce point, la route s’élargit et tend à un carrefour où se croisent deux sentiers, l’un venant de Brisach, l’autre de Gundelfingen.
Pierre avait pesé sur la bride, et Margotte, obéissante, avait ralenti le pas.
L’homme se dressa sur ses étriers et prêta attentivement l’oreille.
— Je me suis trompé, murmura-t-il ; cependant j’avais bien cru entendre le trot d’un cheval de l’autre côté des Neuf Tilleuls…
Par un mouvement instinctif, il porta la main à sa poitrine.
— Le portefeuille est en sûreté, ajouta-t-il. Et à moins qu’on ne me tue… Hop ! Margotte !…
Et il rendit sa main à la jument.
Mais comme si ce mouvement eût été un signal, au même instant… et le doute n’était plus possible… le bruit de sabots heurtant le sol frappa de nouveau son oreille. Cette fois, c’était un rapide galop.
Au carrefour dont il n’était plus éloigné que d’une trentaine de mètres, il y avait une éclaircie dans les ténèbres.
Pierre vit passer une ombre.
C’était un cavalier qui courait à toutes brides, si prompt que, s’engageant dans le chemin, il se perdit immédiatement dans la nuit.
L’honnête Labarre n’était pas facile à émouvoir ; il n’était pas superstitieux, sans quoi il eût cru à une de ces apparitions fantastiques dont l’imagination des paysans du Schwartzwald peuple les montagnes.
Il était d’humeur positive et croyait plus aux voleurs qu’aux fantômes.
Aussi, sans s’émouvoir outre mesure, se pencha-t-il vers ses fontes d’où il retira un pistolet d’arçon.
Il fit jouer la batterie.
— Allons, mon vieux Pierre, dit-il à mi-voix, souviens-toi qu’un homme en vaut un autre…
Et, le doigt sur la détente, il continua son chemin.
Il franchit le carrefour sans encombre ; il n’entendait plus rien.
Peut-être après tout s’était-il trompé : c’était sans doute quelque messager qui se hâtait vers Fribourg et qui se préoccupait fort peu de ceux qui suivaient la même route que lui.
Cependant, il paraissait étrange que les échos de la montagne fussent tout à coup devenus muets, le moindre bruit se répercutant quelquefois à plusieurs lieues de distance.
Du reste, les doutes qui assaillaient l’esprit de Pierre devaient bientôt être résolus.
Il venait de s’engager dans le sentier qui, faisant suite à celui qu’il avait parcouru jusque-là, devait, en une demi-heure, le conduire à Fribourg, quand soudain un éclair brilla. Une détonation retentit, et Pierre, frappé en pleine poitrine, se pencha sur son cheval, en poussant un cri sourd…
Au même instant, d’un des côtés de la route, un homme couvert d’un large manteau qui l’enveloppait tout entier, s’élança vers celui qu’il croyait avoir tué…
Mais, au moment où il posait la main sur la bride du cheval, Pierre se redressa :
— Trop de hâte, bandit ! cria-t-il.
Et, en même temps, il déchargea son pistolet sur l’assassin.
Celui-ci poussa un cri terrible et recula en tournant sur lui-même. Mais, comme par un effort surhumain, il reprit son équilibre… et, bondissant en avant, disparut dans la nuit.
Pierre avait tiré un second coup de pistolet… mais la balle se perdit dans le vide…
— Diable ? fit-il en se frottant la poitrine, bien m’en a pris de placer mon portefeuille en guise de cuirasse… le misérable avait l’œil des hiboux et avait visé comme en plein jour… Bah ! j’en serai quitte pour une contusion… Çà ! dame Margotte ! bon train, maintenant… au galop, si tu veux ramener ton maître avec ses quatre membres…
Et comme la jument bondissait sous l’éperon, Pierre entendit retentir le galop de l’autre cheval. Il était évident que l’assassin s’enfuyait dans la crainte d’être rejoint et peut-être reconnu…
— Je n’ai pas vu son visage, murmura encore Pierre, mais c’est étrange !… quand il a crié, il m’a semblé que cette voix ne m’était pas inconnue…
|2| CE QUE SAVAIT PIERRE LABARRE
La place Notre-Dame, à Fribourg, est encombrée de bourgeois et de soldats. Les bourgeois sont inquiets et causent à voix basse. Les soldats, bruyants, s’exclament en proférant contre la France des menaces et des imprécations. Sur cette foule, la colossale aiguille de la cathédrale, fouillée à jour par les artistes du seizième siècle, projette son ombre énorme.
Les souverains et les diplomates, prêts à lancer sur la France le flot brutal de l’invasion, ont quitté Francfort pour Fribourg. C’est là qu’ils achèvent le plan de haine et de vengeance.
Déjà Blücher, avec le corps d’York, de Saken et de Langeron, se concentre entre Mayence et Coblentz. Le prince de Scharwtzemberg marche vers Bâle. Les Suisses s’irritent, devinant que leur neutralité sera violée.
Au palais du commerce, l’empereur Alexandre, M. de Metternich, lord Castlereagh, penchés sur des cartes, unis pour la curée, démembrent et amoindrissent la France.
Le comte Pozzo di Borgo est parti pour l’Angleterre, mais absent, il semble que son souffle de haine attise encore les colères jalouses.
Sur la place du Munster, une haute maison fait face au portique de la cathédrale ; un perron à balcon de fer ouvragé conduit à la porte de chêne sur laquelle se détachent les lignes grises des barres d’acier forgé.
Au premier étage, dans une vaste pièce à lambris sombres, quelques personnages sont réunis. Les derniers rayons du jour filtrent, incertains, à travers les hautes croisées, à vitraux enchâssés de plomb.
Debout auprès de la fenêtre, une femme vêtue de noir, regarde la place, tandis que de la main elle caresse la chevelure d’un enfant qui se suspend à sa jupe.
Les deux coins de la grande cheminée, dans laquelle brûlent des bûches de bois résineux, jetant à peine quelques éclairs de flamme à travers des flots de fumée, sont occupés, celui de droite par un homme, presque un vieillard, l’autre par une femme enveloppée d’un manteau qui la couvre jusqu’aux pieds.
Le marquis de Fougereuse a soixante ans, mais sa chevelure blanche, les rides de son visage, la sénilité douloureuse de sa physionomie lui donnent l’apparence d’un octogénaire. Il reste immobile, la tête baissée, les mains croisées sur ses genoux.
Celle qui se tient en face de lui, rejetée en arrière, la nuque appuyée au dossier de chêne de son fauteuil, a quarante ans à peine. Ses traits sont durs, ses yeux, fixés sur le marquis, semblent vouloir lire dans sa pensée. Elle se nomme Pauline de Maillezais, marquise de Fougereuse. Quant à celle qui considère si attentivement les groupes qui se croisent devant le Munster, on l’appelle Magdalena, vicomtesse de Talizac.
Le vicomte Jean de Talizac, son mari, est le fils du marquis de Fougereuse. Tout à coup le vieillard relève la tête et dit :
— Où donc est Jean ?
Magdalena tressaille, comme si cette voix éclatant brusquement dans le silence, l’eût effrayée. Elle quitte la fenêtre et se rapproche du marquis.
— Où donc est Jean ? répète M. de Fougereuse.
— M. de Talizac est absent depuis ce matin, répond Magdalena dont la voix tremble légèrement.
— Ah ! fait le marquis dont la tête s’abaisse de nouveau.
Puis il reprend :
— Quelle heure est-il ?
— Laisse-moi… je vais le dire, s’écria alors l’enfant en s’écartant de sa mère et courant à une console surmontée d’une horloge de cuivre.
On voit alors que Frédéric, fils du vicomte de Talizac, est une créature malingre et contrefaite. Une de ses épaules est mal formée et il boite. Cependant il paraît alerte.
— Il est sept heures, dit-il d’une voix criarde.
À ce moment la porte s’ouvre, et un officier allemand paraît. Mme de Fougereuse se lève vivement.
— Eh bien ! monsieur de Karlstein, s’écria Mme de Fougereuse, quelle décision ?…
L’officier s’incline successivement devant les trois personnes qui se trouvent devant lui, puis :
— Dès demain, répond-il, les troupes alliées franchiront la frontière française.
— Enfin ! dit Mme de Fougereuse.
Mme de Talizac lui répond par un cri de joie. Seul, le marquis reste impassible.
— Vite ! donnez-nous des détails ! dit Mme de Talizac.
— C’est bien vrai, qu’on va entrer chez ces méchants Français ? ajoute l’enfant qui s’est rapproché.
— Notre plan a prévalu, reprend l’Allemand. Nous avons pu faire comprendre aux coalisés que c’était folie que de s’engager dans le labyrinthe de forteresses qui ferme la frontière de Strasbourg à Coblentz… bloquer les places depuis Metz et Mézières nous eût affaiblis en pure perte… La plus vigoureuse attaque doit porter sur Bâle ; et c’est par la Suisse que nous pénétrerons la France… Nous arriverons ainsi jusqu’au cœur de l’empire, et la France est perdue… Lord Castlereagh a adhéré à ce plan, et aujourd’hui même, l’empereur Alexandre a donné un avis favorable.
Les deux femmes, debout, penchées en avant, semblaient écouter avec ravissement les paroles de l’Autrichien ; l’enfant ricanait.
— Et les ordres ont-ils été expédiés ? demanda Mme de Fougereuse.
— Des courriers sont partis dans toutes les directions, Blücher et Schwartzemberg sont en marche…
— Et, dans un mois, le roi sera aux Tuileries, s’écria Mme de Talizac.
L’Allemand ne répondit pas à cette exclamation.
— Maintenant, mesdames, reprit-il, veuillez me permettre de me retirer… Il faut que dans deux heures je sois parti avec ma compagnie.
Mme de Fougereuse lui tendit la main.
— Allez, monsieur, dit-elle, allez contribuer à cette œuvre sacrée… Il faut que la France insolente apprenne enfin qu’on ne foule pas impunément aux pieds les droits les plus saints… Vous êtes des justiciers… Que le châtiment soit aussi terrible que le crime a été grand !…
M. de Karlstein salua respectueusement et sortit.
— Enfin ! répéta la marquise dès qu’il eut disparu. Ah ! il y a trop longtemps que ces Français affolés nous insultent et nous méprisent… Vingt-cinq ans d’exil !… Il y a vingt-cinq ans que mon père, le comte de Maillezais, me prit un jour dans ses bras, et me montrant Paris, s’écria : « Enfant ! souviens-toi que ces hommes tueront leur roi comme ils ont forcé ton père à fuir pour échapper à la mort !… » Monsieur de Fougereuse, pourquoi ne semblez-vous pas nous entendre ?… N’est-ce donc pas une grande joie pour vous que de rentrer enfin en maître au milieu de ces hommes qui vous ont chassé, et avec vous tout ce que la France comptait de grands et de nobles ?…
Le vieillard se redressa. À la lueur du foyer, sa figure ascétique avait un caractère solennel.
— Dieu sauve la France ! proféra-t-il d’une voix lente.
Un éclat de rire répondit. C’était le fils du vicomte Jean qui raillait son grand-père.
Mme de Talizac avait haussé les épaules avec impatience.
Mme de Fougereuse lui fit un signe :
— Venez, dit-elle. Aussi bien le marquis tombe en enfance et ses folies m’irritent.
L’enfant revint prendre la main de sa mère :
— C’est nous qui serons les maîtres, n’est-ce pas ? demanda-t-il encore.
Et tous trois sortirent. La vicomtesse murmurait :
— Jean ne revient pas !… Est-ce qu’il n’aurait pas réussi ?…
À peine avaient-elles franchi le seuil, qu’une porte, dissimulée derrière une tenture, tourna lentement sur ses gonds.
Et Pierre Labarre parut.
Sans bruit, il approcha du vieillard qui, absorbé dans ses pensées, semblait n’avoir rien entendu, et s’agenouilla près de lui :
— Mon maître, dit-il d’une voix douce et respectueuse, je suis revenu…
Le marquis tressaillit… poussa un cri… et attirant à lui son serviteur :
— Toi ! toi enfin !… Eh bien ?… réponds-moi !… vite !… Simon ?…
— Chut ! pas si haut ! fit Pierre.
Et se penchant à l’oreille de son maître :
— Il est vivant ! dit-il.
Le vieillard ferma à demi les yeux et ses lèvres muettes s’agitèrent dans une prière, en même temps qu’une grosse larme, perlant sous ses paupières, coulait lentement sur ses joues flétries.
Ici, quelques explications sont nécessaires.
M. le marquis de Fougereuse appartenait à l’une des plus anciennes familles du Languedoc. Ses aïeux avaient depuis des siècles servi fidèlement la France et avaient occupé à la cour des rois les postes les plus élevés.
Les Fougereuse comptaient deux connétables. Le marquis actuel, né en 1754, avait fait partie des pages de Louis XV, puis avait obtenu successivement les plus hauts grades dans l’armée. Mais à l’âge de vingt ans, il avait commis une de ces fautes que pardonnait difficilement l’ancien régime.
Amoureux de la fille d’un de ses fermiers, il l’avait épousée malgré la résistance de sa famille qui était allée jusqu’à le menacer de la Bastille.
Mais il avait passé outre, et s’était marié.
Cette union devait être de courte durée, car un an après, sa femme mourait en donnant le jour à un fils.
Le coup qui avait frappé le marquis était si soudain, si inattendu, que le jeune homme se livra au plus profond désespoir. Emportant son fils avec lui comme un trésor, il se réfugia, loin de la cour, dans une de ses propriétés, cachée au milieu des Vosges, s’abandonnant tout entier à sa douleur, tant avait été profond l’amour qu’il avait voué à la pauvre morte.
Et de fait, Simonne Lemaire, élevée par un père honnête et travailleur, possédait une intelligence au-dessus de sa condition : dès son enfance, elle avait été en proie à une sorte d’exaltation fiévreuse qui, peut-être, tenait de la folie, mais qui ne se traduisait que par une quasi surexcitation de tout ce qu’il y a de bon et grand dans l’âme humaine…
Quand, à peine âgé de vingt ans, le marquis l’emmenait à travers les forêts de sapins, elle lui disait les souffrances de ce peuple auquel elle avait été mêlée depuis sa naissance, et à ce privilégié du hasard, c’est-à-dire de la naissance, elle dévoilait des abîmes inconnus.
Elle lui montrait le paysan écrasé sous l’impôt, la famine décimant des villages entiers, grâce à l’épouvantable agiotage des accapareurs, le peuple déclaré taillable et corvéable à merci ; elle lui désignait du doigt ces animaux farouches, mâles et femelles dont a parlé La Bruyère, répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés par le soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent avec une opiniâtreté invincible.
Et devant ces épouvantables révélations, devant cet abîme de misère que peu de regards avaient osé sonder jusqu’au fond, le jeune homme se sentait saisi d’une immense pitié.
— Ami, disait Simonne, tu es riche, tu appartiens à la caste noble et puissante… richesse, noblesse et puissance, emploie toutes ces forces au soulagement de tes semblables… donne et parle… secours et défends… et que ta voix s’élève, forte comme une cloche d’alarme, sur ce vieux monde qui est le mal !…
Elle tentait d’éveiller en son cœur une ambition splendide : il avait vingt ans et il aimait, c’est-à-dire qu’il écoutait, ravi, le son de cette voix jeune et vibrante.
Si elle n’était pas morte, Armand de Fougereuse eût peut-être été l’un des plus grands dans la crise qui se préparait… Mais tout à coup elle lui avait été ravie…
Armand, jeté dans la solitude comme dans un gouffre, oubliait que la courageuse paysanne lui avait légué une mission sublime.
Seulement il avait pris la cour en haine. De tout ce qu’il avait entendu, il ne subsistait eu lui qu’une sorte d’instinct qui lui rendait le peuple sympathique. Il voulut que son fils fût élevé au milieu des paysans. Simon passa ses premières années en pleine montagne, aspirant l’air à pleins poumons, heureux de sa liberté, grandissant comme l’arbre des forêts…
Mais Armand était faible. Ses amis, sa famille, qui s’étaient écartés de lui à l’époque de son mariage, cherchaient maintenant à le rappeler à eux. Il résista quelque temps, mais son âme naïve ne devait pas tenir longtemps contre les séductions dont il devint l’objet. Un jour, il consentit à se rendre à Versailles, et là, le roi, allant droit à lui, lui adressa ces paroles :
— Monsieur de Fougereuse, il n’est pas bien à vous de nous abandonner ainsi : le trône a besoin de ses plus fidèles soutiens…
Quelques jours après, il fut présenté à Mlle de Maillezais : elle était belle de cette beauté majestueuse et correcte qui éblouit plutôt qu’elle ne touche…
Mais pour lui, elle se fit douce, séduisante. On lui avait expliqué qu’il y aurait triomphe pour elle à ramener au roi ce fils de connétable qui s’était encanaillé.
Armand se laissa entraîner : en 1779, il épousa Mlle de Maillezais. Simon, fils de la paysanne, avait alors cinq ans, et courait, comme un vrai roturier, à travers les vignes et les champs de seigle, riant au soleil et se roulant dans la rosée.
Le marquis de Fougereuse allait-il rappeler son fils auprès de lui ? Quand il en parla à Mlle de Maillezais, quelque temps avant le mariage, elle répondit :
— Faites ainsi qu’il vous plaira. Mais ne pensez-vous pas qu’un changement de régime pourrait être préjudiciable à sa santé ?
Chose bizarre, le marquis éprouvait une sorte de scrupule à jeter le fils de Simonne au milieu de cette société corrompue dont si souvent l’honnête femme lui avait prouvé l’égoïsme féroce. Ce fut en quelque sorte pour obéir à la morte, qu’il laissa Simon dans ses montagnes…
Le mariage fut célébré. M. de Fougereuse reçut le cordon du Saint-Esprit et reprit à la cour le rang qui lui appartenait.
C’était au moment où la lutte soutenue par les ennemis de Necker contre le ministre novateur était parvenue à toute sa violence. Les grands et le clergé, sentant leurs privilèges menacés par l’affranchissement des serfs du domaine royal, par l’abolition du droit de suite, avaient organisé contre le banquier genevois une campagne dans laquelle il devait succomber ! Chacun dut prendre parti. La famille des Maillezais, alliée à M. de Calonne, se montra l’adversaire impitoyable de Necker, et malgré lui, M. de Fougereuse fut entraîné avec elle.
Sa femme avait pris sur lui un empire qui grandissait chaque jour. Son esprit malléable n’était que trop prêt à recevoir l’empreinte des sentiments d’autrui. Tout cet enthousiasme, toutes ces aspirations que Simonne avait dirigés vers les idées nouvelles, se réveillèrent au profit de l’ancien régime. Mme de Fougereuse, fière de cette conversion, habile à plaider sa cause, abusait de son influence pour lier le marquis à la royauté : elle avait l’éloquence brève, frappante, qui entraîne plutôt qu’elle ne persuade. M. de Fougereuse, à force d’entendre sa femme exalter les bienfaits du règne, exagérer les dangers que les moindres réformes faisaient courir à l’ordre social, se lança résolument dans le parti de la résistance à outrance, et il fut un des premiers à applaudir le mot trop oublié de Louis XVI, apposant sa signature à un édit qui grevait le pays d’une nouvelle dette de 420 millions :
— Cela est légal parce que JE LE VEUX !…
Cependant, parfois, quand il était seul, le marquis se souvenait de Simonne : il lui semblait voir apparaître, dans une vague pénombre, ce visage si beau et si intelligent, il entendait résonner cet accent ému et vibrant ; alors il songeait à son fils, à Simon, dont il était depuis si longtemps séparé…
La marquise de Fougereuse haïssait ce fils qu’elle avait à peine entrevu ; elle-même était devenue mère ; le vicomte Jean de Talizac avait été porté sur les fonts baptismaux par la reine Marie-Antoinette.
Dès lors elle mit tout en œuvre pour écarter Simon du cœur de son père. Elle ne réussissait qu’à demi : certes jamais elle n’aurait pu arracher de l’âme du marquis le souvenir du bonheur passé. Elle le savait et était trop habile pour attaquer la mémoire de la morte. Mais c’était une obsession continuelle, d’autant plus puissante qu’elle était plus hypocrite.
Le marquis en était réduit à se cacher pour écrire à son fils, pour obtenir de ses nouvelles. Parfois, il parvenait à s’échapper et courait à triples guides sur la route des Vosges ; il embrassait Simon qui avait déjà au cœur la fierté native et l’ineffable bonté de sa mère.
Puis, comme un écolier en faute, il se hâtait de regagner Versailles où il baissait les yeux sous le regard de la marquise.
Elle avait certaine façon de lui présenter le vicomte Jean qui le troublait. Elle semblait lui dire :
— Voilà votre seul enfant, le seul qui porte dans ses veines le vrai sang de la noblesse française.
Ou bien c’étaient des railleries sanglantes :
— Voyez donc ! comme le vicomte Jean a bonne façon !… Il n’a point l’air paysan !…
Le marquis fut atteint, vers 1787, d’une cruelle maladie. Sa femme fut admirable de dévouement, et un jour que le danger était assez grand pour faire redouter une catastrophe, elle se pencha vers lui et lui dit doucement :
— Voulez-vous que j’envoie chercher le fils de la paysanne ?
Il ferma les yeux et ne répondit pas.
Quand il fut rétabli, il appartenait à la marquise : le souvenir de Simonne s’était presque effacé. Il ne parlait plus de son fils aîné, il se sentait vaincu. Mme de Fougereuse avait atteint son but ; il s’était pris d’une adoration folle pour le vicomte Jean qu’il avait aperçu le premier, souriant à son chevet, au sortir de la léthargie qui avait accompagné la crise suprême…
Vint 1789. Un an après, l’émigration commençait.
La famille de Maillerais fut des premières à quitter la France. M. de Fougereuse, ami des Conti et des Polignac, céda aux instances de sa femme et rejoignit à Worms le prince de Condé qui faisait appel à l’étranger contre la France.
Quant à Simon, je ne sais quelle pudeur intime avait empêché le marquis de le mander auprès de lui…
Bien que soumis tout entier aux volontés de la marquise, M. de Fougereuse comprenait que c’était une mauvaise action que d’abandonner la patrie et d’exciter contre elle les haines de ses plus violents ennemis.
Le fils de la Simonne ne devait pas être associé à cette œuvre parricide.
Le marquis chargea en secret Pierre Labarre, qui était déjà à son service, de se rendre auprès de Simon, qui avait alors quinze ans, et de le pressentir à ce sujet. S’il voulait se rendre à l’armée de Condé, le marquis lui assurait un grade et un brillant avenir.
S’il restait en France, il ne devait plus compter sur son père. Cependant le marquis lui envoyait une forte somme d’argent qui devait le mettre pour longtemps à l’abri du besoin.
Simon refusa l’argent et répondit.
— Dites à mon père que je l’aime et que si jamais il a besoin d’un cœur dévoué et d’un bras courageux, il peut m’appeler à lui : mais puisqu’aujourd’hui il me permet de choisir entre la misère dans mon pays et la richesse à l’étranger, je choisis : je reste !…
— C’est l’âme de Simonne qui parle par ses lèvres, murmura le marquis, lorsque Pierre lui rapporta les paroles du jeune homme.
Depuis 1790, le père et le fils ne s’étaient plus revus…
Revenons maintenant à Fribourg, dans cette chambre où Pierre Labarre répondait aux questions de son maître :
— Simon est vivant !…
M. de Fougereuse pleurait et ne pouvait parler.
C’est que les temps étaient changés : vingt-cinq années avaient passé sur la tête du marquis, vingt-cinq années d’angoisses et de douleurs.
Il avait vu la France luttant de toute son héroïque énergie, contre l’Europe entière acharnée à sa ruine. Il avait entendu les cris d’enthousiasme des enfants de 1792, puis les clameurs furieuses de l’étranger, écrasé sous la botte du conquérant.
Et tandis que la patrie luttait, sanglante, mais grandissant toujours, le marquis, à Londres, à Berlin, à Vienne, rougissait de honte quand arrivaient à ses oreilles françaises les malédictions proférées par les vaincus.
Dès que le vicomte Jean, son fils, avait atteint l’âge de vingt ans, il était devenu un des plus infatigables agents de la coalition : il avait épousé une Allemande comme pour mieux prouver la haine qu’il portait à la France.
Donc, autour du marquis, ce n’étaient que menaces contre la patrie, que rires joyeux quand ses enfants tombaient sur les champs de bataille d’Espagne ou de Russie, que colères furieuses quand, par un retour soudain, le drapeau se redressait plus fier et plus audacieux.
Mais, saisi dans l’engrenage, le vieillard ne pouvait plus se dégager. Il lui fallait, malgré sa conscience, vivre au milieu de ces haines et de ces sacrilèges.
Une seule fois – en 1804 – le vicomte Jean s’était rendu en secret en France pour prêter son concours à la conspiration de Cadoudal. Mais, traqué dans Paris, il avait dû s’enfuir précipitamment. À travers mille périls, avait-il pu franchir la frontière…
Seulement, quand il revint, il resta longtemps plongé dans une sorte de prostration farouche. Était-ce donc le désespoir de n’avoir pas réussi dans l’œuvre entreprise ?… ou bien était-ce quelque remords caché qui le troublait !…
Le marquis le regardait et avait peur. Il lui semblait avoir vu passer sur ce front l’ombre sinistre que laisse le crime. Mais il n’avait pas osé l’interroger…
Les douleurs qui le torturaient avaient abattu les forces du marquis, ridé son front, blanchi ses cheveux. Plongé dans une tristesse profonde, il passait comme un spectre au milieu de ces diplomates qui rêvaient le démembrement de la France, de ces traîtres qui négociaient avec les ennemis de l’intérieur…
Et Simon ! qu’était-il devenu ?…
Un jour, il y avait longtemps de cela, le marquis avait lu dans un bulletin le nom de Simon Fougère porté à l’ordre du jour. C’était après la bataille de Hohenlinden.
Il avait compris. Le fils de la Simonne défendait la patrie… tandis que lui-même… tandis que son fils le vicomte de Talizac !…
C’était horrible, surtout parce que le marquis comprenait où étaient la probité et la justice.
Tout à coup il avait vu l’effondrement de l’idole impériale. Les armées alliées allaient se ruer sur la France ; c’était la vengeance atroce, certaine, c’étaient les représailles sanglantes…
Trois fois, M. de Fougereuse avait envoyé Pierre en France ; il voulait savoir où était Simon pour lequel son amour s’était réveillé d’autant plus grand qu’il avait été plus longtemps contenu. Mais en vain le fidèle serviteur avait fouillé les départements, il n’avait rien appris.
Mais cette fois… le marquis l’avait bien entendu… Simon vivait :
— Parle, disait-il à Pierre, parle… et ne crains pas de tuer… il y a si longtemps que pour revivre j’attends cette immense joie…
Il y avait plus de quarante ans que Pierre était au service du marquis, y étant entré dès sa première jeunesse. Il avait connu Simonne et portait à son maître une profonde affection. Pierre appartenait au peuple, et seule cette affection avait pu l’engager à suivre le marquis dans l’émigration. Peu à peu il était devenu son confident intime : il lisait à livre ouvert dans ce cœur brisé, et quand, pour la première fois, le marquis, laissant échapper le secret de ses mystérieuses douleurs, avait prononcé le nom de Simon, Pierre avait compris tout ce que son accent désolé renfermait de regrets et presque de remords.
Alors il s’était juré d’aider M. de Fougereuse à réparer l’injustice dont Simon, l’abandonné, avait été victime.
Inutile d’ajouter que Pierre avait une nature rude et franche, n’avait jamais éprouvé de sympathie pour la marquise, qui, de son côté d’ailleurs, lui témoignait une aversion non dissimulée.
Souvent même elle avait tenté d’amener le marquis à se priver de ses services ; mais toujours elle l’avait trouvé inébranlable.
Quant au vicomte de Talizac, à la vicomtesse et à son fils, ces trois personnages se défiaient de Pierre et le soumettaient autant qu’il leur était possible à un continuel espionnage.
Quel était leur but ? C’est ce que nous saurons bientôt.
— Monsieur le marquis, dit Pierre, d’après vos instructions et mes renseignements particuliers, je m’étais dirigé vers les Vosges.
« Vous aviez eu cette pensée que Simon devait avoir cherché à se rapprocher du lieu où s’était passée son enfance ; de mon côté j’avais acquis la certitude que le soldat, connu sous le nom de Simon Fougère, après avoir quitté le service, avait fait viser sa feuille de route pour la Lorraine.
« Je me mis donc en mesure de fouiller tout le pays, m’efforçant d’ailleurs, pour obéir à vos ordres, de mettre dans mes recherches toute la discrétion nécessaire. Le nom de Fougère était complètement inconnu ; quant au prénom de Simon, il était malheureusement trop commun pour que je pusse trouver là un indice utile.
« Cependant le hasard me servit… il y avait déjà plus de quinze jours que j’avais visité successivement Épinal, Nancy, Saint-Dié, ne reculant devant aucune démarche pour parvenir à mon but, et je commençais à désespérer… plusieurs fois déjà je m’étais mis en route pour regagner Francfort… mais je revenais sur mes pas, ne pouvant me résigner à abandonner la partie… j’appris alors que le quartier général des coalisés avait été transporté à Fribourg… j’étais à Lunéville, je redescendis encore une fois vers Saint-Dié, afin de passer les Vosges à Sainte-Marie-aux-Mines.
« Un soir, j’arrivai au pied de la montagne… j’avais fourni une longue traite et je succombais à la fatigue.
« J’aperçus un groupe de maisons qui ressemblait plutôt à un hameau qu’à un village… un paysan passait ; je lui demandai s’il me serait possible de trouver là un gîte pour la nuit.
« — Certainement, me répondit-il, allez droit devant vous, et, sur la Grand’place, vous trouverez l’auberge du brave Simon… »
Le marquis osait à peine respirer ; les yeux fixés sur Pierre, il écoutait, frissonnant d’angoisse.
Pierre reprit de sa voix que l’émotion altérait…
— À ce nom je tressaillis… Hélas ! je vous l’ai dit… je l’avais entendu prononcer bien souvent déjà… mais, je ne sais pourquoi, cette fois-là mon cœur battit si fort que je faillis tomber… Remerciant le paysan, je suivis le chemin qu’il m’indiquait, et au bout de quelques minutes, je parvins à ce qu’il appelait la Grand’place… Ah ! monsieur le marquis ! quel pauvre et triste pays ! Et quand je pense qu’un comte de Fougereuse…
— Ainsi c’était lui ! s’écria le marquis, ne pouvant se contenir plus longtemps.
C’était un spectacle à la fois pénible et beau que celui de ce vieillard pleurant de joie. Il s’était levé comme mû par un ressort, et saisissant les mains de Pierre, il les couvrait de baisers et de larmes…
Le serviteur pleurait, lui aussi, et ne pensait pas à se dégager de cette étreinte.
Il comprenait que les baisers du père allaient à l’enfant.
— Tu l’as vu ?… Ah ! il doit être grand et fort… il se porte bien au moins… est-ce qu’il est heureux ?… mais ce village est si pauvre !… Voyons, mais parle donc… tu ne vois donc pas que je vais mourir de joie et d’impatience…
— Il est heureux !… c’est un brave et honnête homme ! dit Pierre.
— Honnête ! brave !… Eh ! parbleu !… est-ce que le fils de la Simonne peut avoir au cœur une pensée qui ne soit pas loyale… continue… continue…
— Monsieur le marquis, reprit doucement Labarre, il vaut mieux que je vous dise tout cela… à la suite… comme je l’ai vu… sans quoi j’oublierais quelque détail…
Il avait doucement contraint le marquis à reprendre sa place.
— Oui, oui, tu as raison, dit M. de Fougereuse. Mais ne m’en veuille pas, mon bon Pierre, tu sais… on est fou à tout âge… et il y a si longtemps que j’ai oublié le bonheur…
— Ayez confiance dans l’avenir… Je continue… Donc, arrivé à un carrefour, j’avisai une petite maison haute d’un étage, toute proprette, et qui faisait contraste avec les humbles chaumières qui l’entouraient.
« Je poussai mon cheval, et m’approchant, je vis l’enseigne : Auberge de France. J’ouvris la porte et me trouvai dans une grande salle, au fond de laquelle pétillait, dans une large cheminée, un feu de sarments…
« Au bruit que j’avais fait en entrant, un jeune garçon d’une dizaine d’années était vivement venu vers moi.
« — Mon ami, lui-dis-je, est-ce bien ici l’auberge de M. Simon ?
« — Oui, monsieur, me répondit-il en fixant sur moi ses grands yeux noirs.
« Déjà, en le regardant, je me sentais saisi d’une émotion dont je n’étais point maître… il me semblait que ses traits me rappelaient un visage que j’avais connu… autrefois…
— Quoi ! s’écria le marquis. Est-ce que cet enfant ?…
— Attendez ! je répondis que je demandais un repas, si modeste qu’il fût, et un gîte pour la nuit… le garçon courut alors vers une petite porte et cria : Maman Françoise !… Au bout d’un instant, je vis apparaître une femme de taille moyenne, aux cheveux bien lissés sur le front et vêtue du costume du pays.
« Elle portait sur les bras une petite fille, blonde, aux traits gracieux, et qui riait en se pendant à son cou.
« La mère me paraissait avoir trente ans environ et la petite six ans tout au plus…
« — Asseyez-vous, monsieur, me dit la maîtresse du logis, nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire.
« Puis, se tournant vers le garçon :
« — Conduis le cheval à l’écurie et va chercher ton père.
« Je m’étais placé auprès du feu, et je prenais plaisir, je l’avoue, à réchauffer mes membres engourdis par le froid. Tout à coup à ce mot : « va chercher ton père ! » je ne pus m’empêcher de tressaillir. Si c’était Simon ! peut-être il me reconnaîtrait… et vous m’aviez bien recommandé de ne pas me trahir… mais je réfléchis aussitôt que Simon, – à supposer que je dusse me trouver en face du comte de Fougereuse, – ne m’avait pas vu depuis plus de trente ans… et je me fiai aux changements que le temps devait avoir apportés à ma physionomie…
« Mme Françoise – puisque tel était son nom – après m’avoir invité à me débarrasser de ma lourde houppelande, se mettait en devoir de m’installer à l’un des bouts de la longue table qui garnissait la salle.
« La petite fille, qu’elle appelait Francinette, courait après elle avec de petits rires d’oiseau, toute fière quand on lui avait confié une assiette de faïence ou un verre, qu’elle venait poser gravement sur la table, levant ses petits bras dont le coude était creusé d’une fossette…
« — Ce pays me semble bien triste, madame, hasardai-je pour entamer la conversation.
« Françoise me regarda avec surprise :
« — On voit bien que monsieur n’est que de passage, dit-elle en souriant. Non, non, le pays est bon, pourvu que l’on ait du travail et que l’été soit favorable, on y est heureux tout aussi bien que dans les grandes villes, ajouta-t-elle en embrassant Francinette.
« — Je vois, repris-je alors, que l’apparence m’a trompé… je me suis laissé impressionner par le froid et l’obscurité de l’hiver.
« — Oh ! si vous voyiez dans nos montagnes comme la neige est brillante !… on dirait une féerie !…
« — Il y a longtemps que vous vivez ici ?…
« — Depuis dix ans…
« — Ces beaux enfants sont les vôtres ?…
« Je crus distinguer en elle un certain embarras. Cependant, je m’étais évidemment trompé, car elle répondit aussitôt :
« — Certainement, et vous allez voir leur père, l’homme le plus honnête et le meilleur de tout le pays…
« Elle plaça sur la table une assiette de soupe fumante dont l’aspect me réjouit, et me dit :
« — Voilà, monsieur. Excusez la simplicité du service… mais l’auberge de France fait ce qu’elle peut…
« À ce moment la porte s’ouvrit…
« — Ah ! monsieur le marquis, j’aurais été au fin fond des déserts de l’Afrique, à mille lieues de la France, je ne sais où… que je l’aurais reconnu… oui, c’était bien le fils de Simonne… il avait ses grands regards si doux et si profonds… seulement… »
Pierre s’était brusquement arrêté.
— Que veux-tu dire ? s’écria le marquis. Pourquoi ce silence ? tu m’effrayes !…
— Oh ! monsieur le marquis, j’ai tort d’hésiter… car, en somme, le mal, pour avoir été grand, n’a pas eu les conséquences qu’on pouvait redouter… M. Simon a perdu une jambe… j’ai vu cela tout de suite… et vrai, j’ai senti les larmes me monter aux yeux…
— Mais comment ce malheur lui est-il arrivé ? est-ce un accident ?…
— Non ! non ! c’est une noble blessure et qui lui fait honneur… M. Simon a eu la jambe emportée par un boulet à Elchingen, en 1805.
Le marquis eut un tressaillement nerveux et murmura :
— Son frère, le vicomte, n’était pas né à cette époque ! Continue, Pierre.
— Je vous disais donc que je l’ai reconnu au premier regard… Il est grand, il est fort, il a des cheveux grisonnants… de grosses moustaches, mais il ne porte pas de barbiche… Le bas du visage est un peu fort ; il était vêtu du costume de paysan vosgien… Il vint droit à moi, sans trop boiter, ma foi, et me dit de sa voix qui rappelait à s’y méprendre celle de sa mère :
« — Soyez le bienvenu !
« Je ne pus m’empêcher de lui tendre la main ; il n’en parut pas surpris et me rendit cordialement ma politesse. Je l’observais avec soin, pour voir s’il me reconnaissait. Mais je fus vite rassuré. Évidemment, mes traits ne lui rappelaient aucun souvenir.
« Pour dissimuler mon trouble, je m’assis à la table et attaquai la soupe qui était bouillante. Tout en soufflant sur ma cuiller, je regardais hypocritement, et je ne perdis pas un seul de leurs mouvements.
« Simon avait pris la petite Francinette, et, l’asseyant sur sa jambe valide, il lui parlait doucement, à voix basse, et l’enfant l’écoutait sérieusement.
« Je ne pouvais entendre ce qu’il lui disait, mais tout à coup, elle s’élança à terre et courant à moi :
« — Monsieur, me dit-elle, voulez-vous me faire bien plaisir ?
« — Certainement, ma chère petite, m’empressai-je de répondre.
« — Je voudrais que vous boiviez avec papa à la santé des armées françaises…
« Je l’embrassai sur les deux joues, et me hâtai de consentir. Je me demandais tout d’abord, et je suis convaincu que j’étais dans le vrai… si le brave Simon ne me prenait pas pour un espion et ne m’observait pas avec le même soin que je mettais à l’examiner. Cette pensée me fit mal.
— Ah ! monsieur le marquis, comme j’avais bonne envie de parler… de lui crier :
« Je suis un ami, je viens au nom de votre père qui vous aime, qui ne vous a pas oublié… Mais je refoulai en moi les sentiments qui m’étouffaient.
« Simon vint prendre place à ma table, il remplit deux verres et m’en tendit un en me disant de sa voix sonore :
« — Au succès de nos armes, n’est-ce pas monsieur ?
« Je répondis en portant le verre à mes lèvres et je répondis :
« — À la France !…
« Un rayon de joie parut dans ses yeux. La franchise de mon accent avait triomphé de ses défiances.
« — Serait-il indiscret de vous demander, monsieur, commença-t-il, par quel étrange hasard vous vous trouvez dans notre pauvre pays ?…
« Je crus devoir mentir. Il le fallait bien. Je lui racontai que m’étant trompé de route à la sortie de Saint-Dié, je m’étais éloigné du but de mon voyage, qui était Langres.
« Il fixa sur moi son regard intelligent, qui semblait lire jusqu’au fond de ma conscience, et il reprit :
« — Vous venez d’Allemagne, n’est-il pas vrai ?
« — Êtes-vous sorcier, m’écriai-je, à quoi le devinez-vous donc ?
« — Rien de plus simple… à l’étoffe et à la coupe de vos vêtements… Les modes marchent, mon cher hôte, et vous trahissent à votre insu…
« — Je n’ai, d’ailleurs aucune raison de me cacher. Voici tantôt deux ans que je ne suis revenu en France, étant employé d’un des fournisseurs de l’armée… ce qui vous explique comment je m’habille où et comme je puis…
« Sans s’arrêter à cette explication qui peut-être lui paraissait suffisante :
« — Est-il vrai, me demanda-t-il, que les armées alliées se disposent à franchir la frontière.
« — Hélas ! je le crains !… Vous n’ignorez pas nos derniers désastres ?
« — Non, non !… la fortune nous a trahis !… elle s’est lassée de nous obéir… mais patience ! patience !
« Je ne pus réprimer un mouvement de surprise :
« Croyez-vous donc que la résistance soit encore possible ?
« — Je suis soldat de la France, répondit-il d’un ton ferme. J’ai foi dans le drapeau et la patrie.
— Bien répondu ! s’écria le marquis. Ah ! Simonne ! Simonne ! si de là-haut tu nous vois tous deux, que le père doit te paraître méprisable… mais que tu dois aimer le fils !
— Alors, reprit Pierre, il m’interrogea longuement sur les forces des coalisés, sur leurs projets. Il m’adressa même une question qui me fit froid au cœur :
« — Est-il vrai, me demanda-t-il que des émigrés français aient accepté des grades dans les armées ennemies ?
« Je répondis évasivement, arguant de mon ignorance. Il passa sa main sur son front comme pour chasser une idée importune, et je me hâtai de détourner l’entretien :
« — Ces deux charmants enfants sont à vous, demandai-je ?
« — Vous me rappelez, dit-il en riant, que j’ai commis une faute d’étiquette en ne procédant pas aux présentations d’usage. Françoise Simon, ma femme, fit-il en désignant sa compagne qui semblait heureuse de lui voir aux lèvres ce sourire, une excellente créature qui m’a consolé de bien des douleurs…
« — Des douleurs ! m’écriai-je. Avez-vous donc été malheureux ?
« Il ne parut pas m’entendre et continua :
« — Jacques, mon aîné. Çà, monsieur Jacques, levez la tête et regardez notre hôte. Qu’en dites-vous, monsieur ? n’est-ce pas là le visage d’un brave gars… Vous connaissez Francinette ? Elle s’est présentée toute seule. Maintenant, monsieur, à votre tour, me direz-vous qui j’ai eu l’honneur de recevoir dans ma pauvre auberge ?
« — Un instant, repris-je, voici Mme Françoise, M. Jacques et Mlle Francinette, mais vous vous êtes oublié, ce me semble. »
« Une ombre rapide passa sur son front.
« — Moi, je m’appelle Simon, dit-il.
« — Simon… tout court ?
« — Simon, rien de plus… Si j’ai porté un autre nom, je ne m’en souviens plus… je me suis engagé en 1791, j’ai fait mon devoir comme j’ai pu… j’ai été blessé et j’ai dû quitter le service… je me suis marié et j’ai deux enfants… Voilà mon état civil… Ne trouvez-vous pas qu’il en vaille un autre ?…
« Il parlait nerveusement. J’avais touché la corde sensible.
« — Mais vos parents ? demandai-je encore.
« Il plongea ses regards dans les miens, se versa un verre de vin, puis me tendant son verre d’une main ferme :
« — Je ne les ai jamais connus, me dit-il.
« Je devais m’exécuter à mon tour et répondre à la question qui m’avait été adressée. Je donnai un nom d’emprunt.
« Nous causâmes longtemps encore, et j’appris divers détails qui m’intéressèrent vivement. C’était dans les premiers mois de 1806 que, définitivement guéri de son horrible blessure, M. Simon était revenu en France et qu’il avait rencontré Françoise. Ils étaient pauvres tous deux, mais courageux et honnêtes. Simon s’était mis au service de riches fermiers, et bientôt, grâce… à son zèle et à son économie, avait pu prendre à bail une petite métairie. Ses efforts avaient été couronnés de succès. Il avait acheté une petite maison à Léigoutte – c’était le village où nous nous trouvions – et il vivait heureux, cumulant les fonctions d’aubergiste avec celles de maître d’école.
« — J’ai reçu une bonne éducation, me disait-il, et ce me fut une grande joie quand je pus rendre aux enfants d’autrui le service qui m’avait été rendu autrefois… Si vous saviez comme mes petits Vosgiens ont l’esprit vif… C’est plaisir que d’être leur maître… J’essaie d’ouvrir à la fois leur cœur et leur intelligence, et j’y parviens facilement… Vous verrez que, dans vingt ans, le pauvre village de Léigoutte comptera sur la carte de France.
« L’heure avait passé si rapidement que je ne m’apercevais plus de ma fatigue. Déjà Mme Françoise et ses enfants s’étaient retirés depuis longtemps, quand M. Simon, laissant échapper une exclamation de surprise, m’avertit que minuit venait de sonner.
« — Quand avez-vous l’intention de vous remettre en route ? me demanda-t-il.
« Je répondis que je désirais repartir le plus tôt possible, aussitôt du moins que mon cheval aurait pris le repos qui lui était indispensable. M. Simon me conduisit à ma chambre. Oh ! j’aurais voulu le garder auprès de moi… mais sous quel prétexte ?… je dus me priver de cette joie. Il me souhaita la bonne nuit et se retira.
« Vous devinez bien que je ne dormis pas jusqu’au jour. Je ne songeais qu’à revoir Simon et à partir immédiatement pour vous rejoindre. Dès que j’entendis un peu de mouvement, je sortis de ma chambre. M. Simon était déjà dehors ; il était allé, me dit sa femme, aider les paysans à charger du bois dans la montagne… Je me résignai à partir… comme j’embrassai les deux enfants !… je ne pouvais me détacher d’eux… mais mon devoir me rappelait auprès de vous… Et puis j’avais formé un projet… qui, je crois, sera approuvé par vous… je quittai Léigoutte de bonne heure, et après avoir feint de me diriger vers l’ouest, je tournai autour de la montagne et me hâtai vers Wisembach, petite ville dont dépend le hameau de Léigoutte. Là, je me rendis chez le maire, et sous un prétexte plausible, j’obtins copie des actes de l’état civil relatifs à M. Simon… Vous savez que depuis le nouveau code, ces documents sont à la disposition de tous les intéressés… je parlai d’affaire contentieuse, d’héritage à recueillir… il ne me fut fait aucune objection.
— Et tu possèdes ces papiers ? s’écria le marquis.
— Là, sur ma poitrine, dans un portefeuille…
Pierre porta la main à son gilet, puis poussa un léger cri de douleur…
— Tiens, je n’y songeais plus, dit-il, j’ai bien failli ne pas vous le remettre…
— Que veux-tu dire ?
Pierre raconta alors au marquis l’incident du Schwartzwald…
— C’est étrange, dit le marquis, il n’est pas un paysan de cette région qui soit capable d’un tel crime…
— Peut-être était-ce quelque maraudeur… En tout cas, il porte la trace du coup de pistolet que je lui ai tiré presque à bout portant, j’en suis sur…
À ce moment on entendit dans la boiserie comme une sorte de craquement.
Les deux hommes tressaillirent. D’un mouvement rapide, le marquis se leva, courut à la porte et se pencha au dehors. Le palier et l’escalier étaient déserts.
— C’est singulier, dit-il en revenant auprès de Pierre, j’avais cru entendre…
— Ces boiseries vermoulues sont travaillées par l’humidité, fit Pierre.
Le marquis jeta autour de lui un regard défiant, et pendant quelques minutes, les deux hommes restèrent silencieux.
Puis M. de Fougereuse reprit à voix basse :
— Donne-moi ces papiers.
Pierre obéit et le marquis les dépliant lut avec attention. Le premier était un acte de mariage, à la date du 6 janvier 1806. Il portait les indications suivantes :
« Simon Fougère, dit Simon, ancien sergent au 75e régiment de ligne, réformé pour cause de blessures graves ; se disant né le 28 mai 1774, ne produisant aucun papier autre que ses états de service ainsi conçus :
« Fusilier au 14e bataillon de fédérés, le 4 août 1792.
« Tirailleur au 27e de ligne, blessé à la bataille de Mouscron, le 17 floréal an II.
« Caporal au 37e de ligne, reçoit un sabre d’honneur en Italie.
« Porté à l’ordre du jour après la bataille de Hohenlinden.
« Sergent au 75e en 1805, blessé à la jambe à la bataille d’Elchingen. Amputé.
« Marié, le 6 janvier 1806, à Françoise-Catherine Lemaire, née à Guebwiller, le 30 octobre 1798. »
Le second de ces papiers était un acte de naissance :
« Françoise, née le 10 juin 1807, de Simon Fougère, dit Simon, et de Françoise-Catherine Lemaire, son épouse. »
Le marquis s’était abîmé dans ses réflexions, puis il reprit :
— Mais ne m’as-tu pas dit avoir vu deux enfants à l’auberge de France… Où est l’acte de naissance de Jacques ?
Pierre hésita un instant puis reprit :
— Monsieur le marquis, cet acte n’existe pas à la mairie de Wisembach… j’ai interrogé le maire à ce sujet et il m’a répondu…
— Eh bien !
— Que lorsque Simon et Françoise se sont mariés, Jacques était déjà né.
— Ah ! fit le marquis. Quoi qu’il en soit, tu le vois Pierre, Simon croit que je l’ai à jamais abandonné. Il cache non seulement son nom, mais encore le lieu de sa naissance… je réparerai tout cela, dès demain, mon bon Pierre… Je te remettrai mon testament.
— Votre testament !… mais à quoi bon ?… N’êtes-vous pas certain maintenant de revoir votre fils, et ne pensez-vous pas reconnaître vous-même ses droits ?
— J’agis ainsi par prudence, mon ami. J’ai horriblement vieilli, et j’ai maintenant bien peu de forces… Ces émotions qui me ravivent aujourd’hui peuvent m’être fatales… et pourtant… je voudrais bien ne pas mourir avant d’avoir embrassé mon Simon bien-aimé… Mais je suis dans la main de Dieu… Donc, par mon testament, je raconterai le passé de Simon… Grâce à ces actes, il sera facile d’établir sa filiation, de telle sorte que toute dénégation soit impossible…
— Mais que craignez-vous donc ?… s’écria Pierre.
Le marquis leva les yeux sur son serviteur.
— Pourquoi cette question ? fit-il. Ne sais-tu pas aussi bien que moi…
— Quoi ! vous croyez que M. le vicomte aurait l’audace !…
M. de Fougereuse posa son doigt sur la poitrine de Pierre :
— Il n’y a pas de paysan, dit-il lentement, qui soit capable d’un tel crime…
Pierre baissa la tête et ne répondit pas. Ils s’étaient compris.
— Ce n’est pas tout, reprit le marquis. Écoute-moi bien et surtout ne perds pas un mot de ce que je vais te dire… Un testament peut être volé, arraché par le meurtre… que sais-je ?… je veux tout prévoir… et je veux… que Simon et ses enfants soient riches… alors même que l’on me tuerait…
Et il se mit à lui parler si bas, que nulle autre oreille que celle de Pierre ne pouvait percevoir le son de sa voix.
|3| PENSÉES FRATERNELLES
Au moment où la marquise de Fougereuse était sortie, suivie de la vicomtesse de Talizac et de son fils, un domestique, attaché au service particulier de M. de Talizac, s’était respectueusement approché :
— Ah ! Cyprien ! dit la vicomtesse en faisant un pas vers lui. Qu’y a-t-il ?
— Madame la vicomtesse, répondit Cyprien à voix basse, M. le vicomte vous prie de vouloir bien vous rendre auprès de lui.
— Ah ! il est de retour !
— M. le vicomte attend madame dans sa chambre.
— Vous permettez, ma mère, demanda la vicomtesse à Mme de Fougereuse.
— Allez, ma fille. Mais, je vous prie, laissez Frédéric auprès de moi… Il ne me plaît pas de rester seule dans ces appartements, sombres comme un cloître…
Mme de Talizac poussa doucement son fils vers la marquise puis, précédée du laquais qui l’éclairait, elle se dirigea vers l’appartement de son mari.
Cyprien – sorte de Scapin hypocrite à figure basse – s’effaça devant elle en souriant ironiquement.
La vicomtesse de Talizac était d’origine autrichienne, la famille des Karlstein remontait à la plus ancienne noblesse.
De haute taille, les cheveux d’un blond mat, Magdalena de Karlstein cachait sous l’apparence d’une indifférence presque languissante une ambition singulière. Ses grands yeux, aux cils clairs, étaient d’ordinaire sans expression, mais, quand un sentiment profond l’agitait, les prunelles d’un bleu gris s’éclairaient d’une incroyable énergie.
Ce qu’elle voulait, ce qu’elle avait demandé à l’union qui l’avait liée au vicomte de Talizac, c’était un rang élevé à la cour de France, c’était l’immense fortune des Fougereuse qui devait lui assurer un luxe princier. Sentiment rare chez une femme, la vicomtesse de Talizac était à la fois orgueilleuse et avare : son caractère dur et froid s’irritait de tout obstacle qui s’élevait entre ses désirs et ses secrètes aspirations.
Par une étrange bizarrerie de la nature, son fils unique était venu au monde difforme, sans vigueur, et longtemps on avait cru qu’il succomberait à ses vices d’organisation.
Mais à mesure qu’il grandissait, la vicomtesse se sentait prise d’une sorte d’amour furieux pour cette créature à laquelle la nature avait refusé les dons physiques et moraux.
Elle s’était plu à développer en lui l’égoïsme profond, l’insensibilité railleuse.
Elle rêvait pour cet enfant, arrivé à l’âge d’homme, une domination basée sur la crainte, peu lui importait qu’il ne fût pas aimé, si du moins tout pliait devant sa volonté : et pour parvenir à son but, elle voulait que ce fils fût riche, que, réunissant sur sa tête la fortune des Fougereuse et des Karlstein, il pût se placer au-dessus de tous les scrupules humains et dominer les consciences.
Fils d’un émigré dont toute la jeunesse avait été employée à combattre son pays ou à conspirer contre lui, le jeune vicomte Frédéric avait appris dès le berceau à haïr la France. Et sa mère, fidèle à son origine, avait développé ce sentiment contre nature. C’est qu’aussi elle éprouvait, à chaque victoire des Français, des sentiments de colère qui débordaient de son âme ulcérée. Et quand enfin elle avait vu la fortune nous trahir, quand elle avait vu chanceler cette puissance qu’elle croyait invincible, elle avait été saisie d’une joie haineuse. Enfin le jour approchait où les émigrés et les vaincus pourraient faire payer cher à la France leurs angoisses et leurs folles terreurs.
C’était comme un éblouissement : ces démons de la patrie, dont les haines avaient grandi pendant ces vingt années, se voyaient déjà aux Tuileries, à Versailles, mâtant ces révolutionnaires dont les revendications les avaient si fort épouvantés, mettant de nouveau le pays en coupes réglées. Ils ne savaient pas encore combien profond était le travail qui s’était opéré dans les mœurs et les idées sociales. Pour eux, tout ce qui avait été fait depuis 1789 n’existait pas : divisions administratives, hiérarchie, ils entendaient tout remanier, tout replacer comme au bon temps d’autrefois. C’était la descente de la féodalité inondant à nouveau la France tout entière de ses prétentions exorbitantes et de ses tyrannies cruelles.