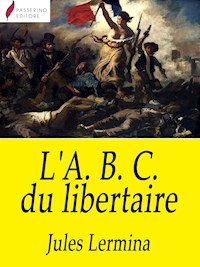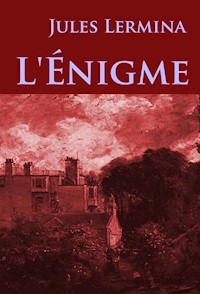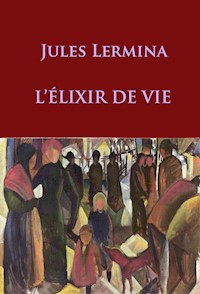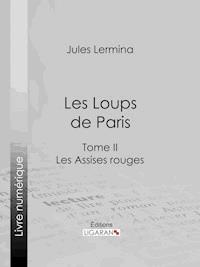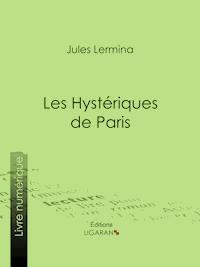
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "– Qui dois-je annoncer ? demanda le valet de pied à un jeune homme qui se présentait, vers onze heures du soir, à l'hôtel de Barnes. Le jeune homme eut une hésitation. – Ne me connaissez-vous pas ? murmura-t-il. – Que monsieur me pardonne, mais je suis ici depuis plus de six mois, et je crois que monsieur ne s'est pas encore présenté à l'hôtel. Certes, la raison donnée par le laquais était plausible. Mais il en était une autre plus difficile à expliquer."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
– Qui dois-je annoncer ? demanda le valet de pied à un jeune homme qui se présentait, vers onze heures du soir, à l’hôtel de Barnes.
Le jeune homme eut une hésitation.
– Ne me connaissez-vous pas ? murmura-t-il.
– Que monsieur me pardonne, mais je suis ici depuis plus de six mois, et je crois que monsieur ne s’est pas encore présenté à l’hôtel.
Certes, la raison donnée par le laquais était plausible.
Mais il en était une autre plus difficile à expliquer.
En ce moment, les salons de la belle comtesse de Barnes, l’idole du monde parisien, regorgeaient d’invités. On entendait à travers les tentures les accords vibrants d’une valse de Strauss, et on eût dit qu’à travers les murailles filtrât hue atmosphère surchauffée de plaisir et de luxe.
Or, pour l’œil exercé d’un laquais de Paris, la tenue du nouvel arrivant était loin de paraître irréprochable.
D’abord, par dix degrés de froid, on était en plein décembre, il n’était couvert que d’un paletot à peine suffisant pour un doux automne ; de plus, l’habit étriqué avait aux coutures des reflets brillants qui témoignaient d’un long usage ; linge lui-même, quoique blanc, n’avait point ce glacis délicat, chef-d’œuvre de nos artistes en blanchissage.
Pour tout dire, les bottines étaient des plus fatiguées.
– Annoncez le baron de Sandras, articula le jeune homme avec impatience.
Le nom sonnait bien. Le laquais s’inclina légèrement.
Un instant après, celui qui avait dit s’appeler baron de Sandras pénétrait dans les salons. Son nom s’était perdu dans le bruit général et son entrée avait passé inaperçue.
C’est en vérité un aspect féerique que celui d’une fête organisée par une femme, surtout quand cette femme, douée de ce goût exquis des vraies Parisiennes, peut jeter les millions au creuset de sa fantaisie.
Tandis qu’au dehors le vent sifflait, âpre et dur, tandis que la neige glacée écrasait la ville comme un linceul, tandis qu’aux coins des pertes ou dans les masures crevassées, des milliers d’êtres grelottaient et sentaient le sang se figer dans leurs veines…
Là, dans cet hôtel bien clos, défendu contre la nature par de triples murailles, tout n’était que fleurs, que diamants, que joies et beautés. Des femmes, adorablement parées, passaient souriantes, nerveusement cambrées aux bras des cavaliers qui les entraînaient dans la valse. Aux cheveux, aux corsages, des diamants, tandis que sur l’habit noir des hommes, des plaques étincelantes ou des brochettes à décorations multiples faisaient concurrence aux coquetteries féminines.
Hector de Sandras, isolé un milieu de cette foule, regardait, pâle.
Il pouvait avoir trente ans à peine : mais ses traits amaigris portaient la trace de fatigues ou de douleurs sans nombre. À les détailler, ils étaient beaux. À les considérer d’ensemble, ils imposaient à l’observateur je ne sais quelle expression de malaise.
Les yeux, cerclés de noir, avaient des étincellements bizarres, et dans les plis de la bouche crispée se cachait une sorte de douleur haineuse.
L’orchestre se tut, les groupes se mêlèrent.
C’était l’accalmie d’un moment.
Les laquais circulaient, portant sur leurs mains tendues, les plateaux surchargés de glaces et de friandises.
Quand l’un d’eux s’arrêta devant Hector, il étendit machinalement la main. Mais, obéissant à une réflexion subite, il la ramena vers lui, vide.
– Et pourtant, murmura-t-il si bas que nul ne pouvait l’entendre, je crève de faim et de besoin !
Mais résistant à cette défaillance passagère, il avait relevé la tête, avec un mouvement de défi violent, et, hardi, sans se soucier des regards étonnés qu’attirait sur lui sa tenue peu correcte, coudoyant les plus élégants avec une insouciance de grand seigneur, il se mit à parcourir les salons.
Tout à coup, il tressaillit.
Il se trouvait alors à l’entrée d’une sorte de boudoir, tendu de soie bleue, à broderies d’argent.
Là, sous le reflet doux de lampes garnies de globes opaques, un groupe, nos pères du XVIIIe siècle auraient dit : un bouquet de femmes, était délicieusement, artistement, éparpillé sur les sofas bas et moelleux. Une seule était debout.
Elle était blonde, et ses cheveux formaient à son front haut et blanc une couronne d’or. Les yeux noirs, grands, fiers, rappelaient ceux des charmeuses dont les tigres viennent lécher les mains. Cette femme eût admirablement porté un manteau de reine. Épaules superbement modelées, poitrine audacieusement belle, nez de Grecque, bouche d’Espagnole, aux lèvres rouges et charnues, tout en elle respirait l’orgueilleuse vitalité des dominatrices.
Elle parlait, disant les riens de Paris, la pièce d’hier, l’attraction de demain, d’une voix chaude et un peu basse qui avait un charme inexprimable.
C’était la comtesse Léonide de Barnes. Et ce nom de Léonide lui convenait à merveille. Il y avait de la lionne en cette femme.
Hector, immobile, à demi caché sous une tenture, avait fixé sur elle son œil noir, où passaient des lueurs cruelles.
Sa main, cachée sous son habit, avait des frissons singuliers.
Et sous ce regard, qui semblait doué d’une puissance attractive, la comtesse Léonide tourna lentement la tête dans la direction du baron. Mais celui-ci, par un mouvement rapide, s’était rejeté en arrière et si brusquement qu’une voix s’écria :
– Sapristi !… en plein sur un cor !
Le baron allait s’excuser, estimant qu’en somme il n’avait pas le droit d’écraser le pied d’un indifférent, quand, ayant jeté les yeux sur celui qui avait proféré cette exclamation, il tressaillit vivement, murmurant :
– Vous ! vous ici !…
– Mais oui, mon petit ! répliqua l’autre. Vous y êtes bien !… et, ajouta-t-il d’un air goguenard, vous avez bien fait de venir… car j’ai à causer avec vous…
Hector, tout à l’heure si audacieux, semblait tout à coup dompté par une puissance plus forte que sa volonté.
Et pourtant l’homme qui lui adressait ces paroles si simples ne présentait pas un aspect bien terrible.
Il était petit, gros, avait le visage couturé par la petite vérole.
L’ensemble était rond, bon enfant. Les lèvres, un peu minces, riaient d’un gros rire.
Quant à la mise, c’était celle de tout le monde : habit du bon faiseur, pantalon habilement coupé, chemise irréprochable, à l’exception des boutons de diamants qui se portent peu, claque à doublure de satin blanc, avec chiffre ; enfin, pour compléter la livrée du monde, de petites croix sautillaient sur la forte poitrine du bonhomme.
Un dernier détail ; il était absolument chauve, à l’exception d’une mince couronne de cheveux gris.
Hector avait encore pâli, et se penchant à l’oreille de son interlocuteur :
– Mais, murmura-t-il, vous vous êtes donc évadé du bagne ?…
– Chut ! fit l’autre en souriant. Nos affaires ne regardent personne. À propos, ajouta-t-il en touchant la poitrine d’Hector à l’endroit que sa main froissait tout à l’heure, si vous ne voulez pas aller là d’où je viens, vous ferez bien de pas jouer de ce joujou-là…
Hector se recula avec un geste de colère :
– Ne vous mêlez point de mes affaires, fit-il, ou bien…
– Ou bien ? demanda l’autre avec son sourire le plus gracieux
– Je pourrais bien me mêler des vôtres…
L’inconnu, qui, paraît-il, était connu en certain lieu peu recommandable, ricana plus fort, et comme à ce moment passait auprès de lui un personnage officiel, très connu à Paris :
– Cher ami, fit-il en l’appelant d’un geste.
Le personnage en question se hâta d’obéir à ce signe amical :
– Cher ami, répéta-t-il, rendez-moi donc le service de me présenter à M. Hector, baron de Sandras.
– Avez-vous donc besoin de ma caution, reprit l’interpellé en souriant. Enfin, à votre service. Monsieur le baron, ajouta-t-il en se tournant vers Hector, je vous recommande tout particulièrement mon ami le chevalier Vergana…
– Le chevalier Vergana, s’écria Hector confondu, le grand chimiste italien ?…
– Lui-même, accentua l’Excellence. Pourquoi donc, cher chevalier, ne vous nommez-vous pas vous-même ?…
Ce que répondit Vergana, comment après avoir serré la main d’Hector, il se perdit dans la foule au bras de l’homme politique, le baron n’eût pu le dire tant il était abasourdi, pour ne pas dire foudroyé !
Nous saurons plus tard dans quelles circonstances il s’était trouvé avec celui qui s’appelait le chevalier Vergana. Mais, à moins d’être fou, il ne pouvait oublier qu’il avait vu condamner aux travaux forcés, pour assassinat et vol, ce même individu qu’aujourd’hui on lui déclarait être une des lumières de la science.
C’était à y perdre la raison.
Et la chose était d’autant plus facile que le baron, exténué de fatigue et, disons le mot, de faim, surexcité par les colères sourdes qui bouillonnaient en lui, sentait la fièvre marteler son cerveau.
Pendant le court colloque qu’il avait engagé avec l’inconnu ou plutôt avec le chevalier Vergana, les dames avaient quitté le boudoir.
La comtesse Léonide était passée devant lui, sans le voir.
L’heure marchait. Peu à peu les salons se vidaient.
– À tout prix, se dit Hector, il faut que je lui parle…
C’était à la comtesse qu’il songeait.
Tout à coup une pensée surgît dans son cerveau. Elle n’exigeait que de l’audace, et il n’en manquait point.
Il se mit à rôder lentement à travers les appartements, et un moment vint où on ne le vit plus.
Pourtant, il n’était pas sorti de l’hôtel.
Avant que les portes des salons se ferment sur les derniers invités, il est toujours, à la fin de toute fête, un moment où les intimes se trouvent enfin presque seuls, et il n’est pas rare que s’établisse entre ces persévérants quelque causerie familière.
On est heureux d’avoir échappé au bruit, et c’est avec une sorte de soulagement qu’on se délasse en échangeant quelques mots que ne couvre plus l’éternel ronronnement de l’orchestre.
Ainsi en était-il chez la comtesse de Barnes.
Il était plus de trois heures du matin, et Léonide, aussi fraîche, aussi vive qu’au début de sa fête, avait retenu quelques amis et amies de choix qui, avalant un dernier verre de punch ou grignotant des fondants, lui donnaient gracieusement la réplique.
Il est vrai de dire qu’en ceci la comtesse Léonide avait eu un allié précieux, que nous devons présenter au lecteur.
C’était le prince Bellina, vingt fois millionnaire, grand seigneur dont les ancêtres avaient régné dans une principauté orientale, et qui lui-même était un des rois du Paris luxueux.
Et le prince adorait la comtesse Léonide, non point par un de ces caprices dont une femme n’est que le jouet, mais d’une de ces passions profondes, irrésistibles, qui dominent toute une existence.
Pourquoi ne lui offrait-il pas sa main ?
Pourquoi ?…
– Ainsi, chère Léonide, disait une des amies retenues, la petite marquise de Sylvère, vous ignorez absolument où est votre mari ?…
– Depuis plus de deux ans je suis sans aucunes nouvelles…
– Et d’où était datée la dernière lettre de ce pauvre comte ?
– De Khiva… Au fin fond du Caucase…
– Il faut avouer que cette passion de voyages est quelque peu impertinente pour vous, ma chère. Voyons ! Après combien de temps de mariage M. le comte a-t-il été repris de sa folie de Juif-Errant ?
– Mais… trois ans à peine, répondit Léonide en souriant.
– Et voici cinq ans qu’il est sorti de cette maison !… Les hommes sont des monstres ! Comment, voici que M. le comte, qui avait bien quelques quarante ans sonnés, a le bonheur inespéré…
– Oh ! marquise !
– Oui, inespéré, – je le répète, – de mettre la main sur un vrai trésor… une charmante femme de dix-sept ans… intelligente, riche…
– Marquise, vous allez me faire rougir…
– Laissez parler, dit le prince en sonnant (il avait un léger accent étranger), vous êtes de celles qu’on ne peut flatter…
Un regard caressant le remercia de cette gracieuseté.
– Je conclus, acheva la marquise, un homme qui quitte un pareil trésor pour aller courir le monde – et quel monde !… des Kirghis, des Guèbres, un tas de démons, cet homme-là…
– Eh bien !
– On ne lui pardonne que quand il a eu l’esprit délaisser une veuve…
– Chut ! fit Léonide en tapant doucement de son éventail la petite main de son amie, il pourrait vous entendre… et prendre la fantaisie de nous prouver qu’il est bien vivant !…
À ce moment (ce serait une erreur que de croire qu’il n’est de coups de théâtre que dans les romans), la femme de chambre de la comtesse qui, certes, ne se serait pas permis sans un cas très grave de pénétrer dans les salons, parut à la porte de la pièce où se tenaient les causeurs, et si agitée, si rouge, si haletante, que la comtesse s’écria :
– Francine !… mais que se passe-t-il donc ?
– Oh ! madame ! Si vous saviez !
– Parlez, fit le prince se levant vivement comme s’il eût cru à quelque danger menaçant…
– Madame la comtesse, dans votre appartement… à l’instant…
– Achevez donc ! Vous me faites mourir d’impatience…
– M. le comte !…
Un cri général l’interrompit. La comtesse Léonide était devenue soudain d’une pâleur mortelle.
Le prince Bellina d’un geste brusque avait desserré sa cravate qui le suffoquait.
– M. le comte, reprit la camériste, vient d’arriver à l’hôtel. Il s’est rendu aussitôt dans l’appartement de madame la comtesse, et il m’a ordonné – bien durement, je dois le dire – de prévenir madame qu’il l’attendait immédiatement…
Il y eut un instant de silence.
Était-ce donc seulement la surprise qui convulsait ainsi les traits de la comtesse Léonide ? En tout cas, il ne semblait pas que ce fût le bonheur d’une réunion attendue depuis si longtemps.
Le prince, qui tenait ses yeux ardemment fixés sur celle qu’il aimait plus que sa vie, avait le masque des désespérés.
La comtesse avait fermé à demi les yeux, comme pour se reconquérir elle-même. Puis s’adressant à sa camériste :
– Dites à M. le comte que je le rejoins dans quelques instants.
C’était pour les intimes un signal de départ.
Certes, on eût bien voulu papoter encore un peu, ne fût-ce que pour déchirer de la belle façon ce mari qui se permettait d’apparaître si intempestivement.
Mais à tout ce monde frivole, le nom seul du comte de Barnes imposait une sorte de respect, surtout depuis qu’on le savait aussi près. À peine chercha-t-on quelques mets ; moins de félicitation que d’encouragement.
Seul, le prince resta en arrière, et s’arrêtant devant la comtesse :
– Léonide, lui dit-il d’une veux frissonnante, vous savez que je vous aime à en mourir.
D’un mouvement spontané, et par cela même charmant, elle pencha son front vers lui :
– Prenez, lui dit-elle, prenez ce baiser, si longtemps demandé, si longtemps refusé, et ayez confiance !
Le prince Bellina était amoureux.
Ceux-là seuls qui ne l’ont jamais été, s’étonneraient qu’il fût sorti de l’hôtel la joie dans le cœur…
Restée seule, au milieu des salons, tout à l’heure encombrés, la comtesse se tint un instant immobile.
Son beau visage – d’ordinaire si placide – s’était transformé. On eût dit qu’un sentiment invincible, qu’une terreur intense s’imposaient tout à coup à elle.
Elle tressaillit comme si à travers les salles de fête un vent de glace avait passé.
Mais, soudain, relevant la tête, dardant à travers le vide ses regards noirs qu’illuminèrent un éclair, elle eut un geste de suprême résolution et prononça ce seul mot :
– Allons !
Qu’était devenu le baron Hector de Sandras ?
Il avait, avons-nous dit, rôdé longuement à travers les salons, protégé d’ailleurs par l’indifférence générale. Il était allé d’une extrémité à l’autre, jusqu’aux dernières pièces réservées aux invités, et là, profitant des instants où la danse ou toute autre attraction faisait le vide autour de lui, il posait sa main sur le bouton des portes et essayait de les ouvrir.
Elles étaient fermées, et une pression des doigts ne pouvait suffire à faire jouer les ressorts.
Quel que fût le dessein qui eût germé dans sa tête, peut-être le baron Hector y eût-il renoncé, si tout à coup une crampe, le saisissant à l’estomac, ne l’eût rappelé à cette sinistre réalité, la faim.
Il eut peur de défaillir :
– Non ! non ! murmura-t-il en pâlissant, je ne veux pas faiblir : il me faut toute ma force… aujourd’hui ou jamais !
À ce moment, un laquais, chargé d’un ordre subit, avait déposé sur une console son plateau chargé de gâteaux et de liqueurs.
Au risque d’être surpris et par conséquent de paraître profondément ridicule, Hector mangea coup sur coup plusieurs gâteaux, puis il se mit à vider un à un les verres de punch. Peu à peu la chaleur de l’alcool, se dégageant, lui monta au cerveau ; il lui sembla qu’une énergie nouvelle s’infusait en lui.
Il but, il but encore.
Et comme il entendit des voix se rapprocher du salon où il se tenait, il en sortit vivement, décidé à tout pour arriver au but qu’il s’était fixé d’avance.
Le hasard le servit.
Il remarqua un laquais qui apparut soudain de derrière une tenture. Il était peu probable, que comme dans les féeries, il eût passé à travers la muraille. Donc il y avait là une porte.
Manœuvrant adroitement, le baron Hector constata bientôt que ses déductions ne l’avaient pas trompé.
Derrière l’épaisse tapisserie se trouvait un châssis mobile donnant accès sur une serre d’hiver. Tout était sombre. Cependant, sous le reflet de la nuit d’hiver, jetant à travers les vitrages sa lueur blafarde, les silhouettes fantastiques des plantes vertes dessinaient vaguement leurs formes bizarres.
Hector se faufila par le châssis déplacé.
Il était seul. Il se glissa autour des caisses, recevant parfois en plein visage le heurt brusque d’une tige, mais insensible à tout ce qui n’était pas l’idée dominante à laquelle il obéissait.
Maintenant il avait trouvé la muraille, et les mains étendues, il palpait, cherchant. Et ses doigts rencontrèrent un bouton de cristal. Il tendit de nouveau l’oreille. Aucun bruit ne retentissait de l’autre côté du panneau qui, bientôt, tourna sous l’effort de sa main.
Où était-il ?
Dans une salle de bains, une de ces merveilles de goût raffiné qui sont à la mode depuis quelques années. Une lampe, descendant du plafond par des chaînes d’acier, jetait sur les murs à soubassement d’onyx, une lumière tamisée par un cristal bleuâtre.
Sous les pieds, des tapis tissés de laines d’Orient, blanches comme des toisons, amortissaient tout écho.
Personne. En Face, une autre porte. Hector y alla tout droit, et cette fois, délibérément ouvrît. C’était le boudoir de repos, nid de dentelle et de satin, chiffonné par les doigts d’une fée. Enfin, une troisième porte… et l’ayant entrouverte, Hector ne put réprimer une exclamation de triomphe.
Devant lui, coquette, riche, voluptueuse, était la chambre à coucher de la comtesse Léonide.
Le baron obéissait-il donc à une de ces exaltations cérébrales qui font les bourreaux ou les martyrs d’amour ?
Et cependant, quoiqu’une sorte d’ivresse sourde lui serrât les tempes, quoiqu’il eût aux membres des frissons inconscients, c’était d’un œil subitement redevenu froid et dur que Sandras examinait cette chambre.
Il la voyait dans ses moindres détails, déjà prête à envelopper dans ses torpeurs reposantes la comtesse fatiguée du bal.
Après hésitation, il y pénétra, étouffant le bruit de ses pas. Là aussi une lampe, à lueur douce, lui permettait de juger de tous les détails.
– Où me cacherai-je ? murmura-t-il.
L’alcôve était large, spacieuse, alourdie de rideaux de soie qui se drapaient en plis épais. Hector les souleva. Il y avait là comme un fond d’ombre vers lequel nul rayon ne glissait.
C’est bien, dit encore le baron Sandras. Ah ! ma belle comtesse, vous ne prévoyez guère la surprise que je vous prépare.
Il avait à ses lèvres pâles un sourire presque féroce.
Et avec une précision de mouvements qui prouvait une résolution inébranlablement arrêtée, il alla refermer la porte du boudoir, et sûr de n’avoir pas attiré l’attention, certain aussi de n’avoir pas été vu par la comtesse pendant le bal et par conséquent de n’avoir pas éveillé ses défiances, il se tint prêt à se glisser sous les rideaux à la première alerte.
Là, encore éclairé par la lampe, il fouilla dans la poche de son habit et sa main reparut armée d’un petit poignard, à poignée d’acier, dont il essaya froidement la pointe sur son ongle. Puis il fit jouer dans l’air la lame qui s’irisa au reflet de la lampe.
– Allons ! se dit-il, la belle Léonide m’obéira… sinon…
Il n’acheva pas.
Des pas venaient de retentir à l’extérieur de la chambre, du côté opposé au boudoir.
Était-ce donc la comtesse qui s’était enfin séparée de ses invités ?
Le baron crispa sa main sur sa poitrine : peut-être craignait-il que les battements précipités de son cœur ne révélassent trop tôt sa présence.
Mais non, ce n’était point le pas d’une femme.
On approchait. La clef joua dans la serrure…
Hector se jeta derrière les rideaux, se courbant…
Et la voix de la camériste dit :
– Si monsieur le comte veut bien attendre quelques instants, je vais prévenir Mme la comtesse.
Le comte de Barnes était un homme de très haute taille, aux épaules larges et carrées.
Bien que son costume fût celui d’un explorateur – guêtres de cuir, culotte de velours brun, blouse serrée à la taille par une ceinture de cuir, cependant il avait ce qu’on appelle grand air.
Il paraissait plutôt cinquante ans que quarante.
Le teint était hâlé, les pommettes saillantes ; le visage étiré se terminait par une barbe taillée à l’américaine, c’est-à-dire pendant sous le menton dont la partie bombée était soigneusement rasée.
Mais dans cette physionomie, tout résidait dans les yeux et dans la bouche.
Les yeux petits, noirs, profondément enfoncés sous l’orbite qu’embroussaillaient des sourcils grisonnants, la bouche charnue, large, franche, pour tout dire d’un mot, honnête.
Ou devinait l’homme intrépide, prêt à lutter contre tous les dangers, physiques ou moraux, sûr de lui parce qu’il était sûr de sa conscience, ne redoutant ni les fauves des bois ni les bandits sociaux
Une vraie nature, aurait dit un artiste.
Il portait à la main une petite valise, un de ces chefs-d’œuvre que les layetiers anglais ont inventé à l’usage de ceux qui, vivant au hasard, doivent comme le philosophe antique tout porter avec eux.
Il était entré dans cette chambre, – plus qu’en mari, – en maître, sans même regarder autour de lui, sans donner un regard à ces mille raffinements du luxe parisien.
De ses gros souliers ferrés, il écrasait ces tapis smyrniotes que seuls des pieds nus de femme semblaient devoir fouler.
Grave, ayant aux sourcils un froncement douloureux, il s’était laissé tomber sur un fauteuil, au coin du feu, et là, immobile, ayant jeté loin de lui, au hasard, le feutre qui couvrait sa tête, il regardait les tisons oh couraient ces lignes brisées, fantastiques, dont tant de malheureux ont voulu follement interroger le sens.
S’étant un peu soulevé, Hector, blême de surprise encore plus que d’épouvante, regardait ce crâne large sur lequel les cheveux drus s’épaississaient, grisonnants.
Quelles pensées gisaient sous cette enveloppe, cachant un cerveau puissant ? Pourquoi cet homme, ce mari, était-il là, pensif, sombre, quand il pouvait, de par son droit, entrer à larges pas dans les salles du bal, certain d’être accueilli par des sourires et des mains tendues, quand il pouvait aller droit à l’adorable comtesse dont tous étaient envieux, et s’inclinant devant elle lui dire ces simples mots :
– Ma femme !
De lui, le baron Hector ne savait rien de plus que les autres. Le comte de Barnes était un savant, un chercheur, qui jusqu’à l’âge de quarante ans s’était dévoué à l’étude du vrai. Géologue comme Lyell, botaniste comme Darwin, naturaliste comme Agassiz, il correspondait des divers points du monde avec les plus illustres. Son nom avait plus d’une fois retenti à l’Académie des sciences.
Un jour, frappé de la foudre d’amour, le comte de Barnes avait épousé la fille du vieux comte de Volsay, mort sans fortune dans une maison de fous où son état de caducité enfantine avait nécessité son internement. Tous avaient approuvé ce mariage qui sauvait de la misère l’héritière d’un des plus grands noms de France.
Les millions du savant comte de Barnes ne pouvaient recevoir un plus honorable emploi.
Certes, chacun croyait que le comte avait à jamais renoncé aux explorations lointaines. Un jour, sans prévenir aucun de ses amis, il était parti. Aujourd’hui, sans avoir été annoncé par aucun avis, il revenait…
Décidément, le comte Olivier de Barnes était tout au moins un original.
Ces souvenirs, rassemblés à la hâte, avaient rapidement traversé la mémoire du baron de Sandras. Mais, tandis qu’il considérait cet homme qu’une préoccupation singulière, – une grande douleur peut-être, – semblait écraser, Hector se disait instinctivement que dans cette existence il devait y avoir un mystère, un crime peut-être.
Les minutes passaient. Le comte n’avait pas bougé.
Mais voici qu’un froissement de soie susurra à la porte de la chambre.
La comtesse était entrée.
Le mari, absent depuis cinq ans, n’avait même pas tourné la tête.
Saisi par le démon de la curiosité, et cependant serré d’une angoisse qu’il ne pouvait définir, Hector s’était blotti de nouveau dans l’ombre des rideaux, retenant sa respiration, sentant au front une sueur froide.
Du reste, prêt à la défense, s’il était besoin, il serrait dans son poing crispé la garde du poignard d’acier.
La comtesse, – troublée sans doute par l’indifférence de celui dont elle portait le nom, – s’était arrêtée devant la porte soigneusement refermée.
Elle était d’une pâleur telle que la mort même n’aurait pu l’augmenter.
Ses lèvres, – violacées, – avaient des contractions inconscientes ; et pourtant il était évident qu’elle tentait d’inouïs efforts pour reprendre son sang-froid.
Tout à l’heure, au seuil de cette chambre, elle s’était crue maîtresse d’elle-même. Mais, maintenant, l’immobilité même du comte paraissait la frapper d’une terreur plus grande.
Trois fois elle agita les lèvres, trois fois aucune parole ne s’en échappa.
Mais à ce moment, le comte, – après une longue aspiration, – se tourna du côté de sa femme, et la voyant, se leva et dit :
– Asseyez-vous, madame. J’ai à vous parler… longuement, très longuement…
Elle ferma à demi les yeux, comme si, l’apercevant moins distinctement, elle se sentait plus forte pour parler, et ce fut d’une voix presque calme qu’elle répondit :
– Ne pourriez-vous, monsieur, remettre cet entretien à demain ?…
Il la regarda bien en face :
– À demain ? Et pourquoi ?
– Je suis exténuée de fatigue…
– C’est pourquoi, madame, je vous ai priée et je vous prie encore de vous asseoir… À mon tour, je vous serais obligée de ne point me contraindre à des redites inutiles. Je vous parlerai cette nuit, et cette nuit vous m’entendrez, parce que demain je repartirai…
À ce dernier mot, un tressaillement rapide agita la comtesse.
Quel que fût le supplice, – encore inconnu, – que lui infligeât la présence de son mari, elle avait la certitude d’être promptement délivrée.
Le comte avait surpris ce mouvement :
– Ne vous hâtez pas de vous réjouir, madame, reprit-il de sa voix dont le calme avait quelque chose d’effrayant, rappelant l’organe monotone du juge qui lit un arrêt formulé d’avance ; demain, je ne serai plus là, parce que dans quelques heures l’œuvre pour laquelle je suis venu sera accomplie, et que vous serez châtiée…
Le mot brutal sembla frapper la comtesse en plein visage comme un coup de fouet.
L’orgueil tout à coup domina la peur, et elle reprit avec colère :
– Châtiée ! oubliez-vous donc, monsieur, à qui vous parlez ?…
– Je n’oublie rien, madame. Et à votre tour, je vous demanderai si, d’aventure, pendant mes années d’absence, vous avez perdu le souvenir…
Elle eut encore aux yeux un éclair de révolte. Mais elle se tut.
– Du reste, madame, reprit le comte dont l’impassibilité ne se démentait pas un seul instant, il est utile que je vous rappelle ce qui s’est passé entre nous… Veuillez, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, prendre un siège et m’écouter…
Cette fois, réprimant à peine un haussement d’épaules, elle se laissa tomber sur une chaise longue, la tête penchée en arrière, les yeux aux draperies, les mains croisées sous les seins, comme résignée à tout entendre sans se donner même la peine de discuter.
Quant au comte, pas un pli de son visage n’avait bougé.
Dans la placidité sévère de cette physionomie énergique, on devinait une résolution invincible.
Sans colère, d’une voix que nulle émotion ne semblait troubler, M. de Barnes commença ainsi :
– Je vous ai beaucoup aimée. C’était une folie, j’avais cru qu’une affection sans bornes, un dévouement de tous les instants, pouvaient vous toucher. C’était plutôt un père qu’un époux que je vous donnais. Vous étiez pauvre, j’étais millionnaire. J’étais prêt à souscrire à toutes vos fantaisies de jeune fille. Je vous ai entourée de toutes les recherches du luxe le plus raffiné. Indulgent à vos caprices, à vos excentricités, et cela parce que je croyais à votre honnêteté, je n’ai jamais formulé un reproche… et, en récompense de cette soumission, disons le mot, de cette adoration… vous avez tenté de m’empoisonner !
Le comte s’arrêta. Peut-être son calme n’était-il qu’apparent.
Léonide n’avait pas bougé.
M. de Barnes passa la main sur son front et reprit :
– Comment cette épouvantable pensée avait-elle germé dans votre cerveau ? De quel crime vouliez-vous me punir par le plus lâche des crimes ? Ma seule faute était de vous avoir aimée, de vous avoir donné mon nom. Vous me haïssez de toutes les énergies d’une nature perverse… Lorsque je vous surpris, ici, dans cette chambre même, versant le poison qui devait me tuer, j’eus d’abord la pensée de faire justice… Souvenez-vous ! M’élançant vers vous, je vous arrachai le flacon de mort et le broyai sous mes pieds. Puis ma main se leva sur vous, sur vous qui, lâche et suppliante, étiez tombée écrasée à mes pieds… Mais cette main ne retomba pas… je ne me vengeai pas… je vous plaignis presque. Vous étiez pour moi une malade, une folle !…
On entendit un craquement.
Entre ses doigts crispés, la comtesse avait écrasé les branches d’ivoire de son éventail.
– Oh ! je sais que ces mots vous irritent, continua le comte dont l’accent s’éleva légèrement Maladie, folie, ces vérités vous semblent autant d’insultes. Et pourtant là était votre excuse… si des crimes se peuvent excuser. Il est dans cette ville, orgueilleuse, dont vous aspirez à être la reine, il est dans Paris une fièvre, plus dangereuse que la mal’aria de Rome, le vomito de Lima, fièvre faite de vanité, de passion, de désirs sans frein : l’exaltation vous prend au cerveau, le brûle, le dessèche. Le cœur n’agit plus. Devant vos yeux troublés, des hallucinations fantastiques, éclairées par une lueur d’or, se meuvent comme des spectres fascinateurs. Pour vous, tout disparaît, sauf ce mirage insensé qui vous appelle et vous entraîne. C’est la folie de la richesse, c’est la folie de l’ambition, la folie du luxe… Oh ! maudits, maudits soyez-vous, vous qui vous appelez les Fous de Paris !…
Le comte s’était levé. Possédé un instant par l’indignation qui étreignait sa conscience, il s’était dressé, le bras levé, comme s’il eût été prêt à écraser l’adversaire menaçant…
– Et c’est à cette folie, reprit-il, que j’avais prétendu vous disputer ; et c’est pour lui obéir, c’est pour la satisfaire, que vous avez voulu me tuer !… Et ce qui m’épouvanta, ce ne fut certainement pas la mort, car, cent fois, luttant contre la nature, je l’ai vue de plus près. Non ! Ce qui me terrifia, c’est que vous, la femme adorée, adulée, heureuse ! c’était vous qui aviez conçu la pensée de cette infamie !…
La comtesse tourna lentement la tête vers son mari :
– Pourquoi me rappelez-vous cette scène ? dit-elle froidement. N’ai-je pas avoué… ma faute !… et vous-même, en partant, ne m’avez-vous pas dit que vous oublieriez ?
– Oui ! oui ! fit le comte en secouant la tête. Dans mon désespoir, dans mon horreur, je m’enfuis loin de vous !… En une minute, j’avais vieilli de vingt ans ! Vous aviez tué en moi toute foi, tout espoir ! Oui, j’ai fui loin de vous… mais savez-vous bien pourquoi ?…
– Non !…
– Je vais vous le dire !…
Il s’approcha d’elle et fixa en plein sur ses yeux son regard noir et profond.
– J’ai tout quitté, j’ai voulu tout abandonner parce que, vous regardant alors comme je vous regarde en ce moment, scrutant vos yeux comme je le fais, sondant les profondeurs de votre pensée, aussi claire à mes yeux que les eaux d’un lac… j’avais deviné que sur cette pente où vous aviez glissé une première fois, vous ne vous arrêteriez plus ! Vous aviez voulu tuer, vous tueriez encore…
– Mensonge et calomnie !…
– Attendez avant de parler de mensonge ! interrompit brutalement le comte, qui devenait plus pâle à mesure que le calme de sa femme le torturait davantage. Oui, vous étiez vouée au meurtre… Et pourquoi ? Parce que vous me haïssiez ! C’était moi que votre fureur menaçait, parce que j’étais l’obstacle à je ne sais quels rêves encore mal formulés ! J’étais riche, mais je n’étais pas ambitieux ! Je vous avais faite comtesse ; je vous avais conquis l’estime de tous ! Qu’était cela pour vous ? Vous avez été atteinte de la maladie de Paris, de l’hystérie irrésistible qui secoue les êtres satis âme et sans cœur ! Vous vouliez être duchesse, princesse, reine ! Vous vouliez un compagnon de ces débauches mondaines où le luxe est une sorte de prostitution. Et moi je n’étais qu’un savant ! Vous ne pouviez trouver avec moi que les saines jouissances du devoir accompli et du progrès réalisé ! Vous pouviez porter dignement un nom que saluaient ceux que la science sauve de la misère et de la mort… En vérité, vous vous souciez bien de cela ! Et vous vouliez être veuve… à tout prix !… Osez donc dire que cela n’est pas vrai !
– Je n’affirme ni ne nie, dit la comtesse. J’attends.
– Nier ! Vous savez bien que cela n’est pas possible, puisque, terrifiée par la découverte de votre crime, vous avez écrit et signé de votre main l’aveu de ce crime !… Ce papier qui vous accuse et peut vous envoyer en cour d’assises…
– Monsieur !
– En cour d’assises, comme empoisonneuse ; ce papier est en sûreté, soyez-en certaine.
Instinctivement, involontairement peut-être, le comte, en prononçant ces derniers mots, avait porté la main à sa poitrine.
« Le papier est là, dans son portefeuille, » pensa la comtesse, qui avait surpris ce mouvement.
– Prétendriez-vous en faire usage ? demanda-t-elle ironiquement. Vous plairait-il que la comtesse de Barnes, car tel est mon nom, ne l’oubliez pas, comparût sur le banc des accusés ?…
– C’est ce que je déciderai tout à l’heure, dit le comte d’une voix grave. Je vous l’ai dit, je suis venu pour prononcer votre arrêt…
Léonide ne put réprimer un mouvement de colère : tout son orgueil révolté lui monta aux lèvres, et elle s’écria :
– Par grâce, monsieur, ces menaces sont indignes d’un galant homme… Épargnez-les-moi, et allez au fait !…
– L’impatience vous égare, madame. Ici, vous n’avez pas à ordonner, mais à obéir !… Car ce n’est pas seulement l’empoisonneuse que j’ai à punir, c’est la femme qui deux fois depuis lors a attenté à ma vie… et qui a fait pis encore.
À ce moment un léger frémissement, comme le bruit d’une étoffe qu’on froisse, arrêta sur les lèvres du comte les paroles prêtes à s’en échapper.
C’était le baron de Sandras qui n’avait pu réprimer un frisson. C’est qu’aussi le hasard l’initiait à d’épouvantables secrets. Quels sentiments éprouvait cet homme qui s’était introduit dans la chambre d’une femme pour la menacer de mort, sinon pour la frapper, et qui, tout à coup, apprenait l’histoire d’un effroyable passé !
Le comte avait tourné la tête dans la direction de l’alcôve. Mais, trop préoccupé pour s’arrêter à un incident insignifiant en apparence, il dit, sans y attacher plus d’importance :
– J’ai hâte d’en finir, madame. Car, en dépit du mépris mêlé d’horreur que vous m’inspirez, je ne suis pas un tortionnaire. Peut-être frapperai-je, mais je ne ferai pas souffrir. Oui, deux fois, j’ai failli périr par vos ordres… vous avez soudoyé des assassins contre moi.
– C’est faux, vous dis-je !…
– La première fois, ce fut à mon arrivée à Marseille, alors que je me préparais à monter sur le Volga, qui devait m’emporter vers l’Asie Mineure. Comme je posais le pied sur la passerelle qui allait du quai au navire, une planche se déroba sous moi… et je fus précipité à la mer…
– Accident ! articula la comtesse.
– Je le croyais, fit tristement le comte. Mais, trois jours après, une épouvantable tempête assaillit le navire. Les lâches ont l’épouvante de la mort et surtout des châtiments que leur crédulité leur montre par-delà le tombeau… Comme on croyait le navire perdu, comme nul secours humain ne paraissait pouvoir nous soustraire au naufrage, un matelot s’approcha de moi et me dit ; « Pardonnez-moi, car j’ai voulu vous assassiner !… »
– Eh bien ! cet homme voulait sans doute se venger de quelque grief imaginaire ou réel !
– Non ! une femme était venue à Marseille, et là, déguisée, rôdant sur le port, elle avait choisi l’instrument de son nouveau crime !… Elle avait trouvé cet homme et l’avait payé !… Et cette femme, c’était vous !
– Je vous dis que ce n’est pas vrai ! Des preuves !
– Des preuves, dites-vous… D’une part, cet homme, par remords, par crainte, fut pris d’une fièvre pernicieuse qui le tua et, avant de mourir, il écrivit et signa l’aveu qu’il m’avait fait verbalement…
– Mais, à supposer qu’il ne mentît pas, savait-il qui était cette femme ?
– Oui, car, reçu par elle dans l’humble auberge oh elle s’était cachée, cet homme, sans qu’elle s’en aperçût, voulant se créer au besoin des éléments de défense ou entraîner sa complice avec lui, lui avait dérobé un médaillon contenant deux portraits… Le vôtre et le mien, madame !… Et c’est au dos même de ce portrait qu’il a écrit et signé son aveu… Je connais le nom de cette auberge… Je sais encore qu’elle est toujours habitée par les mêmes gens qui ne l’ont pas quittée depuis cinq années… Je sais encore qu’ils n’ont pas oublié la voyageuse mystérieuse qui, il y a cinq ans, reçut un matelot dans sa chambre et qu’ils pourraient la reconnaître… Vous me demandiez des preuves, madame ! Pensez-vous que celles-là soient suffisantes !… Est-il un tribunal qui hésiterait à vous condamner ?…
Cette fois, la comtesse, d’un seul élan, se dressa sur le tapis.
Les bras croisés sur sa poitrine, les yeux largement ouverts, dans toute l’arrogance de sa splendide beauté, elle se tenait devant le comte, la bouche contractée par une indicible expression de défi :
– Eh bien ! oui ! dit-elle sourdement. Oui, je vous hais ! Oui, pour me délivrer de vous, de la chaîne trop lourde qui me rive à vous, pour reconquérir ma liberté, j’ai tout tenté ! Je vous hais, non seulement parce que vous êtes mon mari, mais parce que vous vous prétendez un de ces héros de vertu que rien ne détourne de leur chemin !… Ah ! Vous nous appelez les fous de Paris ! Soit, du moins nous avons au cœur, au cerveau la passion qui resplendit, qui étincelle, qui embrase !… C’est la fièvre, dites-vous, soit encore ! mais une fièvre faite d’âcres jouissances qui mettent en jeu toutes les fibres de l’être !… Vous me menacez de vos gendarmes, de vos tribunaux !… Peut-être pousserez-vous l’impassibilité des consciences fortes jusqu’à me traîner à l’échafaud !… Eh bien ! écoutez-moi… Vivre liée à vous, captive de cet esclavage qui s’appelle le mariage, et qui me fait horreur parce que c’est votre nom que je porte, vivre ainsi, pour moi, c’est mourir cent fois, mille fois, de colère, de dégoût et de haine !… Et maintenant que j’ai vidé mon cœur, que je vous ai craché au visage ce dégoût et cette haine… faites de moi tout ce qu’il vous plaira !…
– Vous êtes la dernière des misérables ! s’écria le comte.
– Trêve d’injures ! votre arrêt. Ayez donc au moins le courage de le prononcer. Puis je verrai si je dois m’y soumettre !
– Eh bien ! oui. Vous vous soumettrez ! cria le comte la saisissant par le poignet et la jetant à ses pieds sur le tapis… Car je n’ai plus pour vous ni pitié ni dédain… Vous avez voulu m’empoisonner, je sois parti et je me suis tu… Vous avez payé un misérable pour me précipiter à la mer… il y a de cela cinq ans… je vous ai même laissé ignorer que je connusse cette nouvelle infamie… Mais vous avez commis un crime plus grand encore… et c’est celui-là qui me rendra implacable…
La comtesse ricana. En vérité, cette créature pervertie était d’une effrayante beauté. Pâle, les yeux chargés d’éclairs, elle eût servi de modèle pour une Némésis antique.
Elle était restée agenouillée sur le tapis ; mais, rejetée en arrière, la gorge presque hors de sa robe, elle ressemblait à une bacchante ivre.
Lui se penchait sur elle, et haletant, il lui disait :
– J’avais un ami, un frère, Lionel ; celui que nous appelions Lionel Sans-Nom ! pauvre enfant sans mère, sans famille ! Toute ma vie, je m’étais dévoué à lui ! Il était beau, intelligent ! il m’aimait… oh ! oui ! autant que je l’aimais moi-même… L’avenir s’ouvrait devant lui radieux et beau… j’avais aplani devant lui les duretés de la vie. Dévoué à la science, comprenant toutes les grandeurs du travail, Lionel, mon élève, eût continué, eût achevé mon œuvre… Hélas ! je dus partir, m’éloigner de lui !… emportant ma honte et mon désespoir ; je renonçais à tout… j’oubliais tout !… et je m’enfonçais dans les solitudes de l’Asie Mineure… Je me perdais dans les déserts du Caucase, demandant à la nature l’oubli, cherchant à arracher de mon cœur ce vautour qui le dévorait sans cesse… Soudain, il y a de cela trois mois… étant de retour dans la Turquie d’Asie, et sur le point d’atteindre Scutari, ma dernière étape vers l’Europe, que je ne sais quel instinct, pareil à l’amour filial, m’entraînait à revoir… je me trouvai en face de Lionel !…
Lentement, par un mouvement insensible, la comtesse s’était reculée, et maintenant elle s’était appuyée au sofa, les yeux subitement éteints.
La voix de M. de Barnes s’était abaissée, assombrie par une profonde tristesse :
– Que venait faire cet enfant si loin de son pays ? reprit-il. Était-ce donc une attraction affective qui l’avait poussé vers moi ? Je le crus un instant, et, dans mon égoïsme, j’éprouvai un instant de bonheur !… Lui était pâle, ses pommettes enfiévrées, ses yeux rougis, tout m’effraya… il s’approcha de moi avec un sourire contraint, et quand je lui pris la main, je la Sentis froide comme si déjà la vie s’était retirée de lui… Hélas ! la force me manque pour continuer cet effroyable récit… Ce Lionel, cet enfant, cet ami qui était presque mon fils, vous, comtesse de Barnes, vous, ma femme, vous aviez fait de lui votre amant… et vous lui aviez ordonné de m’assassiner !…
Ah ! misérable enchanteresse ! Était-ce donc une bien grande victoire que celle remportée sur cet adolescent encore vierge des infamies de notre monde, et que vous aviez corrompu d’un baiser !… Sinistres magiciennes de l’enfer parisien, vous avez des philtres qui affolent ces pauvres êtres !… et il vous avait admirée ! et il se prosternait devant vous comme devant une idole… oui, une idole pareille à ces monstrueuses créations du ciel indou qui, au paria prosterné, commandent le meurtre !
En vain, il avait résisté ! En vain il avait pleuré ! vous l’aviez menacé de le chasser ! vous l’aviez exilé pendant de longs mois ! Alors, sachant que la clef de votre boudoir ne lui serait rendue que le jour où sa main y laisserait une trace de sang, il était parti, la tête en feu, comme un aliéné, pour exécuter vos ordres !
Et il était là, devant moi, me regardant de ses yeux caves, ses doigts caressant un pistolet caché dans sa poitrine !
Savez-vous ce que je vis alors ? Tandis que je lui ouvrais mes bras, lui criant : « Tu souffres ! tu es venu ! tu as bien fait ! Confesse-toi à moi ! » J’ai vu le malheureux tourner contre lui-même l’arme de mort et tomber à mes pieds le crâne à demi fracassé !…
J’ai vu cela ! j’ai entendu le pauvre enfant, que j’aimais avec la passion d’un père, m’avouer dans un dernier râle l’épouvantable mission que vous lui aviez donnée… j’ai vu ses doigts défaillants tracer en tremblant la confession entière, l’acte sinistre d’accusation que ses remords dressaient contre vous… j’ai entendu son dernier sanglot… j’ai vu sa lèvre se tordre dans la suprême agonie… Voilà ce que j’ai vu et entendu, comtesse de Barnes ! et alors je me suis dit : « C’en est trop ! l’heure du châtiment a sonné !… » et je suis venu… Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous disais que j’allais vous punir ?…
Il s’arrêta. De grosses larmes avaient jailli de ses yeux et roulaient sur ses joues creusées. L’homme fort était vaincu.
Si Léonide eût parlé en ce moment, peut-être l’aurait-il tuée.
Elle cacha sa tête dans ses mains, ne cherchant même pas à nier !…
Et le comte, pendant quelques instants, rêva. Peut-être se souvenait-il de cette heure première, si ardemment désirée, où il avait pénétré dans la chambre de sa femme, celle-là même dans laquelle il se trouvait !
Que de chemin parcouru depuis ce jour-là !…
Cette femme, qu’il avait tant aimée, n’était plus qu’une coupable indigne de pitié ! Et il lui fallait la frapper !
C’étaient d’effrayantes tortures…
Mais il lui fallait s’aguerrir contre ses angoisses.
Il se redressa, comme le soldat décidé à faire son devoir jusqu’au bout :
– Madame, dit-il ; après ce que vous avez entendu, vous avez compris que ma décision est irrévocable. Toute prière, toute résistance seraient inutiles. Ce que je vais ordonner, vous l’accomplirez, je le veux.
Elle inclina la tête : peut-être se soumettait-elle.
– Vous n’avez à craindre, continua le comte qui avait recouvré son sang-froid, aucune violence ; les pressions que j’exercerai sur vous sont toutes morales. Je possède, comme je vous l’ai dit, les preuves de vos crimes. Aucune considération ne m’arrêterait, au cas où vous refuseriez de m’obéir. Aux yeux du monde, en vous livrant à la justice, je serais doublement déshonoré, puisque chacun saurait et que vous m’avez trompé et qu’une femme portant mon nom est une sorte de Brinvilliers digne du dernier supplice. Mais, je vous le répète, l’opinion de ce que vous appelez la haute société ne saurait me faire dévier du chemin que je me suis tracé. Je suis sûr de ma conscience et elle me suffit…
La comtesse l’interrompit :
– Ainsi, dit-elle avec calme, voici une des alternatives ; la dénonciation, l’arrestation, la condamnation… Quelle est l’autre ?…
– La mort, prononça le comte.
Mais sur un geste nerveux de Léonide :
– Oh ! soyez tranquille ! lui dit-il avec un triste sourire, non pas la mort physique que vous semblez tant redouter, vous qui cependant n’avez songé qu’à tuer, mais la mort morale, la mort de votre individualité… Celle-là me suffit…
– Je ne vous comprends pas !
– Je m’explique. Aux coupables telles que vous, la société n’offre aucun refuge… Une religion qui n’est pas la mienne pourvoit à ces nécessités… Dès demain, la comtesse de Barnes entrera dans un couvent !
– Dans un couvent ! moi ! Jamais !
– Oh ! je sais bien que je vous inflige, à vous, mondaine, un terrible châtiment. Mais c’est ainsi que j’ai décidé. Dès demain, j’aurai fait abandon de tous mes biens. Je suis chef de la communauté, et j’en ai le droit strict. Nous serons, vous et moi, réduits à la misère. Soyez certaine que toutes mes précautions seront bien prises pour que vous ne puissiez pas échapper aux effets de ma volonté. Ces millions qui pour vous ont été la perdition, serviront à des œuvres utiles, sauf la portion nécessaire à assurer votre sort dans la communauté que j’ai choisie pour vous…
– Mais vous savez bien, monsieur, que je me refuse…
– Vous obéirez, vous dis-je ; sans quoi, demain la police envahira cet hôtel et viendra arrêter l’empoisonneuse… celle qui a tué mon pauvre Lionel… Je vous offre la vie sauve… mais je veux, je veux, entendez-vous bien, que la comtesse de Barnes soit morte au monde… Je devine que votre route à travers la vie serait une marche Infâme à travers toutes les hontes… Que de victimes seraient encore frappées !… Que d’innocents tomberaient, atteints par votre infernale perversité !… C’est ce que j’empêcherai à tout prix !… La maison centrale ou le couvent, choisissez !…
Cette fois, frappée par l’accent solennel du comte, Léonide avait peur. Oui, réellement peur. Un argument lui échappait. Elle eût voulu effrayer le comte par la pensée du scandale qui retomberait sur lui.
Il l’avait prévenue en déclarant qu’il acceptait d’avance toutes les conséquences de sa décision.
Et il avait raison de les accepter.
Son honneur était de ceux que l’infamie d’autrui ne saurait souiller.
Et puis, eût-il, sinon à rougir, tout au moins à souffrir de la honte qui rejaillirait sur son nom, il partirait, il s’expatrierait ! le monde lui était ouvert. Sa vraie patrie, c’était l’univers.
Elle pensait à tout cela, et elle se sentait enserrée dans un cercle de fer infranchissable.
Ainsi il fallait choisir :
Elle, la royale comtesse, l’orgueilleuse dominatrice, elle irait, entre des gendarmes, s’affaisser sur le banc où tant de misérables avaient passé !
Se tuerait-elle pour échapper à cet opprobre ?
Non ! elle le savait !
Elle aimait la vie. Ses crimes, elle les avait commis en quelque sorte pour étendre, pour élargir son horizon !
Elle ne se tuerait pas. Mais alors cet horizon se rétrécirait aux quatre murs d’une cellule de cloître ?
Une pensée traversa tout à coup son cerveau ; et, à son insu, elle la formula.
– La lui ne reconnaît pas de vœux éternels ! murmura-t-elle.
C’est-à-dire qu’elle songeait à simuler une soumission, puis, lorsque le comte serait reparti, à reprendre sa liberté :
– Je crois vous avoir dit, fit le comte répondant à la phrase à peine prononcée, que toutes mes précautions étaient prises. Si vous vous permettiez de manquer à votre parole, si vous sortiez ou vous évadiez du cloître dont je fais pour vous une prison perpétuelle, le lendemain l’accusation, jusque-là évitée, vous frapperait ce plein visage… Donc, madame, ne cherchez pas à jouer avec le danger… Oui ou non ? Le cloître ou le bagne des femmes ! Encore une fois, choisissez !…
Alors, changeant soudain de tactique, obéissant peut-être même à un sentiment de terreur réelle, elle se jeta aux pieds du comte.
Elle se traînait sur le tapis, à genoux, criant : « Grâce ! »
Lui, implacable, la repoussa :
– Vous m’avez frappé, moi seul ! j’ai, sinon pardonné, du moins méprisé ! dit-il. Mais la mort de Lionel m’a ouvert les yeux. C’est non pas moi seul, mais tous que vous menacez. La pitié serait de la complicité. J’ai dit. Madame, il est quatre heures du matin, je vais dans mon appartement… là, j’attendrai votre décision… Si à sept heures, vous ne m’avez pas répondu par l’engagement formel d’entrer un cloître, je vais au parquet déposer les pièces que vous connaissez !… Adieu !
Et la laissant accablée, brisée, le comte de Barnes passa devant elle et sortit de la chambre à coucher.
L’arrêt était prononcé.
Et hagarde, affolée, la comtesse tenailles yeux fixés sur la porte par laquelle il venait de disparaître.
Perdue ! Elle était perdue ! Ah ! Comme elle le haïssait, cet homme !
Mais à ce moment, elle sentit une main se poser sur son épaule, tandis qu’une voix murmurait à son oreille :
– Et pourquoi donc ne m’as-tu pas demandé sa mort ?
Celui qui venait de parler était le baron Hector de Sandras.
D’abord la comtesse n’avait entendu que la voix sans comprendre les mots.
Et comme si c’eût été quelque être fantastique soudain évoqué qui l’eût touchée à l’épaule, elle restait glacée, retenant son souffle, n’osant pas se retourner.
Mais alors le baron se pencha vers elle, et tout bas, chuchota à son oreille :
– Léonide ! Léonide !… C’est moi !…
Elle regarda brusquement et se redressant :
– Hector ! Vous ! Que faites-vous ici ?… fit-elle.
Chose singulière, en une seconde, par une incroyable métamorphose, la coupable terrifiée avait disparu pour faire place à la femme du monde, telle qu’elle était tout à l’heure au milieu de ses adulateurs, avec sa lèvre ironique et sa hauteur de grande dame.
Et d’un geste, montrant la porte :
– Sortez ! ajouta-t-elle, ou je vous fais jeter dehors
Il se plaça d’un bond devant cette porte, et, livide :
– Prends garde, Léonide, accentua-t-il en grinçant des dents, j’étais là… et j’ai tout entendu !…
En vérité, elle n’avait pas songé à cela !… Un frémissement parcourut tout son corps :
– J’ai tout entendu, répéta Hector qui haletait. À mon tour, écoute-moi… Je t’aime follement, tu le sais… et c’est toi qui m’as perdu !… Tu sais aussi d’où je sors, n’est-il pas vrai ?… Pour toi, j’ai commis une lâcheté, une infamie et on m’a jeté en prison… J’en suis sorti ce matin, entends-tu bien, Léonide ? Ce matin même, et ce soir, un de tes laquais jetait mon nom à travers tes salons…
– Votre nom ! le nom d’un condamné !
– Non pas !… Celui qui a été frappé par la justice portait un nom d’emprunt… et malgré tout, malgré tous, il ne s’est pas démenti… Ici, je suis le baron Hector de Sandras… Demain, je serai méconnaissable, et nul ne pourra dire : Celui-là était en prison !… Sais-tu maintenant pourquoi cette nuit je m’étais caché dans ta chambre ?… le sais-je moi-même ? Tiens, regarde ! j’étais armé !… et je t’aurais dit : Léonide, rends-moi ton amour ! paie de quelques heures de joie suprême l’épouvantable supplice que j’ai subi pour toi… sinon…
– Sinon ? demanda la comtesse.
– Je t’aurais tuée et me serais tué après !
– Et maintenant ?…
– Maintenant !…
Il se rapprocha d’elle et prenant ses deux mains dans les siennes :
– Léonide, lui dit-il de sa voix qui sifflait entre ses dents serrées, cet homme dont tu portes le nom te disait tout à l’heure que Paris a sa folie, comme Rome a sa fièvre… Eh bien ! moi aussi je suis un de ces fous… je veux la vie large, éblouissante… je veux le luxe, je veux l’amour… et par-dessus tout, avant tout… c’est toi que je veux !…
Elle ne protestait pas. Elle écoutait avidement. C’est que maintenant il lui semblait que certaines paroles prononcées tout à l’heure vibraient de nouveau à son oreille.
– Et pour obtenir tout cela ?… demanda-t-elle.
– Si tu es veuve, Léonide, veuve et riche, te donneras-tu corps et âme à celui qui aura fermé la bouche qui l’accusait là tout à l’heure ? à celui qui aura arraché à cet homme les preuves infamantes dont il te menaçait ! à celui enfin qui te dira : Comtesse de Barnes, tu es libre par moi !… je te donne la vie de cet homme en échange de la tienne !
Brusquement, elle lui jeta cette question :
– Tu le tuerais ?
– Oui !…
– Sans hésitation ? sans faiblesse ?…
– Ma main ne tremblera pas… mais à la condition qu’auparavant tu y auras placé la tienne !…
– Et pour prix de ma délivrance, que me demandes-tu ?
– D’être à jamais à moi… Léonide, baronne de Sandras ! Songes-y bien, je t’aime, je te désire, je te veux ! Pour t’obtenir, je vais tuer !… mais c’est entre nous un pacte de vie et de mort !…
Froidement, avec une sorte de solennité tragique, elle lui tendit la main :
– Pacte de vie et de mort, fit-elle.
Il se jeta sur cette main, la mordant de ses baisers.
Puis, se redressant :
– Où le trouverai-je ? demanda-t-il.
– Attends, fit-elle. Je te conduirai moi-même !…
Elle l’écarta de la porte, l’ouvrit et tendit l’oreille.
Au-devant de sa chambre, se trouvait un petit salon de réception, précédé d’un vestibule.
Au-dessus, on entendait un pas lourd et monotone.
Le comte était là, en proie à ses angoisses, attendant sans doute la décision de la condamnée.
Léonide frissonna.
– Il ne dort pas, murmura-t-elle. Il sera sur ses gardes !
– Qu’importe !
– Il est fort comme un lion. La lutte sera inégale… il appellera, il criera à l’aide. Les domestiques accourront, et alors… nous serons perdus ! Non, ce n’est pas ainsi que vous pouvez le frapper…
– C’est-à-dire que vous avez peur, dit Hector, qui sait ? pitié de lui, peut-être !
– Pitié ! fit la comtesse en lui saisissant le bras, pitié de cet homme que je hais et qui est maître de mon sort ! Non, certes ! mais répondez à cette question : Comment fuirez-vous ? Si vous êtes surpris, comment vous défendrez-vous ? Et suis-je seulement certaine que vous ne me trahirez pas ?
– Moi, vous trahir ! Alors que c’est l’amour, un amour insensé, qui me pousse au meurtre !
– Ainsi, si vous étiez arrêté ?…
– Je ne prononcerais pas votre nom.
Un singulier regard passa dans les yeux de la comtesse ; et, se penchant vers lui de telle sorte que son visage touchait presque celui du meurtrier :
– Tu me le jures ? murmura-t-elle.
– Oui. Mais, de toi aussi j’attends un serment.
– Ne t’ai-je pas promis de t’appartenir ?
– Alors même que je serais surpris, arrêté, condamné, tu me jures de rester libre… de n’appartenir point à un autre ?
– Encore une fois, je te le jure…
– Même si, condamné au bagne, je devais attendre cinq ans, dix ans, la chance d’une évasion ?…
– Je t’attendrai !
– Merci. Je t’appartiens !
D’un mouvement violent, il saisit Léonide dans ses bras et appliqua ses lèvres sur les siennes.
Et se redressant, il tira de sa poche un poignard à lame triangulaire et à poignée d’acier, et dit :
– Je suis prêt !
Oui, le comte de Barnes disait vrai. Celui-là aussi était un de ces fous de Paris qui marchent dans l’ivresse irrésistible du désir inassouvi, de la passion sans frein.
On saura plus tard comment lui, le baron Hector de Sandras, fils d’un père honorable, doué par la nature de facultés réelles, comment, ayant pu, à coup de travail, se frayer une route à travers les difficultés de la vie, il avait renoncé à tout ce qui est bien, à tout ce qui est honnête, et avait peu à peu glissé sur cette pente d’infamie au bout de laquelle est la chute profonde… Comment, sous un nom d’emprunt, il avait fait partie d’une bande, déjà frappée par la justice… Aujourd’hui, cet homme, qui avait souffert dans les prisons l’ignominie, n’ayant, selon l’expression consacrée, rien oublié, ni rien appris, reparaissait avec ses désirs plus ardents, ses volontés plus féroces. Un hystérique, lui aussi !
Et cela parce que son cerveau était en proie à la fièvre de Paris ; parce qu’il était de ceux qui rêvent, furieux d’impuissance et de pauvreté, devant les fenêtres étincelantes des hôtels riches, qui s’arrêtent, haletants, devant les vitrines de changeurs où l’or s’entasse, parce qu’il n’avait eu, parce qu’il n’avait aucune de ces patiences héroïques qui conquièrent l’estime, parce qu’il voulait, n’ayant rien, n’étant rien, arriver d’un seul bond au faîte.
Sa première chute l’avait meurtri, mais non brisé !
Point de repentir. Seulement de la colère. Et il aimait cette comtesse de Barnes, qui s’était révélée naguère à lui dans tout l’éblouissement de la richesse et de la beauté ! On l’a deviné : elle avait été sa maîtresse. Pour elle, il avait volé. Maintenant, il allait tuer. C’est la logique du crime.
Pendant deux ans, cet homme, confondu avec les plus bas vagabonds, tressant des chaussons de lisière dans une maison centrale, méprisé et se méprisant lui-même, avait eu le courage de taire son nom, ayant été condamné sous un sobriquet de bague. Il avait écumé de colère aux insultes de ses codétenus. Mais une seule pensée le soutenait : il reverrait Léonide, il rentrerait, ne fût-ce que pour quelques heures, dans cet enfer éblouissant qui s’appelle le monde parisien… et voici qu’une tentation subite, épouvantable, se dressait devant lui.
Il avait surpris les secrets de cette femme. Il la tenait en son pouvoir.
Que le mari disparût, et lui, Hector, rentrait la tête haute dans cette société, adoratrice des millions.
L’époux de Léonide de Barnes assouvissait enfin cette soif de jouissances qui dévorait Hector de Sandras…
– Je suis prêt, répéta-t-il, ne raisonnant plus, ayant devant les yeux une lueur rouge.
Et il ne voyait pas que sur les lèvres pâles de celle pour qui il se damnait, il y avait une sorte de sourire…
– Viens, lui dit-elle.
Elle alla à un des panneaux, souleva une tenture qui démasqua une petite porte. Elle l’ouvrit ; un escalier se dessina dans la demi-obscurité.
– Ces marches, dit-elle, conduisent à la chambre de cet homme… elles sont recouvertes de tapis qui étouffent le bruit des pas. En haut, une porte qui peut s’ouvrir brusquement… Va… bondis et frappe…
– Oui ! oui ! fit-il d’une voix qui frissonnait de rage.
– Derrière cette porte, j’attendrai… Dès qu’il sera tombé, reviens sur tes pas, je te ferai évader…
Lui n’entendait plus ; il ne songeait même plus à l’évasion. La maladie du meurtre s’était emparée de lui et le secouait comme une épilepsie.
Il monta. La comtesse était derrière lui.
Le tapis était épais. Aucun bruit ne s’entendait.
Même l’écho des pas du comte s’était éteint.
Peut-être pour lui le calme était-il venu ; la tension morale est une fatigue. Sans doute il y avait succombé.
Léonide tenait la main de Sandras :
– Attends ! lui souffla-t-elle à l’oreille, et passant devant lui elle s’approcha de la porte dont elle avait parlé !
Hélas ! C’était – au temps des premières amours du comte – l’issue qui lui donnait accès dans la chambre de sa femme. C’était par là que bien souvent il était descendu, tremblant d’amour… et c’était par là aujourd’hui que la mort montait…
Léonide s’était penchée, et par le trou de la serrure, elle regardait.
Le comte était assis, devant une table. À côté de lui, une lampe projetait sa lueur douce sur ses cheveux grisonnants. Il avait appuyé son front dans ses mains. Il rêvait. À quoi ?