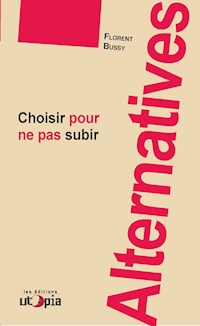
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Utopia
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Par notre production, par notre consommation mais aussi par certaines de nos attentes, nous sommes inscrits dans l’ordonnancement d’un monde qui nous entraîne vers des catastrophes, mais qui globalement ne nous satisfait pas, individuellement comme collectivement. Malgré cela, rien actuellement ne semble devoir l’ébranler profondément. Le célèbre "There is no alternative" thatchérien domine l’esprit de nos dirigeants, mais aussi celui de beaucoup de nos concitoyens. Ce livre propose de récuser ce renoncement et d’envisager quelles seraient les alternatives que nous pourrions choisir pour ne pas subir l’ordre du monde actuel tel que nous le vivons au quotidien.
L’auteur en a retenu quatorze – dans les domaines écologiques, économiques, politiques ou existentiels – qui pourraient changer cet ordre mortifère. Avec la prise de conscience universelle du réchauffement climatique, de l’effondrement de la biodiversité et de l’épuisement des ressources, penser autrement l’économie, le rapport au temps, l’alimentation s’impose peu à peu à la conscience du plus grand nombre. Les alternatives de ce livre ouvrent un espoir dans un monde que menacent chaos et effondrement. À l’opposé des passions tristes, elles peuvent s’avérer enthousiasmantes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Florent Bussy, né en 1972, est professeur de philosophie en lycée en Normandie. Les livres qu’il a écrits portent principalement sur la question de l’écologie, pour laquelle il milite par ailleurs au sein du conseil municipal de Dieppe (Seine-Maritime) et en tant que vice-président d'agglomération, en charge de l’économie sociale et solidaire. Il est l’auteur d’une dizaine de livres, dont en 2020 :
Günther Anders et nos catastrophes,
Le passager clandestin, et
Le vertige de l’illimité.
Société de consommation et mythe de la démesure, Robert Laffont.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Collection Ruptures
Les Éditions Utopia
61 Bd Mortier 75020 PARIS
www.editions-utopia.org
www.mouvementutopia.org
Diffusion: CED
Distribution: Gaudin
© Les Éditions Utopia, mai 2021
Du même auteur
Critique de la raison automobile, Libre et Solidaire, 2014.
Le totalitarisme. Histoire et philosophie d’un phénomène politique extrême, Le Cerf, 2014.
Qu’est-ce que le totalitarisme?, Vrin, 2014.
L’utopie. Entre idéal et réalité, Libre et Solidaire, 2016.
Ce qui nous fait. L’avènement d’homo ecologicus?, Libre et Solidaire, 2017.
William Morris ou la vie belle et créatrice, Le passager clandestin, 2018.
Les élections contre la démocratie? Au-delà du vote utile, Libre et Solidaire, 2019.
Le pont. Parcours de la nécessité, Carnets Nord, 2019.
Günther Anders et nos catastrophes, Le passager clandestin, 2020.
Le vertige de l’illimité. Société de consommation et mythe de la démesure, Robert Laffont, 2020.
Sommaire
Introduction
Faire le tour du Monde ou vivre chez soi
Faire la guerre (au Mali) ou isoler son logement
Pianoter sur son smartphone ou occuper sa journée
Aller plus vite ou prendre son temps
Jeter ou réparer
Dématérialiser ou rematérialiser
Avoir ou être
Se remplir le ventre ou se nourrir
Complexité ou simplicité
Quantité ou qualité
Dépendance ou liberté
Dépasser l’humain ou vivre
Le Ciel ou la Terre
Conclusion: prendre soin ou provoquer le chaos
Notes
Les Éditions Utopia
Introduction
Nos manières de vivre, nos environnements urbains, nos modes de transport, nos métiers, rien de tout cela n’est, la plupart du temps, choisi ou du moins n’est l’objet d’un examen rationnel pouvant donner lieu à des critiques et des revendications. Nous avons peu de prise sur l’organisation de nos vies, sur nos consommations. Nous sommes très peu consultés sur ce qui constitue la substance de nos vies1.
Or, l’existence même des démocraties voudrait que ce qui s’impose à la collectivité soit discuté et fasse l’objet d’une délibération commune. Mais c’est sans compter sur l’organisation libérale des sociétés qui récuse toutes limites à la liberté individuelle d’entreprendre et affaiblit le commun. La consommation qui sanctuarise la liberté du commerce a étendu son « spectre » sur l’ensemble des activités de la société, et nous a lentement mais sûrement dépossédés de notre capacité de construire notre vie, au point de ne plus savoir comment changer et sortir des modes de vie qui sont pourtant aujourd’hui largement reconnus comme délétères ou du moins comme étant des impasses.
Il convient de penser d’une autre manière ou plutôt de montrer qu’est occulté le fait que nous sommes confrontés à des alternatives, mais que nous les ignorons au profit d’une direction unique, dont nous souffrons pourtant en raison des conséquences qu’elle a sur nos vies. Nous ignorons ces alternatives entre directions différentes et souvent contradictoires, que nous ne connaissons donc pas et n’évaluons pas, ce qui nous prive de notre pouvoir de choisir et nous fait perdre une partie non négligeable de nos libertés démocratiques. La société de consommation, l’ordre libéral du monde ne sont pas consubstantiels à la démocratie, mais ont été largement imposés en dehors de toute décision collective. Penser que nous avons devant nous des alternatives, c’est reprendre en main nos existences et décider nous-mêmes de nos vies. C’est pourquoi, à moins d’assimiler la démocratie à la loi du plus puissant et du plus riche, qui a le pouvoir d’influencer les plus faibles et les plus pauvres, nous nous proposons ici un travail démocratique en interrogeant les choix qui sont le plus souvent faits dans notre dos et qui nous ont conduits dans des voies sans issue. Pour qu’en sachant que d’autres choix sont possibles, nous soyons capables de résister au sentiment de fatalité et de retrouver du pouvoir sur nos vies, non seulement individuellement, mais à l’intérieur des groupes auxquels nous appartenons et plus largement à l’intérieur de la société.
Alternatives : parce que penser selon des alternatives, c’est être fidèle à l’ambition démocratique moderne, c’est commencer à dégager des solutions aux graves crises qui émaillent le siècle commençant et qui sèment l’inquiétude à chaque révélation nouvelle sur l’état de la planète. Parce que penser selon des alternatives, c’est grandir, se grandir et, finalement, acquérir une forme de sagesse à la hauteur des temps troublés que nous vivons, une sagesse qui ne se réduise pas à une simple certitude personnelle ou à une sérénité privée, mais qui soit politique et écologique, révolution mentale capable d’amener des changements profonds dans nos rapports avec la nature et avec nous-mêmes.
La crise sanitaire sans précédent de l’année 2020 a fait tomber les masques. Le modèle libéral n’incarne pas la raison, mais seulement un certain ordre des choses construit par des hommes dans l’histoire pour asseoir une domination politique dont on constate toute la puissance aujourd’hui, sous la forme de l’appropriation et de la destruction de la nature réduite à un réservoir de matières premières, sous la forme de la concurrence généralisée, du dumping social et environnemental, sous la forme d’une coalition des élites contre toute limitation de la liberté d’entreprendre. Face à l’épidémie qui a touché l’humanité sans frontières, la politique d’austérité généralisée imposée à l’État social qui a conduit à sélectionner les patients et à mettre les uns sous respirateur artificiel et à «sacrifier » les autres, la concurrence finale entre États pour obtenir des masques, la mise en danger des populations laisseront des traces. Le libéralisme a montré son vrai visage, une odieuse politique d’égoïsme généralisé, centrée sur la production du profit, par indifférence à toute autre considération, qu’elle soit humanitaire, sociale ou écologique.
Les alternatives que nous souhaitons évoquer ont pour objectif de montrer que nous pouvons conquérir le choix entre des options politiques différentes, pour ne pas continuer d’être victimes d’une situation qui produit des dégâts inouïs, dont le coronavirus aura été le révélateur, dans une situation de déni permanent des médias et des élites.
Nous proposons de montrer les destructions engendrées par le libéralisme et de montrer que tel n’est pas l’ordre nécessaire du monde, mais qu’il existe d’autres voies qui ne nous condamnent ni à la bougie, ni à l’autoritarisme, ni aux hiérarchies du passé, ni à l’obscurantisme, ni à « la faim dans le monde » (bien plutôt provoquée par la paupérisation des paysans, acculés à la misère par les grands semenciers). Il convient de décrire ces autres voies, qui sont celles des «jours heureux» (et pas ceux pronostiqués par Emmanuel Macron, pendant l’épidémie, par un tour de passe-passe sémantique et une récupération du principe affirmé par le Conseil national de la résistance en mars 1944), du bonheur pour tous, de la sécurité en un sens global, de la préservation de la Terre et des conditions de la vie, d’une vie digne et décente. Qu’y a-t-il de moderne, de rationnel et de raisonnable, de scientifique dans des politiques qui provoquent depuis des décennies la misère et le chômage, le gaspillage (la destruction du travail humain et le pillage des ressources naturelles), la guerre, le réchauffement climatique et l’extinction des espèces, les migrations humaines dans des conditions désastreuses ?
La «fausse conscience» que nous avons de la réalité dans laquelle nous vivons est produite à la fois par les médias et les représentations du monde qu’ils construisent et par les modes de vie qui s’imposent à nous du fait de la place que nous occupons dans le monde, par le travail, par les besoins qui sont les nôtres et qui nous font dépendre de l’industrie, par les habitudes sociales et culturelles2. Ainsi, d’un côté, nous ne pouvons pas nous passer d’une voiture quand on n’habite pas en ville et de l’autre, non seulement la publicité, mais « l’air du temps », notre appartenance à la société transforment l’automobile en un objet quasiment naturel qu’il est inconcevable de ne pas posséder, sauf à se compliquer l’existence de manière extrême, et encore moins désirer. Il en va de même aujourd’hui avec les outils numériques: d’un côté il est objectivement difficile voire impossible de se passer aujourd’hui d’une adresse mail, d’un numéro de téléphone portable (pour recevoir des sms) et de l’autre, les opérateurs occupent l’espace public et nous tiennent en haleine constante en nous mettant devant les yeux de nouvelles technologies aux opportunités prétendument infinies.
Que répondre face aux injonctions à la puissance, au bonheur, à l’abondance, à l’innovation? Que non seulement il est possible d’y aller voir d’un peu plus près pour en juger sur pièces mais que d’autres possibilités se font peu à peu connaître, qui font passer certains enthousiasmes publicitaires et certains modes de vie que l’industrie a construits sans nous demander notre avis pour des pratiques ridicules et largement mensongères. Qu’il est aussi important de poser la question de l’utilité (et inutilité) éventuelle de l’innovation que d’en jouir. Que la démocratie est une exigence qui doit être prise au pied de la lettre plutôt qu’être réduite à un simple mantra, servant à légitimer toutes les décisions du pouvoir, à défendre nos modes de vie par contraste avec les pénuries permanentes des pays ex-communistes ou à valoriser nos libertés par rapport aux régimes autoritaires.
Jean-Claude Michéa se consacre depuis des années à révéler le sens du libéralisme et à montrer qu’il s’appuie sur une prétendue neutralité axiologique des décisions politiques, qui renvoie tout au marché, c’est-à-dire à l’offre et à la demande, et cantonne toutes les opinions sur le bien, le beau ou le juste au domaine privé, les privant de toute influence publique. L’activité politique doit se réduire à l’organisation des échanges, selon des règles juridiques servant à permettre à chacun d’exercer sa liberté d’agir. Le seul principe qui s’impose est celui de nonnuisance à autrui, dans son être, sa liberté, sa propriété. Toute référence à une idée quelconque de vie commune est considérée comme de nature privée et ferait craindre un retour de l’autoritarisme moral. Seul le marché doit créer du lien, parce que lui seul met en relation des êtres en préservant leur indépendance totale. Tout lien qui serait imposé (ou qui s’imposerait naturellement à la naissance), d’une quelconque manière, pourrait être récusé au nom de la liberté individuelle. « Si parler de vie commune n’a de sens que là où il existe un minimum de valeurs et pratiques morales et culturelles partagées, on doit donc en conclure qu’une politique libérale exclut par définition toute prise en compte théorique de cette dimension anthropologique particulière (sinon, bien entendu, dans le cadre de considérations purement politiciennes et électorales)3.»
Sous couvert de neutralité axiologique et de respect des libertés, le libéralisme impose en fait un ordre politique dans lequel les rapports de force fleurissent et ce qu’on appelle respect des libertés prend alors la forme du libre champ laissé à l’influence politique déterminante des puissants. On voit ainsi de très nombreuses orientations sociales, économiques et environnementales s’imposer à tous, hors tout débat démocratique, au nom de la liberté d’entreprendre et de la fonction de favoriser cette dernière à laquelle doit se réduire la politique dans la logique libérale. C’est au nom du principe démocratique de délibération collective qu’il est donc souhaitable de soumettre à l’examen de nombreux modes de vie qui « nous gouvernent et nous échappent4 ».
L’individu n’est pas naturellement séparé des autres, il dépend depuis son premier souffle d’un entourage, il a donc vocation à appartenir à une société et, à ce titre, à contribuer, en tant qu’être libre et en tant que citoyen, à sa direction. Or, nous en sommes globalement exclus, les élections ne suffisant pas à assurer à quiconque un pouvoir sur les orientations de la société, en raison du poids « politique » que possèdent les grands capitaines d’industrie. Le principe de la démocratie est l’égalité, un homme une voix, c’est pourquoi nous proposons ici d’examiner les alternatives qui existent sur les aspects les plus importants de la vie en société et qui ont été écartées au profit de la pensée unique libérale, au prétexte que seul le marché doit décider, parce qu’il serait à la fois égalitaire et respectueux de la liberté. Le marché, c’est sans doute la liberté, mais tout le monde n’a pas les moyens d’accéder à l’exercice de cette liberté, et l’avantage que les uns possèdent conduit souvent à l’octroi de monopoles ou quasi-monopoles, ici à l’impossibilité de résister à des directions qui sont imposées par les plus puissants, hors tout débat, toute délibération collective et tout vote.
Faire le tour du Monde ou vivre chez soi
Voyager, aller à la découverte d’autres cultures, d’autres manières de vivre, de gens totalement différents. Voyager tous les ans, plusieurs fois par an, sillonner la planète en avion. Asie, Amérique du Nord et du Sud, Océanie. Moins loin, l’Europe. Moins souvent, l’Afrique.
Le transport aérien est devenu bon marché depuis les années 1980, au regard des kilomètres parcourus, et donc accessible à des franges plus importantes de la classe moyenne, grâce à la concurrence, à la guerre des prix et aux compagnies à bas coût (low cost) qui ont imposé leurs tarifs à toutes les autres. Il est maintenant banal (ou presque) de partir deux ou trois fois par an dans un pays d’Europe, du Maghreb ou en Turquie. Plus loin, cela reste plus exceptionnel et réservé aux personnes en retraite, en raison du temps dont il faut disposer et du prix global du voyage, difficile d’accès à une famille avec enfants.
Le voyage est survalorisé aujourd’hui, du fait sans doute de sa facilité et de son peu de dangerosité. Aller voir autre chose, bouger, ne pas rester au même endroit toute l’année. Découvrir des choses nouvelles, belles et instructives. L’avion est devenu le bus des airs, qu’on emprunte (presque) aussi facilement qu’un bus en ville. Sauf qu’il demeure l’attrait du long déplacement, de la nouveauté à l’arrivée, des semaines à passer en immersion à l’étranger (au milieu d’une langue inconnue). Et il demeure surtout l’aura sociale du voyage (surtout lointain), sa banalité dans les milieux privilégiés n’empêchant pas sa rareté dans les autres milieux.
La mobilité s’est accrue tout au long du XXe siècle, pour des raisons professionnelles, d’aménagement du territoire et de loisirs, grâce à l’extraction des énergies fossiles (charbon puis pétrole). Au point d’être considérée comme naturelle et son empêchement comme la violation d’un droit, ce qui est logique dans la mesure où l’on a besoin de se déplacer à partir de chez soi plusieurs fois par jour. Mais à cette mobilité du quotidien, souvent vécue comme une contrainte du fait du temps qui lui est consacré, de son coût et de la fatigue occasionnée, s’ajoute une mobilité positive, celle du mouvement vers des ailleurs porteurs de diversité et de nouveauté. Les métiers qui impliquent une grande mobilité sont souvent valorisés, s’ils occasionnent des déplacements vers d’autres régions et d’autres pays, parce qu’ils sont synonymes de compétences sur le marché de l’emploi et parce qu’ils véhiculent des représentations de changement permanent opposé à l’ennui de la répétition.
Le voyage est en phase avec ce cadre mental. Être immobilisé, c’est être privé d’une capacité fondamentale, laquelle provoque du plaisir, comme le plaisir d’être vivant. L’hôpital, la prison, la maison de retraite, le handicap empêchent ou limitent la mobilité et sont craints pour cette raison. On ne conçoit plus de rester toute sa vie au même endroit.
Il s’agit, de plus, d’un critère de distinction sociale, puisque lorsqu’on n’est pas mobile, on est considéré comme incapable d’évolution, de changement, d’adaptation, comme le requièrent souvent les nouvelles formes du travail qualifié. Sans moyen de transport, sans capacité à bouger, sans maîtrise de l’anglais, on est condamné à rester près de chez soi, ce qui limite souvent l’accès à l’emploi ou du moins l’évolution professionnelle. D’où la tendance très forte, en logique libérale, à culpabiliser les personnes pouvant rencontrer de telles difficultés (bien plus communes qu’on ne le dit), en les rendant responsables, en parlant sans cesse de la nécessité de l’adaptation et de la formation. Comme si la mobilité (quasiment inaccessible dans de nombreux cas) pouvait contrecarrer les délocalisations d’entreprises et le chômage de masse.
Pouvoir se déplacer facilement, voyager pour le plaisir, ne pas rester toujours au même endroit, c’est être moderne. L’immobilité est un avant-goût de la mort. Ce n’est pas une question de style de vie, de choix, mais c’est quelque chose qui s’impose à nous, du fait de l’organisation économique, de l’aménagement territorial et des «attentes de comportement» de la société dans laquelle nous vivons. Ne pas avoir de moyens de transport adéquats à nos besoins, c’est comme ne pas vouloir se bouger. Rester chez soi plutôt que parcourir le monde, surtout si on en a les moyens, c’est comme un crime contre la mobilité.
Mais, au fait, pourquoi bouger? Pourquoi changer de lieu? Pour fuir la banalité du quotidien et l’ennui de la répétition? Ce que l’on recherche quand on part en voyage n’est-ce pas à s’échapper à soi-même et à s’ouvrir à l’aventure, à la différence et au changement? Mais n’est-ce pas que l’on n’est pas bien chez soi ou, pour le dire de manière moins casanière, que l’on n’est pas bien là où l’on est, que « la vraie vie est ailleurs» (Rimbaud)? Alors qu’ailleurs est toujours ailleurs, que l’on emporte sans doute avec soi où que l’on aille et que le voyage n’est le plus souvent qu’un loisir pour homme (ou femme) pressé(e) de savoir si l’herbe est plus verte dans le champ du voisin, quitte à oublier de regarder dans le sien.
La mobilité est un piège quand elle nous domine, quand on ne peut plus s’empêcher de bouger (avoir la bougeotte, disait-on jadis, pour faire la morale aux enfants impatients). Il ne s’agit pourtant pas ici de faire la morale et de regarder avec mépris nos contemporains voyageurs, mais de s’interroger sur le sens, la finalité et les conséquences d’un tel habitus.
Pour bouger comme nous le faisons, nous dépendons des énergies fossiles. Le corps humain comme la traction animale permettent des déplacements limités. Le vélo permet d’augmenter les distances, mais il occasionne vite de la fatigue. Ce qui a changé notre rapport à l’espace, c’est le charbon qui a permis l’apparition du chemin de fer, et le pétrole qui a rendu possible celle de l’automobile. Nous avons du mal à imaginer la griserie ressentie par les premiers usagers de l’automobile. Nous sommes donc profondément dépendants des énergies fossiles et principalement du pétrole, qui alimente quasiment exclusivement les moteurs des voitures, bus et avions que nous empruntons. L’histoire du XXe





























