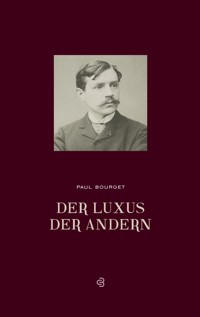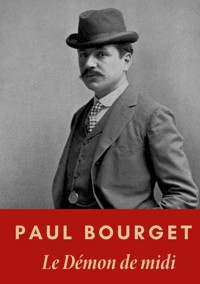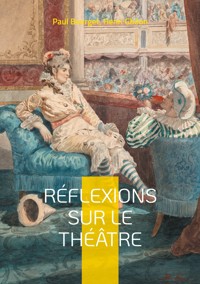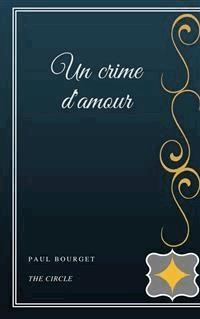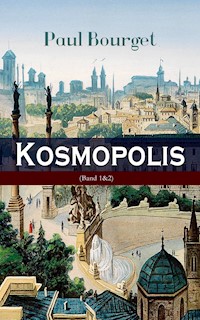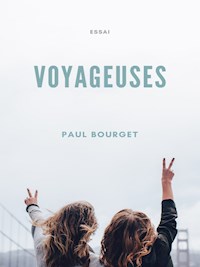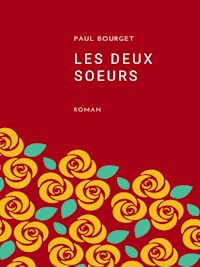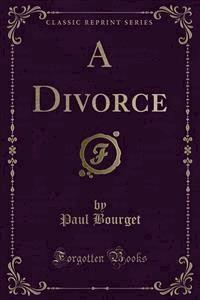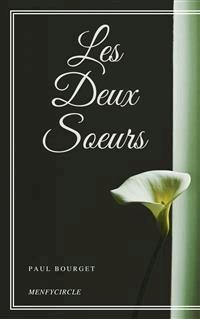Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Quand j'étais enfant, je me confessais. Combien j'ai souhaité de fois être encore celui qui entrait dans la chapelle vers les cinq heures du soir, cette vide et froide chapelle du collège avec ses murs crépis à la chaux, avec ses bancs numérotés, son maigre harmonium, sa criarde Sainte Famille, sa voûte peinte en bleu et semée d'étoiles. Un maître nous amenait dix par dix."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MONSIEUR HIPPOLYTE TAINE
« L’ouvrage auquel on a le plus réfléchi doit être honoré par le nom de l’ami qu’on a le plus respecté… » Permettez-moi, mon cher Maître, d’emprunter cette phrase à la dédicace de votre livre De l’Intelligence, pour vous offrir celle de mes études qui, me semble-t-il, s’éloigne le moins de mon rêve d’art : – un roman d’analyse exécuté avec les données actuelles de la science de l’esprit. Certes, la différence est grande entre votre vaste traité de psychologie et cette simple planche d’anatomie morale, quelque conscience que j’aie mise à en graver le minutieux détail. Mais le sentiment de vénération qu’exprime votre dédicace à l’égard du noble et infortuné Franz Wœpke n’était pas supérieur à celui dont vous apporte aujourd’hui un faible témoignage votre fidèle
PAUL BOURGET.
Paris, 7 janvier 1887.
Quand j’étais enfant, je me confessais. Combien j’ai souhaité de fois être encore celui qui entrait dans la chapelle vers les cinq heures du soir, cette vide et froide chapelle du collège avec ses murs crépis à la chaux, avec ses bancs numérotés, son maigre harmonium, sa criarde Sainte Famille, sa voûte peinte en bleu et semée d’étoiles. Un maître nous amenait, dix par dix. Quand arrivait mon tour de m’agenouiller dans l’une des deux cases réservées aux pénitents sur chaque côté de l’étroite guérite en bois, mon cœur battait à se rompre. J’entendais, sans bien distinguer les paroles, la voix de l’aumônier en train de questionner le camarade à la confession duquel succéderait la mienne. Ce chuchotement me poignait, comme aussi le demi-jour et le silence de la chapelle. Ces sensations, jointes à la honte de mes péchés à dire, me rendaient presque insupportable le bruit de la planchette que tirait le prêtre. À travers la grille, je voyais son regard aigu, son profil si arrêté, quoique le visage fût gras et congestionné. Quelle minute d’angoisse à en mourir, mais aussi quelle douceur ensuite ! Quelle impression de suprême liberté, d’intime allégeance, de faute effacée, et comme d’une belle page blanche offerte à ma ferveur pour la bien remplir ! Je suis trop étranger aujourd’hui à cette foi religieuse de mes premières années pour m’imaginer qu’il y eût là un phénomène d’ordre surnaturel. Où gisait donc le principe de délivrance qui me rajeunissait toute l’âme ? Uniquement dans le fait d’avoir dit mes fautes, jeté au dehors ce poids de la conscience qui nous étouffe. C’était le coup de bistouri qui vide l’abcès. Hélas ! Je n’ai pas de confessionnal où m’agenouiller, plus de prière à murmurer, plus de Dieu en qui espérer ! Il faut que je me débarrasse pourtant de ces intolérables souvenirs. La tragédie intime que j’ai subie pèse trop lourdement sur ma mémoire. Et pas un ami à qui parler, pas un écho où jeter ma plainte. Certaines phrases ne peuvent pas être prononcées, puisqu’elles ne doivent pas avoir été entendues… C’est alors que j’ai conçu l’idée, afin de tromper ma douleur, de me confesser ici, pour moi seul, sur un cahier de papier blanc, – comme je ferais au prêtre. Je jetterai là tout le détail de cette affreuse histoire, morceau par morceau, comme le souvenir viendra. Une fois cette confession finie, je verrai bien si l’angoisse est finie aussi. Ah ! diminuée seulement !… Qu’elle soit moindre ! Que je puisse aller et venir, avoir ma part de la jeunesse et de la vie ! J’ai tant souffert et depuis si longtemps, et je l’aime, cette vie, malgré ces souffrances. Un verre de cette noire drogue, de ce laudanum que j’ai dans un flacon, pour les nuits où je ne dors pas, et cette lente torture de mes remords cesserait du coup.
Mais je ne peux pas, je ne veux pas. L’instinct animal de durer s’agite en moi, plus fort que toutes les raisons morales d’en finir. Vis donc, malheureux, puisque la nature te fait trembler à l’image de la mort. La nature ?… Et c’est aussi que je ne veux pas aller encore là-bas, dans cet obscur monde où l’on se retrouve peut-être. Non, pas cette épouvante-là. Je me suis promis de me posséder, et déjà je me perds. Reprenons. Voici donc mon projet : fixer sur ces feuilles cette image de ma destinée que je ne regarde qu’avec tant de trouble dans le miroir incertain de ma pensée. Je brûlerai ces feuilles quand elles seront couvertes de ma mauvaise écriture. Mais cela aura pris corps et se tiendra devant moi, comme un être. J’aurai mis de la lumière dans ce chaos d’atroces souvenirs qui m’affole. Je saurai où j’en suis de mes forces. Ici, dans cet appartement où j’ai pris la résolution suprême, il m’est trop aisé de me souvenir. Allons ! Au fait ! Je me donne ma parole de tout écrire. – Pauvre cœur, laisse-moi compter tes plaies.
Me souvenir ? – J’ai l’impression d’avoir, durant des années, gravi un calvaire de douleur ! Mais quel fut mon premier pas sur ce chemin tout mouillé de taches de sang ? Par où prendre cette histoire du lent martyre dont je subis aujourd’hui les affres dernières ? Je ne sais plus. – Les sentiments ressemblent à ces plages mangées de lagunes qui ne laissent pas deviner où commence, où finit la mer, vague pays, sables noyés d’eau, ligne incertaine et changeante d’une côte sans cesse reformée et déformée. Cela n’a pas de bornes et pas de contours. On dessine pourtant ces contrées sur la carte, et nos sentiments aussi, nous les dessinons après coup, par la réflexion et avec de l’analyse. Mais la réalité, qu’elle est flottante et mouvante ! Comme elle échappe à l’étreinte ! Énigme des énigmes que la minute exacte où une plaie s’ouvre dans le cœur, – une de ces plaies qui ne se sont pas refermées dans le mien. – Afin de tout simplifier et de ne pas sombrer dans cette douloureuse torpeur de la rêverie qui m’envahit comme un opium, attaquons cette histoire par les évènements. Marquons du moins le fait précis qui fut la cause première et déterminante de tout le reste : cette mort de mon père, si tragique et si mystérieuse. Essayons de retrouver la sorte d’émotion qui me terrassa, dès lors, sans y rien mêler de ce que j’ai compris et senti depuis…
J’avais neuf ans. C’était en 1864, au mois de juin, par une brûlante et claire fin d’après-midi. Comme d’ordinaire, je travaillais dans ma chambre, au retour du lycée Bonaparte, toutes persiennes closes. Nous habitions rue Tronchet, auprès de la Madeleine, dans la septième maison à gauche, en venant de l’église. On accédait à cette petite pièce, coquettement meublée et toute bleue, où j’ai passé les dernières journées complètement heureuses de ma vie, par trois marches cirées sur lesquelles j’ai buté bien souvent. Tout se précise : j’étais vêtu d’un grand sarreau noir, et, assis à ma table, je recopiais les temps d’un verbe latin sur une copie réglée à l’avance et divisée en plusieurs compartiments… J’entendis soudain un grand cri, puis des voix affolées, puis des pas rapides le long du couloir contre lequel donnait la porte de ma chambre. D’instinct, je me précipitai vers cette porte, et, dans le corridor, je me heurtai à un valet de chambre qui courait, tout pâle, une pile de linge à la main, – j’en compris l’usage ensuite. – Je n’eus pas à questionner cet homme. Il m’eut à peine vu qu’il s’écria comme malgré lui :
– « Ah ! Monsieur André, quel affreux malheur !… »
Puis, épouvanté de ses paroles et reprenant son esprit :
– « Rentrez dans votre chambre, rentrez vite… »
Avant que j’eusse pu répondre, il me saisissait dans ses bras, me jetait plutôt qu’il ne me déposait sur les marches de mon escalier, refermait la porte à double tour, et je l’entendais s’éloigner en toute hâte.
– « Non », m’écriai-je en me précipitant sur la porte ; « dites-moi tout, je veux tout savoir… »
Pas de réponse. Je pesai sur la serrure, je frappai le battant de mes poings, je m’arcboutai contre le bois avec mon épaule. Vaines colères ! Et, m’asseyant sur la seconde marche, j’écoutai, fou d’inquiétude, aller et venir dans le couloir les gens qui savaient, eux, « l’affreux malheur », – mais que savaient-ils ? Tout enfant que je fusse, je me rendais compte de la terrible signification que le cri du domestique portait avec lui, dans les circonstances actuelles. Il y avait deux jours que mon père était sorti, suivant son habitude, après le déjeuner, pour se rendre à son cabinet d’affaires, installé depuis quatre ans rue de la Victoire. Il avait été soucieux durant le repas, mais, depuis des mois, son humeur, si gaie jadis, s’était assombrie. Au moment de cette sortie, nous étions à table, ma mère, moi-même et un des familiers de notre maison, un M. Jacques Termonde, que mon père avait connu à l’École de Droit. Mon père s’était levé avant la fin du repas, après avoir regardé la pendule et demandé l’heure exacte.
– « Voyons, Cornélis, vous êtes si pressé ? » avait dit Termonde.
– « Oui, » avait répondu mon père, « j’ai rendez-vous avec un client qui se trouve souffrant… un étranger… Je dois passer à son hôtel pour y prendre des pièces importantes… Un singulier homme et que je ne suis pas fâché de voir de plus près… J’ai fait pour lui quelques démarches, et je suis presque tenté de les regretter. »
Et depuis lors, aucune nouvelle. Le soir de ce jour, quand le dîner, reculé de quart d’heure en quart d’heure, eut eu lieu sans que mon père rentrât, lui, si méticuleux, si ponctuel, ma mère commença de montrer une inquiétude qui ne fit que grandir, et qu’elle put d’autant moins me cacher que les dernières phrases de l’absent vibraient encore dans mes oreilles. C’était chose si rare qu’il parlât ainsi de ses occupations ! La nuit passa, puis une matinée, puis une après-midi. La soirée revint. Ma mère et moi, nous nous retrouvâmes en tête-à-tête, assis à la table carrée où le couvert, tout dressé devant la chaise vide, donnait comme un corps à notre épouvante. M. Jacques Termonde, qu’elle avait prévenu par une lettre, était arrivé après le repas. On m’avait renvoyé tout de suite, mais non sans que j’eusse eu le temps de remarquer l’extraordinaire éclat des yeux de cet homme, – des yeux bleus qui d’habitude luisaient froidement dans ce visage fin, encadré de cheveux blonds et d’une barbe presque pâle. Les enfants ramassent ainsi de menus détails, aussitôt effacés, mais qui réapparaissent plus tard, au contact de la vie, comme certaines encres invisibles se montrent sur le papier à l’approche du feu. Tandis que j’insistais pour rester, machinalement j’observai avec quelle agitation ses belles mains, qu’il tenait derrière son dos, tournaient et retournaient une canne de jonc, objet de mes plus secrètes envies. Si je n’avais pas tant admiré cette canne, et le combat de centaures, travail de la Renaissance, qui se tordait sur le pommeau d’argent, ce signe d’extrême trouble m’eût échappé. Mais comment M. Termonde n’eût-il pas été saisi de la disparition de son meilleur ami ? Sa voix cependant était calme, cette voix si douce qui veloutait chacune de ces phrases, et il disait :
– « Demain, je ferai toutes les recherches, si Cornélis n’est pas revenu… mais il reviendra… Tout s’expliquera après coup… Qu’il soit parti pour l’affaire dont il vous parlait, confiant une lettre à un commissionnaire, et que cette lettre n’ait pas été remise… »
– « Ah ! » disait ma mère, « vous croyez que c’est possible ?… »
Que j’ai souvent évoqué ce dialogue dans mes mauvaises heures, et revu la pièce où il se prononçait, – un étroit salon qu’affectionnait ma mère, tout garni d’étoffes à longues raies rouges et blanches, jaunes et noires, que mon père avait rapportées d’un voyage au Maroc, et je la revoyais, elle aussi, ma mère, avec ses cheveux noirs, ses yeux bruns, sa bouche tremblante. Elle était blanche comme la robe d’été qu’elle portait ce soir-là. M. Termonde était, lui, en redingote ajustée, élégant et svelte. Que cela me fait sourire lorsqu’on parle des pressentiments ! Je m’en allai tout rassuré de ce qu’il avait dit. Je l’admirais d’une manière si enfantine, et, jusque-là, il ne représentait pour moi que des gâteries. J’avais donc assisté aux deux classes du lycée, le cœur sinon tranquille, au moins plus apaisé… Mais, tandis que j’étais assis sur les marches de mon petit escalier, toutes mes inquiétudes avaient recommencé. De temps à autre, je frappais de nouveau sur la porte, j’appelais. On ne me répondait pas, jusqu’au moment où la bonne qui m’avait élevé entra dans ma chambre.
– « Mon père ? » m’écriais-je, « où est mon père ? »
– « Pauvre ! pauvre !… » fit la vieille femme en me prenant dans ses bras.
On l’avait chargée de m’annoncer l’atroce nouvelle. Les forces lui manquaient. Je m’échappai d’elle et courus dans le couloir. J’enfilai deux pièces vides et j’arrivai dans la chambre à coucher de mon père, avant qu’on pût m’arrêter. Ah ! sur le lit, ce corps dont le drap moulait la rigidité, sur l’oreiller cette face exsangue, immobile, avec ses yeux fixes et grands ouverts, comme de quelqu’un à qui l’on n’a pas fermé les paupières, cette mentonnière blanche et cette serviette autour du front, et, au pied, agenouillée, écrasée de douleur, une femme encore vêtue de couleurs gaies… c’était mon père et c’était ma mère ! Je me jetai sur elle comme un insensé. « Mon fils, mon André ! » dit-elle en m’étreignant avec passion. Il y avait dans ce cri une si ardente douleur, une si frénétique tendresse dans cet embrassement, son cœur était si gros de larmes dans cette minute, que j’ai encore chaud jusqu’au fond de l’âme, lorsque j’y pense. Puis, tout de suite, elle m’emporta hors de la chambre, pour que je ne visse plus le spectacle horrible. Ses forces étaient décuplées par l’exaltation. « Dieu me punit ! Dieu me punit !… » répétait-elle sans prendre garde aux paroles qu’elle prononçait. – Elle avait toujours eu des moments de piété mystique. – Et elle couvrait mon visage, mon cou, mes cheveux, de baisers et de larmes. – Pour la sincérité de ces larmes à cette seconde, que toutes nos souffrances, celles du mort et les miennes, te soient, pauvre mère, pardonnées ! Vois-tu, même aux plus noires heures, et quand le fantôme était là, qui m’appelait, du moins ta douleur d’alors a plaidé pour toi plus haut que sa plainte. J’ai pu croire en toi toujours, malgré tout, à cause des baisers de cette seconde. Oui, ces larmes et ces baisers ne cachèrent pas une arrière-pensée. Ton cœur tout entier se révolta contre la terrible aventure qui me privait de mon père. J’en jure par nos sanglots unis de cette seconde, tu n’étais pour rien dans l’affreux complot. Ah ! pardonne-moi d’avoir, encore aujourd’hui, besoin de m’affirmer cela, de redoubler cette évidence. Si tu savais comme on a soif et faim de certitude, quelquefois, – jusqu’à l’agonie.
Quand je demandai à ma mère, à ce moment-là, un récit de l’affreux évènement, elle me dit que mon père avait été frappé d’une attaque dans une voiture, et, comme il n’avait point de papiers sur lui, on était demeuré deux jours sans le reconnaître. Les grandes personnes croient trop volontiers qu’il est également aisé de mentir à tous les enfants. J’étais de ceux qui travaillent longuement en pensée sur les discours qu’on leur tient. À force de mettre ensemble une masse de petits faits, j’arrivai bien vite à voir que je ne savais pas toute la vérité. Si mon père était mort comme on me l’avait raconté, pourquoi le valet de chambre m’avait-il demandé, un jour qu’il me ramenait chez nous, « ce que l’on m’avait dit ? » Et pourquoi cet homme avait-il ensuite gardé le silence, lui si loquace d’ordinaire ? Ce même silence, pourquoi le sentais-je flotter autour de moi, s’abattre sur toutes les bouches, dormir dans tous les regards ? Pourquoi changeait-on sans cesse de sujet de conversation, lorsque j’approchais ? Je le devinais à tant de menus signes ! Pourquoi ne laissait-on plus traîner un seul journal, tandis que, du vivant de mon père, les trois feuilles auxquelles nous étions abonnés se trouvaient toujours sur la table du salon ? Pourquoi surtout, lorsque je rentrai au collège, dans les premiers jours d’octobre, près de quatre mois après ce malheur, les yeux de mes camarades et même ceux des maîtres se fixèrent-ils sur moi si curieusement ? Ce fut, hélas ! cette curiosité qui me révéla toute l’étendue de la catastrophe.
Il n’y avait pas deux semaines que les cours avaient recommencé. Je me trouvais, un matin, à jouer avec deux nouveaux ; je me souviens de leurs noms : Rastouaix et Servoin. Je revois leurs visages, la grosse face bouffie du premier et la mine chafouine du second. C’était dans le quart d’heure de récréation que nous prenions, quoique externes, à l’intérieur, entre la classe de latin et celle d’anglais. Les deux enfants m’avaient retenu, depuis la veille, pour une partie de billes, et voici qu’à la fin de cette partie, s’approchant de moi, s’encourageant du regard, ils me demandent, comme cela, sans préparatifs :
– « Est-ce que c’est vrai qu’on vient d’arrêter l’assassin de ton père ?… »
– « Et qu’on va le guillotiner ?… »
Après seize ans, je ne peux pas me rappeler sans horreur la sorte de battement de cœur qui me saisit à ces deux questions. Je dus devenir affreusement pâle, car les deux étourdis qui m’avaient porté ce coup avec la légèreté de leur âge, – de notre âge, – restèrent là tout décontenancés. Une colère aveugle s’emparait de moi qui me poussait à leur ordonner de se taire et à me jeter sur eux à poings fermés, s’ils continuaient ; une curiosité folle, en même temps ; – si c’était là l’explication de ce silence dont je me sentais enveloppé ? – une timidité aussi, la peur de l’inconnu. Et un flot de sang me monta au visage, tandis que je balbutiais :
– « Je ne sais pas. »
Le tambour qui appelait les élèves en classe nous sépara. Quelle journée je passai, perdu d’angoisse, à prendre et à reprendre les deux phrases qui m’avaient bouleversé ! Il eût été naturel que je questionnasse ma mère, mais le fait est que je me sentis incapable de lui répéter ce que mes deux bourreaux inconscients m’avaient dit. Chose étrange ! Dès cette époque, cette femme que j’aimais pourtant de tout mon cœur exerçait sur moi une influence paralysante. Elle était si belle dans sa pâleur, si royalement belle et fière ! Non, je n’aurais jamais osé lui montrer le doute irrésistible que deux simples demandes d’écoliers avaient soulevé en moi, et instinctivement, sur le récit qu’elle m’avait fait. Mais comme j’aurais étouffé de silence, je pris le parti de m’adresser à Julie, la bonne qui m’avait élevé. C’était une vieille fille de cinquante ans, petite, avec une face plate et ridée comme une pomme trop mûre. Que de bonté dans ses yeux noirs, et sur toute cette face, quoique ses lèvres un peu rentrées, à cause de la chute de ses dents de devant, lui donnassent une bouche de sorcière ! Elle avait pleuré mon père auprès de moi, l’ayant servi autrefois, bien avant son mariage. On la gardait pour mon service particulier et de menus ouvrages, à côté de la femme de chambre, de la cuisinière et du domestique mâle. C’était elle qui me couchait le soir, bordant mon lit, me faisant dire mes prières et me confessant de mes petites peines. « Ah, les mauvais !… » s’écria-t-elle naïvement quand je lui eus ouvert mon cœur et répété les phrases qui m’avaient tant remué, « mais quoi ? On ne pouvait pas te le cacher toujours… » Et ce fut elle qui dans ma chambrette de petit garçon, à voix basse, et tandis que je sanglotais dans mon lit étroit, – oui, ce fut elle qui me raconta la vérité. Du moins elle en souffrait autant que moi, et sa vieille main sèche de travailleuse aux doigts piqués par l’aiguille était bien douce aux boucles de mes cheveux, qu’elle caressait tout en parlant.
Cette lugubre histoire, et qui mit le poids de son mystère impénétrable sur toute ma jeunesse, – je l’ai retrouvée écrite dans les journaux de l’époque, mais pas plus nette qu’elle ne sortit de la bouche fanée de ma vieille bonne. La voici, dans l’aridité de ses détails, telle que je l’ai tournée et retournée, des jours et des jours, avec la stérile espérance d’éclairer d’un rayon ce mystère. Mon père, avocat distingué, avait depuis quelques années quitté la Cour, et acheté, dans l’intention d’arriver plus vite à la grande fortune, un important cabinet d’affaires. Quelques relations officielles, une probité scrupuleuse, une entente accomplie des questions les plus ardues, une puissance rare de travail lui avaient assuré bien vite une place à part. Il occupait dix secrétaires, et le million et demi, dont nous héritâmes, ma mère et moi, n’était que le commencement d’une richesse qu’il voulait considérable, un peu pour lui ; beaucoup pour son fils, mais surtout pour sa femme dont il était follement épris. Les notes et les lettres trouvées dans ses papiers attestèrent qu’il était, à l’époque de sa mort, en correspondance depuis un mois avec un certain William Henry Rochdale, ou soi-disant tel, chargé par la maison Crawford de San-Francisco, d’obtenir du gouvernement français une concession de chemin de fer dans la Cochinchine, alors tout récemment conquise. C’était à un rendez-vous avec ce Rochdale que mon père allait en nous quittant, après avoir déjeuné avec ma mère, M. Termonde et moi-même. Cela, l’instruction n’eut aucune peine à l’établir. Le lieu de ce rendez-vous était l’hôtel Impérial, – un grand bâtiment à longue façade situé rue de Rivoli, pas très loin du ministère de la marine. Les incendies de la Commune ont détruit ce paquet de maisons, mais que de fois, durant mon enfance, j’ai demandé à ma bonne de passer là pour regarder, avec une émotion poignante, la cour garnie de verdures, l’escalier et son tapis, la plaque de marbre noir incrustée de lettres d’or, l’entrée de cette funeste demeure vers laquelle ce pauvre père s’acheminait, tandis que ma mère causait avec M. Termonde et que je jouais auprès d’eux ! Mon père nous avait quittés à midi un quart et il avait dû aller à pied en un quart d’heure, car le concierge de l’hôtel, après avoir vu le cadavre, le reconnut et se rappela que mon père lui avait demandé le numéro des chambres occupées par M. Rochdale, aux environs de midi et demi. Cet étranger était arrivé de la veille, et, après quelque hésitation, il s’était décidé pour un appartement au second étage, composé d’une chambre à coucher et d’un salon, le tout séparé du couloir par une petite pièce. Il n’était pas sorti depuis ce moment, et il avait pris dans son salon le dîner du soir, puis le déjeuner du lendemain. Le concierge se rappelait encore que, vers deux heures, ce même Rochdale était descendu, seul ; mais, habitué aux continuelles allées et venues, cet homme n’avait même pas songé à se demander si le visiteur de midi et demi était ou non reparti. Rochdale avait remis la clef de son appartement, en donnant l’ordre, si quelqu’un venait pour lui, qu’on fît attendre en haut. Il était parti ainsi, de son pas tranquille, une serviette sous le bras, fumant un cigare, et il n’avait point reparu.
La journée se passa. Vers la nuit, les femmes de chambre entrèrent dans l’appartement de l’étranger pour préparer le lit. Elles traversèrent le salon sans y rien remarquer d’anormal. Les bagages du voyageur, composés d’une grande malle très fatiguée et d’un petit nécessaire tout neuf, étaient là, ainsi que les objets de toilette disposés sur la commode. Le lendemain matin, vers midi, les mêmes servantes entrèrent, et, trouvant que le voyageur avait découché, elles ne se donnèrent pas d’autre peine que de recouvrir le lit sans s’occuper du salon. Le même manège se répéta le soir. Ce fut seulement le surlendemain qu’une de ces femmes, étant entrée dans l’appartement au matin, et trouvant de nouveau toutes choses intactes, s’en étonna, fureta un peu et découvrit sous le canapé un corps couché tout du long, la tête enveloppée de serviettes. Au cri qu’elle poussa, d’autres domestiques accoururent, et le cadavre de mon père, – c’était lui, hélas ! – fut tiré de la cachette où l’assassin l’avait placé. Il ne fut pas malaisé de reconstituer la scène du meurtre. Un trou à la nuque indiquait assez que le malheureux avait été tué par-derrière, presque à bout portant, sans doute quand il était assis à la table, examinant des papiers. Le bruit du coup n’avait pas été entendu, en raison de cette proximité même d’une part, puis à cause du fracas de la rue et aussi de la place du salon, isolé derrière son antichambre. D’ailleurs les précautions prises par le meurtrier permettaient de croire qu’il s’était muni d’armes assez soigneusement choisies pour que la détonation fût très légère. La balle avait touché la moelle allongée, et la mort avait dû être foudroyante. L’assassin avait préparé les serviettes toutes neuves et sans chiffres dont il enveloppa aussitôt le visage et le cou de sa victime, afin d’éviter toute trace de sang. Il s’était essuyé les mains à une serviette semblable et il avait employé pour cela l’eau de la carafe, qu’il vida ensuite à nouveau dans cette même carafe qu’on retrouva cachée sous le tablier baissé de la cheminée. Était-ce un vol ou une simulation de vol ? Mon père n’avait plus sur lui ni sa montre, ni son portefeuille, ni aucun papier propre à reconnaître son identité, qu’une indication fortuite découvrit cependant aussitôt. Il portait à l’intérieur de la poche de sa jaquette une petite bande de toile, mise là par son tailleur, avec le numéro de la fourniture et l’adresse de la maison d’où venait le vêtement. On s’y transporta et c’est ainsi que l’après-midi qui suivit la triste découverte, et après les constatations légales, le corps put être déposé chez nous.
Et l’assassin ? Les seules données offertes à la justice furent bien vite épuisées. On ouvrit la malle laissée par ce mystérieux Rochdale ; – mais ce n’était certainement pas son nom ; – elle était remplie d’objets achetés au hasard, comme la malle elle-même, chez un marchand de bric-à-brac que l’on retrouva, et qui donna un signalement très différent de celui qu’avait fourni le concierge de l’hôtel Impérial, car il dépeignit le prétendu Rochdale comme un homme blond et sans barbe, tandis que le concierge le décrivait comme un homme très brun, très barbu, et très basané. On retrouva aussi le fiacre qui avait chargé la malle aussitôt achetée, et la déposition du cocher fut identique à celle du marchand de bric-à-brac. L’assassin s’était fait conduire par ce fiacre, d’abord dans une boutique d’objets de voyage, où il avait acheté un nécessaire, puis dans un magasin de blanc, où il s’était procuré les serviettes, puis à la gare de Lyon, où il avait déposé la malle et le nécessaire à la consigne. On retrouva l’autre fiacre, celui qui trois semaines plus tard l’avait amené de la gare à l’hôtel Impérial, et le signalement donné par ce second cocher se trouva être le même que celui de la déposition du concierge. On en conclut que dans l’intervalle de ces trois semaines l’assassin s’était grimé, – car les témoignages concordaient sur l’allure, le timbre de la voix, les manières et la carrure. – Cette hypothèse fut confirmée par un coiffeur du nom de Jullien, lequel vint raconter de lui-même ce singulier détail : un personnage au teint clair, aux cheveux blonds, glabre, grand et large d’épaules, comme le marchand de bibelots et le premier cocher décrivaient Rochdale, était venu, le mois précédent, à sa boutique, commander une perruque et une barbe assez bien exécutées pour qu’on ne pût le reconnaître. Il s’agissait, disait-il, de figurer dans une soirée costumée. Cet inconnu prit livraison, en effet, d’une perruque et d’une barbe noires ; il se munit de tous les ingrédients nécessaires pour se grimer en Américain du Sud, il acheta du Khôl pour se noircir les paupières, une composition de terre de Sienne et d’ambre pour colorer son teint. Le maquillage lui réussit assez bien pour qu’il pût revenir chez Jullien sans que ce dernier le reconnût. Le coiffeur avait été trop étonné de cette perfection dans le déguisement, et aussi de l’étrangeté de ce bal masqué donné en plein été, pour que son attention ne fût pas attirée lors des articles des journaux sur le mystère de l’hôtel Impérial, comme on appela cette affaire. Mais quoi ? cette révélation rendait plus difficile encore la tâche des magistrats en démontrant quelles précautions avait multipliées l’inconnu. On découvrit chez mon père deux lettres signées Rochdale, datées de Londres, mais sans leurs enveloppes, et toutes deux écrites d’une écriture renversée, que les experts jugèrent simulée. Il avait dû remettre quelque mémoire justificatif. Peut-être mon père le portait-il dans la serviette que l’assassin avait prise aussitôt son crime accompli. La maison Crawford de San-Francisco existait réellement, mais elle n’avait jamais formé le projet d’une entreprise de voie ferrée en Cochinchine. On était en présence d’un de ces problèmes criminels qui défient l’imagination. Ce n’était probablement pas pour voler que l’assassin avait multiplié à ce degré les habiletés de ses ruses. On n’attire pas un homme d’affaires dans un piège combiné avec cette perfection, pour lui dérober quelques billets de mille francs et une montre. Était-ce une vengeance ? On fouilla dans la vie privée de mon père, et l’on découvrit qu’il avait eu quelques-unes de ces faiblesses communes aux jeunes gens de sa classe et de son temps. Il avait été lié autrefois avec une femme mariée, mais cette intrigue était rompue depuis longtemps, et, si le mari l’avait jamais soupçonnée, pourquoi aurait-il attendu, avant de s’en venger, que cette relation fût brisée ? D’ailleurs cet homme, vieux de cinquante-cinq ans à cette époque, engagé dans de grandes entreprises industrielles, n’avait pas un caractère à pousser ainsi une passion jusqu’au crime, et son signalement de Parisien chétif ne correspondait en rien à celui du faux Rochdale. Était-il admissible que sa femme eût voulu se venger, elle, par quelque instrument docile, d’un abandon ancien ? Dans le délire de mes premières recherches, plus tard, j’en suis venu à rêver cela. J’ai tenu à la connaître. Je l’ai vue. Elle avait des cheveux blancs et un fils plus âgé que moi, – qui sait ? peut-être mon frère ? L’étrange impression que je ressentis à songer que mon père avait aimé cette femme qui me regardait avec des yeux où elle ne savait pas que je cherchais une inquiétude ! Et je ne trouvais dans ces beaux yeux bleus, demeurés la seule jeunesse d’un visage vieilli, qu’un attendrissement profond, quelque chose de si doux et de si triste, une telle pitié mélangée à tant de souvenirs que j’eus honte de mes soupçons comme d’une infamie.
La justice, qui n’a pas de ces pudeurs sentimentales, eut-elle ce soupçon comme moi, ou d’autres encore ? S’il en fut ainsi, l’imagination de ses représentants se heurta au point indiscutable et inexplicable, à la réalité de ce Rochdale, dont l’existence ne pouvait pas être contestée, non plus que sa présence à l’hôtel Impérial depuis les sept heures du soir la veille jusqu’à deux heures de l’après-midi le lendemain ; et puis il s’était évanoui, comme un être fantastique, sans qu’une seule trace en demeurât, – une seule. Cet homme était venu, d’autres hommes lui avaient parlé. On savait où il avait passé la nuit et la matinée d’avant le crime. Il avait accompli son œuvre de meurtre, et puis rien. Tout Paris se passionna pour cette affaire, et depuis, lorsque j’ai voulu rechercher la collection des journaux relatifs à elle, j’ai trouvé que, pendant plus de six semaines, les chroniqueurs en avaient parlé chaque matin. Ensuite la rubrique fatale avait disparu des colonnes des journaux, comme le souvenir de cette lugubre énigme s’était effacé de la mémoire des lecteurs, comme le souci de cette enquête de la pensée des limiers de police. La vie avait continué, roulant cette épave dans sa vague qui emporte toutes choses. Oui ; mais moi, le fils ? Comment oublier jamais le récit de la vieille femme, qui avait rempli d’une tragique épouvante ma petite chambre d’enfant ? Comment ne pas revoir toujours et toujours la face pâle de l’assassiné, ses yeux ouverts, sa bouche fermée par une mentonnière, le linge noué de son front ? Comment ne pas dire : je te vengerai, pauvre mort. – Pauvre mort !… – Lorsque je lus l’Hamlet de Shakespeare pour la première fois, avec cette avidité passionnante que donne à l’esprit une analogie entre la situation morale étudiée dans une œuvre d’art et quelque crise de notre propre vie, je me souviens que ce jeune homme me fit horreur. Ah ! si le fantôme de mon père était venu me raconter, à moi, avec ses lèvres sans souffle, le drame qui l’avait tué, aurais-je hésité une minute ? Non ! m’écriai-je ; et puis j’ai tout su, et puis j’ai hésité, comme lui, moins que lui pourtant, à oser l’action terrible. – Silence ! Silence !… Revenons encore aux faits.
Les faits qui suivirent ? Je me les rappelle à peine. Ils furent si petits, si médiocres, entre cette première vision d’épouvante et la vision de tristesse qui lui succéda deux années plus tard. En 1864, mon père mourait. En 1866, ma mère épousait M. Jacques Termonde. Dans l’intervalle de ces deux dates se place une période qui n’est pourtant pas abolie de mon souvenir, car c’est la seule où ma mère se soit occupée de moi avec une attention suivie. Avant la date fatale, c’était mon père, et, plus tard, ce ne fut personne. Nous avions quitté notre appartement de la rue Tronchet, qui nous rappelait trop le sinistre drame, et nous nous installâmes dans un petit hôtel du boulevard de Latour-Maubourg, qui avait appartenu à un peintre amateur. Un mince jardin l’entourait, qui semblait plus grand parce que d’autres jardins verdoyaient derrière son mur d’enclos. Cet hôtel renfermait une espèce de hall qui avait été l’atelier du précédent propriétaire, et dont ma mère fit presque tout de suite sa pièce d’habitation. Il y avait en elle, je le comprends aujourd’hui à distance, quelque chose d’irréel et d’un peu théâtral, mais si naïvement, qui la poussait à exagérer l’expression visible de tous les sentiments qu’elle éprouvait. Tandis qu’elle s’occupait à étudier avec une enfantine coquetterie les attitudes propres à traduire son émotion, elle laissait cette émotion elle-même s’en aller de son cœur. C’est ainsi que, dans l’exil volontaire où elle voulut se cloîtrer après son malheur, ne recevant plus qu’un petit nombre d’amis dont était M. Jacques Termonde, elle recommença bien vite de se parer et de parer toutes choses autour d’elle, avec le goût délicat et subtil qui lui était inné. C’était une femme d’une beauté singulière, mince et pâle, avec des cheveux si longs qu’ils tombaient réellement jusqu’à terre quand elle les peignait devant moi le matin. Devait-elle cette beauté originale de son fin profil, de ses yeux si doux et de sa fragile personne aux gouttes du sang grec qui coulaient dans ses veines ? Son aïeul maternel était un M. Votronto, venu du Levant à Marseille, lors de l’annexion des îles Ioniennes à la France. Toujours est-il que souvent depuis j’ai pensé au contraste étrange de cette beauté si rare et si menue avec la solide et lourde carrure de mon père, et avec la mienne propre. Qui peut dire que ce ne fût pas là une grande cause à tant de malentendus irréparables ? Mais, à cette époque, je ne raisonnais pas. Je subissais le charme de cet être gracieux qui me disait : « mon fils ». Quand elle était assise à son piano dans cet asile élégant qu’elle s’était organisé parmi les étoffes drapées, les plantes vertes et tout un petit décor si à elle, je la contemplais avec une idolâtrie infinie. À cause d’elle, je m’efforçais, malgré ma maladresse native, de me garder bien propre dans les costumes de plus en plus composés qu’elle me faisait porter, et de plus en plus aussi la terrible image de l’assassiné s’effaçait de cet intérieur, – dont toute la délicatesse était cependant payée par la fortune que nous avait laissée son travail à lui. La vie moderne comporte si peu le drame sanglant, les rudes sauvageries du meurtre et de la passion, que les scènes tragiques auxquelles une famille a pu assister semblent bien vite, aux personnes mêmes de cette famille, une espèce de songe, un cauchemar dont il est impossible de douter et auquel on ne croit pourtant pas entièrement.
Oui, la vie avait repris son cours presque normal quand le second mariage de ma mère me fut annoncé. Je me souviens, cette fois, avec une précision minutieuse, non seulement de l’époque, mais du jour et de l’heure. Je me trouvais en vacances chez mon unique tante, une sœur de mon père, vieille demoiselle de quarante-cinq ans, qui habitait Compiègne. Elle vivait là, dans une maison située à l’extrémité de la ville, avec trois domestiques, parmi lesquels était ma bonne Julie, dont le caractère ne convenait pas à maman. Ma tante Louise était petite, avec un air d’une personne de province ; – à peine si elle consentait à visiter Paris pour quarante-huit heures, quand vivait mon père. Elle portait presque toujours une robe de soie noire faite à la maison, avec une ligne de blanc au cou et aux poignets, et autour du cou aussi une vieille chaîne d’or, très longue, qui passait sous son corsage et ressortait à sa ceinture avec sa montre et des breloques anciennes. Quand elle n’avait pas son bonnet à rubans, noirs comme sa robe, ses cheveux grisonnants montraient leurs bandeaux et encadraient un front et des yeux d’une telle expression de douceur, que la pauvre femme plaisait tout de suite, malgré son nez un peu fort, ses lèvres trop larges et son menton trop long. Elle avait élevé mon père ici même, dans cette petite ville de Compiègne. Elle lui avait donné de sa fortune ce qu’elle avait pu distraire des besoins si simples de sa vie. Quand il avait voulu épouser Mlle de Slane, c’était le nom de jeune fille de maman, elle l’avait doté pour que la famille où il voulait entrer s’ouvrît plus aisément devant lui. Combien elle avait souffert depuis deux ans, le contraste entre le portrait que j’avais d’elle dans mon album d’enfant et de son visage actuel le disait assez. Ses cheveux avaient beaucoup blanchi, les rides qui vont des narines aux coins des lèvres s’étaient creusées, ses paupières s’étaient comme flétries. Et cependant elle ne s’était livrée à aucune démonstration. À mon regard de petit garçon observateur, l’antithèse entre le caractère de ma mère et celui de ma tante se précisait dans la différence de leurs douleurs. Alors j’avais de la peine à comprendre la réserve de la vieille fille dont je ne pouvais cependant pas suspecter la tendresse. Aujourd’hui, c’est pour l’autre sorte de nature que je suis injuste. Ma mère aussi avait l’âme tendre, si tendre qu’elle ne s’était pas sentie capable de me révéler sa vie nouvelle, et c’était ma tante qui s’en chargeait. Elle n’avait pas voulu assister au mariage, et M. Termonde avait préféré, je l’ai su depuis, que je n’y assistasse point, afin sans doute d’épargner la sensibilité de celle qui devenait sa femme. Mon Dieu ! comme ma tante Louise, malgré sa surveillance d’elle-même, avait des larmes au bord de ses yeux bruns lorsqu’elle m’emmena dans le fond du jardin, où mon père avait joué, enfant comme moi. Les teintes dorées du mois de septembre commençaient à s’étendre sur le feuillage des arbres. Le berceau sous lequel nous nous assîmes était garni d’une vigne dont les raisins, déjà presque blonds, attiraient un vol bourdonnant de guêpes. Ma tante prit mes deux mains dans les siennes et commença :
– « André, j’ai à te faire part d’une grande nouvelle. »
Je la regardai avec anxiété. De la secousse que m’avait infligée l’affreux évènement, il me restait une sorte de susceptibilité nerveuse. Pour la moindre surprise, mon cœur battait à me faire mal.
– « Ta mère se remarie, » dit simplement la vieille fille, à laquelle mon trouble ne put échapper.
Chose étrange, cette phrase ne me causa pas tout de suite l’impression que mon regard de tout à l’heure aurait fait prévoir. À l’accent de ma tante, j’avais pensé qu’elle allait m’apprendre une maladie de maman ou sa mort. Mon imagination frappée avait de ces peurs. Ce fut donc avec un certain calme que je répondis :
– « Avec qui ? »
– « Tu ne devines pas ? » demanda ma tante.
– « Avec M. Termonde ? » fis-je brusquement.
Encore aujourd’hui, je ne me rends pas compte des raisons qui me poussèrent ce nom aux lèvres, comme cela, tout de suite. Sans doute M. Termonde était venu souvent chez nous depuis le veuvage de ma mère. Mais n’y venait-il pas autant, sinon davantage, avant que ma mère ne fût veuve ? Ne s’était-il pas occupé du détail de nos affaires avec une fidélité que je comprenais dès lors être bien rare ? Et pourquoi la nouvelle de son mariage avec ma mère m’apparaissait-elle tout d’un coup comme plus triste que si elle eût épousé n’importe quel autre ? C’est la sensation contraire qui aurait dû se produire, semblait-il. Je connaissais cet homme depuis si longtemps. Il m’avait beaucoup gâté autrefois, et il me gâtait encore. Mes plus beaux jouets m’étaient venus de lui, et mes plus beaux livres, – un merveilleux cheval de bois quand j’avais sept ans, qui marchait avec une mécanique ; avais-je assez amusé mon pauvre père en lui disant de ce cheval qu’il était « deux fois pur sang » ? – le Don Quichotte