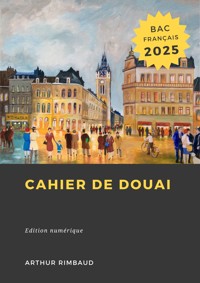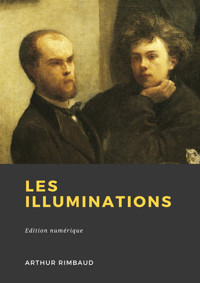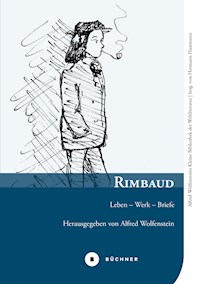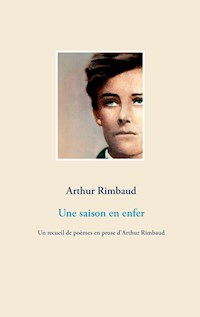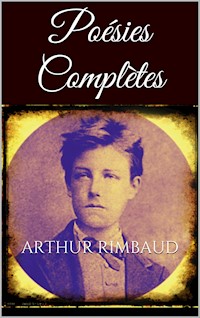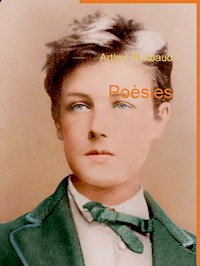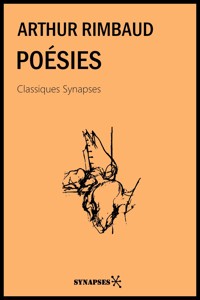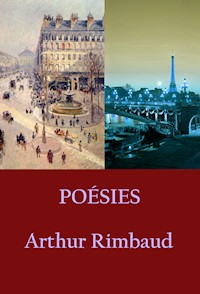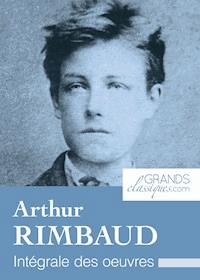
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Toutes les œuvres d’Arthur Rimbaud réunies en un seul ebook
Découvrez l'œuvre d’Arthur Rimbaud dans son ensemble et emmenez-la partout avec vous !
À propos de la collection GrandsClassiques.com :
La collection GrandsClassiques.com a pour objectif de mettre à disposition des lecteurs les œuvres complètes des incontournables de la littérature. Un soin tout particulier est apporté à ces versions afin de garantir une qualité de lecture optimale.
Dans la même collection :
• Ésope
• Héraclite
• Jean de la Fontaine
• Guy de Maupassant
• Jean Racine
• Virgile
• Émile Zola• Guillaume Apollinaire• Henri Bergson• Honoré de Balzac• Charles Baudelaire• Homère• Pierre de Marivaux• Marcel Proust
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Note de l'éditeur
GrandsClassiques.com met à disposition des lecteurs les œuvres intégrales des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature.
Si un soin tout particulier a été apporté à ces versions numériques afin de garantir une lecture la plus agréable qui soit, il n'est toutefois pas impossible que quelques erreurs ou coquilles subsistent.
N'hésitez donc pas à nous contacter pour toute remarque ou demande d'informations à l'adresse suivante : info]grandsclassiques.com
L'équipe deGrandsClassiques.com
Biographie de l'auteur
Arthur Rimbaud, l’enfant terrible
Enfant doté d’un talent littéraire précoce, Rimbaud compose la totalité de ses poèmes avant ses vingt ans. Précurseur d’un nouveau souffle poétique, il annonce avec son style rebelle et anarchiste la poésie du XXe siècle. Il choisit de mettre un terme à sa carrière littéraire pour entamer de longs voyages, dont certains le mènent en Abyssinie et au Yémen. Adolescent turbulent, il reste aujourd’hui encore l’une des figures majeures de la littérature française.
Arthur Rimbaud naît à Charleville le 20 octobre 1854. En raison des nombreuses affectations militaires de son mari, sa mère décide de quitter le domicile familial en 1861. Ce déménagement marque également le début de la scolarité du jeune Arthur à l’institution Rossat. Excellent élève, il collectionne au fil des années scolaires les premiers prix des concours. À partir de son entrée au collège municipal de Charleville en 1865, il se distingue notamment pour sa plume littéraire et son talent de linguiste et de traducteur. C’est à cette époque qu’il compose ses premiers textes poétiques, le plus souvent en latin. En 1870, il est l’élève de Georges Izambard, professeur de rhétorique. Il l’initie davantage à la littérature et les deux hommes entament ce qui sera une longue amitié. La même année, il publie dans La Revue pour tous le poème Les Etrennes des orphelins. Dans ce texte, les inspirations de Rimbaud sont sensibles et notables. Se réclamant des écrivains du Parnasse, il n’hésite pas à envoyer quelques-uns de ses vers à Théodore de Banville, affirmant son ambition de rejoindre le groupe poètes. Mais ses écrits ne seront pas publiés.
Attiré par l’ambiance insurrectionnelle à Paris et ne pouvant subir plus longtemps le caractère oppressant de sa mère, Rimbaud décide de fuguer pour se rendre à la capitale. Arrivé à la Gare du Nord, il est arrêté et incarcéré à la prison de Mazas, car il ne peut présenter un titre de transport en règle. Pour sortir de prison, il envoie une lettre à Izambard en lui priant de payer sa dette. Le professeur accepte, et recueille l’adolescent à Douai, avant que ce dernier ne regagne Charleville. Le tempérament révolutionnaire de Rimbaud est palpable : il est déterminé à accompagner Izambard qui se porte volontaire dans la Garde Nationale. Mais n’étant pas majeur, sa demande est refusée. Rimbaud fuit de nouveau le domicile familial quelques semaines plus tard et se rend à Charleroi, aspirant à retrouver Izambard. Cet épisode est relaté dans le sonnet Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir. Ambitionnant une carrière de journaliste, il essaye de se faire embaucher comme rédacteur pour le Journal de Charleroi. Il est finalement ramené à Charleville. En 1871, il échappe encore à la vigilance de sa mère et part pour Paris, où il espère rencontrer ceux qui seront les figures emblématiques de la Commune, comme Jules Vallès ou Eugène Vermesch. À dix-sept ans, son style se durcit, devient cynique et acerbe. Employant un ton sarcastique, il attaque les romantiques et les parnassiens qu’il admirait tant autrefois.
Alors qu’il rentre à Charleville, Charles Bretagne le met en relation avec Verlaine. Ce dernier l’invite à Paris et lui fait découvrir les groupes poétiques, notamment celui des Vilains Bonshommes. Cette passion amoureuse correspond à l’acmé littéraire de l’adolescent : il compose ses poèmes les plus connus, dont Les Premières Communions et Le Bateau ivre. Ce dernier texte illustre son intention de dessiner une « poésie subjective », renonçant aux descriptions réalistes. Mais le tempérament tumultueux de Rimbaud agace et provoque de terribles accidents. Il frappe le photographe Carjat au cours d’une réunion des Vilains Bonshommes en 1872. Alors que le jeune homme loge chez Verlaine, les deux hommes partent pour Londres et Bruxelles en 1872, et entament l’une des liaisons les plus sulfureuses de l’histoire littéraire française. Rapidement, la passion devient dévastatrice : Verlaine menace de se tuer si Rimbaud refuse qu’il retourne auprès de sa femme. L’adolescent envisage alors la rupture, mais complètement saoul et fou de jalousie, Verlaine lui tire dessus et le blesse superficiellement au poignet. Pour se rétablir, Rimbaud retourne à la ferme de ses grands-parents maternels à Roche, où il écrit son recueil de poèmes en prose Une saison en enfer, aux influences autobiographiques indéniables. C’est à cette époque qu’il achève la composition du recueil Illuminations, qui constitue une véritable révolution poétique. Dans les poèmes Marine et Mouvement, il emploie pour la première fois le vers libre, symbolisant la poésie moderne de la fin du XIXe siècle. Agé d’à peine vingt ans, il choisit de mettre un terme à sa carrière littéraire pour se consacrer aux études linguistiques.
Il part ainsi pour Stuttgart en 1875 pour approfondir ses notions d’allemand, puis à Milan pour apprendre l’italien. De retour de ses pérégrinations, il souhaite voyager davantage : il fait une première étape en Autriche en 1876, mais est victime d’un vol à Vienne et est arrêté pour vagabondage. Une fois revenu à Charleville, il décide de se présenter au bureau de recrutement de l’armée coloniale néerlandaise. Engagé pour six ans, Rimbaud déserte son poste et part pour l’Indonésie où il embarque à bord du Wandering Chief qui a pour destination Queenstown en Irlande. Après ces périples à travers les mers, « Rimbald le marin » rêve de nouvelles destinations en 1877. Il part pour Marseille pour atteindre Alexandrie afin de trouver un emploi. Il devient chef de chantier sur l’île de Chypre. Malade, il est contraint de retourner à Roche en 1879. À plusieurs reprises, sa faible santé compromettra d’ailleurs ses projets professionnels et de voyage. Maîtrisant la langue arabe, il est employé en 1880 comme surveillant de café à Aden, au Yémen. À cette époque, il effectue plusieurs étapes commerciales en Afrique, notamment à Harar en Abyssinie. En 1885, on lui propose de participer à un trafic d’armes et de munitions au Choa entre l’Europe et l’Afrique. Il parcourt ainsi plusieurs zones géographiques alors inexplorées. Après ces commerces non conventionnels, Rimbaud choisit de s’établir à Harar. En 1891, de nombreux rhumatismes et des douleurs persistantes aux jambes l’obligent à retourner en Europe. Il doit être rapidement amputé et entame sa convalescence à Roche. Malgré ses graves problèmes de santé, il nourrit l’espoir de retourner à Harar. Il part pour Marseille, mais meurt épuisé par le voyage le 10 novembre 1891.
Ses œuvres principales
Une saison en enfer
, recueil de poésie, 1873
Voyelles et Le Bateau ivre (Les Poètes maudits)
, poèmes, 1884
Le Dormeur du val
, recueil de poésie, 1891
Illuminations
, recueil de poésie, publié dans son intégralité à titre posthume en 1895
Quelques citations
« L'amour est à réinventer. »
« La morale est la faiblesse de la cervelle. »
« La nature n'est qu'un spectacle de bonté. »
Une saison en enfer, 1873
« À noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, Je dirai quelque jour vos naissances latentes. »
Voyelles (Les Poètes maudits), 1884
« Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. »
Le Bateau ivre (Les Poètes maudits), 1884
Premiers vers
(1869 - 1871)
Note de l'éditeur
Dans ce volume, les pièces de vers, rigoureusement placées par ordre chronologique, se subdivisent en trois périodes. La première est l'année scolaire 1869-1870 : Rimbaud a quinze ans. La deuxième est l'année de la guerre. Dans la troisième le poète s'inspire des événements de la Commune et achève ses seize ans par le Bateau Ivre, avec lequel, à Paris, il fera en Octobre 1871, son apparition dans le monde des lettres.
Introduction par Paterne Berrichon
Fils d'un capitaine d'origine franc-comtoise et d'une terrienne ardennaise, Jean-Arthur Rimbaud naquit le 20 octobre 1854 à Charleville, où il fit de mémorables études. À sept ans, dit-il lui-même, il faisait des romans sur la vie du grand désert. Le premier de ses poèmes publiés, Les Etrennes des Orphelins, date de 1869. La guerre de 1870 et la Commune l'émurent en pleine puberté et déterminèrent ses premières fugues en même temps qu'elles excitèrent son génie littéraire.
Le Bateau ivre et les plus substantielles de ses pièces en vers réguliers sont de sa seizième année. À dix-sept ans il composa Les Illuminations ; à dix-huit ans Une Saison en Enfer. Puis, abandonnant tout de la vie littéraire, durant sept années, il erra silencieusement et pauvrement à travers le monde. En 1880, il débarquait à Aden. Et c'est en Ethiopie qu'il passa les onze dernières années de son existence dans une activité incroyable, explorant, commerçant, traçant des voies ; civilisant, armant les Abyssins dont il parlait la langue, qui le vénéraient et dont les chefs, Ménélick, Makonnen, d'autres, devinrent ses amis et, sans doute, ses disciples.
En 1891, atteint d'un sarcome du fémur, il se fit transporter en France ; à Marseille d'abord, où on l'amputa de sa jambe droite, puis à Roche, dans sa famille, où sa sœur Isabelle l'assista avec un merveilleux dévouement. En proie aux plus atroces souffrances, il voulut quand même retourner en Abyssinie ; mais, obligé par l'aggravation de son mal, de s'arrêter à Marseille, il y mourut comme un saint dans les bras de sa sœur, le 10 novembre 1891.
Grandiose unité de vie, en dépit des apparences ! Car, si, de seize à dix-huit ans, Rimbaud fut un prodigieux poète, durant sa trentaine, dans l'Orient africain, il fut, selon une communication récente de M. Lagarde, ancien gouverneur d'Obock, « un prophète ayant des fidèles qui s'empressaient autour de lui, suscitant les jalousies et les haines des cadis et des muphtis qui essayèrent de le faire tuer sur place ».
Paterne Berrichon.
Proses liminaires
Narration
Trouvée dans un Cahier de Pensums de l'Année scolaire
1862 – 1863
Le soleil était encore chaud ; cependant il n'éclairait presque plus la terre ; comme un flambeau placé devant les voûtes gigantesques ne les éclaire plus que par une faible lueur, ainsi le soleil, flambeau terrestre, s'éteignait en laissant échapper de son corps de feu une dernière et faible lueur, laissant encore cependant voir les feuilles vertes des arbres, les petites fleurs qui se flétrissaient, et le sommet gigantesque des pins, des peupliers et des chênes séculaires. Le vent rafraîchissant, c'est-à-dire une brise fraîche, agitait les feuilles des arbres avec un bruissement à peu près semblable à celui que faisait le bruit des eaux argentées du ruisseau qui coulait à mes pieds. Les fougères courbaient leur front vert devant le vent. Je m'endormis, non sans m'être abreuvé de l'eau du ruisseau.
Je rêvai que... j'étais né à Reims, l'an 1503.
Reims était alors une petite ville ou, pour mieux dire, un bourg cependant renommé à cause de sa belle cathédrale, témoin du sacre du roi Clovis.
Mes parents étaient peu riches, mais très honnêtes : ils n'avaient pour tout bien qu'une petite maison qui leur avait toujours appartenu et qui était en leur possession vingt ans avant que je ne fus encore né, en plus, quelques mille francs auxquels il faut encore ajouter les petits louis provenant des économies de ma mère.
Mon père était officier1 dans les armées du roi. C'était un homme grand, maigre, chevelure noire, barbe, yeux, peau de même couleur... Quoiqu'il n'eût guère, quand j'étais né, que 48 ou 50 ans, on lui en aurait certainement bien donné 60 ou... 58. Il était d'un caractère vif, bouillant, souvent en colère et ne voulant rien souffrir qui lui déplût.
Ma mère était bien différente : femme douce, calme, s'effrayant de peu de chose, et cependant tenant la maison dans un ordre parfait. Elle était si calme que mon père l'amusait comme une jeune demoiselle. J'étais le plus aimé. Mes frères étaient moins vaillants que moi et cependant plus grands. J'aimais peu l'étude, c'est-à-dire d'apprendre à lire, écrire et compter... Mais si c'était pour arranger une maison, cultiver un jardin, faire des commissions, à la bonne heure, je me plaisais à cela.
Je me rappelle qu'un jour mon père m'avait promis vingt sous, si je lui faisais bien une division ; je commençai ; mais je ne pus finir. Ah ! combien de fois ne m'a-t-il pas promis... de sous, des jouets, des friandises, même une fois cinq francs, si je pouvais lui... lire quelque chose... Malgré cela, mon père me mit en classe dès que j'eus dix ans. Pourquoi me disais-je apprendre du grec, du latin ? je ne le sais. Enfin, on n'a pas besoin de cela. Que m'importe à moi que je sois reçu... à quoi cela sert-il d'être reçu, à rien, n'est-ce pas ? Si, pourtant ; on dit qu'on n'a une place que lorsqu'on est reçu. Moi, je ne veux pas de place ; je serai rentier. Quand même on en voudrait une, pourquoi apprendre le latin ? Personne ne parle cette langue. Quelquefois j'en vois sur les journaux ; mais, dieu merci, je ne serai pas journaliste. Pourquoi apprendre et de l'histoire et de la géographie ? On a, il est vrai, besoin de savoir que Paris est en France, mais on ne demande pas à quel degré de latitude. De l'histoire, apprendre la vie de Chinaldon, de Nabopolassar, de Darius, de Cyrus, et d'Alexandre, et de leurs autres compères remarquables par leurs noms diaboliques, est un supplice ?
Que m'importe à moi qu'Alexandre ait été célèbre ? Que m'importe... Que sait-on si les latins ont existé ? C'est peut-être quelque langue forgée ; et quand même ils auraient existé, qu'ils me laissent rentier et conservent leur langue pour eux. Quel mal leur ai-je fait pour qu'ils me flanquent au supplice ? Passons au grec... Cette sale langue n'est parlée par personne, personne au monde !...
Ah ! saperlipotte de saperlipopette ! sapristi ! moi je serai rentier ; il ne fait pas si bon de s'user les culottes sur les bancs, saperlipopettouille !
Pour être décrotteur, gagner la place de décrotteur, il faut passer un examen ; car les places qui vous sont accordées sont d'être ou décrotteur, ou porcher, ou bouvier. Dieu merci, je n'en veux pas, moi, saperlipouille ! Avec ça des soufflets vous sont accordés pour récompense ; on vous appelle animal, ce qui n'est pas vrai, bout d'homme, etc...
Ah ! saperpouillotte !...
(La suite prochainement).
Arthur.
Charles d'Orléans à Louis XI
Devoir de classe
Sire, le temps a laissé son manteau de pluie ; les fourriers d'été sont venus : donnons l'huis au visage à Mérencolie ! Vivent les lais et ballades, moralités et joyeusetés ! Que les clercs de la Basoche nous montrent les folles soties ; allons ouïr la moralité du Bien-Avisé et du Mal-Avisé, et la conversion du clerc Théophilus, et comme allèrent à Rome Saint Pierre et Saint Paul et comment y furent martyres ! Vivent les dames à rebrassés collets, portant atours et broderies ! N'est-ce pas, Sire, qu'il fait bon dire sous les arbres, quand les cieux sont vêtus de bleu, quand le soleil clair luit, les doux rondeaux, les ballades haut et clair chantées ? J'ai un arbre de la plante d'amour, ou une fois me dites oui, madame ou Riche amoureux a toujours l'avantage... Mais me voilà bien esbaudi, Sire, et vous allez l'être comme moi : maître François Villon, le bon folâtre, le gentil raillard qui rima tout cela, engrillonné, nourri d'une miche et d'eau, pleure et se lamente maintenant au fond du Châtelet. Pendu serez ! lui a-t-on dit devant notaire ; et le pauvre follet tout transi a fait son épitaphe pour lui et ses compagnons, et les gracieux gallands dont vous aimez tant les rimes s'attendent danser à Montfaucon, plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre, dans la bruine et le soleil !
Oh ! Sire, ce n'est par folle plaisance qu'est là Villon. Pauvres housseurs ont assez de peine ! Clergeons attendant leur nomination de l'université, musards, montreurs de singes, joueurs de rebec qui payent leur écot en chansons, chevaucheurs d'écuries, sires de deux écus, reîtres cachant leur nez en pots d'étain mieux qu'en casques de guerre, tous ces pauvres enfants secs et noirs comme écouvillons, qui ne voient de pain qu'aux fenêtres, que l'hiver emmitoufle d'onglée, ont choisi maître François pour mère nourricière ! Or, nécessité fait gens méprendre et faim saillir le loup du bois : peut-être l'écolier, un jour de famine, a-t-il pris des tripes au baquet des bouchers pour les fricasser à l'abreuvoir Popin ou à la taverne du Pestel ? Peut-être a-t-il pippé une douzaine de pains au boulanger, ou changé à la Pomme-de-Pin un broc d'eau claire pour un broc de vin de Bagneux ? Peut-être, un soir de grand galle, au Plat-d'Etain, a-t-il rossé le guet à son arrivée ; ou les a-t-on surpris, autour de Montfaucon, dans un souper, conquis par noise, avec une dizaine de ribaudes ? — Ce sont méfaits de maître François. Puis, parce qu'il nous montre un gras chanoine mignonnant avec sa dame en chambre bien nattée, parce qu'il dit que le chapelain n'a cure de confesser, sinon chambrières et dames, et qu'il conseille aux dévotes, par bonne mocque, parler de contemplation sous les courtines, l'écolier fol, si bien riant, si bien chantant, gent comme émerillon, tremble sous les griffes des grands juges, ces terribles oiseaux noirs que suivent corbeaux et pies ! Lui et ses compagnons, pauvres piteux, accrocheront un nouveau chapelet de pendus aux bras de la forêt ; le vent leur fera chandeaux dans le doux feuillage sonore. Et vous. Sire, comme tous ceux qui aiment le poète, ne pourrez rire qu'en pleurs en lisant ses joyeuses ballades et songerez qu'on a laissé mourir le gentil clerc qui chantait si follement, et ne pourrez chasser Mérencolie !
Pippeur, larron, maître François est pourtant le meilleur fils du monde. Il rit des grasses soupes jacobines, mais il honore ce qu'a honoré l'église de Dieu et Madame la Vierge et la Très Sainte Trinité ! Il honore la Cour de Parlement, mère des bons et sœur des benoîts anges ! Aux médisants du royaume de France, il veut presque autant de mal qu'aux taverniers qui brouillent le vin ! Et dea ! il sait bien qu'il a trop galle au temps de sa jeunesse folle. L'hiver, les soirs de famine, auprès de la fontaine Maubuay ou dans quelque piscine ruinée, assis à croppetons devant un petit feu de chenevottes, qui flambe par instants pour rougir sa face maigre, il songe qu'il aurait maison et couche molle, s'il eût étudié !... Souvent, noir et flou comme chevaucheur d'escovettes, il regarde dans les logis par des mortaises : « O ces morceaux savoureux et friands, ces tartes, ces flans, ces grasses gelines dorées ! — Je suis plus affamé que Tantalus ! — Du rôt ! du rôt ! Oh ! cela sent plus doux qu'ambre et civettes ! — Du vin de Beaune dans de grandes aiguières d'argent ! — Haro, la gorge m'ard !... O, si j'eusse étudié !... — Et mes chausses qui tirent la langue, et ma hucque qui ouvre toutes ses fenêtres, et mon feutre en dents de scie ! — Si je rencontrais un pitoyable Alexander pour que je puisse, bien recueilli, bien débouté, chanter à mon aise comme Orpheus, le doux ménétrier ! — Si je pouvais vivre en honneur une fois avant de mourir !... » Mais, voilà : souper de rondels, d'effets de lune sur les vieux toits, d'effets de lanternes sur le sol, c'est très maigre, très maigre ; puis passent, en justes cottes, les mignottes villotières qui font chosettes mignardes pour attirer les passants ; puis le regret des tavernes flamboyantes, pleines du cri des buveurs heurtant les pots d'étain et souvent les flamberges, du ricanement des ribaudes et du chant âpre des rebecs mendiants ; le regret des vieilles ruelles noires où saillent follement, pour s'embrasser, des étages de maisons et des poutres énormes, où, dans la nuit épaisse, passent, avec des sons de rapières traînées, des rires et des braieries abominables... Et l'oiseau rentre au vieux nid : tout aux tavernes et aux filles !... Oh ! Sire, ne pouvoir mettre plumail au vent par ce temps de joie ! La corde est bien triste en mai, quand tout chante, quand tout rit, quand le soleil rayonne sur les murs les plus lépreux ! Pendus seront, pour une franche repue ! Villon est aux mains de la Cour de Parlement : le corbel n'écoutera pas le petit oiseau ! Sire, ce serait vraiment méfait de pendre ces gentils clercs : ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas ; laissez-les vivre leur vie étrange, laissez les avoir froid et faim, laissez-les courir, aimer et chanter : ils sont aussi riches que Jacques Cœur, tous ces fols enfants, car ils ont des rimes plein l'âme, des rimes qui rient et qui pleurent, qui nous font rire et pleurer : laissez-les vivre ! Dieu bénit tous les miséricordieux, et le monde bénit les poètes.
1. Colonel de Cent-gardes.
Partie I
1869-1870
Les étrennes des orphelins
I
La chambre est pleine d’ombre.
On entend vaguement
De deux enfants le triste et doux chuchotement.
Leur front se penche, encore alourdi par le rêve,
Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève.
Au dehors, les oiseaux se rapprochent, frileux ;
Leur aile s’engourdit sous le ton gris des cieux.
Et la nouvelle année, à la suite brumeuse,
Laissant traîner les plis de sa robe neigeuse,
Sourit avec des pleurs et chante en grelottant.
II
Or les petits enfants, sous le rideau flottant,
Parlent bas, comme on fait dans une nuit obscure.
Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure.
Ils tressaillent souvent à la claire voix d’or
Du timbre matinal qui frappe et frappe encor
Son refrain métallique en son globe de verre.
Et la chambre est glacée. On voit traîner à terre,
Epars autour des lits, des vêtements de deuil.
L’âpre bise d’hiver, qui se lamente au seuil,
Souffle dans le logis son haleine morose.
On sent dans tout cela qu’il manque quelque chose...
Il n’est donc point de mère à ces petits enfants,
De mère au frais sourire, aux regards triomphants ?
Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée,
D’exciter une flamme à la cendre arrachée,
D’amonceler sur eux la laine et l’édredon ?
Avant de les quitter, en leur criant : pardon !
Elle n’a point prévu la froideur matinale,
Ni bien fermé le seuil à la bise hivernale ?...
— Le rêve maternel, c'est le tiède tapis,
C’est le nid cotonneux où les enfants, tapis
Comme de beaux oiseaux que balancent les branches,
Dorment leur doux sommeil plein de visions blanches
Et là, c’est comme un nid sans plumes, sans chaleur,
Où les petits ont froid, ne dorment pas, ont peur ;
Un nid que doit avoir glacé la bise amère...
III
Votre cœur l’a compris : ces enfants sont sans mère.
Plus de mère au logis ! — et le père est bien loin !...
Une vieille servante, alors, en a pris soin.
Les petits sont tout seuls en la maison glacée...
Orphelins de quatre ans, voilà qu’en leur pensée
S’éveille, par degrés, un souvenir riant.
C’est comme un chapelet qu’on égrène en priant :
Ah ! quel beau matin que le matin des étrennes !
Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes,
Dans quelque songe étrange où l’on voyait joujoux,
Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux
Tourbillonner, danser une danse sonore,
Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore.
On s’éveillait matin, on se levait joyeux,
La lèvre affriandée, en se frottant les yeux ;
On allait, les cheveux emmêlés sur la tête,
Les yeux tout rayonnants comme aux grands jours de fête
Et les petits pieds nus effleurant le plancher,
Aux portes des parents tout doucement toucher ;
On entrait ; puis, alors, les souhaits... en chemise,
Les baisers répétés, et la gaieté permise !
IV
Ah ! c’était si charmant, ces mots dits tant de fois...
— Mais comme il est changé, le logis d’autrefois !
Un grand feu pétillait, clair, dans la cheminée.
Toute la vieille chambre était illuminée ;
Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer,
Sur les meubles vernis aimaient à tournoyer.
L’armoire était sans clefs, sans clefs la grande armoire !
On regardait souvent sa porte brune et noire :
Sans clefs, c’était étrange ! On rêvait bien des fois
Aux mystères dormant entre ses flancs de bois ;
Et l’on croyait ouïr, au fond de la serrure
Béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure...
— La chambre des parents est bien vide aujourd’hui !
Aucun reflet vermeil sous la porte n’a lui.
Il n’est point de parents, de foyer, de clefs prises ;
Partant, point de baisers, point de douces surprises.
Oh ! que le jour de l’an sera triste pour eux !...
Et, tout pensifs, tandis que de leurs grands yeux bleus
Silencieusement tombe une larme amère,
Ils murmurent : « Quand donc reviendra notre mère ? »
V
Maintenant, les petits sommeillent, tristement.
Vous diriez, à les voir, qu’ils pleurent en dormant,
Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible :
Les tout petits enfants ont le cœur si sensible !...
Mais l’ange des berceaux vient essuyer leurs yeux,
Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux,
Un rêve si joyeux que leur lèvre mi-close,
Souriante, paraît murmurer quelque chose.
Ils rêvent que, penchés sur leur petit bras rond,
Doux geste du réveil, ils avancent le front ;
Et leur vague regard tout autour d’eux repose.
Ils se croient endormis dans un paradis rose...
Au foyer plein d’éclairs chante gaiement le feu ;
Par la fenêtre, on voit là-bas un beau ciel bleu ;
La nature s’éveille et de rayons s’enivre ;
La terre, demi-nue, heureuse de revivre,
À des frissons de joie aux baisers du soleil,
Et, dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil,
Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre,
La bise sous le seuil a fini par se taire :
On dirait qu’une fée a passé dans cela !...
Les enfants, tout joyeux, ont jeté deux cris... Là,
Près du lit maternel, sous un beau rayon rose,
Là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose.
Ce sont des médaillons argentés, noirs et blancs,
De la nacre et du jais aux reflets scintillants,
Des petits cadres noirs, des couronnes de verre,
Ayant trois mots gravés en or : « À NOTRE MÈRE ! »
Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien.
Mais l’amour infini me montera dans l’âme ;
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, — heureux comme avec une femme.
Mars 1870
Le forgeron
Palais des Tuileries, vers le 10 Août 1792
I
Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant
D’ivresse et de grandeur, le front vaste, riant,
Comme un clairon d’airain, avec toute sa bouche,
Et prenant ce gros-là dans son regard farouche,
Le Forgeron parlait à Louis Seize, un jour
Que le peuple était là, se tordant tout autour
Et sur les lambris d’or traînant sa veste sale.
Or le bon roi, debout sur son ventre, était pâle,
Pâle comme un vaincu qu’on prend pour le gibet,
Et, soumis comme un chien, jamais ne regimbait,
Car ce maraud de forge aux énormes épaules
Lui disait de vieux mots et des choses si drôles,
Que cela l’empoignait au front, comme cela !
« Or, tu sais bien, Monsieur, nous chantions tra la la
Et nous piquions les bœufs vers les sillons des autres :
Le Chanoine, au soleil, filait des patenôtres
Sur des chapelets clairs grenés de pièces d’or ;
Le Seigneur, à cheval, passait, sonnant du cor ;
Et l’un, avec la hart, l’autre, avec la cravache,
Nous fouaillaient. Hébétés comme des yeux de vache,
Nos yeux ne pleuraient plus. Nous allions, nous allions ;
Et quand nous avions mis le pays en sillons,
Quand nous avions laissé dans cette terre noire
Un peu de notre chair... nous avions un pourboire :
On nous faisait flamber nos taudis dans la nuit,
Nos petits y faisaient un gâteau fort bien cuit.
« Oh ! je ne me plains pas. Je te dis mes bêtises.
C’est entre nous. J’admets que tu me contredises.
Or, n’est-ce pas joyeux de voir, au mois de juin,
Dans les granges entrer des voitures de foin
Énormes ? De sentir l'odeur de ce qui pousse,
Des vergers quand il pleut un peu, de l’herbe rousse ?
De voir des blés, des blés, des épis pleins de grain,
De penser que cela prépare bien du pain ?...
Oh ! plus fort on irait, au fourneau qui s’allume,
Chanter joyeusement en martelant l’enclume,
Si l'on était certain de pouvoir prendre un peu,
Etant homme à la fin, de ce que donne Dieu !
Mais voilà, c’est toujours la même vieille histoire !...
« Mais je sais, maintenant ! Moi, je ne peux plus croire,
Quand j’ai deux bonnes mains, mon front et mon marteau,
Qu’un homme vienne là, dague sous le manteau,
Et me dise : « Mon gars, ensemence ma terre » ;
Que l’on arrive encor, quand ce serait la guerre,
Me prendre mon garçon, comme cela, chez moi !
Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi ?
Tu me dirais : « Je veux » ? Tu vois bien, c’est stupide.
Tu crois que j’aime voir ta baraque splendide,
Tes officiers dorés, tes mille chenapans,
Tes palsembleus bâtards tournant comme des paons ?
Ils ont rempli ton nid de l’odeur de nos filles
Et de petits billets pour nous mettre aux Bastilles,
Et nous dirions : « C’est bien : les pauvres à genoux ! »
Nous dorerions ton Louvre en donnant nos gros sous,
Et tu te soûlerais, tu ferais belle fête,
Et ces Messieurs riraient, les reins sur notre tête ?
« Non. Ces saletés-là datent de nos papas !
Oh ! le Peuple n’est plus une putain. Trois pas,
Et, tous, nous avons mis ta Bastille en poussière.
Cette bête suait du sang par chaque pierre ;
Et c’était dégoûtant, la Bastille debout
Avec ses murs lépreux qui nous racontaient tout
Et, toujours, nous tenaient enfermés dans leur ombre !
— Citoyen, citoyen, c’était le passé sombre
Qui croulait, qui râlait, quand nous primes la tour !
Nous avions quelque chose, au cœur, comme l’amour ;
Nous avions embrassé nos fils sur nos poitrines,
Et, comme des chevaux, en soufflant des narines,
Nous allions fiers et forts, et ça nous battait là !
Nous marchions au soleil, front haut, comme cela,
Dans Paris ; on venait devant nos vestes sales ;
Enfin, nous nous sentions Hommes ! Nous étions pâles,
Sire ; nous étions soûls de terribles espoirs.
Et quand nous fûmes là, devant les donjons noirs,
Agitant nos clairons et nos feuilles de chêne,
Les piques à la main, nous n’eûmes pas de haine.
Nous nous sentions si forts : nous voulions être doux !...
« Et, depuis ce jour-là, nous sommes comme fous !
Le tas des ouvriers a monté dans la rue,
Et ces maudits s’en vont, foule toujours accrue
De sombres revenants, aux portes des richards.
Moi, je cours avec eux assommer les mouchards ;
Et je vais dans Paris, noir, marteau sur l’épaule,
Farouche, à chaque coin balayant quelque drôle ;
Et, si tu me riais au nez, je te tuerais !
— Puis, tu peux y compter, tu te feras des frais
Avec tes hommes noirs, qui prennent nos requêtes
Pour se les renvoyer comme sur des raquettes,
(Et tout bas les malins se disent : « Qu’ils sont sots ! »),
Pour mitonner des lois, coller des petits pots
Pleins de jolis décrets roses et de droguailles,
S’amuser à couper proprement quelques tailles,
Puis se boucher le nez quand nous marchons près d’eux,
(Nos doux représentants qui nous trouvent crasseux !),
Pour ne rien redouter, rien, que les baïonnettes...
C’est très bien. Foin de leur tabatière à sornettes !
Nous en avons assez, là, de ces cerveaux plats
Et de ces ventres-dieux. Ah ! ce sont là les plats
Que tu nous sers, bourgeois, quand nous sommes féroces,
Quand nous brisons déjà les sceptres et les crosses ?... »
II
Il le prend par le bras, arrache le velours
Des rideaux et lui montre, en bas, les larges cours
Où fourmille, où fourmille, où se lève la foule,
La foule épouvantable avec des bruits de houle,
Hurlant comme une chienne, hurlant comme une mer,
Avec ses bâtons forts et ses piques de fer,
Ses tambours, ses grands cris de halles et de bouges
Tas sombre de haillons saignant de bonnets rouges.
L’Homme, par la fenêtre ouverte, montre tout
Au roi pâle et suant qui chancelle debout,
Malade à regarder cela.
« C’est la crapule,
Sire. Ça bave aux murs, ça monte, ça pullule.
Puisqu’ils ne mangent pas, Sire, ce sont des gueux !
Je suis un forgeron ; ma femme est avec eux,
Folle : elle croit trouver du pain aux Tuileries.
On ne veut pas de nous dans les boulangeries.
J’ai trois petits. Je suis crapule. — Je connais
Des vieilles qui s’en vont pleurant sous leurs bonnets,
Parce qu’on leur a pris leur garçon ou leur fille.
C’est la crapule. — Un homme était à la Bastille,
Un autre était forçat : et tous deux, citoyens
Honnêtes. Libérés, ils sont comme des chiens :
On les insulte ; alors, ils ont là quelque chose
Qui leur fait mal, allez ! C’est terrible et c’est cause
Que, se sentant brisés, que, se sentant damnés,
Ils sont là, maintenant, hurlant sous votre nez !
Crapule. — Là-dedans sont des filles, infâmes
Parce que vous saviez que c’est faible les femmes,
Messeigneurs de la cour, que ça veut toujours bien ;
Vous leur avez craché sur l’âme, comme rien ;
Vos belles, aujourd’hui, sont là. C’est la crapule...’
« Oh ! tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle
Sous le soleil féroce, et qui vont, et qui vont,
Qui dans ce travail-là sentent crever leur front :
Chapeau bas, mes bourgeois, oh ! ceux-là sont les Hommes !
Nous sommes Ouvriers, Sire ! Ouvriers ! Nous sommes
Pour les grands temps nouveaux où l’on voudra savoir,
Où l’Homme forgera du matin jusqu’au soir,
Chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes ;
Où lentement vainqueur il domptera les choses
Et montera sur Tout, comme sur un cheval.
O splendides lueurs des forges ! Plus de mal,
Plus !... Ce qu’on ne sait pas, c’est peut-être terrible :
Nous saurons ! Nos marteaux en main, passons au crible
Tout ce que nous savons ; puis, Frères, en avant !
Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant
De vivre simplement, ardemment, sans rien dire
De mauvais, travaillant sous l’auguste sourire
D’une femme qu’on aime avec un noble amour ;
Et l’on travaillerait fièrement tout le jour,
Ecoutant le devoir comme un clairon qui sonne ;
Et l’on se sentirait très heureux, et personne,
Oh ! personne, surtout, ne vous ferait ployer !
On aurait un fusil au-dessus du foyer...
« Oh ! mais l’air est tout plein d’une odeur de bataille.
Que te disais-je donc ? Je suis de la canaille.
Il reste des mouchards et des accapareurs.
Nous sommes libres, nous ! Nous avons des Terreurs
Où nous nous sentons grands, oh ! si grands ! Tout à l’heure,
Je parlais de devoir calme, d’une demeure...
Regarde donc le ciel ! — C’est trop petit pour nous ;
Nous crèverions de chaud, nous serions à genoux...
Regarde donc le ciel ! — Je rentre dans la foule,
Dans la grande canaille effroyable qui roule,
Sire, tes vieux canons sur les sales pavés.
Oh ! quand nous serons morts, nous les aurons lavés !
Et si, devant nos cris, devant notre vengeance,
Les pattes des vieux rois mordorés, sur la France,
Poussaient leurs régiments en habits de gala,
Eh bien, n’est-ce pas, vous tous : « Merde à ces chiens-là ! »
III
Il reprit son marteau sur l’épaule.
La foule
Près de cet homme-là se sentait l’âme soûle.
Et, dans la grande cour, dans les appartements
Où Paris haletait avec des hurlements,
Un frisson secoua l’immense populace...
Alors, de sa main large et superbe de crasse,
Bien que le roi ventru suât, le Forgeron,
Terrible, lui jeta le bonnet rouge au front.
Tête de faune
Dans la feuillée, écrin vert taché d’or,
Dans la feuillée incertaine et fleurie
De splendides fleurs où le baiser dort,
Vif et crevant l’exquise broderie,
Un faune effaré montre ses deux yeux
Et mord les fleurs rouges de ses dents blanches :
Brunie et sanglante ainsi qu’un vin vieux,
Sa lèvre éclate en rires sous les branches.
Et quand il a fui — tel qu’un écureuil, —
Son rire tremble encore à chaque feuille,
Et l’on voit épeuré par un bouvreuil
Baiser d’or du Bois, qui se recueille.
Soleil et chair
I
Le Soleil, le foyer de tendresse et de vie,
Verse l’amour brûlant à la terre ravie,
Et, quand on est couché sur la vallée, on sent
Que la terre est nubile et déborde de sang,
Que son immense sein soulevé par une âme
Est d’amour comme Dieu, de chair comme la femme,
Et qu’il renferme, gros de sève et de rayons,
Le grand fourmillement de tous les embryons.
Et tout croît, et tout monte !
— O Vénus, ô déesse !
Je regrette les temps de l’antique jeunesse,
Des satyres lascifs, des faunes animaux,
Dieux qui mordaient d’amour l’écorce des rameaux
Et dans les nénuphars baisaient la nymphe blonde.
Je regrette les temps où la sève du monde,
L’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts
Dans les veines de Pan mettaient un univers ;
Où le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre ;
Où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre
Modulait sous le ciel le grand hymne d’amour ;
Où, debout sur la plaine, il entendait autour
Répondre à son appel la Nature vivante ;
Où les arbres muets, berçant l’oiseau qui chante,
La terre, berçant l’homme, et tout l’Océan bleu
Et tous les animaux, aimaient, aimaient en Dieu.
Je regrette les temps de la grande Cybèle,
Qu’on disait parcourir, gigantesquement belle
Sur un grand char d’airain, les splendides cités :
Son double sein versait dans les immensités
Le pur ruissellement de la vie infinie.
L’Homme suçait, heureux, sa mamelle bénie,
Comme un petit enfant, jouant sur ses genoux.
Parce qu’il était fort, l’Homme était chaste et doux.
Misère ! maintenant il dit : Je sais les choses,
Et va, les yeux fermés et les oreilles closes.
Et pourtant, plus de dieux ! plus de dieux ! l’Homme est roi.
L’Homme est dieu ! Mais l’Amour, voila la grande Foi !
Oh ! si l’homme puisait encore à ta mamelle,
Grande mère des dieux et des hommes, Cybèle !
S’il n’avait pas laissé l’immortelle Astarté
Qui jadis, émergeant dans l’immense clarté
Des flots bleus, fleur de chair que la vague parfume,
Montra son nombril rose où vint neiger l’écume,
Et fit chanter, déesse aux grands yeux noirs vainqueurs,
Le rossignol aux bois et l’amour dans les cœurs !
II
Je crois en toi, je crois en toi, divine mère,
Aphrodité marine ! — Oh ! la route est amère,
Depuis que l’autre dieu nous attelle à sa croix.
Chair, marbre, fleur, Vénus, c’est en toi que je crois !
Oui, l’Homme est triste et laid, triste sous le ciel vaste ;
Il a des vêtements, parce qu’il n’est plus chaste,
Parce qu’il a sali son fier buste de dieu
Et qu’il a rabougri, comme une idole au feu,
Son corps olympien aux servitudes sales !
Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles
Il veut vivre, insultant la première beauté !
Et l’idole où tu mis tant de virginité,
Où tu divinisas notre argile, la Femme,
Afin que l’homme pût éclairer sa pauvre âme
Et monter lentement, dans un immense amour,
De la prison terrestre à la beauté du jour,
La Femme ne sait plus même être courtisane !
C’est une bonne farce ! Et le monde ricane
Au nom doux et sacré de la grande Vénus.
III
Si les temps revenaient, les temps qui sont venus !...
Car l’Homme a fini, l’Homme a joué tous les rôles.
Au grand jour, fatigué de briser des idoles,
Il ressuscitera, libre de tous ses dieux,
Et, comme il est du ciel, il scrutera les deux.
L’Idéal, la pensée invincible, éternelle,
Tout le dieu qui vit sous son argile charnelle
Montera, montera, brûlera sous son front.
Et quand tu le verras sonder tout l’horizon,
Contempteur des vieux jougs, libre de toute crainte,
Tu viendras lui donner la rédemption sainte.
Splendide, radieuse, au sein des grandes mers
Tu surgiras, jetant sur le vaste Univers
L’Amour infini dans un infini sourire !
Le Monde vibrera comme une immense lyre
Dans le frémissement d’un immense baiser.
— Le Monde a soif d’amour : tu viendras l’apaiser.
IV
O splendeur de la chair ! ô splendeur idéale !
O renouveau d’amour, aurore triomphale
Où, courbant à leurs pieds les dieux et les héros,
Callypige la blanche et le petit Eros
Effleureront, couverts de la neige des roses,
Les femmes et les fleurs sous leurs beaux pieds écloses !
O grande Ariadné, qui jettes tes sanglots
Sur la rive, en voyant fuir là-bas, sur les flots,
Blanche sous le soleil, la voile de Thésée,
O douce vierge enfant qu’une nuit a brisée,
Tais-toi ! Sur son char d’or bordé de noirs raisins,
Lysios, promené dans les champs phrygiens
Par les tigres lascifs et les panthères rousses,
Le long des fleuves bleus rougit les sombres mousses.
Zeus, taureau, sur son cou berce comme une enfant
Le corps nu d’Europé, qui jette son bras blanc
Au cou nerveux du dieu frissonnant dans la vague ;
Il tourne lentement vers elle son œil vague ;
Elle laisse traîner sa pâle joue en fleur
Au front de Zeus ; ses yeux sont fermés ; elle meurt
Dans un divin baiser, et le flot qui murmure
De son écume d’or fleurit sa chevelure.
— Entre le laurier rose et le lotus jaseur,
Glisse amoureusement le grand Cygne rêveur,
Embrassant la Léda des blancheurs de son aile ;
Et, tandis que Cypris passe, étrangement belle,
Et, cambrant les rondeurs splendides de ses reins,
Etale fièrement l’or de ses larges seins
Et son ventre neigeux brodé de mousse noire,
Héraclès le Dompteur, qui comme d’une gloire,
Fort, ceint son vaste corps de la peau du lion,
S’avance, front terrible et doux, à l’horizon !...
Par la lune d’été vaguement éclairée,
Debout, nue et rêvant dans sa pâleur dorée
Que tache le flot lourd de ses longs cheveux bleus,
La Dryade regarde au ciel silencieux...
Dans la clairière sombre, où la mousse s’étoile,
La blanche Séléné laisse flotter son voile,
Craintive, sur les pieds du bel Endymion,
Et lui jette un baiser dans un pâle rayon...
La Source pleure au loin dans une longue extase...
C’est la Nymphe qui rêve, un coude sur son vase,
Au beau jeune homme blanc que son onde a pressé.
Une brise d’amour dans la nuit a passé,
Et, dans les bois sacrés, dans l’horreur des grands arbres,
Majestueusement debout, les sombres marbres,
Les dieux, au front desquels le bouvreuil fait son nid,
Les dieux écoutent l’Homme et le Monde infini.
Ophélie
I
Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles,
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles.
On entend dans les bois lointains des hallalis.
Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir ;
Voici plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise du soir.
Le vent baise ses seins et déploie en corolle
Ses grands voiles bercés mollement par les eaux.
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule.
Sur son grand front rêveur s’inclinent les roseaux.
Les nénuphars froissés soupirent autour d’elle.
Elle éveille parfois, dans un aulne qui dort,
Quelque nid d’où s’échappe un petit frisson d’aile.
Un chant mystérieux tombe des astres d’or.
II
O pâle Ophélia, belle comme la neige,
Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté !
C est que les vents tombant des grands monts de Norwège
T'avaient parle tout bas de l’âpre liberté.
C’est qu’un souffle inconnu, fouettant ta chevelure,
À ton esprit rêveur portait d’étranges bruits ;
Que ton cœur entendait la voix de la Nature
Dans les plaintes de l’arbre et les soupirs des nuits.
C’est que la voix des mers, comme un immense râle,
Brisait ton sein d’enfant trop humain et trop doux ;
C’est qu’un matin d’avril un beau cavalier pâle,
Un pauvre fou, s’assit muet à tes genoux.
Ciel, Amour, Liberté : quel rêve, ô pauvre Folle !
Tu te fondais à lui comme une neige au feu.
Tes grandes visions étranglaient ta parole.
— Et l’Infini terrible effara ton œil bleu.
III
Et le Poète dit qu’aux rayons des étoiles
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis,
Et qu’il a vu sur l’eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys !
Bal des pendus
Au gibet noir, manchot aimable,
Dansent, dansent les paladins,
Les maigres paladins du diable,
Les squelettes de Saladins.
Messire Belzébuth tire par la cravate
Ses petits pantins noirs grimaçant sur le ciel,
Et, leur claquant au front un revers de savate,
Les fait danser, danser aux sons d’un vieux Noël !
Et les pantins, choqués, enlacent leurs bras grêles.
Comme des orgues noirs, des poitrines à jour,
Que serraient autrefois les gentes damoiselles,
Se heurtent longuement dans un hideux amour.
Hurrah, les gais danseurs qui n’avez plus de panse !
On peut cabrioler, les tréteaux sont si longs !
Hop, qu’on ne sache plus si c’est bataille ou danse !
Belzébuth, enragé, racle ses violons !
O durs talons, jamais on n’use sa sandale !...
Presque tous ont quitté la chemise de peau.
Le reste est peu gênant et se voit sans scandale.
Sur les crânes la neige applique un blanc chapeau.
Le corbeau fait panache à ces têtes fêlées ;
Un morceau de chair tremble à leur maigre menton.
On dirait, tournoyant dans les sombres mêlées,
Des preux roides heurtant armures de carton.
Hurrah, la bise siffle au grand bal des squelettes !
Le gibet noir mugit comme un orgue de fer !
Les loups vont répondant, des forêts violettes.
À l’horizon, le ciel est d’un rouge d’enfer...
Holà, secouez-moi ces capitans funèbres


![Una temporada en el infierno / Iluminaciones [Edición ilustrada] - Arthur Rimbaud - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3f6ec4269b535ed9159ac324a8b5182e/w200_u90.jpg)