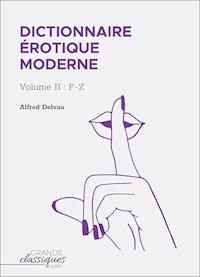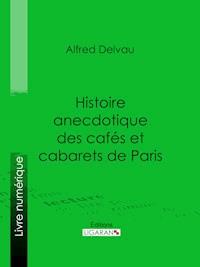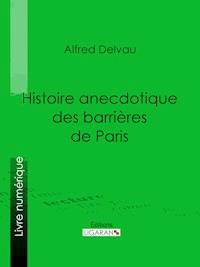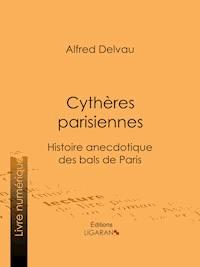Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je ferai un jour, moi aussi, ma petite théorie des milieux. On ne sait pas assez, on ne se dit pas assez quelle influence ont, — sur la conduite des pensées, sur les opérations de l'esprit et les évolutions du cœur, — les objets extérieurs avec lesquels vous êtes en contact familier chaque jour. C'est une influence d'autant plus funeste ou salutaire..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076325
©Ligaran 2015
« Une préface est la bénédiction qu’un auteur donne à son livre. »
C’est Rabener, un Allemand, qui a dit cela. Ces braves Teutons n’en font jamais d’autres. Ils trouvent toujours moyen, – à travers les épigrammes dont on ne se fait pas faute à leur endroit, et en courant ainsi à travers choux, c’est à-dire à travers la métaphysique ; – ils trouvent moyen, dis-je, d’être pleins de bon sens, d’humour et de finesse.
Va donc pour la bénédiction ! Pain bénit et livre béni n’en sont pas meilleurs pour cela assurément ; mais les fidèles et les lecteurs le mangent et le lisent avec plus d’appétit.
Sois donc béni, ô mon livre, enfant conçu dans les heures de désœuvrement d’une existence besogneuse et tourmentée, et venu au monde un peu-par les bras et par les pieds, comme la mère de Caligula.
Tu vas tomber entre les mains d’inconnus et d’inconnues, les uns bourrus, les autres nerveuses, qui te jetteront souvent par-dessus leur tête sur l’angle d’un meuble ou dans les cendres de l’âtre. Tu seras brûlé ou lacéré comme un livre illustre ; ou tu seras tout bonnement laissé là, dédaigneusement, parce qu’on t’aura trouvé mal léché, mal peigné, mal brossé, pauvrement vêtu, et le visage trop fade, Habent sua fata libelli… Oh ! mon Dieu oui… c’est comme j’ai l’honneur de le dire – en langue morte.
Va donc à travers le monde littéraire, et ne t’étonne pas, ne te scandalise pas des rudoyements, des sarcasmes, des quolibets et des sifflets. Je te bénis – selon l’usage antique et solennel – je te bénis, mais voilà tout. Je ne m’occuperai pas plus de toi, désormais, qu’on ne s’occupe des vieilles lunes et des neiges de l’an passé.
Bonne chance, cher enfant, et bon voyage.
… Je ferai un jour, moi aussi, ma petite théorie des milieux.
On ne sait pas assez, on ne se dit pas assez quelle influence ont, – sur la conduite des pensées, sur les opérations de l’esprit et les évolutions du cœur, – les objets extérieurs avec lesquels vous êtes en contact familier chaque jour. C’est une influence d’autant plus funeste ou salutaire, – selon ces objets, – qu’elle est lente et continue. Les moindres clous, les moindres angles de la boîte dans laquelle se meut votre individu physique, s’enfoncent chaque jour plus avant dans les profondeurs de votre individu moral. C’est un peu l’histoire des habitudes, de l’accoutumance volontaire ou involontaire à des choses ou à des êtres qui accomplissent les mêmes évolutions que vous. C’est la communion intime et efficace de votre moi avec les mille riens dont se compose votre existence quotidienne ; communion charmante, après tout, et à laquelle, malgré tout, on veut rester fidèle.
Il y a des gens qui vivent pendant trente ans dans la même chambre qui est malsaine et triste, et avec la même maîtresse qui est maigre, jaune et acariâtre. Pourquoi ?
Je n’ai jamais été, pour ma part, indifférent aux localités dans lesquelles les ballottements de ma vie m’ont jeté. Il y a des séjours dans lesquels j’aurais voulu pouvoir vivre tout mon soûl, jusqu’aux confins extrêmes de l’existence humaine. Il y en a d’autres qu’on ne m’eût pas imposés impunément. Une cellule de prison, – malgré tout l’odieux des désavantages y attachés, une cellule serait presque acceptée par moi sans trop de répugnance, mais à la condition qu’elle aurait son jour sur un horizon de forêts et qu’on me permet trait de la meubler de meubles à mon goût et d’amis de mon choix. Je n’ai pas une nature contemplative et songeuse pour rien ; il faut bien se garder de lui refuser les aliments qu’elle réclame impérieusement, sous peine de voir cette rêverie empêchée, cette contemplation contrariée se changer en mélancolie. Et de la mélancolie à la tristesse il n’y a qu’un pas ; il y en a deux de la tristesse au suicide.
Jusqu’ici j’ai été aussi peu prisonnier que possible, et, bien loin d’en être fâché, – comme le seraient certaines barbes longues à idées courtes, de ma connaissance, qui s’imaginent qu’on sert une cause en se faisant mettre dans l’impossibilité de la servir, – bien loin d’en être fâché, je m’en suis, au contraire, toujours applaudi et estimé. Il est plus spirituel et plus facile d’être libre que d’être prisonnier.
Aussi, dans mes prières, – quand j’en adresse à l’Être suprême, régisseur général des biens terrestres et des consciences humaines, – je n’oublie jamais ce morceau :
– Mon Dieu ! Préservez-moi des verrous, des méchants et des niais ! Ne mettez ni mon corps, ni mon cœur, ni mon esprit dans des prisons odieuses. Être prisonnier d’un imbécile est plus douloureux que d’être prisonnier chez des anthropophages. Les anthropophages vous tuent avant de vous manger ; les sots vous mangent avant de vous tuer… Délivrez-moi donc des verrous, des méchants, des niais et des menteurs. – Amen !… »
Je suis depuis quelques mois dans un logement qui ne plairait pas à tout le monde, mais dont je suis enchanté d’avoir fait la connaissance. J’y vis depuis un mois d’une vie cénobitique et en même temps familiale, pleine de joies austères. J’éprouve, – dans ce milieu nouveau où des circonstances quelconques m’ont transplanté violemment, – un bonheur calme, égal et profond qui ne ressemble, certes, à aucun des autres bonheurs desquels j’ai tâté jusqu’ici, mais c’est du bonheur.
Pour en arriver là, il a fallu la rupture d’une affection envahissante et spoliatrice des autres affections. Il y a donc des douleurs bienfaisantes et des désastres salutaires ? Il faut le croire…
Pour moi, à mesure que je sens se décrocher de mon cœur toutes les pampilles amoureuses, toutes les fanfreluches de la passion, toutes les passementeries des désirs, et que je m’enfonce davantage dans l’ombre et dans la paix de la vie familiale, je m’applaudis d’un accident, – si triste en soi, – dont j’ai déploré la venue et dont je bénéficie à cette heure.
Je m’applaudis surtout de faire ce que je fais comme si c’était le résultat naturel d’une vie simple, candide, unie, – tandis que c’est, au contraire, l’aboutissement d’une existence peuplée de chimères et sillonnée de folies.
Je rentre dans le sentier obscur, mais non pénible, de la vie intime, duquel je m’étais un peu écarté et égaré, et j’y rentre avec un attendrissement sincère ; je m’y sauve de moi-même, ou plutôt je m’y reconquiers.
Je n’y entre pas trop brisé, trop dépouillé, trop appauvri. Je n’étais pas assez fort pour les luttes du genre de celles qu’il m’a fallu soutenir pour vivre de la vie dont j’ai vécu, et cela m’a un peu fatigué, un peu cassé les bras et le cœur. Mais je ne suis pas encore, Dieu merci ! à ranger parmi les invalides du sentiment. J’ai gaspillé une partie de mes trésors, j’ai semé une bonne part de ma cervelle et de mon cœur sur les sentiers perdus de la folie et de l’enamourement… mais je suis encore assez riche pour être heureux, je le sens bien ; et toutes ces rêvasseries et toutes ces flambes de jeunesse ne m’ont pas tellement affolé que je ne puisse encore prouver la santé de ma cervelle et de mon cœur.
Je reviens à mon point de départ ; à quelques-pas de l’endroit où je suis né et où je ne mourrai pas, sans doute. J’y reviens avec la joie calme, mais-grande et sans pareille, du voyageur qui retrouve enfin l’humble clocher de l’humble village qu’il avait quitté un jour pour aller par-delà les monts et les mers à la recherche des pays étranges et inconnus…
Et cætera, pantoufle ! Quand on rime sa douleur on ne souffre plus ! Quand on raconte ses amours on n’aime plus. J’en suis là. Il s’est fait un apaisement subit dans mon cœur et dans mon esprit. J’ai repris possession de moi-même, – je m’appartiens ! Qui que ce soit qui ait fait cela, préparé cela, amené cela, je l’en remercie et je m’en applaudis. Le résultat est si bon, si plein de santé, si prometteur de joies véritables, que je ne sais vraiment pas si j’ai fait quelque chose pour mériter qu’il soit.
J’oublie mes années d’oubli. Je me redresse assoupli, retrempé, rajeuni, sur le seuil de cette vie familiale, si pleine de calme et de recueillement.
J’ai à faire amende honorable et je la fais gaiement. J’ai été fou, vaniteux, puéril, fanfaron. C’est bien. Je dépose ma vieille défroque de jeune homme, sans cris de colère, sans lamentation, sans reproches et sans regrets. J’ai trop gagné à la transformation qui s’est opérée en moi pour être tenté de regarder avec la moindre amertume ce qui a précédé ce moment. D’ailleurs, les regrets et les reproches m’ont toujours semblé chose parfaitement absurde, parce que parfaitement inutile.
Adieu paniers ! vendanges sont faites ! J’ai mordu aux grappes de l’amour ; j’ai rougi mes lèvres de son sang divin ; je me suis grisé avec toutes les liqueurs fortes des passions et des chimères. Je me garderai bien, aujourd’hui que je suis dégrisé, de bafouer et d’anathématiser mes ivresses d’autrefois, de rougir de moi-même, de me montrer au doigt, de me faire une morale ridicule, – que je n’écouterais pas. Je suis plus respectueux devant mes ivresses que Cham devant Noé, – je passe devant elles sans les réveiller, de peur de les attrister…
Le logement que j’habite est situé dans un quartier pour lequel j’ai une prédilection particulière. Je suis peut-être le seul qui ait pour lui cette prédilection : c’est le faubourg Saint-Marceau !
Peu de gens, – de ceux qui sont partis d’où je suis parti, – de la cuve d’un tanneur, – et qui ont traversé dans leurs pérégrinations diverses les couches les plus élevées de la vie matérielle et morale, – consentiraient à revenir vers ces humbles sentiers tout empuantis, où se sont essayés leurs premiers pas ; ou, s’ils le faisaient, ils s’y feraient voiturer dans une baignoire pleine d’eau de Cologne, – de peur des asphyxies.
Moi, loin de redouter les inconvénients attachés à mon faubourg Saint-Marceau, je les aime et je les recherche. On aime toujours son nid, nid de torchis, de mousse, de sable ou de duvet.
Je ne suis pas né pour rien en plein faubourg Saint-Marceau, entre la rue Mouffetard et le marché aux chevaux sur les bords de cette peu poétique rivière de Bièvre, dont les naïades sont des blanchisseuses et les tritons des mégissiers. Mon enfance ne s’est pas passée pour rien sur la berge de ce ruisseau noir, à écouter les bruits discordants et tapageurs des battoirs et des marteaux ; sur les montagnes de tannée élevées dans la cour de la maison paternelle, à contempler les motteux piétinant sur leurs petits cercles noirs, et travaillant pour les chaufferettes des portières et les cheminées des pauvres ménages.