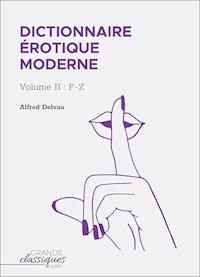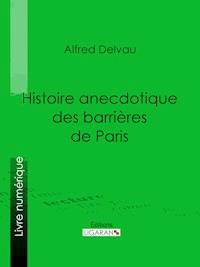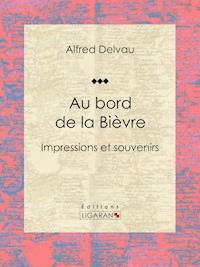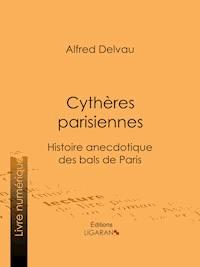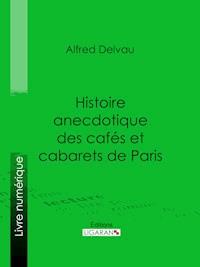
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Si vous avez lu certaine fantaisie de Henri Heine sur l'Allemagne, publiée après 1848, vous devez vous rappeler ce passage charmant où, après s'être gaussé des Allemands, il se gausse ainsi des Français, en s'adressant au vieux père Rhin : Va, ne crains pas, mon bon vieux, les sarcasmes moqueurs des Français, ce ne sont plus les Français d'autrefois ; ils portent aussi d'autres pantalons."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À M. le comte Joseph BOSSI FEDERIGOTTI, à Roveredo (principauté de Trente).
Je m’étais proposé, mon excellent ami, d’attacher votre nom à un livre plein de fièvre et de passion, qui eût été pour vous l’écho de choses déjà entendues, le miroir de choses déjà vues : un roman parisien éloquent et brutal comme la vérité, où j’avais mis des lambeaux de ma vie, c’est-à-dire mon cœur tout entier.
Ce livre n’a pas paru, ce roman ne paraîtra pas. Je le regrette un peu à cause de moi, et beaucoup à cause de vous, qu’il eût intéressé, j’en suis certain, intéressé et remué. Je le regrette, parce que, tout indigne qu’il fût d’être publié, il était du moins très digne de vous être offert, par son sujet même et par les soins que j’avais mis à le traiter.
N’en parlons plus, et enterrons-le avec les vieux souvenirs et les jeunes amours dont il était rempli.
Me voilà donc réduit, cher ami, à vous prier d’accepter la dédicace de cet autre livre, qui traite de tout autre chose. Si je savais attendre, j’aurais attendu une occasion meilleure pour inscrire fraternellement votre nom à côté du mien ; mais je ne sais pas attendre, et vous voilà forcé de prendre ce merle au lieu des grives que je vous destinais.
D’ailleurs, en y réfléchissant bien, c’est à vous que revenait de droit la dédicace de ce livre, puisque c’est à vous que quelques-uns des chapitres qui le composent ont dû de voir le jour. Vous avez été pendant huit mois, du 7 mars au 4 novembre 1857, sous le pseudonyme d’Armand Sédixier, le rédacteur en chef d’un vaillant petit journal, auquel il n’a manqué que quelques billets de banque pour devenir un grand journal, un vrai journal, le journal parisien, comme le Figaro, qui aurait pu finir par prendre inquiétude de son voisinage, car ce n’étaient ni les noms, ni les talents, ni le courage, ni l’esprit qui lui faisaient défaut. Vous aviez appelé à vous d’aimables écrivains qui s’étaient empressés d’accourir : Henry Murger et Charles Monselet, Nadar et Baudelaire, Aurélien Scholl et Amédée Rolland, Henri de la Madelène et Charles Bataille, Alfred Busquet et Antoine Fauchery, Jules Viard et le marquis de Lauzières, Alphonse Duchesne et Petrucelli della Gattina, puis des petits, des obscurs, parmi lesquels, moi. C’est dans le Rabelais que Murger a publié la Nostalgie ; – Monselet, ses Dessus de tabatières ; – Nadar, son Salon de 1857 (texte et dessins) ; – Aurélien Scholl, l’Auberge romantique ; – Charles Baudelaire, la Morale du joujou ; – Jules Viard, les Petites félicités du bonhomme Pangloss ; – Eugène Wœstyn, les Femmes de Béranger ; – Charles Bataille, ses Lettres de la campagne ; – Amédée Rolland, ses plus beaux vers ; – celui-ci son plus fin esprit ; – celui-là sa meilleure érudition, et moi quelques-uns de mes Cabarets, Tavernes et Cafés de Paris. Sans vous, mon cher ami, mes articles et moi nous restions enfouis dans la poussière de la Bibliothèque impériale, inédits, eux et moi. C’eût été un bien pour un mal, assurément, un bien pour le public, qui m’eût ainsi ignoré, un mal pour moi, qui eusse été ignoré. Comme le public n’aurait pas songé à vous remercier, il est tout simple que je vous remercie, moi, en son lieu et place. C’est ce que je fais aujourd’hui, mon cher Federigotti.
Quoique, durant votre séjour parmi nous, vous ayez beaucoup plus vécu en dedans qu’en dehors, avec les livres qu’avec les gens, vous vous êtes cependant mêlé assez au mouvement général pour avoir de notre civilisation parisienne une idée suffisamment nette, et je ne vous étonnerai pas en disant que l’at home, qui est la caractéristique du tempérament anglais, est complètement inconnu en France, je veux dire à Paris, où l’on s’extériorise volontiers. Vivre chez soi, penser chez soi, boire et manger chez soi, aimer chez soi, souffrir chez soi, mourir chez soi, nous trouvons cela ennuyeux et incommode. Il nous faut la publicité, le grand jour, la rue, le cabaret, pour nous témoigner en bien ou en mal, pour causer, pour être heureux ou malheureux, pour satisfaire tous les besoins de notre vanité ou de notre esprit, pour rire ou pour pleurer : nous aimons à poser, à nous donner en spectacle, à avoir un public, une galerie, des témoins de notre vie.
De là les cabarets, de là les cafés, de là les buvettes parisiennes, cousines germaines des xénies grecques, des popines romaines, des kellers allemands, des public-houses anglais, des ventas espagnoles, des osterie italiennes, des slaatuintjes hollandaises, des kabacks russes, des mehanas hongrois, des cong-quans chinois et des carchemats polonais. Mais avec cette différence que les autres peuples ont en petite quantité ce que nous avons en foule, et que là où, chez eux, il y a un cabaret, nous en avons vingt : on compte les leurs, on ne saurait compter les nôtres. Sterne, en entrant à Paris, s’étonnait d’en voir une douzaine par rue ; que dirait-il maintenant ?
Ce n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, ni d’avant-hier que nous nous conduisons ainsi. Il y a longtemps que cela dure, et cela durera probablement longtemps encore ainsi. Faut-il nous en réjouir ou nous en attrister ? je l’ignore, ou plutôt je préfère l’ignorer, n’ayant pas autre chose à faire, pour le moment, que l’histoire des popines parisiennes : un historien n’est pas forcément un moraliste. Je vais raconter, avec mes impressions, purement et simplement : si je me trompe, vous m’avertirez, cher ami.
« La vie de café », comme disent avec mépris les vieilles demoiselles qui sont condamnées au gynécée à perpétuité, est menée par tout le monde, à Paris, par les grands comme par les petits, par les riches comme par les pauvres, par les artistes comme par les artisans. Aussi, en écrivant une histoire des cabarets et des cafés parisiens, est-on exposé à écrire une histoire de toutes les classes de la société parisienne, depuis les plus élevées jusqu’aux plus basses, depuis les plus nobles jusqu’aux plus viles. S’il y a le café Véron et le café d’Orsay, il y a la Californie et l’Assommoir. Je n’oublierai ni les premiers ni les derniers.
Il y a longtemps, mon ami, que les cafés et les cabarets sont les « salons de la démocratie » – pour employer la juste expression de M. Hippolyte Castille. Les salons de la démocratie, c’est-à-dire de tout le monde, puisque l’aristocratie a été guillotinée le 21 janvier 1793. Les lieux et leurs habitués ont changé, mais les habitudes sont restées les mêmes. Ce ne sont plus ni les mêmes cabarets ni les mêmes buveurs, mais ce sont toujours des cabarets et des buveurs.
La première recommandation d’un père à son fils, lorsqu’il l’envoie dans la grand-ville pour y faire son apprentissage de la vie, c’est de ne pas hanter les cabarets et les cafés, qui sont « lieux de perdition. » Les pères qui ont des fils pensent là-dessus comme les vieilles filles de tout à l’heure, oubliant qu’ils ont été jeunes, qu’ils ont traversé, comme tout le monde, les cabarets et les cafés, sans y perdre autre chose que du temps et de l’argent. Le temps est de l’argent, sans aucun doute : c’est pour cela qu’il faut le dépenser. Le thésauriser ne servirait à rien, à ce que j’imagine, car on n’a pas encore vu d’avare de cette nature qui ait pu employer, vers la soixantaine, les dix ou quinze années de sa jeunesse épargnées par lui.
Les pères de province qui font cette recommandation puérile oublient également que tout ce que Paris renferme d’illustrations, grosses, moyennes et petites, mène « la vie de café, » – comme la menaient les illustrations du temps jadis, ainsi qu’ils l’apprendront s’ils veulent bien feuilleter, d’une part leurs souvenirs, et, d’autre part, ce modeste petit volume auquel j’ai attaché mon nom pour avoir, moi aussi, mon lopin de renommée.
Je leur apprendrai, s’ils l’ignorent, que, tout comme Diogène le Cynique, Socrate le Sage allait volontiers dans les tavernes d’Athènes, au milieu des portefaix du Pirée, des oisifs démagogues du Pnyx, des courtisanes du Céramique, manger une assiette de boudins au poivre, arrosés d’un cotyle ou deux de vin frelaté ;
Qu’Athénée de Naucrate, le célèbre grammairien, allait volontiers dans le cabaret de Strarambos, qu’il cite lui-même comme un bon cuisinier, sans l’appeler capèlos comme les autres ;
Que Denys le Jeune, ex-tyran de Syracuse, allait volontiers dans les cabarets de Corinthe se consoler de l’humiliation d’être maître d’école ;
Que Virgile, le doux Virgile, allait volontiers chez les cabaretières syriennes, avec ses amis Varius et Gallus, deux poètes aussi, dont le dernier même ne craignit pas de devenir amoureux d’une ambubaia rencontrée dans leurs excursions popinatoires ;
Qu’Ovide, en compagnie d’Horace, de Properce et de Tibulle, allait volontiers chez le cabaretier Coranus ;
Que Cicéron lui-même, l’homme grave, le bourgeois par excellence, allait volontiers chez Macula, un cabaretier de la campagne de Rome, dont il ne craint pas de recommander le vin, à plusieurs reprises, à son ami Lepta ;
Qu’Antoine lui-même, l’ami de César et l’amant de Cléopâtre, allait volontiers, après le meurtre de l’un et avant la défaite de l’autre, dans les ganea des bords du Tibre, en ayant soin, il est vrai, d’y entrer la tête cachée dans sa toge ;
Que, pour quitter les temps anciens et aborder les temps modernes, Shakespeare allait volontiers à la taverne du Cygne, à Londres, où, par parenthèse, il fit la meilleure partie de la Vie et la Mort de Henry IV ;
Que Luther allait volontiers au cabaret de l’Ourse noire, à Orlemonde, où, par parenthèse, se passa entre lui et Carlostadt la fameuse scène du florin d’or racontée par Bossuet ;
Que Rabelais allait non moins volontiers au cabaret de la Cave peinte, à Chinon ; – Cromwell à la taverne du Lion Rouge, dans le Strand, à Londres, avec ses amis Price, un charretier, et Harrisson, un boucher ; – Gœthe, à l’Auerbach keller, à Leipzig, où il écrivit sa ballade à la Puce et plusieurs scènes du Faust ; – Hoffmann, à la Cave de Triober, dans le Peterstrass, à Leipzig, où il composa quelques-uns de ses Contes fantastiques ; – Dryden, Ben Jonson, Beaumont et Flechter, à la taverne de la Sirène, dans Cornhill, à Londres ; – François Villon, à la Pomme de Pin, dans la Cité ; – Ronsard, au Sabot, dans le faubourg Saint-Marcel ; – Montmaur et Ménage, à l’Écu d’argent, derrière l’Université ; – Regnard, Dufresny, Davaux et Duché, au Port à l’Anglais, à Ivry, en compagnie des sœurs Loyson, la Doguine et la Tontine ; – le chevalier de la Ferté, au Petit Père noir, place Maubert ; – Chaulieu, La Fare, Brueys et Palaprat, en compagnie du chevalier de Bouillon et du grand prieur de Vendôme, dans la salle basse de Tite ou dans la cave de la Morellière, au Temple ; – Saint-Amand, Voiture, et Tallemant des Réaux, à la Fosse aux Lions, tenue par la Coiffier, rue du Pas-de-la-Mule ; – François Colletet et d’autres poètereaux, à la Croix de fer, rue Saint-Denis ; – Chapelle et d’Assoucy, au Chêne vert, près du préau du Temple ; – Racine, au Mouton blanc, chez la veuve Bervin, près du cimetière Saint-Jean, où il composa ses Plaideurs, en compagnie de Despréaux et de l’avocat Brilhac ; – Mézeray, au cabaret de madame Lefaucheur, à la Chapelle-Saint-Denis ; – Lasserre (« Morbleu ! » dit-il…), aux Trois Ponts d’or ; – Sarrazin, au cabaret de la Duryer, à Saint-Cloud ; – Cyrano de Bergerac, au cabaret de Renard, aux Tuileries ; – Voltaire, au café Procope ; – Dancourt, à la Cornemuse, chez Chéret, rue des Prouvaires ; – Louis Racine et Marivaux, à l’Épée de bois, rue Quincampoix ; – l’abbé Prévost, au cabaret de la rue de la Huchette, où il composa ManonLescaut ; – Préville et Clairfontaine, au Soleil d’or, rue Vieille-du-Temple ; – Vadé, Fréron, Collé, Panard, au Tambour royal, chez Ramponneau, à la Courtille ; – Crébillon, Piron, Marmontel, au cabaret de Landel, rue de Buci, etc., etc., etc. J’en passe, naturellement, mon cher ami, car longue est cette liste de cabarets et de hanteurs de cabarets. Je ne voulais dire qu’une chose, c’est qu’il y en avait autrefois, comme aujourd’hui, pour tous les goûts, pour tous les sexes, pour toutes les classes. Si les poètes allaient où je viens de dire, et encore ailleurs, les grands seigneurs, de leur côté, allaient chez Rousseau, rue d’Avignon ; – les grandes dames, au cabaret de la Maison rouge, à Chaillot ; – les grands cabotins, chez Forel, près du Théâtre-Français ; – et les grands voleurs, chez Germain Savard, à la Haute Borne, un cabaret de la Courtille.
Quant aux grands poètes, aux grands financiers, aux grands industriels, aux grandes drôlesses, aux grands cabotins, aux grands filous d’aujourd’hui, ils ont été, ils vont dans les cabarets dont j’ai essayé d’écrire l’histoire, au courant de ma plume et de mes impressions personnelles.
C’est dans toutes ces popines parisiennes, bien ou mal famées, populacières ou bégueules, que j’ai connues comme dom Pablo de Ségovie toutes les hôtelleries d’Espagne, que je vous condamne à entrer avec moi, mon cher ami. Vous ne retrouverez pas, dans cette rapide excursion, tous les cabarets et tous les cafés célèbres de ce siècle, parce que quelques-uns ont disparu, auxquels je n’avais pas à consacrer de monographie spéciale, entre autres : le café de Valois, l’antagoniste du café Lemblin, le club pacifique des voltigeurs de Louis XIV ; le café de Paris, fondé en 1822, et mort en 1857, qu’ont traversé bourgeois et gens de lettres, banquiers et gandins, acteurs et artistes, depuis M. Véron jusqu’à M. Alexandre Dumas, depuis le comte de Montrond jusqu’à M. Roger de Beauvoir ; le cabaret de la mère Saguet, à la barrière du Maine, où se sont tant de fois attablés Victor Hugo et Raffet, Romieu et Tony Johannot, Alexandre Dumas et David d’Angers, Chenavard et Armand Carrel ; le café Saint-Agnès, rue Jean-Jacques Rousseau, où venaient les républicains de la Réforme, Ferdinand Flocon et Caussidière, Victor Léoutre et Ribeyrolles, Auguste Luchet et Jeanty-Sarre ; le café d’Aguesseau, sur la place du Palais-de-Justice, où MM. les avocats venaient déjeuner en robe et causer des assassins illustres qu’on était en train de condamner à mort ; le café Cuisinier, sur la place Saint-André-des-Arcs, où l’empereur Napoléon déjeuna incognito avec le maréchal Duroc, sans avoir un sou pour payer son déjeuner ; le café des Arts, rue du Coq-Saint-Honoré, où allaient Jules-Janin et Théodose Burette, en compagnie d’autres lettrés ; le café Achille, sur le boulevard du Temple, où se tenait la foire aux comédiens ; l’Estaminet de l’Épi-scié, sur le même boulevard, une sorte de tapis-franc où se réunissaient tous les vendeurs de contremarques et tous les vendeurs de filles du quartier ; et quelques autres lieux publics plus ou moins célèbres, plus ou moins bien famés dont il faut rechercher l’histoire dans les petits volumes anecdotiques qui ont paru depuis cinquante ans.
Mais il vous en reste assez à parcourir, mon ami : la quantité ne vous manquera – non plus que la qualité. Oubliez les côtés désagréables de cette excursion, et n’en voyez que le côté intéressant, qui est une sorte d’exhibition des différentes classes de la société traversée il y a cinq ans par vous. Si quelque chose vous blesse le regard ou l’esprit dans ces nombreux tableaux, où j’ai essayé de rendre les différentes physionomies de Paris, rappelez-vous qu’elle a sa raison d’être ici, qu’elle y est contre mon gré, et que de ces hantises assidues il ne m’est rien resté – qu’un amour immense de l’at home, si dédaigné de tous. Plus j’ai vu la foule, plus j’ai préféré la solitude.
Voilà ce que je voulais vous dire, mon cher ami, avant de vous laisser commencer la lecture de mon livre. Puissiez-vous aller sans fatigue jusqu’au bout : ce sera son meilleur éloge et ma plus douce récompense.
Je vous serre cordialement la main,
Votre
ALFRED DELVAU.
Si vous avez lu certaine fantaisie de Henri Heine sur l’Allemagne, publiée après 1848, vous devez vous rappeler ce passage charmant où, après s’être gaussé des Allemands, il se gausse ainsi des Français, en s’adressant au vieux père Rhin :
Va, ne crains pas, mon bon vieux, les sarcasmes moqueurs des Français : ce ne sont plus les Français d’autrefois : ils portent aussi d’autres pantalons.
Les pantalons ne sont plus blancs, ils sont rouges. Ils ont aussi d’autres boutons ; ils ne chantent plus ; ils ne dansent plus ; ils penchent mélancoliquement la tête.
Ils philosophent maintenant et parlent de Kant, de Fichte et d’Hégel. Ils fument, et boivent de la bière, et plus d’un joue aux quilles.
« Ils se font épiciers tout comme nous, je crois même qu’ils nous ont dépassés. Ils ne sont plus voltairiens, ils deviennent Hengstenbergiens. »
L’épigramme est fine et aiguë : je l’ai sentie s’enfoncer dans mon amour-propre national. Elle est cruelle et juste – comme la plupart des choses cruelles. La première fois que j’ai bu de la bière et que j’ai entendu parler d’Hégel, de Kant, de Schelling, ailleurs que dans les livres, ç’a été dans une brasserie.
Depuis j’ai hanté d’autres brasseries et d’autres parlottes métaphysiques, à Paris et à Munich. Ici et là elles se ressemblent, avec quelques différences, dont la première est celle de la langue, la seconde celle de la bière, la troisième celle qu’on voudra. À Munich, ces temples à houblon s’appellent des Keller (ou celliers à bière) ; à Paris on les appelle purement et simplement des Brasseries, par suite d’une figure de rhétorique qui permet de donner aux lieux où l’on boit la bière le nom qui appartient seulement aux lieux où on la fait, ce qui n’est pas précisément la même chose. À Munich, le Keller le plus connu est le Knorr-Keller, la taverne de M. Knorr, un brave homme, à ce qu’il paraît, rotond, ventripotent, jovial avec les hommes, galant avec les femmes – auxquelles, dit-on, il offre toujours des bouquets, avec quelques compliments bavarois autour. À Paris, la brasserie la plus ancienne, je crois, la plus famée du moins à l’époque où je la fréquentais, est le Andler-Keller, rue Hautefeuille, sur les ruines de l’ancien prieuré des Prémontrés : et M. Andler, qui est aussi Bavarois que M. Knorr, n’est ni moins rotond, ni moins jovial, ni moins galant que lui, quoiqu’il soit doublé de madame Andler, une Suissesse qu’on croirait née à Anvers, et dont les ancêtres sont au Louvre, dans le Roi boit ! de Jacques Jordaens.
Un soir, il y a une douzaine d’années de cela, je me trouvais accoudé devant un pot de bière, dans l’Andler-Keller. Je songeais et je fumais, en regardant songer et fumer les autres. La somnolence me gagnait déjà, parce que j’étais seul, parce que j’avais envie de dormir, et aussi parce que mes voisins avaient des conversations charmantes – que je ne comprenais pas du tout.
Il pouvait être dix heures. La double rangée de tables en chêne, à bancs de même étoffe, était garnie de buveurs de houblon forcenés – étudiants et graveurs sur bois mêlés. La cuisine, au fond, était muette. Madame Andler dormait dans son comptoir, et, aux oscillations répétées de sa tête débonnaire, on pouvait supposer, sans calomnie, qu’elle aspirait à la tombe – c’est-à-dire au lit conjugal – comme le nez du respectable père Aubry de feu Girodet-Trioson. Mademoiselle Louise, prononcez Luisse, pour prononcer comme madame Andler, l’imitait dans un coin, avec des oscillations plus discrètes mais tout aussi significatives. Quant à M. Andler, il faisait sa traditionnelle partie de piquet à une table, ma voisine, et donnait, de temps à autre, de violents assauts à un moss, son voisin.
Les conversations étaient d’ailleurs engagées sur tous les points de la salle, et il n’y avait guère de table qui n’eût son speaker. C’était animé, mais bruyant en diable. Les billes de l’unique billard, situé à côté de la cuisine, s’en mêlaient aussi, et s’entrechoquaient avec une furie remarquable. Je ne m’entendais pas rêver.
À cette époque-là florissait déjà le Réalisme, ce fruit incestueux d’une carpe et d’un lapin. Et dans ce temple du Réalisme, dont M. Courbet était alors le souverain-pontife et M. Champfleury le cardinal officiant, il n’y avait alors, comme public de buveurs, étudiants et graveurs sur bois compris, que des réalistes et des non-réalistes.
Je n’ai ni le temps ni l’espace nécessaires pour me livrer ici à une catilinaire en règle. Mais ce que je puis et veux dire, c’est que, depuis que je suis au monde et qu’elles sont attachées de chaque côté de ma tête, mes oreilles ont été choquées de bien des jargons différents. Le jargon des enthousiastes, des sceptiques, des novateurs, des « apôtres de l’idée, » – des « missionnaires de l’art, » – des « amis du progrès, » – des « amis de la liberté, » – des théologiens, des métaphysiciens, des rapins, des gens de lettres, et le jargon, plus barbare encore, des avocats, les a souvent tourmentées. Mais, de tous les jargons, aucun ne m’a paru aussi formidablement ennuyeux que celui des réalistes.
Probablement parce que les réalistes ne savent pas ou ne veulent pas parler français. Et cependant M. Courbet est un maître peintre et M. Champfleury un écrivain de talent !
Un homme qui, à ce qu’il me semble, se connaissait en style, M. Joubert, a dit : « Les hommes qui n’ont que des pensées communes et de plates cervelles ne doivent employer que les mots les premiers venus. Les expressions brillantes sont le naturel de ceux qui ont la mémoire ornée, le cœur ému, l’esprit éclairé et l’œil perçant. »
Cela peut s’appliquer, en partie, au Réalisme en peinture et en littérature. Le Réalisme est, en effet, la négation de l’élégance, de la poésie, et – de la vérité. Je m’expliquerai une autre fois.
Ce soir-là, donc, au moment où dix heures allaient sonner au cartel de la brasserie, un homme entra – superbe !
Comme je ne sais pas faire le portrait, je vais m’adresser à un artiste qui s’en acquitte très bien, M. Théophile Silvestre :
« C’était, dit l’auteur de l’Histoire des peintres vivants , un très beau et très grand jeune homme, âgé de trente-six ans et demi. Sa remarquable figure semblait choisie et moulée sur un bas-relief assyrien. Ses yeux noirs, brillants, mollement fendus et bordés de cils longs et soyeux, avaient le rayonnement tranquille et doux, des regards de l’antilope. La moustache, à peine indiquée sous le nez aquilin, insensiblement arqué, rejoignait avec légèreté la barbe déployée en éventail, et laissait voir des lèvres épaisses, sensuelles, d’un dessin vague, froissé, et des dents maladives. La peau était d’un brun olivâtre, changeant et nerveux ; le crâne, de forme conique, cléricale, et les pommettes saillantes, marquaient l’obstination. »
Il est inutile d’ajouter que ce portrait est celui de Courbet.
À son entrée, il y eut un brouhaha significatif qui l’aurait recommandé à mon attention, si déjà son aspect ne m’eût fortement intéressé. Les manieurs de carton laissèrent là leurs « cent d’as » et leur « quinte et-quatorze » pour saluer du regard, du geste et de la voix le pontife du Réalisme ; les joueurs de billard, eux-mêmes, distraits de leur partie comme les autres, s’interrompirent respectueusement et élevèrent leurs queues comme autant de points d’exclamation.
Il s’avança, portant haut la tête – comme Saint-Just et on l’entoura ! Il s’assit, et l’on fit cercle autour de lui ! Il parla, et on l’écouta ! Quand il s’en alla, on l’écoutait encore. Quand il fut parti, ce fut un concert. – « Quelle tête ! » disait l’un, « C’est un Assyrien ! » disait l’autre. – « Quel nez ! » reprenait celui-ci. – « C’est un Espagnol ! » répondait celui-là. – « Quelle bouche ! » redisait le premier. – « C’est un Vénitien ! » répondait le second. – « Quels yeux ! » ajoutait un troisième. – « C’est un Indien ! » affirmait un quatrième. – « Quelles dents ! » faisait observer quelqu’un. – « C’est un Burgonde ! » répondait tout le monde. – « Ce Bisontin est tout simplement un Byzantin ! » exclamait un enthousiaste.
Etc., etc., etc. Enfin un chœur – comme dans les tragédies du vieil Eschyle ou du jeune Sophocle.
Je revins, bien entendu, à la brasserie Andler le lendemain de ce soir-là – et plusieurs autres lendemains après ce lendemain. Mes habitudes errabondantes m’avaient bien servi : j’avais découvert quelque chose d’intéressant.
À cette époque se réunissait là, à peu près régulièrement, un groupe d’artistes d’une réputation plus ou moins sérieuse et d’un talent plus ou moins contesté : Adrien Guignet, l’artiste regretté, l’auteur de ces deux belles choses qui s’appellent la Défaite d’Attila et les Jardins d’Armide ; Français, le paysagiste des bords de la Seine ; Staal, l’illustrateur le plus délicat de toutes ces publications à quatre sous et à un sou dont la France est inondée depuis quinze ou vingt ans ; Anastasi, le peintre des bords de la Meuse ; Baron, le Gavarni de la peinture ; François Bonvin, le successeur de Chardin ; Traviès, le Cruishank parisien, père de Monsieur Mayeux, cette brutale et cynique satire au crayon, qui lui a survécu et lui survivra longtemps encore ; Bodmer, le peintre des intérieurs de forêt, un Suisse transplanté en France ; Mouilleron, le roi de la lithographie ; Célestin Nanteuil, son vice-roi ; Smithon, le graveur anglais ; Regnier, le graveur français ; Promayet, un musicien ; Champfleury, l’auteur si discuté – et si discutable – de Mademoiselle Mariette, des Bourgeois de Molinchart, de M. de Boisdhyver, et de dix autres volumes agaçants à lire, mais intéressants à étudier ; Charles Baudelaire, l’auteur des Fleurs du mal, qui alors étaient encore inédites ; Silbermann, préparateur de chimie et membre de la Société de météorologie ; Dupré, professeur d’anatomie ; Furne, éditeur ; puis une notable quantité d’autres notabilités de grande et de moyenne vertu, le tout mêlé, ainsi que je l’ai dit plus haut, à des étudiants en médecine, à des employés, à des graveurs sur bois.
On se réunissait principalement dans une salle du fond, prise sur la cour de la maison, derrière le billard et à côté de la cuisine. On y mangeait d’abord, et plantureusement, et, ensuite, on s’y livrait à des « beuveries mirifiques » entrecoupées de conversations à gilet déboutonné et de chansons à gorge déployée. Bodmer racontait des histoires de voyage. Baudelaire essayait l’effet de son Edgar Poë sur la tête de ses compagnons, qui lui servait ainsi de dynamomètre : il amenait quelquefois le mille de la terreur. Français, doué d’un remarquable talent de mimique, parodiait la voix, le geste et les allures de certains personnages connus, ses amis et ses ennemis ; il avait, en outre, une Histoire du Grand Serpent pleine d’humour. Silbermann, en sa qualité de membre de la Société de météorologie, causait de la pluie et du beau temps, en savant et en homme d’esprit, à ce point que, lorsqu’il pleuvait, la mère Andler s’en prenait sérieusement à lui. Baron se mêlait volontiers au groupe des causeurs, mais par pure amitié, car, au bout de quelques instants, il s’endormait – pour ne se réveiller que lorsqu’on trinquait. Traviès philosophait et métaphysiquait comme un Allemand – doublé de Parisien – avec une sorte de gouaillerie sérieuse ; parfois, lorsqu’il lui échappait un paradoxe trop insensé, il répondait par un « C’est Hartmann qui l’a dit » qui m’a toujours comblé de stupéfaction, car cet Hartmann n’a jamais existé que dans le cerveau de Traviès : aujourd’hui, que Traviès est mort, l’illustre Hartmann est enterré. Pendant ce temps – cependant, comme on écrivait jadis – Smithon, Français, Courbet, Guignet, Anastasi, faisaient la poule. Quelquefois, Baron, las de ne pas écouter les paradoxes de la grande table, venait se mêler à cette poule aux billes d’or ; il choisissait une queue, lui mettait du blanc, s’asseyait pour attendre son tour, et, son tour arrivé, il dormait.
Mais on ne jouait pas toujours, mais on ne causait pas toujours : on chantait surtout. Staal connaissait un tas d’airs suisses, des tyroliennes, le Ranz des Vaches, et il chantait tout cela – en allemand : madame Andler était très heureuse.
Français chantait le Scieur de long :
Ou bien :
Adrien Guignet chantait sur l’air des Fraises– bien avant M. Adam et madame Cabel :
Promayet chantait la ballade du Roi de Thulé de Gœthe – traduite par Gérard de Nerval
Quand c’était le tour de Courbet – ou à Courbet, pour parler réalistement – il se renversait en arrière et, de sa voix bisontine, mais agréable, il chantait des chansons en vers blancs composées par lui ; par exemple :
Ou bien :
Ou bien :
Ou bien encore :
Ou bien enfin cette vieille chanson ronde bosse, qui fut chantée par lui – affirme M. Théophile Silvestre – devant d’honnêtes bourgeois et de respectables bourgeoises de Pontoise :
Il y en a encore quatre ou cinq couplets – que je vous demande la permission de passer. Les bourgeois de Pontoise les faisaient bisser – ce qui n’a rien d’étonnant de la part de bourgeois – et les compagnons de l’Andler-Keller imitaient les bourgeois de Pontoise – ce qui ne m’étonne pas non plus de leur part.
Je viens de parler longuement de Courbet, à propos de la petite brasserie de la rue Hautefeuille, bien qu’il ne fût pas le seul hôte de ce cellier à bière. Il n’en était pas le seul, il est vrai, il n’en était même pas le plus illustre, à cette époque-là du moins, mais c’était lui qui occupait le plus de place en cet endroit, à cause de son exubérante et envahissante personnalité.
Plus tard, d’autres y vinrent comme lui, qui du reste cessa d’y venir aussi assidûment. Parmi ces autres, je cite au hasard : Gueymard, de l’Opéra ; Best, Leloir, Brugnot, Trichon, Pisan, les princes de la gravure sur bois ; Joseph Lebeuf, l’auteur du Spartacus noir, une très bonne statue remarquée à la dernière exposition ; Émile Thérond, un dessinateur qui enrichit, bon an mal an, d’une cinquantaine de merveilleux dessins, le recueil le plus artistique qui soit, le Magasin pittoresque ; Schann, un musicien qui est peintre, un peintre qui est musicien, le Schaunard de la Vie de bohême, aujourd’hui marchand de jouets d’enfants (successeur de son père) rue aux Ours ; Lancelot, un peintre ; le docteur Meynier, un jeune savant, qui explore en ce moment les bords du fleuve Amour, un des plus grands de l’Asie septentrionale, la ligne naturelle de séparation de l’empire russe et de l’empire chinois ; Théophile Silvestre, le biographe fougueux et pittoresque des Artistes vivants ; Gustave Planche, l’éminent écrivain, mort aujourd’hui et non encore remplacé ; Fillias, un brave et délicat esprit, mort aujourd’hui aussi ; Cressot, un jeune poète, mort aujourd’hui aussi ; et une vingtaine d’autres encore, oubliés ou morts, retirés du commerce des muses ou de celui des vivants, car il faut bien que le temps fasse son œuvre et qu’il couche par terre, d’année en année, les gens qu’on a connus debout.
La brasserie Andler, après une période de bruit et d’agitation, de grands éclats de voix et de grands éclats de rire, est arrivée au quasi-silence et à la quasi-solitude. Ses illustres habitués se sont dispersés, volontairement et involontairement. Louise elle-même, Luisse ! – a quitté sa bienveillante patronne, pour s’établir patronne à son tour, dans une rue voisine.
Heureusement que le maître de l’Andler-Keller a de quoi se consoler de toutes ces désertions, et que le jour où personne ne viendra plus chez lui, il pourra se retirer chez lui – c’est-à-dire dans l’une des deux ou trois fermes qu’il possède en Suisse, la patrie de la liberté et de sa femme.
Il est situé en plein quartier Bréda, le pays des jolies filles et des garçons de talent, à ce qu’il paraît, au coin de la rue de Navarin, en face de l’imprimerie de la Librairie Nouvelle.
Ce cabaret date d’hier, c’est-à-dire d’une quinzaine d’années, et cependant il a un vieil ancêtre, le Caveau de Landel, au Carrefour Buci, qui a été la Pomme de Pin du XVIIIe siècle, comme Dinochau aura été la Pomme de Pin du XIXe.
Je n’ai pas cherché le rapprochement entre ces deux cabarets de lettrés ; il est venu de soi. Chez Landel accouraient rire, chanter, manger et boire, tous ceux à qui leurs moyens permettaient d’avoir de la gaieté, de l’esprit, de l’appétit et de la soif. C’étaient, par exemple, Crébillon fils et Crébillon père, Crébillon le Gai et Crébillon le Triste, Panard, Cahusac, d’Allainval, Piron, La Bruère, Sallé, Pont-de-Vesle, Saurin porc et Saurin fils, Collé, Fuselier, Poinsinet, Palissot, Fréron, Paradis de Moncrif, Gentil Bernard, Duclos, Marmontel, Helvétius, Boucher, Chardin, Rameau, Diderot et quelques autres contemporains plus ou moins célèbres, plus ou moins intéressants qui, connaissant les Propos de table de maître Martin Luther, et ne tenant pas à passer pour des « idiots, » aimaient le jeu, le vin – et les femmes. Si nous doutions, par hasard, de cette triple alliance d’Apollon, de Bacchus et d’Éros, un couplet de 1801 sur l’ancien Caveau nous l’affirmerait :
Landel est mort ; morts aussi son Caveau et ses hôtes aimables. Mais Dinochau vit, et ses habitués, pour n’être pas tous de la valeur de ceux que je viens de nommer, en sont au moins la monnaie.
Il y a une vingtaine d’années, le cabaret de la rue Bréda, qui alors portait pour enseigne : Au Petit Rocher, était tenu par la mère Dinochau ; elle faisait lentement sa petite fortune, pendant que son fils Édouard faisait ses études au collège de Blois, en compagnie d’Armand Baschet – qui, par parenthèse, mangeait tous les pots de confiture envoyés de Paris à son copain. Plus tard, Édouard Dinochau se mit à la tête de l’établissement maternel, appelant à lui ses amis d’autrefois et les amis de ses amis. On vint un à un, deux à deux, quatre à quatre. Ce furent, d’abord, Voillemot, Léo Lespès, Nadar, Chabouillet, Armand Baschet, Bonnaire, des gens de lettres, des peintres, des architectes. Puis, l’impulsion ôtant donnée, le chemin étant connu, littérateurs, artistes et architectes continuèrent à faire la vogue du cabaret et l’ornement de la salle du premier étage, interdite aux profanes du rez-de-chaussée.
Les voici pêle-mêle, les petits et les grands, les maigres et les gras, les illustres et les pseudo-illustres ; Voillemot, le peintre des choses galantes ; Charles Monselet, le Brillat-Savarin de notre génération ; Henry Murger, le chantre de la Vie de bohême ; Nadar, un romancier devenu photographe ; Antoine Fauchery, un photographe devenu écrivain ; Poulet-Malassis, un élève de l’École des Chartes devenu libraire ; Alexandre Pothey, un excellent humaniste devenu très bon graveur sur bois ; Émile de la Bédollière, courriériste grave le matin, au Siècle, et causeur badin le soir, au cabaret ; Champfleury ; Amédée Rolland, un jeune poète devenu auteur dramatique ; Aurélien Scholl, le chroniqueur du Figaro ; Antoine Gandon, un chasseur d’Afrique devenu homme de lettres ; Alphonse Daudet, l’aimable et charmant auteur d’une Double Conversion ; Baudelaire ; Alphonse Duchesne, un poète devenu critique, et bon critique ; Asselineau ; Armand Barthel, l’auteur du Moineau de Lesbie ; Jules Noriac, l’heureux auteur de la Bêtise humaine, du Grain de Sable, du 101e et de la Mort de la Mort ; Victor Cochinat, l’auteur de Lacenaire ; Louis Pollet, le farouche Pollet, l’excentrique Pollet, le sombre Pollet, l’amusant Pollet, le truculent Pollet, l’humoristique Pollet ; Aimé Millet, le sculpteur de l’Ariane ; Henri de La Madelène, l’auteur de Madame Barbe-Bleue ; Ludovic Durand, le sculpteur de l’Amour fait revivre, et du buste du Père Pavard ; Charles Bataille, l’un des auteurs de l’Usurier de Village ; Vernet, peintre éventailliste ; Fernand Desnoyers ; Franceschi, le sculpteur du Général Kamienski ; Auguste de Châtillon, le chantre de la Grand-Pinte ; Étienne Carjat, caricaturiste hier, photographe aujourd’hui, auteur dramatique demain peut-être ; Alfred Busquet, le chantre aimable des Heures