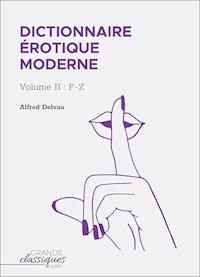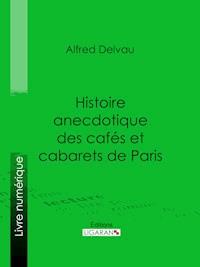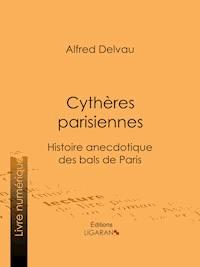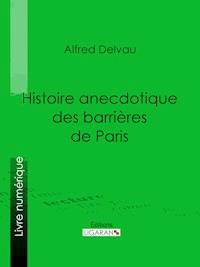
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous commencerons par cette barrière, si vous le permettez, non parce qu'elle est la première, mais uniquement parce qu'il faut bien commencer par quelqu'une, — si l'on veut finir par les autres. L'eau-forte de Thérond me dispense d'entrer dans les détails de sa physionomie architectonique ; bous voyez le bâtiment dû à l'imagination de Le Doux : il est orné de douze colonnes d'un ordre inconnu à Vignole, &, en outre, de deux arcs & de quatre frontons."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MONSIEUR L. HAVIN, directeur politique du journal le Siècle.
Monsieur,
Quoique appartenant aujourd’hui au bataillon des tirailleurs irréguliers de la Petite Presse, – qui a brûlé autant de cartouches et sacrifié autant de soldats que sa grande sœur en l’honneur de la liberté de pensée et de l’indépendance de la conscience humaine, – je me souviens que j’ai été enrôlé, il y a quelques années, dans le régiment des journalistes sérieux, et que c’est à votre paternelle bienveillance que je dois de n’avoir pas trouvé trop lourds à porter ma plume de munition et mon sac de tourlourou libéral. J’ai fait mon devoir jusqu’au bout et je pourrais me considérer comme quitte envers le journal sous lequel j’ai servi, – si ce journal n’était pas représenté par vous. Collaborateur plein de zèle, je crois lui avoir payé ma dette ; mais je serai toujours votre débiteur.
C’est pour essayer de m’acquitter un peu envers vous, Monsieur, que je vous prie de vouloir bien accepter la dédicace de ce livre – qui est une œuvre de bonne foi, et, comme tel, digne de vous être offert par votre bien reconnaissant.
ALFRED DELVAU.
Tour de Crouy, mars 1865.
On conserva – rapporte Mercier dans son Tableau de Paris, – on conserva jusqu’au temps de Démétrius de Phalère, c’est-à-dire l’espace de neuf cents années, le vaisseau que montait Thésée lorsqu’il délivra les Athéniens du tribut du Minotaure. À mesure que ce vaisseau vieillissait, on remplaçait les pièces pourries par des pièces d’un bois neuf ; de sorte que l’on disputa dans la suite si c’était le même vaisseau ou si c’en était un autre.
La ville de Paris ressemble un peu à ce vaisseau de Thésée : on a mis tant de moellons neufs à la place des vieux moellons qu’il ne reste rien, ou presque rien, de sa première construction.
Il y a eu un grand nombre de Paris depuis dix-huit cents ans, – chacun d’eux avec sa physionomie propre, ses mœurs particulières, ses costumes spéciaux, son originalité, son individualité.
Il y a eu d’abord Lutèce, – une île d’une quarantaine d’arpents, laquelle, défendue par Camulogène, fut prise par Labienus, lieutenant de César. Je crois même qu’elle fut un peu brûlée, car César la fit rebâtir et fortifier quelques années après. Le Paris des Druides devint le Paris de Jupiter et de Mercure. Les autels du premier ont disparu ; mais le Dieu Mercure a encore un temple qui résille au temps et aux lois, – bien qu’il n’ait pas été bâti par les Romains.
Il y a eu le Paris de Julien l’Apostat, – que représente le Palais des Thermes. La vigne et le figuier poussaient en ce temps-là à la place même où depuis ont poussé tant de vilaines maisons. Lutèce devint l’Urbs Parisiorum, et comme la Cité n’était pas assez grande pour contenir ses anciens et ses nouveaux habitants, elle s’étala à droite et à gauche, au nord et au midi, dans la plaine et sur la montagne : les bourgs furent !
Après la période gallo-romaine, la période mérovingienne. Après le Paris de Julien, le Paris de Clovis, – dont il nous relie un échantillon sur la montagne Sainte-Geneviève ; puis le Paris de Childebert, qui a laissé sa trace sur la place Saint-Germain-des-Prés ; puis le Paris de Chilpéric, – qu’atteste l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.
On devine bien que les quarante arpents primitifs de la Cité sont déjà loin, puisque des Conciles se donnent la peine de se tenir à Paris et que les rois se donnent la peine d’y demeurer. Les rois et les conciles n’aiment pas, vous le savez, à être gênés : ils prennent de la place, beaucoup de place, ils ont une foule, ils ont un peuple. Les nautæ parisiaci du règne de Tibère sont avantageusement remplacés par des moines, des clercs, des marchands, des soldats – et le reste. Le grand et le petit Châtelets sont avantageusement doublés d’églises, d’abbayes et d’écoles.
L’enfant grandit, la jeune fille devient femme : on lui met un corset de pierre. C’est le Paris d’Hugues Capet, divisé en quatre quartiers.
Nous voici arrivés au Paris de Louis VII, dit le Jeune, – qui a vu naître Notre-Dame, la vieille cathédrale. Les églises continuent à s’élever çà et là. Le quartier de l’Université continue à s’accroître. Les moines les écoliers arrivent de toutes parts ; il en arrivait tant, à ce qu’il paraît, qu’on fut obligé d’expulser les Juifs – momentanément.
Voici maintenant le Paris de Philippe-Auguste. La jeune fille devenue jeune femme devient une vigoureuse commère : son corset l’étouffe, – elle le jette à terre et s’en fait construire un nouveau. Si vous êtes désireux de savoir en quelle étoffe, vous n’avez qu’à vous rendre rue des Grés ou rue des Fossés-Saint-Victor : il en reste encore quelques morceaux. Les quarante arpents primitifs se sont changés en sept cent trente-neuf arpents. Il y a maintenant trois villes à Paris : la Cité, la Ville, l’Université, – l’Université sur la rive gauche de la Seine, la Ville sur la rive droite et la Cité au milieu.
Après le Paris de Philippe-Auguste et ses murailles, vient le Paris de Charles V et sa nouvelle ceinture de pierre, au nord. Celui-là devient de plus en plus exubérant comme sève et comme exigence. Il lui faut maintenant douze cent quatre-vingt-quatre arpents, qui se divisent en seize quartiers. Nous sommes en 1367, – c’est à peu près un arpent par année. C’est à peu près aussi vers cette époque qu’on éprouva le besoin de construire la Bastille, – les deux Châtelets et les autres tours fortifiées ne suffisant plus, à ce qu’il paraît, à la consommation des criminels.
Le Paris de Charles VI est écrit en rouge dans l’histoire : aussi se voit-il mieux que les autres. Nous sommes là sur les confins du Moyen Âge, – mais non sur ceux de la barbarie. La guerre civile règne à la place du roi, qui est fou, et de la reine, – qui doit être un peu folle. Les factions s’égorgent, le sang coule à flots : et, avant la guerre civile – pour préparer l’œuvre de destruction – la pelle ! En 1399, trois mois d’épidémie. En 1407, grandes inondations qui emportent les ponts et ruinent les gens. Le duc d’Orléans est assassiné rue Culture-Sainte-Catherine par Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne. En 1413, massacre des Cabochiens. En 1418, massacre de quatre mille Armagnacs, – puis, brochant sur le tout, cent mille personnes enlevées par la pelle, en trois mois. Savez-vous qu’il fallait que Paris commençât à être grand, pour s’appauvrir ainsi de cent mille habitants sans en être ruiné ? C’était le tiers qui s’en allait ainsi aux cimetières.
Après le Paris de Charles VI et de Charles VII, celui de Louis XI – restitué tout entier, mœurs, langage, costumes et monuments, dans le magnifique livre de Victor Hugo, que nous connaissons tous. Sous le règne précédent, on avait commencé à éclairer les rues ; sous celui-ci on commence à les balayer. Il faut du temps pour songer aux choses les plus élémentaires.
Puis viennent :
Le Paris de François Ier et de la Renaissance, – dont les échantillons sont le vieux Louvre et la fontaine des Innocents.
Le Paris de Henri II, – ou plutôt de Catherine de Médicis, – dont les échantillons sont l’Hôtel-de-Ville et les Tuileries.
Le Paris de Charles IX, – dont il nous reste, comme souvenir, la Saint-Barthélemy.
Le Paris de Henri III, qui sert de date au Pont-Neuf. Ce Paris-là occupait une surface de quatorze cent quatorze arpents.
Le Paris de Henri IV, un peu plus grand encore que le précédent, – seize cent soixante arpents. Nous sommes en l’an 1600. Vous voyez que la progression persiste.
Le Paris de Louis XIII, dont les échantillons sont la place Royale, la place Dauphine, le Palais-Royal et le Luxembourg. Ce Paris-là s’agrandit de plus en plus. La nouvelle ceinture de murailles commençait à la Porte de la Conférence, à l’extrémité du jardin des Tuileries, se prolongeait jusqu’à la rue Saint-Honoré, passait à la porte Gaillon, puis à la porte Richelieu, puis à la porte Montmartre, et aboutissait aux anciens murs de clôture, rue Saint-Denis, à la Porte-Saint-Denis.
Le Paris de Louis XIV, – un peu plus sérieux que les précédents, malgré les troubles de la Ligue et de la Fronde. On plante des boulevards, on bâtit la Colonnade du Louvre, on construit l’Hôpital général, on élève le Palais des Quatre-Nations, on éclaire les rues de Paris avec des lanternes, – excepté les jours de lune. Les falots d’abord, les lanternes ensuite ; puis viendront les réverbères, puis les becs de gaz : mais les esprits, quand les éclairera-t-on ?
La ville de Louis XIV, « le grand roi, » est une grande ville. Il y a vingt quartiers populeux. Il y a des hôtels, des théâtres, des promenades. C’est le rendez-vous de l’Europe. Ce n’est pas encore le monde, – mais cela ne tardera pas.
Nous sommes en 1728 et au Paris de Louis XV. L’enceinte est fixée : elle a trois mille neuf cent dix-neuf arpents, – juste trois mille huit cent soixante-quinze de plus qu’au temps de Camulogène. Sous le règne précédent, on avait planté les boulevards du nord. Sous celui-ci on plante les boulevards du midi. Les villages continuent à devenir faubourgs. On institue la petite poste. On bâtit le Panthéon et la Halle au Blé, l’Hôtel des Monnaies et l’église Saint-Sulpice. Louis XV meurt : Voltaire a régné – et la Pompadour aussi.
Nous touchons au terme de notre course. Louis XVI règne – ou fait semblant de régner, occupé qu’il est de serrurerie avec l’ouvrier Gamain. M. de Calonne, qui ne fait pas semblant d’être ministre, lui, autorise les Fermiers Généraux à enfermer les faubourgs dans un nouveau mur d’enceinte pour « arrêter les progrès toujours croissants de la contrebande, » – et surtout pour faire payer les droits d’entrée à un plus grand nombre de consommateurs. Les travaux, aussitôt commencés qu’autorisés, sont poussés avec vigueur, malgré les murmures et les épigrammes des Parisiens :
Une prison dont il paya les verrous et les grilles – un peu plus de 25 millions, – et que le successeur de M. de Calonne, M. de Brienne, indigné, fut sur le point de faire démolir, sans respect pour les monuments dont Le Doux, architecte de la Ferme, avait orné les barrières ; monuments remarquables – par leur laideur, par leur architecture ampoulée, gauche et pédante que de faux hommes de goût avaient osé comparer aux célèbres propylées de l’Acropole d’Athènes.
Ce que l’archevêque de Toulouse, poussé par son indignation, avait été un instant tenté de faire, le peuple le fit en partie le 14 juillet 1789, brûlant les barrières, démolissant çà et là le mur d’enceinte, mais respectant – sans savoir pourquoi – les affreux monuments de l’architecte Le Doux. Mieux encore, la Convention Nationale, qui cependant n’y allait pas de main morte, et plus timide en ceci que l’Assemblée Constituante, qui avait aboli les droits d’entrée, – la Convention, par décret du 13 messidor an II, songeait à utiliser les fameuses « propylées, » au lieu de songer à les supprimer, ainsi que les murailles qui emprisonnaient toujours la capitale de la Liberté :
« Les bâtiments nationaux désignés sous le nom de Barrières de Paris sont érigés en monuments publics. Les diverses époques de la Révolution et les victoires remportées par les armées de la République sur les tyrans y seront gravées incessamment en caractères de bronze. Le Comité du Salut public est autorisé à prendre toutes les mesures pour la prompte exécution du présent décret, en invitant les gens de lettres et les artistes à concourir et à former les inscriptions. »
L’idée avait de la noblesse et de la grandeur, – comme la plupart des résolutions de cette Assemblée, la plus mémorable dont fasse mention notre histoire ; mais elle ne valait pas cette autre idée, plus révolutionnaire, plus radicale, plus logique : la destruction des monuments de l’honnête M. Le Doux et des murs d’enceinte encore debout. Et la preuve que cette idée était bonne, c’est que, si ces sept lieues de moellons avaient été jetées bas, le Conseil des Anciens, dans sa séance du 27 fructidor an VI, n’aurait pu – à cause des 25 millions qu’il en eût coûté pour les relever – décréter un « Octroi municipal de bienfaisance, » bientôt transformé en octroi pur et simple, aussi excessif, aussi vexatoire que celui qu’avait aboli l’Assemblée Constituante.
Le 1er janvier 1860, les barrières de Paris ont été définitivement supprimées, – plus que supprimées, démolies, – et les limites de la ville reculées jusqu’aux fortifications exécutées, en vertu d’une loi de 1840, sur une étendue d’au moins 36 kilomètres de pourtour.
C’est de ces barrières démolies que j’ai entrepris d’écrire l’histoire, – qui sera un peu celle des quartiers excentriques de Paris, de ses faubourgs et de sa banlieue. Mission délicate, parce que difficile à remplir convenablement, mais que j’ai néanmoins acceptée avec empressement, lorsqu’elle m’a été offerte, parce que c’était une occasion pour moi, enfant du « faubourg Marceau, » de parler de ma ville natale, – une vénérable aïeule qu’on est en train de transformer en galante commère, et dont je ne peux m’empêcher de regretter les rides, si pittoresques.
Oui, – et ces regrets, quoique vains, sont excusables chez un homme qui a appris l’histoire de Paris à l’aide de ses vieux monuments, et qui a déchiffré de bonne heure ses vieilles légendes de pierre, si dramatiques et si pleines d’enseignements de toutes sortes ; oui, je regrette le Paris de nos pères que ne remplacera jamais le Paris de nos fils ; oui, je regrette ses vieilles maisons pignonnées, surplombantes, moussues, culottées par les pluies et par les fumées, qui étaient le cortège naturel de ses vieilles églises enfouies au milieu d’elles – comme les chênes oraculaires au milieu de la forêt de Dodone. Ces amoncellements de pierres qui cherchent à monter jusqu’à Dieu pour intercéder en faveur des fourmis humaines qui grouillent à leurs pieds ; ces pierres de taille superposées, qui ne sont plus aujourd’hui que des monolithes « au sens aboli, » signifiaient alors quelque chose : on ne les regardait pas comme des monuments curieux à visiter, mais bien comme des temples où l’on allait ployer ses genoux et son orgueil.
Je n’admire pas les siècles évanouis pour me dispenser d’admirer le siècle présent, qui sera certainement un grand siècle, le siècle initiateur par excellence, – le portique colossal de l’Humanité future. Mais je ne peux m’empêcher, en fouillant du regard et de la pensée dans les ténèbres des âges disparus, de reconstruire le Paris de Louis XI, par exemple, le comparant avec le Paris de Napoléon III, de le trouver plus poétique, plus merveilleux – et plus caractéristique. On ne mourait pas alors beaucoup plus vite qu’aujourd’hui, – quoi qu’en disent les statistiques et les statisticiens, – et il faisait peut-être meilleur, ou tout au moins plus agréable vivre au milieu de ces rues biscornues, de ces quartiers fantastiques, de ces maisons extravagantes, où tout avait une signification, une originalité, un accent, depuis la borne jusqu’au pignon ; il faisait peut-être meilleur vivre là que dans ces maisons froides, incolores, régulières comme des casernes et tristes comme des prisons, au milieu de ces rues alignées comme des fantassins, tirées au cordeau, tracées stratégiquement, et, à cause de cela, lamentables dans leur régularité.
On a tué la Fantaisie. Il y a des gens qui s’en applaudissent comme d’un progrès : ce n’est pas moi. La Fantaisie n’a rien d’immoral et d’antisocial, à ce que je crois ; elle était reine autrefois, vous en avez fait une servante qui vous sert mal : tant pis pour vous !
Tant pis pour nous aussi, hélas ! pour nous, rêveurs obstinés, chercheurs affamés d’idéal, prophètes à rebours, qui expliquons le passé au profit de l’avenir ! Tant pis pour nous, qui nous sentons ainsi détrônés et découronnés par les inventeurs de marmites autoclaves et de roastbeefs de cheval ; pour nous dont la mission est finie, dont la parole est sans écho, et qui sommes forcés de déposer notre poésie au vestiaire ! Tant pis !
Mais voilà des regrets bien ridicules, – parce que bien inutiles. J’oublie un peu trop les « splendeurs » du Paris d’aujourd’hui, je regrette un peu trop ma bourbe d’autrefois, comme les carpes de madame de Maintenon, et comme madame de Maintenon elle-même, – cette carpe transvasée d’un plat de terre en un bassin d’argent. Ce siècle a une tout autre mission que les siècles qui l’ont précédé : il faut qu’il la remplisse. « L’Humanité est en voyage » : il ne faut pas qu’elle s’arrête. Sauval a comparé l’île de la Cité – le Paris primitif – à un grand navire enfoncé dans la vase et échoué au fil de l’eau vers le milieu de la Seine.
Ce grand navire s’est remis à flot. Les ancres sont levées, les voiles tendues, le vent va souffler : en route pour l’Avenir, Léviathan !
Nous commencerons par cette barrière, si vous le permettez, non parce qu’elle est la première, mais uniquement parce qu’il faut bien commencer par quelqu’une, – si l’on veut finir par les autres.
L’eau-forte de Thérond me dispense d’entrer dans les détails de sa physionomie architectonique ; vous voyez le bâtiment dû à l’imagination de Le Doux : il est orné de douze colonnes d’un ordre inconnu à Vignole, et, en outre, de deux arcs et de quatre frontons. Deux statues de taille raisonnable lui tiennent compagnie : l’une, qui est chargée de représenter la Normandie, et l’autre qui a pour mission de personnifier la Bretagne. Ce n’est pas de la très belle sculpture, mais c’est assez monumental, et à Paris, où le sens artistique n’est pas précisément un sens commun, « être monumental » suffit. N’en parlons plus.
Ce qui m’intéresse dans cette barrière, c’est ce qui m’intéressera dans toutes les autres les souvenirs qui peuvent s’y rattacher, de près ou de loin, anciens ou récents, politiques ou familiers, graves ou badins.
Et les souvenirs abondent ici.
D’abord, cette barrière s’était appelée Barrière des Bons-Hommes, par suite de son voisinage de l’ancien couvent des religieux Minimes de Nigeon, fondé par François de Paule, – un saint homme que Louis XI traitait familièrement de bonhomme. Puis elle s’était appelée Barrière de la Conférence, – une désignation plus noble, mais tout aussi vague pour les habitants de Paris, dont la mémoire fugace n’a gardé nulle trace de l’assemblée par laquelle Louis XIV s’était ménagé une alliance diplomatique et matrimoniale avec l’Espagne.
Quant au nom de Passy qui était resté à cette barrière, elle le devait au village qu’elle séparait de Paris, et dont l’étymologie indique la situation : Passiacum, c’est-à-dire passus ad aquam.
La première illustration de ce petit village est, non pas le roi Charles V, dit le Sage – comme le voudrait mon cher confrère Albéric Second – mais bien plutôt le roi Philippe IV, dit le Bel. Ce destructeur des Templiers – de cet Ordre fameux dont il ne nous reste plus rien que l’hémistiche de Raynouard – possédait là un château dont il nous reste encore une tourelle, et où il attendit si longtemps en vain le troubadour provençal, Arnauld de Catelan, que lui envoyait, pour le distraire, Béatrix de Savoie, et qui fut assassiné en traversant le Bois de Boulogne, à l’endroit même où dansent aujourd’hui les petites dames.
Après Philippe le Bel, Charles le Sage. Jusque-là, d’après Albéric Second, – mes réserves sont faites – Passy n’avait été qu’un misérable hameau composé d’une douzaine de bicoques branlantes, exposées de toutes parts à la fureur des ouragans et aux coups de main des tire-laine. Un jour qu’il passait par là, le roi Charles V s’émut au spectacle de ce complet délabrement et de cette profonde misère ; aussi s’empressa-t-il d’accorder, par lettres particulières, à ses amés sujets de Passy, la permission de clore leurs héritages de murs faits à chaux et à sable ; bien plus, il leur concéda le précieux privilège de prendre, d’étrangler et de manger les conils – quadrupèdes plus vulgairement connus sous le nom de lapins – qui leur feraient du dégât. Est-il besoin d’ajouter qu’à dix lieues à la ronde la nouvelle d’une si royale munificence se répandit avec la célérité d’une commotion électrique ? Tous ceux qui aimaient la gibelotte, et le nombre en était grand, transportèrent leurs pénates dans cette heureuse contrée, où l’on avait le droit de vie et de mort sur les conils.
Voilà comment ce misérable hameau devint un bourg assez peuplé, et ce bourg une seigneurie que possédèrent tour à tour le financier Samuel Bernard, l’historien Boulainvilliers et le fermier général la Popelinière, – cet autre Samuel Bernard « dont la cheminée à plaque tournante pivotait pour le maréchal de Richelieu. » Puis vinrent successivement demeurer là d’autres grands seigneurs et quelques grandes dames : le duc d’Aumont, le duc de Lauzun, l’amiral d’Estaing, la duchesse de Valentinois, etc., etc. Quelques simples grands hommes honorèrent aussi cette bourgade de leur présence, – par exemple Jean-Jacques Rousseau et Benjamin Franklin.
Jean-Jacques, malade d’une strangurie qu’il ne put jamais guérir et qui fut l’incessante cause de ses accès de misanthropie, Jean-Jacques y vint demander la santé aux eaux minérales découvertes dans la propriété du vieil abbé Le Ragois – dont, par parenthèse, la burlesque Histoire de France m’a valu tant de coups de patoche lorsque je faisais mes petites classes à l’Institution Courtois. L’auteur de la Nouvelle Héloïse ne retrouva pas à Passy sa santé perdue, mais ce qui vaut mieux – pour nous – il y trouva trois airs délicieux de son Devin de village, trois airs que beaucoup de compositeurs modernes achèteraient au prix d’une strangurie : J’ai perdu mon serviteur, qui est celui du premier monologue ; L’amour croît s’il s’inquiète, qui est celui du devin, et À jamais, Colin, je t’engage qui est celui du dernier duo.
À Passy vint encore demeurer Jean-Conrad Kocke, banquier hollandais réfugié en France à la suite des troubles de 1787. Appartenant au parti le plus avancé de la Révolution, – qui avait ses tièdes comme elle avait ses chauds, – il recevait tout naturellement chez lui les hommes qui représentaient le plus audacieusement ce parti : Hébert, Anacharsis Clootz, Momoro, Ronsin, Vincent, Proly et quelques autres, et qui tenaient là des conciliabules compromettants, dénoncés à la tribune de la Convention par Saint-Just, et dans son Vieux Cordelier par Camille Desmoulins. On se rappelle la fameuse apostrophe de son numéro 5, crachée en pleine face d’Hébert : « Toi qui me parles de mes sociétés, crois-tu que j’ignore que tes sociétés, c’est une femme Rochechouart, agent des émigrés ; c’est le banquier Kocke chez qui, toi et ta Jacqueline, – une moinesse défroquée, – vous passez à la campagne les beaux jours de l’été ? Penses-tu que j’ignore que c’est avec l’intime de Dumouriez, le banquier hollandais Kocke, que le grand patriote Hébert, après avoir calomnié dans sa feuille les hommes les plus purs de la République, allait, dans sa grande joie, lui et sa Jacqueline, boire le vin de Pitt et porter des toasts à la ruine des réputations des fondateurs de la liberté ? »
Ce banquier hollandais, « ami intime de Dumouriez, » ainsi foudroyé par Camille et ainsi dénoncé par Saint-Just, et qui mourut sur l’échafaud, le 4 germinal an II, avec les Hébertistes, était le père de notre Paul de Kock, le seul écrivain français – qu’admirât Sa Sainteté Grégoire XVI.
À cette liste d’habitants célèbres, à des titres différents, il faut coudre une foule d’autres noms de morts et de vivants, – les vivants, plus oubliés que les morts, – artistes et gens de lettres, philosophes et comédiennes, médecins et généraux, cantatrices et pairs de France : l’abbé Prévost, André Chénier, la Tour d’Auvergne, Goldoni, Chastellier, Picard, le comte de Las-Cases, le marquis de Pastoret, le général Moreau, Hoffmann, Piccini, le comte Portalis, Orsila, Alexis Monteil, Droz, l’abbé Raynal, Scipion Pinel, Deyeux, Lepeintre aîné, Benjamin Delessert, Michaud, Raynouard, Brazier, Dumersan, Bouffé, Auriol, Bressant, mademoiselle Contat, madame Mainvielle-Fodor, Rose Chéri, Honoré de Balzac, Jules Janin, Proudhon, Béranger…
Hélas ! la gent poétique n’est pas aussi vates qu’on lui fait l’honneur de le lui dire : Béranger dut quitter Passy pour retourner à Paris, rue d’Enfer, puis rue de Vendôme, où il mourut. Et la rue de Vendôme n’a pas beaucoup de feuillage !
Jules Janin, songeant à son prédécesseur des Débats, Hoffmann, est venu en avril 1856, rue de la Pompe, se faire construire sur les terrains de la Petite-Muette un chalet charmant, suisse par les découpures, romain par les mosaïques, où il reçoit avec tant de cordialité ses confrères jeunes et vieux, ses ennemis d’hier et ses admirateurs d’aujourd’hui.
P.-J. Proudhon, lui, est mort le mois dernier (janvier 1865) dans le voisinage de cet aimable vivant.
Je ne saurais quitter la barrière de Passy sans consacrer quelques lignes de souvenir au hameau d’Auteuil, où elle conduisait – et où il est si agréable d’être conduit.
Car Auteuil est un village d’opéra-comique, – gens et maisons, pays et paysans. « Les paysans d’Auteuil vont aux champs en bottes, en paletots et en chapeaux gibus, dit Albéric Second, – à qui je ne crains pas d’emprunter, parce que c’est un des chroniqueurs les plus riches de ma connaissance ; quant aux paysannes, elles sont vêtues comme des modistes de la rue Vivienne. Vous ne trouverez peut-être pas dans tout le village une seule Jeanneton ni un seul Nicolas. Toutes les filles s’y nomment Irma, Evelina, Angèle ou Ernestine, et les hommes Adolphe, Ernest ou Alfred. On m’y a montré un gardeur de dindons qui s’appelle Arthur. » Il n’en pouvait être autrement d’un village qui a eu l’honneur d’abriter, pendant plus ou moins de temps, une pléiade de gens illustres, – ou tout au moins célèbres : La Fontaine et Molière, Racine et Boileau, Chapelle et Nicolle, Jonsac et Lulli, Brossette et Nantouillet, Baron et Jacques de Tourreil, Charpentier et l’abbé Morellet, Chamfort et Turgot, Boufflers et Cabanis, Houdon et Condorcet, le duc de Montmorency et le prince de Talleyrand, Destutt de Tracy et le peintre Gérard, Arnal et Gavarni…
Ce n’est pas à cause de Racine, et encore moins de Boileau – ce Narsès de la littérature française – que je m’arrête complaisamment sur la frontière de ce village d’opéra-comique où, depuis si longtemps, se réfugient les poètes et les danseuses, les financiers et les bourgeois lettrés : c’est pour saluer respectueusement d’autres ombres plus chères, celles de Molière et de La Fontaine. Qui n’a entendu parler du fameux souper d’Auteuil ? ce souper auquel assistaient Molière, La Fontaine, Boileau, Chapelle, Racine, Baron et quelques autres gens de lettres, et qui, après avoir débuté par une gaieté folle, s’était terminé par une tristesse plus folle encore, – tant il est vrai de dire qu’il n’y a rien au monde de plus mélancolisant que la joie et que, pour n’avoir pas à pleurer, il faut soigneusement se priver de rire…
On n’a jamais su le pourquoi de cette tristesse générale, de ce dégoût subit de la vie, de ce subit enthousiasme pour le fond de la Seine. Ce n’était pas le vin ; à part Boileau, tous montaient assez bien l’ivresse et ne se laissaient jamais désarçonner par elle – que pour aller se reposer sous la table.
Qu’était-ce donc ? Ah ! voilà ! si on le savait, on ne se donnerait pas la peine de le chercher.
Peut-être que, ce jour-là, entre deux toasts portés à la gloire, à la poésie, à l’amitié, à l’amour, Molière s’était mis à rêvasser plus que de raison à l’infidèle Armande Béjart, Racine à la fidèle Champmeslé, La Fontaine à madame de la Sablière, Chapelle à son ami Bachaumont, Baron à quelque grande dame trop coquette, et Boileau au cruel coup de bec du coq que l’on sait…
En descendant d’Auteuil vers la Seine, où les compagnons de Molière voulaient aller boire le coup de l’étrier, à l’endroit où l’avenue de Boulainvillers vient rejoindre le quai de Passy, en face du pont de Grenelle, est un petit hameau, une réunion de petits cottages – parmi lesquels celui de Gavarni. C’est le Point-du-Jour, – où nous nous sommes tant de fois donné rendez-vous, mes amis et moi, aux beaux jours de notre insouciante jeunesse, pour voir lever l’aurore et manger une friture en compagnie de quelques Cydalises en jupons courts – et à mémoire plus courte encore. Tu t’en souviens, cher Matéo. Mais vous ne vous en souvenez plus, chère infidèle qui avez troqué votre nom de fille – que je n’ai plus le droit de prononcer – contre un nom de dame, et votre adorable maigreur de grisette contre un lourd embonpoint de bourgeoise. Ah ! les bons goujons que nous mangions et que nous étions alors, – hameçonnés par vos jolis yeux !
Le Point-du-Jour n’a pas d’autre histoire que cette histoire intime – qui n’intéresse personne. Son nom seul est une anecdote que je veux citer, en l’empruntant à M. A. de Laborde : « Il était trois heures après minuit, le jeu de la reine se ralentissait et n’était plus soutenu que par des paris considérables entre le prince de Dombes, fils du duc du Maine, et le marquis de Coigny. Ce dernier, perdant d’un coup une somme assez forte, s’écria : “Il faut être bâtard pour avoir un tel bonheur !” Le prince, se penchant à son oreille sans discontinuer son jeu, lui dit : “Vous pensez bien que nous allons nous voir tout à l’heure, n’est-ce pas ? – Où et quand ? – Mais sur la route, au point du jour. ” Les voitures partent… le jour paraît… On s’arrête… Le prince de Dombes est heureux à ce jeu comme à l’autre ; il tue son adversaire, et le lieu où se passa cette scène en a conservé le nom de Point-du-Jour. »
J’aurai dit tout ce qui concerne la barrière de Passy, en rappelant que ce fut par elle que Paris vomit sur Versailles sa « grande populace » le 5 octobre 1789. Ce dut être un spectacle étrange et saisissant que celui de cette tumultueuse procession de femmes en guenilles, conduites par un homme noir, pâle et sinistre, l’huissier Stanislas Maillard, et suivies d’une longue file de charrettes et de canons auxquels s’étaient attelés des hommes en guenilles comme elles ! Le bruit de cette armée de la faim, aux pas haletants, aux clameurs convulsives comme des sanglots, – vagues humaines déferlant sur la route avec la furie d’une tempête, – ce bruit dut s’entendre au loin et faire réfléchir les imprudents qui, deux jours auparavant, dans la salle de l’Orangerie, avaient foulé à leurs pieds la cocarde tricolore et porté des toasts injurieux à l’Assemblée nationale et aux Parisiens.
Non moins étrange et saisissante dut être, le lendemain 6 octobre, la rentrée dans Paris, par cette même barrière de Passy, du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette et du Dauphin, – c’est-à-dire, pour parler le langage du temps, « du boulanger, de la boulangère et du petit mitron, » – escortés de leur peuple, de ce bon peuple parisien, si mobile en ses impressions, qui hurlait maintenant de joie comme il avait hurlé de colère la veille, quoique toujours aussi affamé. Il est vrai que maintenant il avait son illustre otage entre les mains…