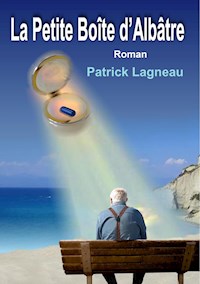6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une mystérieuse Sara convoque, au dernier étage d'un building situé 4857 Mao Zedong Avenue dans la mégalopole sino-américaine de Washandong, Georges Boulanger, libraire en retraite et veuf, ainsi que plusieurs autres hommes du même âge que lui. Lorsqu'ils sont réunis dans la salle de réunion où il ont été invités à entrer, et en attendant que la mystérieuse Sara fasse son apparition, ils discutent entre eux et réalisent qu'ils étaient tous dans la même classe d'école primaire avec le même instituteur sans s'être jamais revus. Personne ne sait ce que leur veut Sara, mais lorsqu'elle les rejoint, ils vont comprendre que chacun d'entre eux a un secret qu'il va être amené à dévoiler aux autres. Alors seulement lorsque tous seront passés aux aveux, Sara pourra leur délivrer son message...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
À mes parents, et à René Tresson, mon instituteur de primaire, pour les valeurs qu’ils m’ont transmises
L’homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté
Albert Einstein
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
1
Une lumière pauvre et triste plombait ce matin de Toussaint. Des larmes de soleil ocre tombaient de là-haut et ricochaient sur le nuage opaque, pesant, immobile, qui se mélangeait à la brume matinale sur un mètre-vingt au-dessus de l’asphalte. Les véhicules sans roues semblaient se déplacer sur un coussin d’air, et les piétons sans jambes donnaient l’impression de glisser sur des tapis roulants invisibles.
Le studio de Georges Boulanger se situait en sous-sol. Aussi, quand il parvint au pied de l’escalier qui menait à la rue, son pot de chrysanthèmes dans les mains, il leva la tête. Surpris, il hésita quelques secondes puis se lança à l’assaut des marches. Il s’arrêta juste sous la chape viciée, se mit en apnée et ferma les yeux pour la traverser. Quand il les rouvrit, une seconde plus tard, il était dans l’autre monde. Celui des hommes-troncs.
Il glissa ainsi sur le trottoir pendant une dizaine de minutes, et lorsqu’il rejoignit la file d’attente à l’arrêt de bus, tous avaient retrouvé leurs membres inférieurs. La brume rampante s’était dissoute. Ne subsistaient que des lambeaux grisâtres de contamination industrielle et des molécules de gaz d’échappement en suspension. L’autobus rouillé et tagué se rangea sur l’espace de stationnement dans le souffle chaud et caractéristique de ses freins hydrauliques fatigués. La porte s’ouvrit en couinant et la file d’attente fut aspirée par le véhicule dont les sièges étaient libres. Les passagers s’éparpillèrent comme des écoliers indisciplinés. Georges Boulanger s’installa sur la banquette du fond, seul.
Georges avait soixante-sept ans. Il avait consacré toute sa vie aux livres. Il avait tenu une librairie dans un quartier animé de la ville, puis l’avait abandonnée – même pour un bon prix, ça avait été un vrai déchirement - à un jeune couple quand l’heure du repos avait sonné. Il ne ressentait ni amertume, ni nostalgie. Juste de merveilleux souvenirs liés à sa passion, mais aussi aux rencontres savoureuses qu’elle avait suscitées : des lecteurs assidus, des étudiants fouineurs, des écrivains pour des séances de dédicaces, tous habités par la même flamme, le même enthousiasme, le même espoir d’être un jour reconnus à défaut d’être célèbres, des bibliophiles à la recherche de perles rares, des enseignants avides de nouveautés littéraires… Oui, Georges les avait aimées ces rencontres. Mais ce dont il était le plus fier était celles qu'il avait faites avec les enfants. Il parvenait à les subjuguer, les captiver, voire les ensorceler, en leur contant des débuts d’histoires qu’il savait enrober de mystères, juste en dévoilant de l’intrigue les prémisses de suspenses haletants. Rares étaient ceux qui ne repartaient pas avec un livre sous le bras. Bien sûr, il n’agissait de la sorte qu’avec les enfants accompagnés de leurs parents avec qui il partageait la même conviction : la certitude que la lecture contribuait à l’épanouissement de l’enfant, à l’éveil de son imagination, à l’apprentissage de la langue, à la construction de sa pensée, et peut-être même pour certains à la structuration du mécanisme de leur propre créativité littéraire. Loin de lui l’idée d’imposer à tout prix, au sens mercantile du terme, un livre à un enfant qui se serait hasardé seul dans la librairie. À la limite il s’autorisait à piquer sa curiosité. Libre au gamin de convaincre ensuite ses parents de lui acheter tel ou tel livre. Et même s’il ne revenait jamais, ce n’était pas bien grave. Il savait qu’en tant que jardinier de l’esprit, il avait semé les bonnes graines. Et comme tout bon jardinier qui se respecte, il savait que la récolte n’était jamais immédiate. Il fallait biner, enlever les mauvaises herbes, et beaucoup de soleil avant que le fruit ne parvienne à maturité. Dans les mauvaises herbes, il rangeait le diktat technologique qui rendait les jeunes générations addictives aux écrans, aux images, aux jeux vidéo et les éloignait de plus en plus des valeurs qui construisent l’individu. Mais si d’aventure, un seul d’entre eux succombait à la curiosité de savoir ce que révélait l’histoire cachée dans les pages noircies de lettres, de mots, de phrases et qu’il avait su rendre attractives, alors le soleil entrait dans sa vie. Et si le même gamin repassait un jour chez lui, il savait que le fruit était mûr. Mais pour un seul qui parvenait à se gorger de sucre, combien tombaient de l’arbre et s’écrasaient au sol avant même d’avoir mûri ?
Oui, il gardait d’excellents souvenirs de cette époque révolue. Il inspira pour chasser une vague de nostalgie et regarda ses chrysanthèmes. La librairie disparut, balayée par l’image d’Anne. Malgré lui, le souvenir de ce matin d’automne le submergea.
Cela remontait déjà à pas mal de temps. C’était une fin de septembre. Ou peut-être d’octobre. C’était flou. Anne était infirmière de nuit à l’hôpital. Elle alternait les périodes de travail avec plusieurs journées consécutives de récupération. Ce matin-là, elle avait quitté son service à six heures, comme d’habitude. Elle rejoignait à pied l’arrêt de bus qui se situait à cinq minutes. Cinq minutes… C’est pourtant court comme trajet. Mais cela avait été suffisant pour qu’un chauffard ivre la renverse sur un passage protégé… Il ne s’était même pas arrêté… La police l’avait retrouvé à l’issue d’une enquête rondement menée. Il était passé au tribunal et avait écopé de trois ans de prison pour délit de fuite et homicide involontaire. L’excuse du coupable le hantait. Pardon, je n’ai pas fait exprès… Quelle honte ! Comme si on l’avait forcé à boire. À prendre le volant. C’était un homicide, bon dieu !… Homicide… Derrière ce mot terrible, il y a assassin, criminel, meurtrier, tueur… Et pour tout cela, trois ans seulement… Trois ans pour une vie fauchée… Quelle injustice !
Ça l’avait rendu malade… Une forme de dépression qui avait disparu un jour, comme par magie. Il s’était levé un matin, et hop ! Plus rien. Plus de douleur dévastatrice. Plus de tristesse infinie. C’était sans doute là, comme on dit, qu’il avait fait son deuil. Il se rendait au cimetière plusieurs fois par mois, et bien sûr, la visite à la Toussaint était incontournable.
Il était le dernier passager du bus. Il descendit à l’ultime station de la ligne dans la banlieue sud de Washandong. Comme à chaque fois qu’il se retrouvait là, il frissonna. Pas de crainte particulière, non, pas non plus à cause des bâtiments froids. Délabrés. La ville en général avait cet aspect. Mais peut-être le manque de verdure. Si le centre-ville était doté de quelques parcs où, par miracle, il faisait encore bon se promener, la banlieue sud souffrait cruellement d’une absence de végétation. Pas un arbre. Pas un brin de pelouse. Pas une balconnière fleurie. Que du béton, du béton, et encore du béton. Des espaces vides entre les bâtiments étaient couverts de plaques de ciment coulé, aux jointures desquelles poussaient des herbes sauvages. La seule marque de vie sociale apparente reposait sur quelques bancs en béton noirci par le temps et les intempéries, plantés au milieu de ces espaces, comme abandonnés. Les quelques travailleurs de nuit étaient déjà rentrés chez eux et avaient croisé ceux de jour. Leur prochaine rencontre n’aurait lieu que douze heures plus tard. Quant aux autres, ceux qui avaient abandonné depuis longtemps l’idée que quelque part un emploi les attendait, ils dormaient encore. Leurs rejetons, comme des zombies, commençaient à peine à sortir des immeubles aux murs couverts de tags. Sweats floqués au nom de groupes de rap quelconques, capuches relevées sur des casques branchés sur leurs smartphones, baggys affaissés le plus bas possible pour afficher avec ostentation les sous-vêtements de la marque la plus médiatisée, ils traînaient déjà leur démarche fatiguée et convergeaient vers quelque endroit secret de leur tribu, afin d’établir le plan quotidien qui leur permettrait de s’enrichir davantage.
Georges hâta le pas, traversa une rue et longea le mur du cimetière jusqu’à l’entrée principale. Il se dirigea sans difficulté, par habitude, à travers les allées labyrinthiques jusqu’à la tombe de son épouse. Il ne pria pas. Il ne pouvait plus. Il gardait une sorte de rancune envers Dieu d’avoir permis que son épouse lui soit enlevée de cette manière cruelle. Pendant qu’il enlevait les fleurs fanées et les remplaçait par ses chrysanthèmes, il parla à voix haute, comme à son habitude.
- Bonjour, ma chérie. Tu sais, avant-hier, cela a fait… depuis combien de temps déjà es-tu partie ?... Tu vois, je ne m’en souviens même plus… Tu imagines ? Je dois commencer à perdre la mémoire… C’est loin, mais j’ai l’impression que c’était hier. Même pas ! J’ai l’impression que tu es toujours là. Tu sais, parfois, quand je regarde la télévision, le soir, je me crois encore dans la petite maison où nous habitions. Avant. Il me semble que tu es dans la cuisine. J’entends du bruit… Même ta voix ! Je vais t’avouer quelque chose, ma chérie… Je me surprends quelquefois à te parler… Mais tu ne me réponds jamais… Alors le silence me renvoie à ton absence. Tu me manques. Si tu savais comme tu me manques… Mais je ne pleure plus. Je ne sais plus. Je ne peux plus. J’ai sans doute versé toutes les larmes de mon corps. Au début… Maintenant, c’est tout sec… Je suis un vieil arbre desséché…
Il saisit la bouteille en plastique cachée derrière la stèle, alla la remplir d’eau à l’unique robinet du cimetière et entreprit de nettoyer le soubassement et la pierre tombale en marbre avec un chiffon qu’il tira de sa poche.
- Tiens, au fait ! Émilie est venue me voir hier… Si tu voyais comme elle a grandi notre petite-fille… Elle est brave, cette petite… Je dis petite, mais c’est une jeune femme maintenant… Elle doit avoir au moins vingt-deux ans… vingt-cinq peut-être. Elle te ressemble un peu, je trouve. Remarque, je dis ça, mais c’est surtout pour te retrouver en elle, je suppose… En tout cas, elle est jolie… Toi aussi, tu étais belle… Ses parents ? Oh, elle doit les voir une ou deux fois par an. Tu sais, même si elle était bien avec nous, elle a souffert malgré tout de leur absence. Je ne leur pardonne toujours pas d’avoir privilégié leur carrière au détriment de leur fille. C’est dur à dire, mais pour moi, c’est comme s’ils étaient morts… Oui, je sais, je sais, tu vas me dire que depuis le temps j’aurais dû jeter l’éponge… Mais on ne me changera pas. Remarque, j’ai une satisfaction… Émilie est passée à mi-temps ! Deux jours et demi par semaine, elle est avec ses élèves, et le reste est occupé par des responsabilités syndicales. Et ça, ça me plaît ! Une manière d’envoyer un message clair à ses parents…
Il alla reposer la bouteille derrière la stèle sur laquelle le visage du Christ en relief posait toujours le même regard figé sur la tombe. En silence, il se recueillit quelques instants, les doigts entrelacés sur son ventre.
- Allez, ma chérie, je te laisse pour aujourd’hui… Repose-toi bien ! Je sais, c’est idiot de te dire ça, mais au moins j’ai l’impression que tu dors… Je reviendrai te voir mardi prochain. Ils annoncent des orages pour la fin de la semaine. Il y a de fortes chances que le pot de chrysanthèmes soit renversé… Mais ne t’inquiète pas ! Je veille au grain… Au revoir, Anne chérie… Je t’aime…
Il s’éloigna, pensif, et quitta le cimetière.
Il traversa l’espace maintenant plus animé entre les immeubles et rejoignit l’arrêt où stationnait un bus, moteur en marche. Le chauffeur faisait une pause cigarette. Georges ne put s’empêcher de lui faire la remarque.
- Si vous coupiez le moteur, il y aurait moins de gaz, vous savez…
L’homme tira une dernière fois sur sa cigarette, inhala la fumée jusque dans le plus profond recoin goudronné de ses poumons, souffla lentement un mince filet bleuté entre ses lèvres retroussées, et jeta le mégot d’une pichenette.
- Vous avez vu mon bus ? Vous avez vu dans quel état il est ? Si je coupe le moteur, comme vous dites, je ne redémarre plus. Personne au dépôt n’a le temps de mettre son nez dedans… Tout le monde s’en fout. Alors moi, si j’ai la chance que le moteur démarre le matin, il tourne jusqu’au soir. C’est comme ça. Et c’est pas ces gaz en plus qui vont augmenter la pollution, si ? Au point où on en est… Et puis par les temps qui courent, j’éviterais de me mêler des affaires qui ne me regardent pas. On ne sait jamais. Si vous voyez ce que je veux dire…
Georges Boulanger s’abstint de toute réponse qui, de toute évidence, n’inciterait pas son interlocuteur à couper le moteur. Il devina chez cet homme une sorte de résignation. C’est tellement plus simple de capituler que de se battre. Il monta dans le bus en silence.
Un peu plus tard, il décida de descendre deux stations avant la sienne. Juste pour déambuler dans des quartiers moins sensibles, et savourer le plaisir de marcher sans appréhension.
En regardant les vitrines de luxe qui se succédaient, il en vint à regretter le temps où il fallait se mettre dans les files d’attente devant les dernières boulangeries, boucheries ou épiceries aujourd’hui disparues. Et quand il était gamin, il n’y avait même pas besoin d’attendre… On entrait, bonjour madame, une baguette s’il vous plaît, on payait, merci, au revoir madame, on sortait, et c’était tout. Mais ça, c’était bien avant que les hypermarchés ne développent leur hégémonie tentaculaire. D’ailleurs, le vocabulaire de Georges était vraiment caduc. On ne parlait même plus d’hypermarchés. La mondialisation était passée par là. La guerre commerciale avait tourné en faveur d’une seule enseigne, la S.A.S.A, fusion des deux multinationales les plus importantes de Chine et des États-Unis… S.A.S.A. pour Société Anonyme Sino-Américaine. Toute concurrence avait été éliminée. Il ne subsistait que ce sigle commun sur toute la planète. On mangeait sino-américain. On s’habillait sino-américain. On écoutait de la musique sino-américaine. Même l’exception culturelle française de l’enfance de Georges avait cédé le pas à la culture de masse sino-américaine. Et tout cela dans la mouvance occulte de la finance mondiale. Les principales banques avaient jonglé, et jonglaient toujours, avec les spéculations virtuelles les plus folles. Les actionnaires s’étaient enrichis grâce aux délocalisations d’entreprises pourtant déjà délocalisées. Cela avait commencé, il y avait bien longtemps, vers les pays de l’Est, puis vers la Chine, et comme les profits étaient toujours insuffisants, vers l’hémisphère sud, Madagascar et les pays d’Afrique où des décennies de guerre avaient engendré la misère la plus profonde. On était passé de trois cents yuanars - contraction officielle du yuan, ancienne monnaie chinoise et de l’ex-dollar américain - par mois pour les ouvriers des pays de l’Est, à cent pour les Chinois, pour finalement stagner aux alentours de quinze en Somalie, en Tanzanie ou au Mozambique. Le coût du travail réduit au strict minimum propulsait les travailleurs dans une descente vertigineuse vers l’enfer. Le consortium sino-américain, où s’étaient engouffrés son fils et sa belle-fille, accroissait ses profits dans des proportions exponentielles. Le problème, c’est que de moins en moins de gens travaillaient, donc ils ne pouvaient dépenser l’argent qu’ils ne gagnaient pas. Et comme toute allocation chômage avait été abolie par le pouvoir politique en place, il fallait se battre pour survivre. Ou vivre, tout simplement. C’est l’option qu’avait choisie Émilie, sa petite-fille, et qui l’opposait à ses parents. Mais pour d’autres, tous les moyens étaient bons pour engranger sans le moindre scrupule le maximum de yuanars. Afin de conforter cette situation en toute sécurité, les puissants n’hésitaient pas à gangréner les couches les plus misérables de la population par la corruption. Quand on était un peu chef de bande, ou tout simplement désœuvré avec un peu de jugeote, il était facile de gagner de l’argent en s’acquittant de quelques basses besognes commanditées de là-haut. On devenait alors en quelque sorte les partenaires privilégiés des requins mafieux de la finance, mais asservis et redevables.
Ces réflexions amères nées d’un regard sur les vitrines somptueuses renvoyèrent Georges à des souvenirs encore plus lointains. Une époque où le mot « morale » avait un sens, où la politesse était coutume et le respect, ligne de conduite commune. Une époque où l’argent n’était pas une fin en soi, où un homme portant une casquette ou un chapeau se découvrait en entrant dans n’importe quel commerce. Où un adolescent s’effaçait devant une dame à l’entrée d’un magasin, ou encore se levait dans les transports en commun pour céder sa place à une femme enceinte ou une personne âgée. Mais ça, c’était avant. Que s’était-il passé ?
Devant l’orgie de parfums, de robes de soirée sophistiquées, de bijoux, de sacs en cuir, voire de coupés sport exposés dans les magasins estampillés S.A.S.A, Georges eut la nausée. Ce monde n’était pas le sien. Ce monde était artificiel. Ce monde n’avait aucun sens. Et pour lui, le monde se résumait à cette ville, Washandong, pourtant si jolie contraction de l’ancienne capitale des États-Unis, Washington, et de cette province la plus peuplée de Chine, Shandong.
Il bifurqua à l’angle d’une rue, soulagé de ne plus avoir à subir la débauche sino-américaine.
Il parvint devant le parc Georges W. Bush et décida de le traverser pour gagner du temps. Il emprunta les allées que les jardiniers municipaux s’évertuaient à fleurir malgré la pollution qui réduisait à néant leurs créations paysagères, et que les délinquants n’hésitaient pas à piétiner dès que des fleurs plus résistantes parvenaient à exhiber avec fierté leurs robes de pétales colorés.
Georges quitta peu après le parc, salua une jeune femme qui détourna son regard et accéléra le pas sans lui répondre. Triste monde, songea Georges, où adresser la parole à quelqu’un est ressenti comme une agression… Il est vrai que l’insécurité avait pris des proportions alarmantes. La crise économique y était pour beaucoup. Le fossé entre riches et pauvres s’était creusé et avait accru les vols et la violence. Mais Georges restait profondément persuadé que, même s’il était le dernier, il se devait d’être le garant d’une moralité exemplaire. Tant pis si on le prenait pour un extraterrestre. Seule la croyance viscérale au retour à des valeurs plus humanistes pouvait changer la vision de l’avenir. Et pas seulement la vision, mais l’avenir lui-même. Nul ne pourrait l’empêcher de s’accrocher à cet espoir.
Il parvint dans une petite rue étroite qui portait le doux nom de Clintong.
… un « G » ajouté au nom de l’ex-président américain, juste pour que cela sonne asiatique. Les Chinois n’ont vraiment rien lâché…
Une file de voitures était bloquée par des déménageurs qui chargeaient des meubles, provoquant une cacophonie de coups de klaxon rageurs et d’insultes véhémentes, hurlées par des conducteurs impatients. Un huissier venait de procéder à une saisie dans un appartement dont les propriétaires ne pouvaient sans doute plus payer les mensualités de remboursement du prêt accordé miraculeusement par leur banque. Le couple était là, sur le trottoir, et la femme pleurait en suppliant l’officier ministériel de leur accorder un délai supplémentaire. Méprisant, il ne leur accorda même pas un regard. C’est à cet instant que la scène prit un tour dramatique. L’homme sauta sur l’huissier et lui planta un couteau dans la gorge. Il s’effondra dans un bain de sang alors que l’homme continuait à s’acharner sur son corps. La femme hurlait. Les déménageurs ceinturèrent l’homme alors que des policiers, comme s’ils venaient de bondir de starting-blocks, accouraient pour leur prêter main-forte. Des journalistes, apparus de nulle part comme par enchantement, braquaient déjà leurs caméras comme des rapaces sur leur proie. La police avait son flag. Les médias leur scoop. Voilà qui alimenterait les journaux télévisés pendant au moins quarante-huit heures. Là, il y avait du sang. Et le sang vampirise le spectateur, l’attire, le fascine, l’envoûte, l’électrise. Jusqu’au prochain évènement qui ferait exploser l’audimat.
Georges se précipita dans une ruelle perpendiculaire, bien nommée rue de l’Abondance, dans laquelle il vomit derrière un tas d’immondices. Un fait divers de plus. Une banalité du quotidien qu’il refusait d’admettre. Il s’essuya les lèvres avec son mouchoir et se demanda si sa réaction était plus provoquée par l’acte sanglant lui-même, ou par le comportement des médias qui s’emparaient des images du meurtre pour les transformer en profits mirobolants, grâce aux publicités diffusées à l’antenne, juste après l’annonce de l’info. Ils avaient de l’hémoglobine. Et l’hémoglobine faisait vendre.
Il évita de revenir en arrière et décida de poursuivre son chemin par la ruelle dans laquelle il se trouvait. Il ne l’avait jamais empruntée, mais il savait d’instinct où elle menait. Il déboucha sur la rue de Beijing qu’il remonta sur sa droite. Il traça mentalement le parcours qui le conduirait chez lui. Les quelques piétons qu’il croisait semblaient tous perdus dans leurs pensées.
À une vingtaine de mètres, il remarqua un jeune d’une quinzaine d’années qui avançait dans sa direction. Il dévorait à pleines dents un Big Jack, ce super sandwich multi couches, qui avait détrôné depuis plusieurs décennies le produit phare de McDonald’s dans la suprématie de la cuisine rapide où il s’était hissé. Le ketchup dégoulinait de chaque côté de son menton à chaque nouvelle bouchée. Comme bien souvent pour la plupart des consommateurs de ce produit, la quantité à ingurgiter était bien supérieure au volume de l’estomac qui pouvait l’absorber, aussi, il n’était pas rare que le dernier quart finisse sa carrière d’ersatz alimentaire avec les détritus. C’était d’ailleurs à la quantité de ses déchets agroalimentaires que l’on mesurait la santé d’une nation. Et là, pas de souci ! Le pays se portait bien. À la mine poussive de l’énergu-mène lorsqu’il regarda ce qui lui restait entre les mains, Georges sut ce qui allait se passer. Sauf que ! Alors qu’il passait à proximité d’une poubelle grise en plastique de gros volume, avec désinvolture et sans vergogne, le garçon jeta sur le trottoir les résidus de pain, de viande, de salade et autres ingrédients qui s’écrasèrent dans un splash écœurant au milieu d’une flaque de ketchup. Un sourire ironique aux lèvres, il s’amusa de l’air ahuri de Georges scandalisé par son acte. Georges ne put s’empêcher de l’interpeller avec prudence.
- Excusez-moi ! Mais vous avez laissé tomber quelque chose…
L’adolescent afficha un étonnement forcé.
- Ah bon ? Où ça ? dit-il en levant la tête pour regarder avec insolence tout autour de lui.
- Là ! indiqua Georges patient, de son bras tendu vers la bouillie sur le trottoir. Il y a une poubelle… Ce n’est pas fait pour les chiens…
Alors que Georges ne le quittait pas des yeux, le jeune vaurien se décomposa et afficha un rictus provocateur.
- J’ t’emmerde, connard ! lança-t-il d’un ton agressif.
Surpris et consterné, Georges ne sut quoi répondre. Il savait aussi qu’avec ce genre d’individu, il valait mieux ne pas insister. D’autres avaient été poignardés pour moins que ça. La violence des mots résonnait dans sa tête. Il passa à côté de lui alors qu’il ricanait, mais il évita de croiser son regard, de crainte que la fripouille n’y décèle tout le mépris qu’il éprouvait pour lui. Il s’éloigna, bouillant de colère contenue, mais quelques secondes plus tard, il entendit des cris derrière lui. Il se retourna et se figea sur place. Tout se passa si vite, que longtemps après, il se demandera encore s’il n’avait pas rêvé.
Le jeune était tombé la tête la première dans la poubelle. Seules les jambes qu’il agitait dans tous les sens dépassaient. Elles disparurent également à l’intérieur alors que les cris se transformaient en hurlements sauvages étouffés lorsque le couvercle se rabattit avec violence.
Georges était blanc. De surprise, qui se transforma bientôt en effroi. Il était incapable d’émettre le moindre son. D’effectuer le moindre mouvement. Un camion-benne à ordures remontait lentement la rue de Beijing pendant que deux éboueurs accrochaient les poubelles qui étaient soulevées, puis renversées afin que le contenu se déverse sur le broyeur intérieur.
Georges ressentait maintenant une terreur sourde. Sa panique l’empêchait d’agir ou au minimum d’avertir les éboueurs. Le camion s’approcha de LA poubelle. Le moteur et le broyeur en action couvraient les cris sourds et redoublés du garçon. Georges Boulanger crut qu’il assistait au paroxysme de l’horreur, mais il se trompait. Il y avait une gradation supplémentaire.
La poubelle fut roulée, accrochée, soulevée, retournée.
Le contenu fut déversé à l’intérieur. Un craquement épouvantable résonna dans la benne. Le broyeur toussota, faillit caler comme s’il était parvenu à un point de rupture, puis soudain il repartit gaillardement comme si de rien n’était.
- ’Font chier. Z’ont encore dû mettre des morceaux d’ bois, râla l’un des éboueurs en décrochant la poubelle.
- Ouais ! Un d’ ces quat’, le broyeur va nous rester sur les bras, enchaîna l’autre tout en poussant la suivante vers la benne.
- T’as raison. Mais on peut quand même pas les vérifier toutes …
- Ben, on devrait, moi j’ dis. Parce que si un jour on rentre sans l’ broyeur, on peut dire adieu au taf…
- Oh, les filles ! Z’avez fini d’ papoter, s’écria par la fenêtre le conducteur du camion. J’ vous rappelle qu’on doit être rentrés pour onze heures…
Le camion-benne poursuivit son parcours et quand il disparut à l’angle de la rue, Georges Boulanger était toujours pétrifié. Il ne pouvait pas bouger. Sa bouche était sèche. Il regarda autour de lui. Personne. Il avait été le seul témoin de ce drame. Il songea que peut-être, il avait eu une hallucination. Il s’était inventé ce qu’il avait vu. Mais quand il baissa la tête vers l’endroit où la poubelle avait été reposée, il sut qu’il avait tort.
Les restes du Big Jack éclaté au milieu des éclaboussures de ketchup en étaient la preuve.
Il frissonna et avec beaucoup de volonté, il parvint à se mouvoir. Ses muscles étaient tétanisés. Chaque pas lui arrachait un gémissement. Mais au-delà de la douleur diffuse qu’il ressentait, il y avait pire. Une bestiole qu’il ne connaissait pas le dévorait de l’intérieur, le rongeait à coups de dents acérées : le remords. Une culpabilité qui s’appelait non-assistance à personne en danger s’insinuait dans son esprit avec une frénésie insidieuse. Toute sa vie, il avait été contre toute forme de violence. Jamais il n’aurait agressé qui que ce soit. Et même si ce gosse avait mérité une leçon pour son insolence et son manque de respect, il ne méritait pas la mort. En tout cas, il ne l’avait pas souhaitée. Enfin, il se contraignit à penser qu’il ne l’avait pas souhaitée… Sa souffrance morale lui arracha une plainte qui se transforma en un cri lorsqu’elle déborda de sa bouche. Il eut une remontée de bile acide qui provoqua une violente nausée. Il se précipita vers la poubelle et régurgita sa détresse à l’intérieur. Quand il ouvrit les yeux et qu’il songea que le gamin avait été là, au fond de la poubelle souillée, il s’effondra assis sur le trottoir et sanglota comme un enfant. Plusieurs personnes passèrent à proximité et lui jetèrent à peine un coup d’œil. On ne regarde pas la misère des autres. De peur qu’elle éclabousse. Qu’elle soit contagieuse. Ou par mépris, tout simplement.
Georges perçut les pensées intérieures des passants à leurs regards furtifs et il en ressentit une profonde honte. Il se releva au bout de quelques minutes en prenant appui sur la poubelle. L’image de ce qu’elle représentait le fit reculer d’un pas et il exécuta un demi-tour radical. Il devait fuir. Mettre le maximum de distance entre elle et lui. Il courait presque maintenant et parvint à bout de souffle devant l’escalier qui descendait à son studio. Afin de reprendre sa respiration, il prit appui quelques instants contre une grille. Elle était censée protéger une bande de pelouse clairsemée qui longeait la façade, mais qui était jonchée de canettes en tous genres, de journaux froissés et bouteilles en plastique écrasées : une déchèterie sauvage comme on en trouvait un peu partout dans la ville. Et dire que la municipalité avait multiplié par trois le nombre de poubelles… Le mot lui vrilla les intestins. Il dévala les marches, pénétra dans le vestibule et sortit avec fébrilité une clef de la poche de son imper. Sa main tremblait tant pour l’introduire dans la serrure qu’il dut l’étreindre de l’autre. Soulagé, il entendit le verrou claquer à l’intérieur. Il poussa la porte au dos de laquelle il s’appuya quand elle fut refermée. Il tourna le verrou au-dessus de son épaule. Mais il savait qu’il ne serait pas pour autant en sécurité. Le danger était intérieur. Il venait de son esprit. Il ôta son imperméable qu’il jeta sur le dossier d’une chaise, se dirigea vers la salle de bain, ouvrit l’armoire à pharmacie et s’empara d’un flacon. Il fit glisser deux gélules dans la paume de sa main, les jeta dans sa bouche, puis but un verre d’eau pour les avaler. Il retourna s’asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre et tenta de se détendre. De sa position, il pouvait voir les jambes des passants sur le trottoir. Il suffisait qu’un seul s’arrête juste là, pour relacer son soulier par exemple, et il pourrait le voir dans son fauteuil par la fenêtre. Peut-être même le reconnaître… Le reconnaître ? Mais pour quelles raisons ?...
Allez, ne te voile pas la face, Georges ! Il pourrait t’identifier comme étant celui qui a laissé mourir un être humain de la façon la plus horrible qui soit… Par broyage dans une benne à ordure !
Dans son esprit, les os de l’adolescent craquaient encore. Il serra les dents et contracta ses paupières comme pour effacer de sa mémoire, sinon l’épouvantable scène, du moins l’identification improbable du passant… Il ouvrit les yeux. Les jambes continuaient leur ballet perpétuel. Personne ne se baissa pour relacer son soulier. Il soupira et songea qu’il avait été le seul à assister à la scène de la poubelle. Il ne devait pas sombrer dans la paranoïa. Sans qu’il s’en aperçoive, il s’endormit sous l’effet des somnifères.
*
- Georges ! Comment as-tu pu ne pas intervenir ?
Il se retourna. Anne était là. Les poings sur les hanches, elle le fixait avec reproche, le sourcil froncé. Derrière elle, l’adolescent mordait à pleines dents dans son Big Jack, les yeux pétillants de jouissance. De quoi se régalait-il le plus ? De son monstrueux hamburger ou du reproche qu’Anne lui adressait ? Le moteur d’un camion-benne tournait au ralenti et entraînait un broyeur énorme dans un impitoyable mouvement rotatif. Son épouse indiqua d’un bras tendu vindicatif la direction de la benne. Il ne comprenait pas. Refusait de comprendre. Alors, il se sentit agrippé par les bras des deux éboueurs. Il fut soulevé de terre et conduit jusqu’au camion. Georges hurlait de terreur sans qu’aucun son ne jaillisse de sa gorge. Il jetait des regards implorants vers sa femme dont la posture autoritaire n’avait pas changé. Les deux hommes lui attrapèrent les jambes qui s’agitaient dans le vide, et ils balancèrent son corps dans la benne. Aussitôt ses pieds furent happés par le broyeur. Il ne sentait rien. Ne ressentait que l’horreur de voir son corps happé progressivement, grignoté, haché, malaxé par les dents carnassières d’un saurien gigantesque et métallique…
*
Il sursauta, en nage. Regarda autour de lui, hagard. Il prit conscience de l’endroit où il se trouvait, soulagé d’être sorti de son affreux cauchemar. Dorénavant, sa culpabilité et son remords étaient inscrits jusque dans son subconscient. Il eut la sensation d’étouffer. Il se leva et approcha de l’indicateur du chauffage à air pulsé. Trente… Il ouvrit le col de sa chemise, stupéfait. Quelqu’un avait monté le thermostat à trente degrés ! Il était certain de ne pas l’avoir touché lui-même depuis qu’il s’était réveillé le matin. Personne n’avait pu entrer dans le studio. C’était impossible. Pour faire quoi, d’ailleurs ? Il ne venait là que pour dormir… Il n’avait aucune provision alimentaire. Depuis quelque temps, il ne mangeait plus… Comme si son corps avait stocké pour toujours les protéines nécessaires pour se maintenir en vie. Dormir lui paraissait la seule nécessité. De plus, il n’avait aucun bijou, à peine quelques yuanars en liquide. Non, personne ne s’était introduit chez lui. Il avait certainement frôlé le thermostat en passant. C’était involontaire et la seule hypothèse vraisemblable. Il le baissa à vingt. L’air pulsé devint aussitôt plus frais. Sa tension musculaire se relâcha. Il se laissa tomber à nouveau dans le fauteuil et attendit que sa respiration retrouve un rythme régulier. Il jeta un regard circulaire sur le studio. C’était son havre de paix. Sa cellule d’isolement et son…
Pour quelles raisons cette expression lui était-elle venue à l’esprit ? L’anticipation instinctive d’une probable incarcération ? Il soupira. Décidément, il n’en avait pas terminé avec ce qu’il convenait d’appeler maintenant : le meurtre de la poubelle.
C’est alors qu’il remarqua une enveloppe qui avait été glissée sous la porte. Il se leva et alla la ramasser. On y avait juste écrit à la main son prénom et son nom : Georges Boulanger. Il retourna l’enveloppe. Rien. Il se décida à la décacheter, saisit la feuille qui se trouvait à l’intérieur et la déplia. Un court paragraphe composait le texte tapé sur un ordinateur. Il prit ses lunettes dans l’étui posé sur le réfrigérateur, retourna s’installer dans le fauteuil et commença à lire. À cet instant, il ignorait encore que la lecture de ces lignes allait bouleverser sa vie.
Monsieur,
À la suite de l’homicide involontaire dont vous venez d’être le témoin privilégié rue de Beijing, je vous prie de bien vouloir vous rendre ce jour à 17 h au 4857, Mao Zedong Avenue, dernier étage, afin que nous en parlions ensemble. Étant donné le caractère extraordinaire de l’incident, je ne saurais que vous conseiller de répondre favorablement à cette invitation, de faire preuve d’une extrême prudence et surtout de garder le silence absolu sur cette affaire dont vous n’aimeriez évidemment pas qu’elle s’ébruite.
À bientôt,
Sara
Sidéré, Georges avait bondi. Il relut trois fois de suite le texte. Crut que son cœur allait s’arrêter. Le sang battait à ses tempes. Quelqu’un savait. Sa respiration s’accéléra. Il ne parvenait pas à saisir la logique de ce qui lui arrivait. Pourtant, les mots lui renvoyaient avec certitude une réalité qui l’effrayait. Contrairement à ce qu’il avait cru, une personne avait aussi assisté au meurtre de la poubelle. Et elle s’appelait Sara. À force de retourner la situation dans tous les sens, il en vint à se dire que, dans le meilleur des cas, cette Sara était comme lui. Elle avait assisté à la scène, mais n’était pas intervenue. Pour elle également, il y avait non-assistance à personne en danger. Mais dans le pire des cas, elle n’avait pas pu intervenir pour des raisons qui lui échappaient, et elle avait alors la possibilité de l’accuser.
… afin que nous en parlions ensemble.
L’évidence lui sauta aux yeux. Quelqu’un qui s’exprimait ainsi ne pouvait être qu’un maître chanteur. Voilà ! C’était l’objectif de cette… Sara. Le faire chanter. Lui soutirer un maximum d’argent contre son silence. Même si ce genre de pratique était aussi vieux que l’humanité, il s’était considérablement développé dans le contexte de crise économique dans lequel la société était plongée. La corruption, le chantage, les dessous de table, le blanchiment et les fraudes en tous genres étaient monnaie courante. La majorité des gens étaient prêts à franchir les limites de la légalité pour vivre mieux, ou pour vivre, tout simplement. Et Georges avait offert à cette femme une opportunité dans laquelle elle s’était engouffrée. Eh bien, il n’irait pas. Il ne donnerait pas à cette canaille en jupons le plaisir de s’enrichir à ses dépens. Jamais. Il se laissa tomber dans le fauteuil. Les ressorts gémirent et leur grincement se mêla aux craquements des os broyés de l’adolescent. La confusion des sons provoqua la naissance d’une goutte glacée de transpiration qui roula lentement le long de ses cervicales et le renvoya au sentiment douloureux qu’avait éveillé sa conscience. Il consulta sa montre. 11 h 20.
Fataliste, il sut qu’il irait au rendez-vous de Sara.
2
Le chauffeur de taxi expliqua que la Mao Zedong Avenue se situait tout au nord de Washandong, au-delà de la Hard City.
- Quelle idée ! Ils auraient pu garder CENTRE VILLE au lieu de HARD CITY, se lamenta Georges.
- Oh, mais pour comprendre il faut remonter à l’origine, répliqua le chauffeur tout en restant attentif à sa conduite. Je vais vous expliquer. Autrefois, bien avant Washandong, il y avait bien un centre-ville. Après la fusion sino-américaine, les Américains ont proposé DOWNTOWN pour le cœur de Washandong. Les Chinois trouvant ce mot trop anglophone, les Américains ont proposé HEART CITY, et comme le mot CITY est courant, même en Chine, les Chinois ont accepté cette dénomination. Mais - parce qu’il y a un mais - la crise est passée par là. La vie est devenue de plus en plus dure pour tout le monde. Alors dans le langage populaire et par homophonie, HEART CITY est devenu HARD CITY. Voilà l’explication, Monsieur.
Georges apprécia l’historique étymologique de cette zone dans laquelle il vivait sans s’être une seule fois posé la question. Quant à la Mao Zedong Avenue, il ne s’était jamais aventuré jusque-là. Non pas qu’il imaginât qu’il pût y avoir un danger quelconque, mais la peur de l’inconnu constituait un frein pour pas mal de gens. Et Georges était de ceux-là. Le taxi parcourut la Hard City sur une cinquantaine de kilomètres, franchit un dernier carrefour et stationna le long d’un trottoir.
- Voilà, Monsieur, je ne peux pas aller plus loin, dit le chauffeur en le scrutant dans son rétroviseur. La Mao Zedong Avenue commence ici.
Georges détailla par la fenêtre les façades au crépi détérioré par des années de tags successifs.
- Mais nous ne sommes qu’au numéro 3, se plaignit-il. Je vous ai demandé de me conduire au 4857.
- Je sais. Mais c’est dans le SFD…
- Le SFD ?
- Le Shanghai Financial District, le centre administratif, politique et financier de Washandong… Oh ! Vous ne connaissez pas cela non plus ? Les Chinois ont réussi à imposer la sonorité d’une de leurs provinces dans le logo, et les Américains la syntaxe. SFD, c’est plus court que Shanghai Financial District.
Pour la première fois, Georges comprit que c’est là que s’étaient exilés son fils et sa belle-fille pour travailler. Et non pas à Shanghai, en Chine, comme il l’avait toujours supposé.