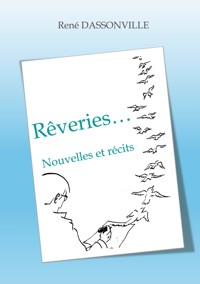Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans un récit qui mêle harmonieusement le factuel et les réflexions sur la société des années quarante, l'auteur se remémore sa prime jeunesse passée à Rennes et surtout à Dinard. Il nous dépeint les fais et gestes d'un enfant , ses sentiments et ses réactions, face au monde et aux adultes. Des références à la littérature, des extraits de chansons, ainsi que des illustrations viennent enrichir cette oeuvre pleine de vie, de sensibilité et d'humour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes parents
Un grand merci à Maïthé et Valérie pour l'aide qu'elles m’ont apportée
Préface
J'ai pensé que ma famille, mes amis et peut-être quelques lecteurs seraient intéressés par le récit des années de mon enfance passées à Rennes, puis à Dinard.
Cette époque commença par la guerre, puis ce furent les années de reconstruction, de retour progressif "à la normale", le début des Trente glorieuses.
J'ai essayé de raconter comment j'ai grandi dans l'ambiance de cette époque, de dépeindre la vie de tous les jours et d'évoquer quelques évènements marquants.
René Dassonville, mai 2019
Table des matières
SOUVENIR
LE P'TIT CAMION
SAINT-LAURENT ET LA GUERRE
NOUS QUITTONS RENNES ET SAINT-LAURENT
LA ROTONDE
LA PLAGE DE L'ÉCLUSE
JEUDI MATIN
L'ÉPICERIE
MA GRAND-MÈRE PATERNELLE
PREMIERS SOUVENIRS D'ÉCOLE
L’ÉCOLE PUBLIQUE ET LE COURS COMPLÉMENTAIRE
RETOUR DE L'ÉCOLE.
QUE FERAS-TU PLUS TARD?
LA VILLA ALIZIA
LE JARDIN
LA PLACE PAUL CROLARD
LE TOUR DE FRANCE
LA PENSION DE FAMILLE
LE FOURGON CITROËN
NOS AMIS RENNAIS
SOUVENIRS PÊLE-MÊLE.
ÉMERVEILLEMENTS ET DÉCOUVERTES
RETROUVER DINARD
LE BORD DE MER
SOUVENIR
« Le souvenir est le seul paradis dont on ne peut nous chasser ».1
Oui, dans mon souvenir, dans mes souvenirs, il y a plusieurs paradis : l’un d’entre eux fut ma petite enfance. Malgré la guerre et l’après-guerre, ce fut pour moi une période heureuse. Je me rends très bien compte de la chance que j’ai eue.
Bien sûr, le ciel ne fut pas toujours bleu et il y eut des jours de grisaille, des orages aussi : je me souviens parfois de quelques grands accès de pleurs, de quelques punitions, la plupart du temps mal perçues, même si elles étaient justifiées. Mais l’enfance est à la fois la période de la candeur, de la franche spontanéité et aussi de l’affabulation, du refus de certaines réalités. L’enfant a sa propre logique, souvent bien différente de la nôtre. Quand un enfant ment, le mécanisme n’est pas le même que chez la plupart des adultes, du moins me semble-t-il. L’enfant finit souvent par être persuadé qu’il dit la vérité. C’est un peu comme l’homme du midi, si l’on s’en réfère à Alphonse Daudet : « Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, ce n’est pas du mensonge, c’est une espèce de mirage. »
Donc, pendant cette période sereine, il y eut aussi ces punitions, ces pleurs, ces moments de profonde détresse où l’on se croit le plus malheureux des êtres, où l’on en veut à tout le monde, où l’on passe ses nerfs sur un quelconque objet qui nous est tombé sous la main : on le malmène, on le jette rageusement par terre. Ainsi croit-on naïvement se venger des adultes et les punir. Vaine illusion !
Mais, aujourd'hui, ces moments malheureux n’ont plus guère d’impact, ils n’assombrissent pas les épisodes lumineux dont je me souviens. Quand ils réapparaissent malgré tout, j’y porte un regard détaché, comme si je n’avais pas été, parfois, ce garnement fauteur de bêtises plus ou moins graves.
En fait, il y a surtout deux « incidents » qui me reviennent de temps en temps en mémoire. Le premier, c’était après une dispute avec ma sœur, ma cadette de deux ans et demi : j’étais tellement énervé, que je m’emparai, à son insu, d’un de ses baigneurs en celluloïd, je le déshabillai et, horresco referens, je le livrai à la flamme d’une allumette. Comment ai-je pu faire pour ne pas me brûler moi-même, car j’avais à peine plus de six ans? La punition fut à la mesure de mon forfait.
Un autre « incident » date de l’année de mes huit ans. Mes parents avaient prévu d’aller au cinéma avec des amis. Évidemment, je voulais absolument les accompagner. Hélas, le film, Clochemerle, était interdit aux enfants. Je fis une telle scène que mes parents téléphonèrent au directeur du cinéma, disant qu’ils assumaient la responsabilité de m’emmener avec eux. Rien n’y fit, ce dernier devait respecter la loi. Alors, je trépignai de plus belle, je menaçai de faire mille bêtises si l’on ne m’emmenait pas. Mais, devant la réprobation de tous les adultes, je finis heureusement par me calmer.
Donc, mon enfance fut heureuse, et ce grâce à mes parents. Ils ont vécu les deux guerres mondiales, et comme ils étaient loin d'avoir les deux pieds dans le même sabot, ils ont su se débrouiller, mais sans compromissions. Je sais qu’ils ont aidé plusieurs personnes, comme, par exemple, cet horloger-bijoutier qui, craignant d’être arrêté par la Gestapo, leur confia des bijoux, un petit trésor qu’il put évidemment récupérer après la guerre. Plus tard, à la fin des années cinquante, j’ai connu ce brave homme : il tenait encore sa petite échoppe à Rennes et c’est chez lui que nous allions quand il fallait donner une montre à réparer.
Mes parents ont traversé toute leur époque en exerçant différents métiers. Ma mère, par exemple, tint un hôtel à Vitré, elle dirigea le restaurant du pavillon de la Bretagne à l’Exposition universelle de 1937 à Paris. Pendant la guerre, ce fut un hôtel-bar-restaurant situé boulevard de la Liberté à Rennes, ensuite l’hôtel de la Rotonde à Dinard, puis une épicerie-crèmerie et enfin une agence immobilière à Rennes, une agence d’affaires comme on disait à cette époque-là.
Mon père exerça d’abord la profession de représentant de commerce, puis il s’installa à Rennes dans un atelier « d’électricité automobile ». J’évoquerai dans d’autres chapitres ses activités à Dinard.
Deux attitudes, deux états d’esprit caractérisèrent le parcours professionnel de mes parents : tout d’abord leur adaptation aux nécessités et aux opportunités du moment. En 1951, ils pensèrent qu’il était préférable pour les études de ma sœur et moi-même de quitter Dinard pour revenir à Rennes. En effet, il n’y avait à Dinard qu’un cours complémentaire : je me garderai bien de dénigrer cette école, j’ai un excellent souvenir des instituteurs que j’ai eus en sixième, mais ce type d’établissement ne proposait ni l'option latin, ni la seconde langue. Il aurait fallu que j’aille à Saint-Malo, en prenant la vedette matin et soir, ou que je sois pensionnaire. Des amis bien informés conseillèrent à mes parents de créer une agence immobilière à Rennes, ce qu’ils firent. C’était la bonne époque, la ville était en reconstruction, en plein boom. Disons au passage que les agents d’affaires n’avaient pas toujours bonne réputation, et je me souviens d’ailleurs que mes parents hésitaient à travailler avec certains confrères dont les méthodes ne leur paraissaient pas toujours des plus recommandables. J’avais pris conscience de cette mauvaise image et cela me gênait quelque peu. C’est pourquoi je fus heureux quand mes parents, pour diversifier leur affaire, devinrent aussi agents d’assurances. Cela me paraissait plus noble. Et, par la suite, à chaque rentrée scolaire, lorsque nous remplissions nos fiches, je n’oubliais pas d’ajouter à la ligne « profession des parents » la précision «…et d’assurances », « agents d’affaires et d’assurances ».
Un deuxième élément important fut leur disponibilité, leur ardeur au travail. Pour eux, c’étaient des semaines d’au moins quarante cinq heures, souvent plus. Je sais que c’est encore le lot de beaucoup de commerçants, artisans et autres professions. Cela dit, la plupart des gens vivaient d’une autre façon, moins échevelée. Était-ce mieux, je n’en sais rien, mon jugement doit être faussé par ces années qui m’ont imprégné et qui font que je ne puis percevoir cet aspect « pressé » de la vie d’aujourd’hui de la même façon que les générations plus récentes. La tortue de notre jardin doit bien s’étonner des courses effrénées de notre chat. Et, lui, du mépris du temps qui passe, que celle-ci affiche obstinément.
Une dernière chose que je voudrais dire, dans ce contexte : quelques années après l’enfance, j’ai compris la différence entre avarice et esprit d’économie. Pendant la guerre et après, je pense que la plupart des gens avaient une attitude bien différente de celle que nous a plus ou moins imposée la société de consommation, qui est d’ailleurs souvent devenue la société de gaspillage. Dans la décennie des années quarante, un sou était un sou : on savait économiser. Pour les grosses dépenses bien sûr, mais aussi et surtout dans la vie de tous les jours. On jetait le moins possible, on essayait de récupérer, de donner une seconde vie à des produits, à des objets déjà utilisés. Certains souriront d’apprendre, par exemple, que nous ne jetions pas les enveloppes des courriers reçus : nous utilisions la face intérieure comme papier de brouillon. De nos jours, dans tous les domaines, la lutte contre le gaspillage reprend heureusement des couleurs. Des efforts sont faits pour que, dans les pays riches, on adopte une attitude plus respectueuse envers la nourriture : n’est-elle pas le fruit issu de la générosité de la terre associée au travail des hommes ? A-t-on le droit d’être irrespectueux envers ce trésor ?
Comme la plupart des enfants, nous n’avions pas beaucoup de jouets. Il fallait faire preuve d’un peu d’imagination. Ainsi, à l’automne, fabriquions-nous des animaux, des personnages, des structures diverses avec des marrons et des allumettes. Avec des coquilles de noix, nous faisions voguer sur l’eau du caniveau de frêles embarcations. Aujourd’hui, il y a pléthore de jeux de société, de jeux-vidéos, etc. On peut le regretter, d’autant plus que les fabricants et la société de consommation y trouvent leur compte, mais il faut faire avec. Si les premiers hommes qui ont connu le jeu d’osselets revenaient sur terre, ils s’étonneraient peut-être que celui-ci ne soit plus le nec plus ultra.
Je suis conscient de la chance que j’ai eue, surtout si je compare avec l’époque actuelle. Je ne dirai pas « c’était le bon temps », il y avait aussi des souffrances, des difficultés à bien vivre pour certains. Aujourd’hui, les conditions de vie se sont améliorées pour beaucoup. Le progrès, les progrès dans différents domaines ont rendu l’existence plus facile. Pour la majorité, pas pour tous, hélas.
Et, surtout, des menaces pèsent sur l’humanité, à mon avis, plus graves que ce qu’on pouvait redouter il y a quelques décennies : surpopulation, réchauffement climatique (vrai ou faux problème, surmontable ou pas ?), terrorisme et conflits, pollution, etc.
À l’époque de ma jeunesse, il me semble que le temps était plus apaisé, que la vie prenait le temps de respirer.
Souvenir embelli ou réalité ?
Jeanne, ma mère, née Gaignoux
René, mon père
Ma mère (à droite) au pavillon de la Bretagne
Robe aux drapeaux des nations exposantes, portée par ma mère en certaines occasions.
1 « Dle Erinnerung ist das einzige Paradies, aus der wir nicht vertrieben werden können.» Citation de Jean-Paul, écrivain allemand peu connu en France (1763-1825).
LE P'TIT CAMION
Le 8 mars 1943, à Rennes, c’était la guerre, il faisait beau. Ce n’est pas la date de ma naissance, mais ce fut un jour important pour moi.
Pour beaucoup, hélas, ce fut une horrible journée.
En ce jour d’hiver finissant, le printemps avait décidé de nous faire une petite visite préparatoire à sa proche venue. Voyant ce beau soleil, mes parents, qui travaillaient à l’époque boulevard de la Liberté, m’avaient confié à Marcelle, une dame qui était à leur service, afin qu’elle m’emmène sur le Champ-de-Mars. Cet endroit a beaucoup changé. C’était un vaste terrain où, comme son nom le suggère, avaient lieu autrefois des parades et revues militaires. C’est là aussi que s’installaient les cirques et que se déroulait une foire-exposition renommée : celle-ci se transporta par la suite à la périphérie de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Le Champ-de-Mars a perdu le caractère un peu brut de décoffrage qu’il avait à l’époque. On y a construit une salle omnisports, des bâtiments administratifs, des parkings.
Donc, ce 8 mars 1943, je jouais près d’un bac à sable avec un petit camion en bois que j’avais eu à Noël. Il était prévu que j’aille ensuite faire deux ou trois tours de manège à la fête foraine qui s’était installée à quelque distance de là, sur le Champ-de-Mars. Où étions-nous ? Je ne sais plus. Je jouais depuis déjà assez longtemps, quand Marcelle commença peut-être à s’impatienter et me pressa plusieurs fois de venir faire un tour de manège. « Encore un peu le p’tit camion », lui dis-je, d’un ton sans doute suffisamment suppliant pour qu’elle me laissât continuer à jouer. Ce petit camion me sauva la vie. En effet, des forteresses volantes arrivèrent, apportant à nouveau le malheur et la désolation. Il me semble que les autorités n’avaient pas eu le temps de déclencher les sirènes. Les avions déversèrent à plusieurs endroits de Rennes leurs bombes meurtrières, faisant ainsi plus de trois cents morts. La fête foraine n’était plus qu’un chaos.
Rennes, qui était occupée par les Allemands, a beaucoup souffert des bombardements alliés.
Je me souviens très bien de ce petit camion, mais pas de cet épisode sur le Champ-de- Mars : ce sont mes parents qui me l’ont raconté et qui l’ont souvent raconté à des amis.
« La destinée, à quoi ça tient
On n’en sait rien, rien, rien
La destinée, à quoi çà tient
On n’en sait rien, rien. »
Voilà ce qu’a chanté Guy Béart.
Ma destinée a tenu, ce jour-là, à un petit jouet.
Après le bombardement
Le Champ de Mars
L’avenue Janvier (autrefois avenue de la Gare)
SAINT-LAURENT ET LA GUERRE
La peur des bombardements incita mes parents à installer toute la famille dans une très petite maison, près d’une ferme à Saint-Laurent. À cette époque, ce village était bien séparé de Rennes, nous étions à la campagne.
Dans cette maison, je me souviens d’une cave qui servait d’abri en cas d’alerte aérienne. Était-ce d’ailleurs une vraie cave ? Elle avait peut-être été creusée spécialement pour servir de refuge : c’était une excavation couverte de grosses traverses de voie ferrée. Quand il y avait une alerte, nous y descendions par une échelle et, comme il fallait parfois rester assez longtemps dans cet abri, on y entreposait un peu de nourriture et notamment, souvenir impérissable, le célèbre Petit Beurre LU. Nous commencions toujours par les quatre coins : « Les coins d’abord », c’était, me semble-t-il, un slogan publicitaire de la marque, mais je n’en ai trouvé aucune trace. En revanche, lors de mes recherches, j’ai découvert « LU et approuvé » et, encore plus intéressant, c’est Sarah Bernhardt qui fit, en 1897, la promotion du biscuit : « Quoi de mieux qu’un Petit Beurre LU ? Deux Petits Beurre LU ! » Un texte un peu simplet pour l’interprète de Phèdre et de Roxane, mais, de nos jours aussi, de grands artistes font de « l’alimentaire » pour des produits qui ne sont pas toujours aussi savoureux qu’un Petit Beurre. Au fait, a-t-il aujourd’hui le même goût qu’autrefois ? Je pense que oui. Tout n’était pas nécessairement meilleur par le passé.
Il semblerait que les inventeurs du Petit Beurre, Louis Lefèvre et sa femme, née Utile, aient voulu créer un biscuit qu’on puisse manger tous les jours, c’est pourquoi il présente quatre coins (les saisons), cinquante-deux dents (les semaines) et vingt-quatre petits trous (les heures).
Et c’est dans cet abri que je connus ma « madeleine de Proust ». Nous avions reçu un paquet de la part de parents suisses, c’était un colis renfermant des oranges. Beaucoup de choses se sont banalisées depuis, mais, en 1943, en pleine guerre, ce fruit représentait quelque chose d’assez exceptionnel. Souvenons-nous des Allemands de l’ex-RDA qui, après la chute du mur, se précipitaient, à Berlin-ouest, sur les bananes, un luxe pour eux.
Ah, ces oranges ! Comme elles avaient été enfermées quelque temps, les parfums s’étaient condensés, sublimés, et, quand on ouvrit le paquet, ce fut une apothéose d’arômes que je n’ai pas oubliée. Je retrouve parfois dans les oranges d’aujourd’hui ces fragrances capiteuses et captivantes, comme un soleil qui serait devenu parfum. Et je revois et je revis ce moment dans notre abri.
Je me souviens aussi d’une demande que j’avais faite à mes parents à cette occasion (les enfants savent avoir de grands élans de générosité) : « Est-ce qu’on peut offrir une orange à un enfant pauvre ?» D’où cette idée m’était-elle venue? Sans doute m’étais-je plaint un jour qu’on ne veuille pas m’acheter une friandise dont j’avais très envie, et on avait dû me répondre à peu près ceci : « Tu sais, il y a des enfants qui n’ont presque jamais de bonbons ou de chocolat. »
Nous sommes descendus assez souvent dans cet abri, à chaque fois que nous percevions dans le lointain le grondement des bombardiers ou les sirènes qui les annonçaient.
Un jour, Marcelle nous avait emmenés faire une promenade dans la campagne environnante, ma sœur et moi, et c’est alors que nous entendîmes le bruit inquiétant des avions : que faire ? Nous étions trop loin de la maison, c’est pourquoi Marcelle décida de nous faire nous allonger dans le fossé qui bordait le chemin. Cela nous aurait sans doute sauvés si une bombe était tombée à quelques dizaines de mètres de ce refuge improvisé.
Ces bombardements furent une dure épreuve pour la population de Rennes, qui ne comprenait pas la nécessité de ces attaques et la mettait en doute. En évoquant cela, je pense au titre poignant d’un journal du Havre: « Nous vous attendions dans la joie, nous vous accueillons dans le deuil.». Cette ville venait d’être libérée, mais elle avait subi peu auparavant un horrible bombardement dont l’utilité n’a toujours pas été comprise par la plupart des historiens.