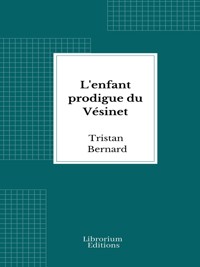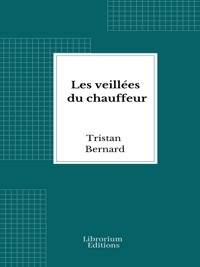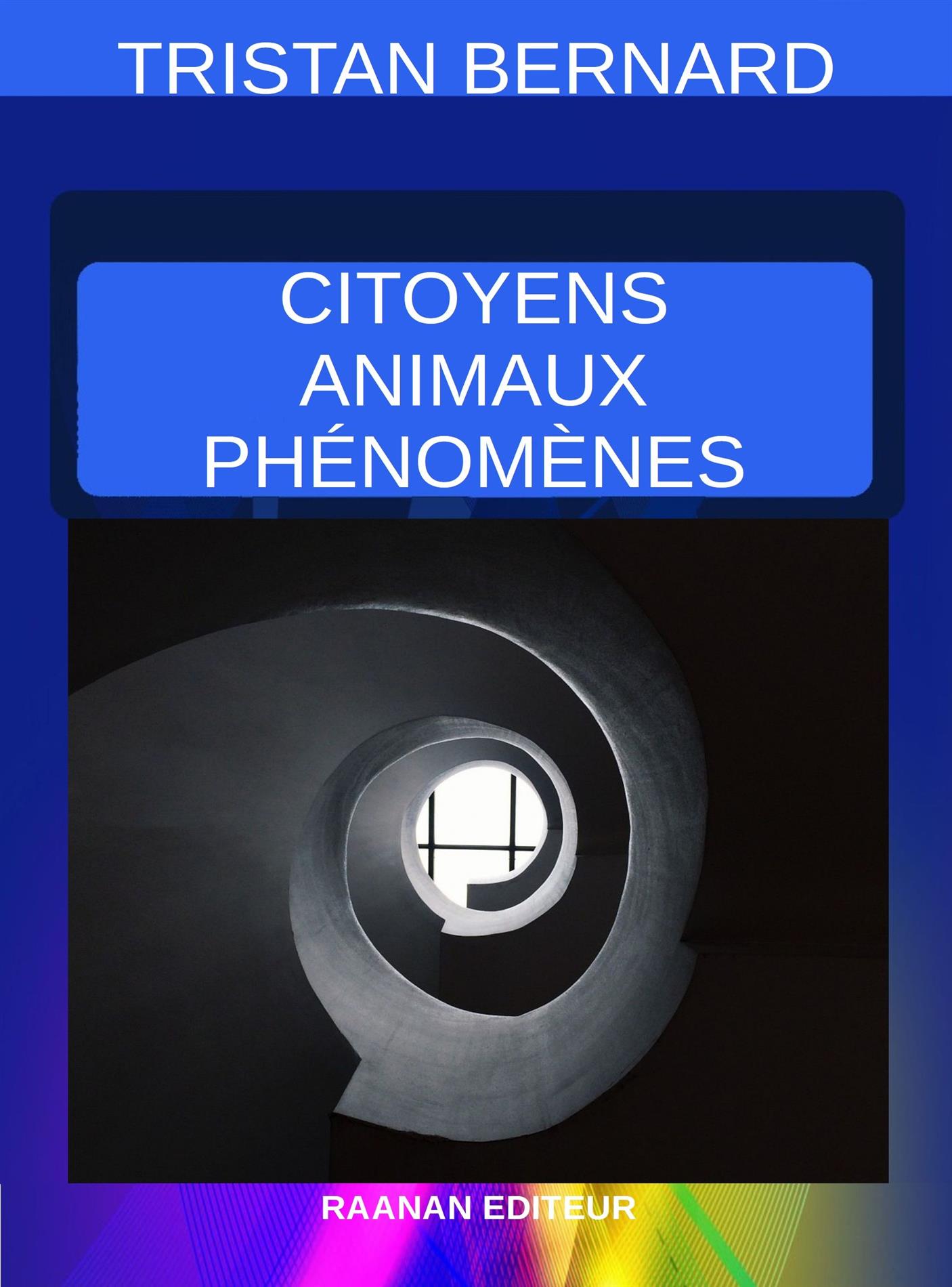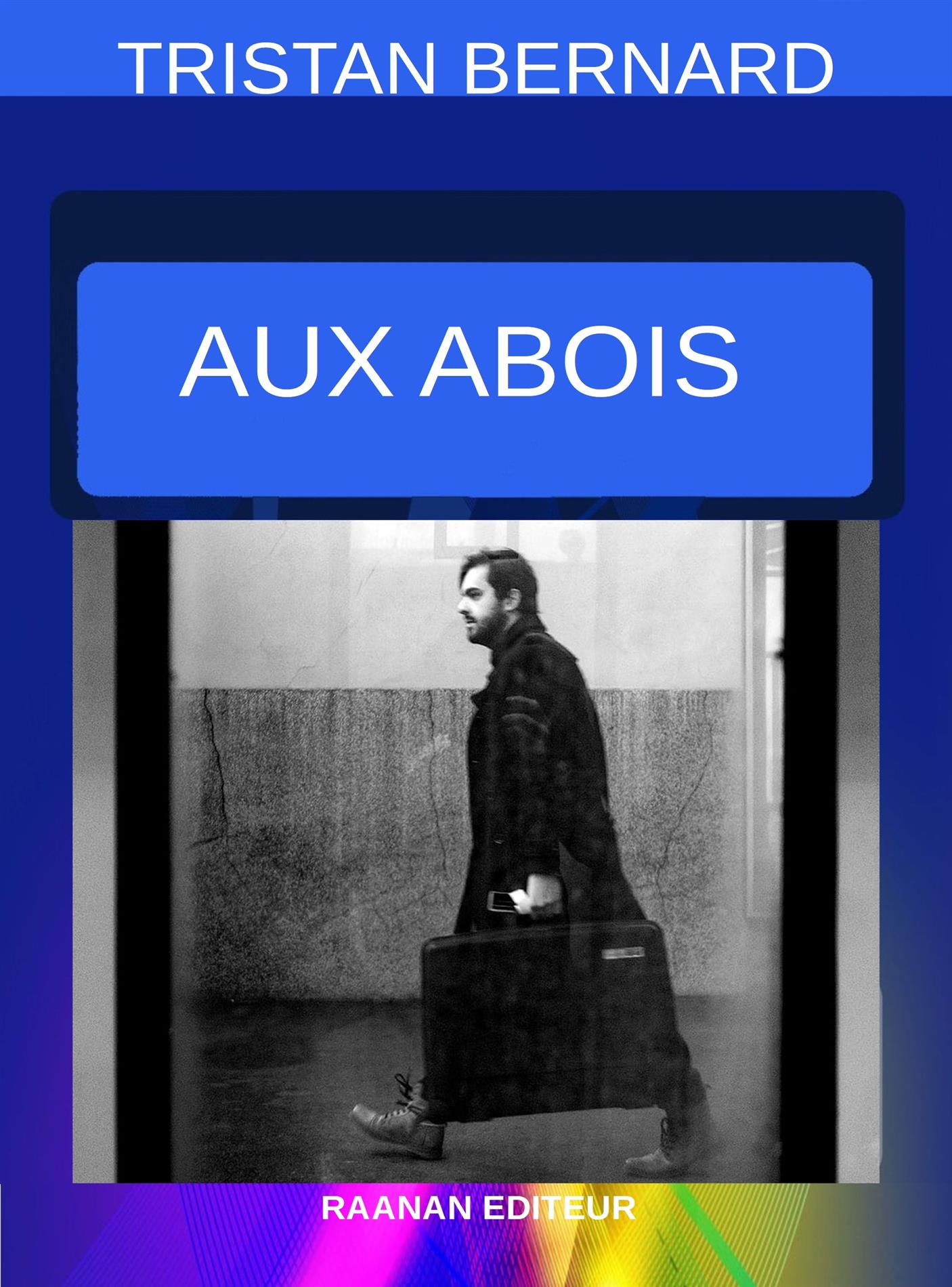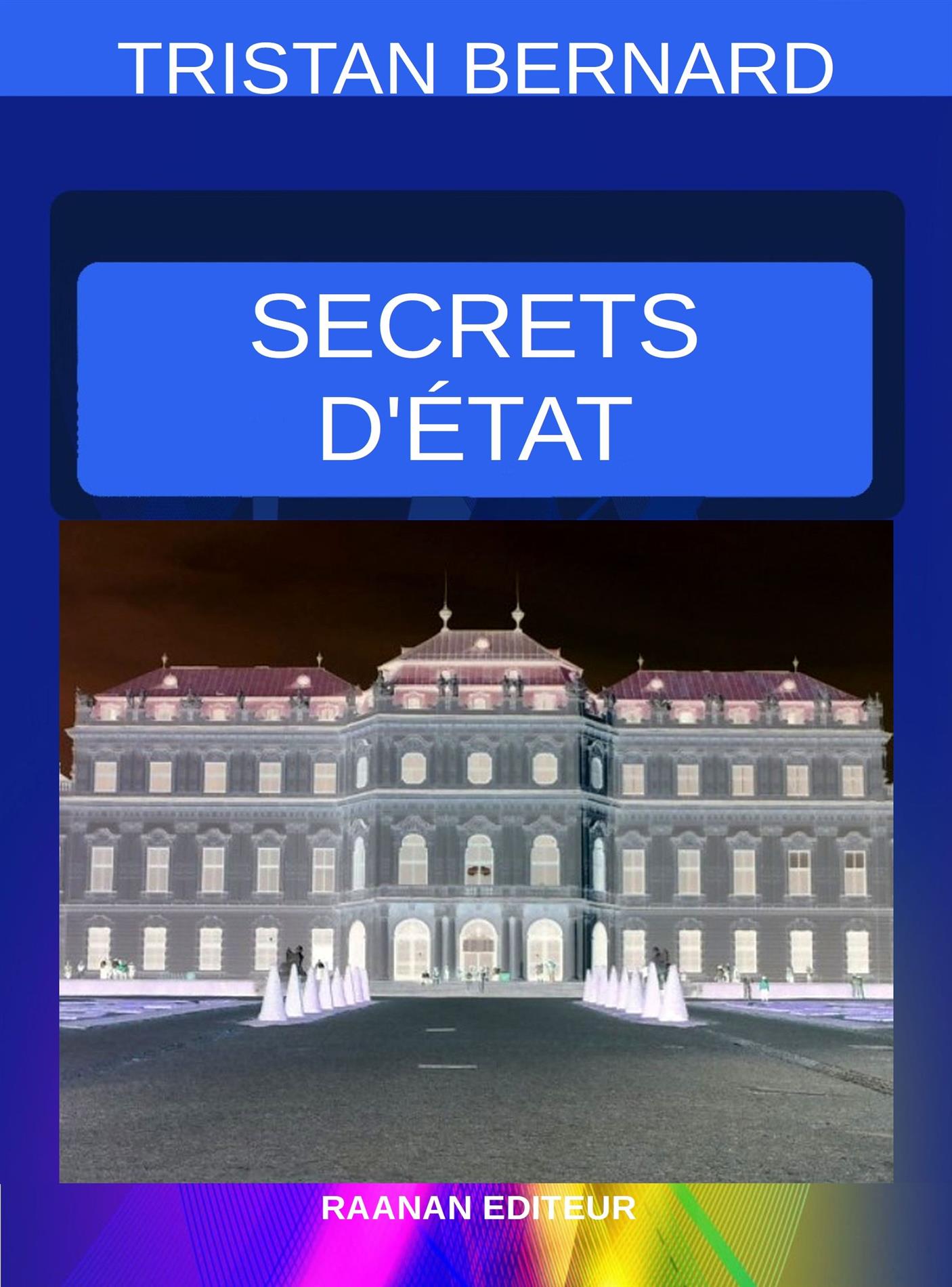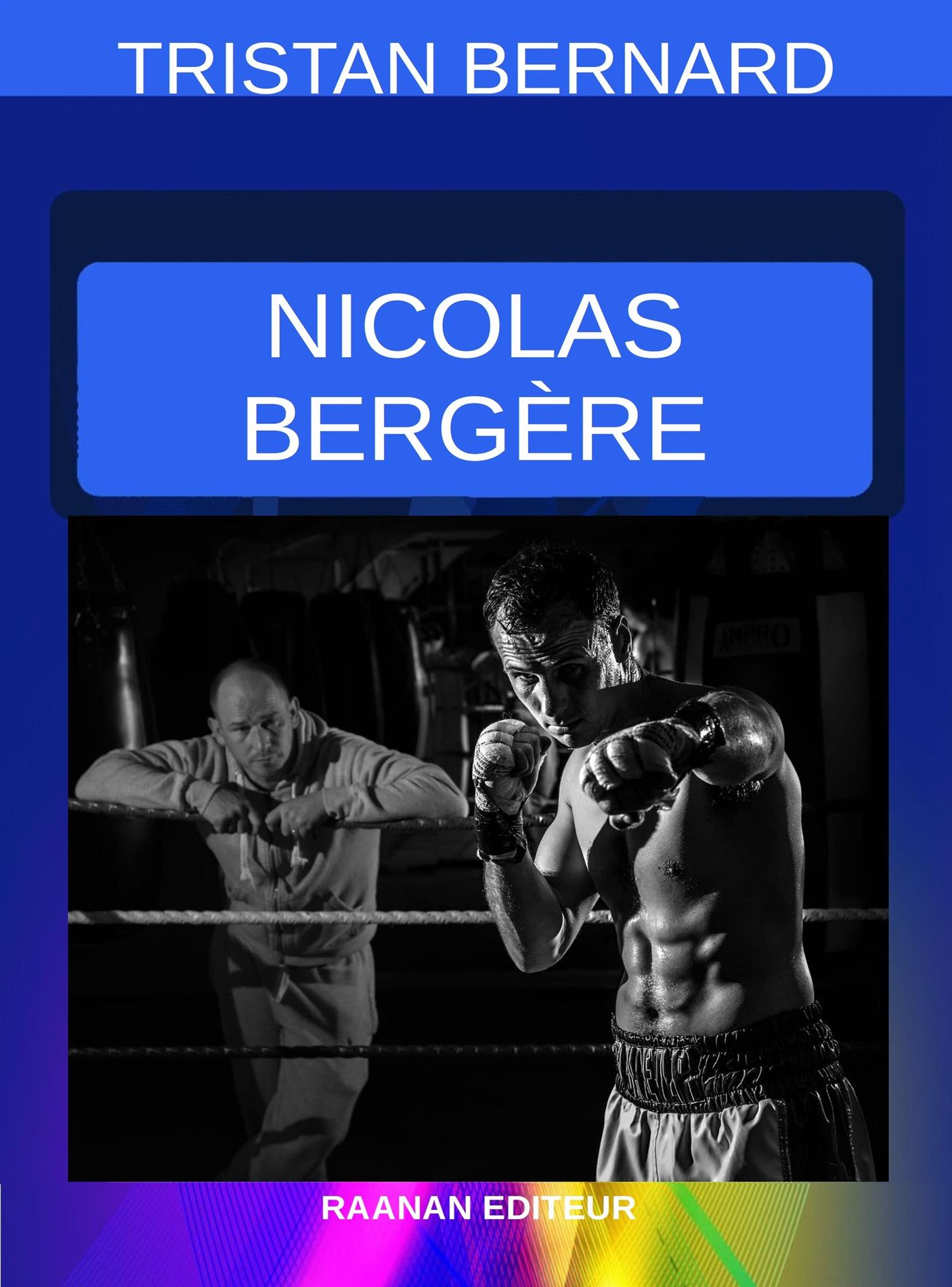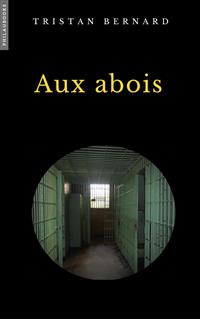
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
J’ai eu beaucoup d’ennuis d’argent. J’étais assureur et j’avais une assez bonne clientèle, mais j’ai été obligé de la céder. J’ai des créanciers que je suis obligé de faire attendre. Ils attendront peut-être longtemps. Ce n’est pas qu’ils soient faciles, mais je ne suis pas très solvable. Ils le savent et, comme moi, ils sont forcés d’attendre des jours meilleurs. J’ai fini par supporter sans trop de peine ce passif. Mais je serais très malheureux si je ne pouvais pas envoyer d’argent à mon ancienne femme. L’homme qui avait négocié la cession de ma clientèle était un ancien clerc d’huissier. J’avais été mis en rapport avec lui par un camarade, un nommé Daubelle. L’ancien clerc d’huissier s’appelait Sarrebry. La première fois que je l’ai vu, il m’a déplu et ça n’a pas changé… Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Aux Abois
Tristan Bernard
philaubooks
Table des matières
Journal d’un meurtrier
16 mai
17 mai, 4 heures
17 mai, 9 heures
18 mai, 11 heures
18 mai, 10 heures du soir
19 mai, midi
19 mai, 10 heures du soir
20 mai, midi
Dijon, 21 mai, 10 heures du matin
Dans le train, 3 heures de l’après-midi
Marseille, 22 mai, 10 heures du soir
Même jour, minuit
5 heures du matin
10 heures
Monte-Carlo, 23 mai, 9 heures du soir
Monte-Carlo, 24 mai, 3 heures du matin
24 mai, midi
25 mai, 9 heures du matin
26 mai, 9 heures du matin
Le même jour, midi
Marseille, 9 heures du matin
8 heures du soir
Lyon, 29 mai, 6 heures du soir
Ce même jour, un peu avant minuit
30 mai, 9 heures du matin
30 mai, 3 heures de l’après-midi
7 heures du soir, même jour
31 mai, 9 heures du matin
3 heures
10 heures du soir
4 heures du matin
7 juin
8 juin, 10 heures
Le même jour, 7 heures du soir
Prison de la Santé, 9 juin, 7 heures du soir
10 juin, après dîner
… Juin, après dîner
15 juin, le soir
16 juin, 4 heures après midi
18 juin, au soir
24 juin… au jugé (date à vérifier)
28 juin (date fournie par le gardien)
1er juillet
4 juillet
7 juillet
9 juillet
10 Juillet
11 juillet
14 juillet
22 juillet
Conciergerie, 23 juillet
25 juillet
26 juillet
27 juillet
3 août
6 août
7 août, 11 heures du soir
De la Santé, 8 août au soir
14 août
17 août
20 août
22 août
28 août
2 septembre
3 septembre
5 septembre
6 septembre
7 septembre, midi
8 septembre
10 septembre
12 septembre
16 septembre
À propos de l’auteur
Journal d’un meurtrier
La chambre où j’écris est au troisième étage d’un hôtel du Havre. Elle donne sur un des bassins. Mais à quoi bon décrire ce que je vois ? Ce n’est pas pour cela que j’ai pris la plume. J’écris pour moi tout seul. J’écris parce que je n’ai personne à qui parler. Et comme je ne veux pas que ces pages traînent, je les enverrai sous des initiales dans un bureau de poste de Paris, toujours le même pour ne pas me tromper.
Je me regarde dans la glace, je ne suis ni beau ni laid, ni grand ni petit. J’ai trente-quatre ans. Il y a des personnes qui me donneront moins, d’autres plus. Mais quand je dirai mon âge, elles n’insisteront pas, car cette évaluation ne leur tient pas à cœur. Mon nez paraît un peu pointu depuis que je ne porte plus que la moustache. J’ai des cheveux châtain clair pas très dociles. Quand je me coiffe avec une raie, ça ne tient pas.
J’ai un peu d’instruction, j’ai passé mon bachot. Au lycée, je n’ai pas fait sensation. Il y avait des professeurs qui me jugeaient intéressant, mais la plupart ne faisaient pas attention à moi.
Je me suis marié de bonne heure, à vingt-quatre ans, et j’ai divorcé il y a trois ans. Ma femme me trompait.
C’est moi qui ai pris les torts à mon compte. Ce n’était pas une mauvaise créature. Elle réfléchissait peu, voilà tout.
Elle écoutait facilement les gens quand ils lui plaisaient. Moi, elle ne m’a pas écouté longtemps.
Elle vit avec son amant, qui n’est pas non plus un mauvais type. Je sais qu’ils ne sont pas très heureux au point de vue matériel. Jusqu’à présent, je lui ai servi régulièrement sa pension. Maintenant, ça commence à être dur.
J’ai eu beaucoup d’ennuis d’argent. J’étais assureur et j’avais une assez bonne clientèle, mais j’ai été obligé de la céder. J’ai des créanciers que je suis obligé de faire attendre. Ils attendront peut-être longtemps. Ce n’est pas qu’ils soient faciles, mais je ne suis pas très solvable. Ils le savent et, comme moi, ils sont forcés d’attendre des jours meilleurs. J’ai fini par supporter sans trop de peine ce passif. Mais je serais très malheureux si je ne pouvais pas envoyer d’argent à mon ancienne femme.
L’homme qui avait négocié la cession de ma clientèle était un ancien clerc d’huissier. J’avais été mis en rapport avec lui par un camarade, un nommé Daubelle. L’ancien clerc d’huissier s’appelait Sarrebry. La première fois que je l’ai vu, il m’a déplu et ça n’a pas changé. C’était un petit homme rondelet, mal rasé, déjà tout gris. Il avait de vilains yeux qui dansaient, et un râtelier qui bougeait dans sa bouche tordue. Quel remue-ménage inutile sur cette vilaine figure !
Il avait bien une gueule d’ennemi… Notre affaire se traita comme un combat haineux. Elle était bonne pour lui, mais il ne me sut aucun gré des avantages qu’il en tira. Il dut avoir de furieux regrets de ne pas m’en avoir pris assez.
On ne s’était pas vus depuis un an, et je le rencontre à la terrasse d’un café près de la porte Saint-Denis. Il se trouve que j’avais un peu songé à lui quelques jours auparavant. J’avais absolument besoin de trois mille francs. Je m’étais bien dit que c’était absurde de les lui demander, qu’il ne me les donnerait pas, car je n’avais rien de sérieux à lui offrir en garantie.
Le matin même où je l’avais rencontré à ce café, j’avais vu Daubelle, celui qui m’avait fait connaître ledit Sarrebry. Il paraît que l’ancien clerc d’huissier était devenu terriblement serré depuis la crise. Il ne risquait plus ses fonds et Daubelle croyait savoir qu’il avait de côté, chez lui, des billets de banque en nombre.
— Je suis sûr qu’il en a beaucoup, car il a vendu l’autre jour des valeurs qui se trouvaient n’avoir pas trop baissé.
Sur cette terrasse de café, Sarrebry fit un effort pour être aimable et mit en train un sourire qui aboutit plus ou moins. Il me fit signe de m’asseoir et m’offrit une consommation. Je crus lui faire plaisir en la refusant.
En cherchant bien, j’avais tout de même une modeste affaire à lui proposer, pas une bonne affaire, c’est entendu, un petit quelque chose sur quoi on pouvait cherrer un peu.
C’était une créance de quatre mille et des francs que je considérais comme perdue, mais on peut se tromper…
Je le répète, c’était surtout un prétexte pour reprendre mes relations avec lui. J’avais appris qu’il avait de l’argent. Je comptais sur la Providence pour me faire avoir un peu de ce numéraire. J’étais comme un homme qui s’approcherait d’une mine d’or sans outil sur lui, sans permission de l’explorer, mais qui ne bougerait pas de là parce que l’or est à proximité.
— Venez chez moi, nous serons mieux pour causer.
Il habitait tout à côté, rue Meslay, au troisième sur la cour, dans un petit appartement où il vivait seul. J’examinai l’étroite salle à manger, et un bureau un peu plus grand, meublé de meubles disparates qui, sans doute, provenaient de laissés-pour-compte, à la suite de diverses opérations de prêts.
Je lui donnai quelques renseignements sur la créance que je voulais lui céder et j’allai jusqu’à lui raconter que j’attendais une précision intéressante, relative à ce créancier dont on allait m’indiquer la nouvelle adresse. Tout cela était mensonger. Je tenais avant tout à garder une nouvelle occasion de le revoir.
Il me dit qu’il ne sortait jamais le soir et qu’on pouvait venir jusqu’à dix heures.
À dix heures, le soir, dans ce petit appartement…
Entendons-nous. Je me sentais incapable d’un meurtre ou d’un vol. Toute ma vie, il m’avait semblé que c’était un pas impossible à franchir. Je n’avais jamais commis le moindre acte délictueux.
… J’allai dîner ce soir-là chez un marchand de vins du faubourg Saint-Martin.
Tout en mangeant, je me répétai dix fois que j’étais tout à fait incapable de tuer ou de voler. Il n’y avait point à tabler là-dessus. C’était une impossibilité absolue.
Cette conscience de mon impuissance à devenir un malfaiteur me laissait tout le calme d’esprit pour imaginer un assassinat, qui se présentait vraiment dans des conditions favorables.
D’abord, je n’avais pas de casier judiciaire. Personne dans ma maison, dans mon quartier, ne fournirait sur moi de renseignements fâcheux. Enfin, pas de complice, pas de bavardage à craindre.
La chose une fois exécutée, je n’irais pas bêtement voir des filles qui me donneraient à la police. Je n’agirais pas comme ces criminels imbéciles, ces ingénus qui ne connaissent rien du monde. On les prend pour des malins tant qu’ils sont invisibles. Dès qu’ils ont quelques sous sur eux, ils ne savent plus ce qu’ils font. Ils vont s’amuser, comme des enfants.
Passons aux moyens d’action.
Les armes à feu font trop de bruit. L’idée de me servir d’un couteau me faisait mal au cœur. Je n’arriverais jamais à percer la peau d’un être vivant.
Et puis il faudrait acheter un couteau ou un browning. Et c’est là le bon moyen de se faire repérer.
Les marchands d’armes, aussitôt qu’ils lisent le récit d’un crime, sont si contents de jouer un rôle en apportant un renseignement à l’instruction !
… À la rigueur, je serais capable de frapper avec un casse-tête… Tiens ! un marteau… J’ai un marteau assez gros dans un tiroir. Il y a très longtemps que je l’ai acheté pour clouer des caisses, la dernière fois que j’ai déménagé.
Je vais rentrer chez moi. Et puis je reviendrai ce soir rue Meslay, avec mon marteau dans ma poche. Je ferai cela simplement pour continuer l’histoire que j’ai imaginée dans ma tête.
Serais-je capable, si j’avais vraiment l’idée de tuer quelqu’un, de prendre seulement le marteau et de l’emporter avec moi ?
Pourrais-je seulement franchir le seuil d’une maison où il y aurait quelqu’un à tuer ?
— Garçon, l’addition ! Vous ferez ajouter un petit verre d’eau-de-vie.
Je me sens un peu mou. Je ne veux pas être mou.
Et, du restaurant à ma maison, je marche très vite… Mais c’est trop loin… Je prends un taxi. Ça n’a aucune importance pour me faire conduire chez moi. Quand j’irai rue Meslay, c’est une autre affaire. Pas de taxi, pas de chauffeur bavard. Je sais bien que ces précautions ne signifient rien, puisque je n’ai aucune intention. Mais le jeu, c’est d’agir comme si j’avais positivement une intention…
Je me souviens que, dans le taxi, je me sentais très animé. Et j’ai monté impatiemment mes quatre étages.
Je n’ai pas trouvé tout de suite le marteau. J’ai cru qu’il était dans ce tiroir de commode… Ah ! que je me suis senti dépité !
Et puis voilà que, dans ce petit cabinet où sont mes vêtements, en passant la main sur un rayon assez élevé où je pose mes chaussures, j’ai mis tout à coup la main sur ce marteau, sur ce bon marteau. Il n’est pas grand. Il est bien équilibré, solide. On a le manche bien en main, et le bois de ce manche est fortement assujetti. Il ne joue pas dans la tête de fonte d’acier. Oh ! cette fonte, qu’elle est dure !
La concierge est en train de bavarder sur la porte. Elle m’a vu rentrer. L’embêtant, c’est qu’elle va me voir sortir. J’attends un instant. Peut-être va-t-elle faire quelques pas dehors pour accompagner quelqu’un ?
Après tout, à quoi bon feindre de ne pas sortir de chez moi, puisqu’il faudra rentrer tout à l’heure et donner mon nom en rentrant ?
Je ne sais plus à quoi j’ai pensé pendant la route, en gagnant la rue Meslay. C’est parti de ma tête. Je crois m’être dit un instant que je n’avais pas l’air d’un criminel, mais d’un homme comme les autres. Au fait, pourquoi aurais-je l’air d’un assassin, puisque tout cela c’est du chiqué ? Je sais bien que je ne tuerai pas.
Dans l’après-midi, quand j’étais venu là avec Sarrebry, personne ne m’avait vu entrer, personne ne m’avait vu sortir. J’avais aperçu dans le fond de la loge un vieillard assis dans un fauteuil, un journal à la main. Il lisait ou il dormait. Quand j’entrai cette fois dans l’allée, la porte de la maison étant encore ouverte, je vis le même vieillard momifié, toujours au même endroit. Je traversai la cour et montai les trois étages.
En sonnant, j’ai eu l’impression, mais une seconde à peine, que ce n’était plus un jeu et qu’il allait vraiment se passer quelque chose. Mais, quand il vint m’ouvrir, cette idée s’enfuit tout à fait.
Allons, à quoi avais-je pensé ? Je viens chez cet homme tout simplement pour lui raconter un boniment quelconque et pour qu’il consente à me donner trois billets, garantis par cette créance de quatre mille quatre cents francs. J’enverrai tout de suite à mon ancienne femme les deux mille francs en retard. Je serai très soulagé. Et, pendant quelque temps, je pourrai dormir tranquille.
… Il m’a fait entrer dans son cabinet. Il m’a fait asseoir. Il s’est assis sur son fauteuil de bureau. Je lui parle de mon affaire sans penser à ce que je dis. Et j’ai intérieurement une envie de rire à l’idée de la comédie que je me suis jouée. Comme ça me ressemble d’avoir imaginé, même en blague, que je pourrais faire du mal à cet individu !
Il m’avait fait entrer et asseoir sans aucune défiance. Mais, devant cette confiance, il n’y a même pas de quoi m’attendrir. C’est si naturel ! Nous sommes deux bourgeois normaux, comme il y en a tant. Nous allons notre petit trantran d’existence et il n’a pas plus l’air d’une victime que moi d’un assassin.
… Ce que je vais raconter maintenant, je ne le dirais pas devant un tribunal, car personne ne me croirait.
À un moment donné, il a quitté son fauteuil, il a passé devant moi. Il est allé s’accroupir devant une commode pour ouvrir le tiroir du bas. Il cherchait, je crois, de quoi fumer. J’avais tout près de moi son crâne. J’ai tiré mon marteau de ma poche et je lui ai donné un grand coup sur la tête. Je crois qu’il a été tout de suite assommé. J’ai entendu comme un reniflement très sourd. Personne n’a pu l’entendre que moi. Et puis ce n’était pas un bruit trop anormal.
… Ce n’est qu’à ce moment-là que le crime a commencé. Il me semble que c’est bien consciemment que j’ai continué à taper avec le marteau. Alors, j’ai été vraiment un assassin. Je pensais qu’il était touché à mort, mais il avait encore des spasmes, des secousses. Il a fallu l’achever, taper, taper sur cette tête pour en chasser la vie.
Les gens diront : « La victime a été achevée avec une férocité abominable. » Mais ce n’est pas de la sauvagerie, c’est la précipitation éperdue d’un affolé qui fait une besogne odieuse avec la hâte frénétique d’en finir.
Commençons les explorations… D’abord, j’ai eu l’idée que je ne trouverais rien.
J’ai déplacé le corps. Il avait ses clefs dans une poche de son pantalon. Mais que de clefs, que de clefs !
Lesquelles étaient les bonnes ?
Il fallait les essayer à toutes les serrures. Dans le bureau d’abord, sur trois tiroirs fermés. Et puis, dans sa chambre, sur l’armoire. Et, dans cette armoire, encore d’autres tiroirs fermés.
Jamais je n’y arriverais… Pourtant j’avais tout mon temps… Je commençai mes recherches. Et soudain une idée me sauta dans la tête. Je savais qu’il n’avait pas de domestiques, une femme de ménage seulement, qui ne venait que le jour. Mais il m’avait dit qu’il ne sortait pas le soir… Les gens qui le connaissaient savaient cela. Si on allait sonner à la porte ? Ce coup de sonnette, qui maintenant me semblait imminent, allais-je l’entendre à la minute, à la seconde suivante ?
Non, il ne faut pas s’attarder ici. Je vais regarder dans les poches de son veston. Il a peut-être un portefeuille…
Ça y est… Un portefeuille bourré de billets… Plusieurs liasses… Il devait garder cela sur lui jusqu’au moment de se coucher, avant de le placer dans une cachette. Je prends ces billets… Je les compterai chez moi.
Je bute contre le marteau. Qu’est-ce que je vais en faire, de ce marteau ? Il ne peut rien révéler. Il y a si longtemps que je l’ai acheté… C’est égal, il vaut mieux qu’on ne le trouve pas tout de suite. J’ouvre la porte de la chambre et je glisse le marteau sous le lit, le plus loin possible.
Maintenant, il s’agissait de s’en aller sans perdre une minute et cependant je n’ai pas pu m’empêcher de regarder combien il y avait de liasses. Cinq, six, sept liasses de dix mille. Soixante-dix mille francs. Quelle curiosité de gosse ! J’aurais pu attendre d’être chez moi.
Avant de m’en aller, je fermai le bouton de l’électricité. Il était l’heure pour lui d’éteindre sa lumière. Il ne faut pas que le logement reste éclairé toute la nuit. Il vaut mieux n’attirer que le plus tard possible l’attention des voisins.
J’ai tout éteint. Puis j’ai ouvert la porte doucement et je suis sorti très droit, pour n’avoir pas l’air d’un voleur, si quelqu’un s’était trouvé dans l’escalier.
Encore éclairé, l’escalier. Je traverse la cour. La porte d’entrée est fermée.
J’ai demandé le cordon avec une de ces voix rudes qui n’ont aucune personnalité.
C’est égal, on est plus à son aise dans la rue.
Passant quelconque parmi tous ces passants anonymes, je gagne la rue Saint-Martin, puis le boulevard. Il vaut mieux ne pas m’arrêter dans un de ces cafés. Changeons de quartier, changeons de quartier…
Le tramway de Montrouge vient à point pour m’emmener dans les environs de Montparnasse. Mon argent est dans ma poche gauche.
Il n’y a pas grand monde dans le tramway. Je me dirige vers une place de l’intérieur et, tout à coup, il me semble que mon pantalon traîne d’un côté. J’ai fait sauter un bouton de bretelles…
C’est grave… À quel moment l’ai-je fait sauter ? Peut-être en assenant le coup de marteau…
Le bouton porte-t-il la marque d’un tailleur ? Il faudrait examiner de près un autre de mes boutons. Mais ce n’est pas le moment. Il y a quelques personnes dans le tramway. Pas de gestes singuliers.
Ah ! oui, c’est grave… En fouillant là-bas dans les papiers, les gens de police découvriront que nous avons eu des relations d’affaires. S’ils portent le bouton chez le tailleur, le tailleur retrouvera mon nom. On fera un rapprochement dangereux.
J’eus un instant l’idée absurde de retourner là-bas à la recherche de ce bouton, mais quelles difficultés, quel danger ! Comment peut-on concevoir des bêtises pareilles ?
Le tramway, heureusement, continue sa course comme pour m’éloigner de là et m’empêcher de faire cette idiotie.
Les boutons où s’attachent mes bretelles sont à l’intérieur de la ceinture de pantalon. Seulement, le bouton qui manque peut avoir sauté en dehors et c’est même la grande probabilité.
Je promenai ma main négligemment, comme pour me gratter, le long de ma jambe, et j’eus la joie de sentir, un peu plus haut que la chaussette, retenue par la jarretelle, une petite saillie dure… ronde… Il y a du bon, c’est le bouton. Il s’est arrêté là, gentiment.
Je descendis à la place Denfert et me dirigeai vers un grand café du boulevard Montparnasse. J’avais soif et j’avais faim.
Je commandai une bonne soupe au fromage, un bœuf à la mode froid, et un demi pour commencer. Et tout à coup je me rappelai que je n’avais pas emporté assez d’argent de chez moi pour payer ce petit souper. J’étais parti avec un peu de monnaie et j’avais laissé trois billets dans ma commode, trois cents francs qui me restaient.
Je n’allais pas tirer de ma poche, pour payer l’addition, mes soixante-dix billets de mille. Je me rendis d’abord à la toilette et je détachai un de ces billets. Je profitai de l’occasion, étant bien enfermé, pour voir si chaque liasse était complète et si les dix billets s’y trouvaient bien.
Du café où j’étais pour aller chez moi, il y avait cinq minutes à pied. Mais j’avais trop d’argent pour m’aventurer dans ces rues un peu désertes.
Il fallait mettre de côté, dès le lendemain, la plus grosse partie de cette fortune. Cinquante mille, même soixante mille. Je n’aimais pas avoir autant d’argent sur moi. Mais où les mettre, ces billets ? Dans une banque, en me faisant ouvrir un compte, c’était bien imprudent, et, si j’étais soupçonné un jour, quelle coïncidence de dates entre le dépôt et l’assassinat ! Le mieux était de prendre un coffre. On met les billets dans une enveloppe et les employés de banque ne savent pas ce que vous avez caché.
Je me souviens qu’une fois chez moi, après avoir placé mon argent dans le tiroir de la table de nuit, tout près de moi, je me suis endormi assez vite… Je me suis réveillé deux heures après en me demandant ce qui s’était passé. Tout était un peu trouble dans ma tête et je me suis mis à pleurer silencieusement, sans savoir pourquoi. C’était un être faible que j’avais en moi et qui pleurait comme un enfant.
Est-ce que je m’attendrissais sur le compte de Sarrebry ?
Pas une minute, je n’ai pensé à lui. Peut-être est-ce parce que je m’étais un peu attendu à ce qu’une pitié sournoise entrât dans mon cœur. Je m’étais mis malgré moi en garde contre cette compassion.
Souvent on se rend incapable d’éprouver des sentiments, quand on les a trop escomptés.
Je me réveillai au grand jour. Pourquoi me lever ? Je n’avais rien à faire. Un moment, j’avais eu l’idée d’aller chercher des journaux. Mais certainement rien n’avait été découvert avant ce matin. Pour l’instant, moi seul étais au courant de la chose. Je savais avant tout le monde ce qu’il y aurait de sensationnel dans les premières éditions des journaux du soir.
Comment ça s’est-il passé ? La femme de ménage est arrivée vers les huit heures à l’appartement de la rue Meslay. Elle a sonné. On n’a pas répondu. Elle a peut-être la clef…
Je crois entendre son cri…
Elle ameute les voisins, la concierge.
… Peut-être y aura-t-il quelque chose déjà dans le journal de midi… Je ne crois pas. Il s’imprime entre neuf et dix heures. Ils ne sauront encore rien. Attendons la première édition des journaux du soir.
Question importante : vais-je rester à Paris ? J’ai toujours entendu dire que Paris est l’endroit du monde où l’on se cache le mieux.
Mais je ne crois pas que j’aurai la patience d’y rester. J’ai l’impression que je suis trop près de la police.
Je sais où j’irai : j’irai au Havre. Pourquoi ? Une idée.
Ce n’est pas du tout que j’aie l’intention de partir pour l’Amérique. Mais, au Havre, je suis à côté de la sortie, si je me sens obligé de partir tout à coup. Je sais bien que l’on s’emprisonne en partant sur un bateau et que les transatlantiques sont surveillés. Une fois là-dessus, quel énervement ! Pendant six jours interminables…
Enfin, je n’ai pas dit que je m’embarquerais. Je verrai cela. En tout cas, je veux aller au Havre.
Il faut tout de même se lever. J’aime mieux être habillé et prêt à sortir. Et puis, tout à l’heure, il faut aller déjeuner.
Depuis mon divorce, je prenais mes repas dans un petit restaurant du quartier. Je leur devais même de l’argent. Mais je n’allais pas les payer ce même jour. Pas si bête.
Je ne paierai aucune dette ces jours-ci. J’enverrai seulement deux mille francs à mon ancienne femme ; ça, j’y tiens.
Décidément, j’attendrai aussi pour mettre mes billets dans un coffre. C’est embêtant de trimbaler de l’argent sur soi. Mais c’est encore ce qu’il y a de plus sûr.
Les avait-il numérotés, ses billets ? Je ne pense pas. Jadis il y avait des gens qui gardaient les numéros des billets. Aujourd’hui, ça ne se fait plus guère.
La matinée a été horriblement longue. Je m’étais habillé en traînant le plus possible. Puis, j’étais allé au bureau de poste pour envoyer les deux mille francs. J’avais mis soixante billets dans une enveloppe fermée, puis cinq mille francs dans une autre enveloppe, petite réserve destinée à être entamée bien avant la grande à laquelle je ne toucherai qu’à la dernière extrémité… Les rares fois de ma vie où je m’étais trouvé nanti de sommes importantes, j’avais pris les mêmes précautions, et je continuais à y croire. Pourtant elles n’avaient jamais retardé la moindre débâcle. Il y a des gens qui savent garder l’argent. Ceux-là n’ont pas besoin d’avoir recours à ces endiguements puérils.
Comme je le pensais, il n’y avait rien dans le journal de midi.
C’est curieux. Je sens en moi une impression de tranquillité absolue. Et, la veille au soir, je m’étais dit que je n’aurais plus une seconde de paix.
D’ordinaire, je prenais mon café à mon restaurant, et très vite. Ce jour-là, je sentis le besoin de le savourer longuement à la terrasse d’un grand café. J’en commandai même une autre tasse, mais, réflexion faite, je ne la bus pas. J’avais peur de m’agiter un peu et de n’avoir plus le sang-froid qui m’était nécessaire.
Faute de soucis matériels immédiats, je me sentais désœuvré. Où aller ? Quinze ans, dix ans auparavant, j’avais été un habitué des courses. Mais il y avait longtemps que, faute d’argent, j’y avais renoncé et que j’en avais perdu le goût.
Les jours précédents, j’avais fait des antichambres, à la recherche d’une situation. C’est une attente fastidieuse, parce que l’on est sans foi, sans espérance. Le « patient » ne s’impatiente pas, parce qu’il sait trop ce qu’on va lui dire : on prendra note de son nom et de ses références. On lui dit encore : on vous écrira. On ne vous écrit jamais. Le postulant le sait à peu près d’avance. Il n’est pas pressé de recevoir une réponse qu’il pressent évasive. On fait tout de même des démarches, car on ne croit plus à la légende de l’homme que la fortune vient trouver dans son lit. On sait trop que c’est là un bobard monstrueux, inventé par le prochain, qui vous pousse à l’inaction pour supprimer la concurrence.
J’avais pris l’autobus pour aller aux grands boulevards, non pas ceux qui avoisinent la porte Saint-Martin.
Je la connaissais, cette remarque ressassée des criminalistes : l’assassin qui revient invinciblement sur le lieu de son crime. Ils ne m’auront pas comme ça. À cet égard au moins, je suis bien tranquille. Cette fameuse observation, ce n’est pas moi qui l’illustrerai d’un exemple nouveau.
Je descendis au grand carrefour du boulevard Haussmann et de la rue Richelieu. Et c’est là que j’entendis crier la « première » d’un journal du soir. Je l’achetai en affectant de n’y mettre aucune précipitation. Précaution instinctive et imbécile. Le camelot était un peu trop pressé de se débarrasser de son papier pour scruter l’état d’âme des acheteurs.