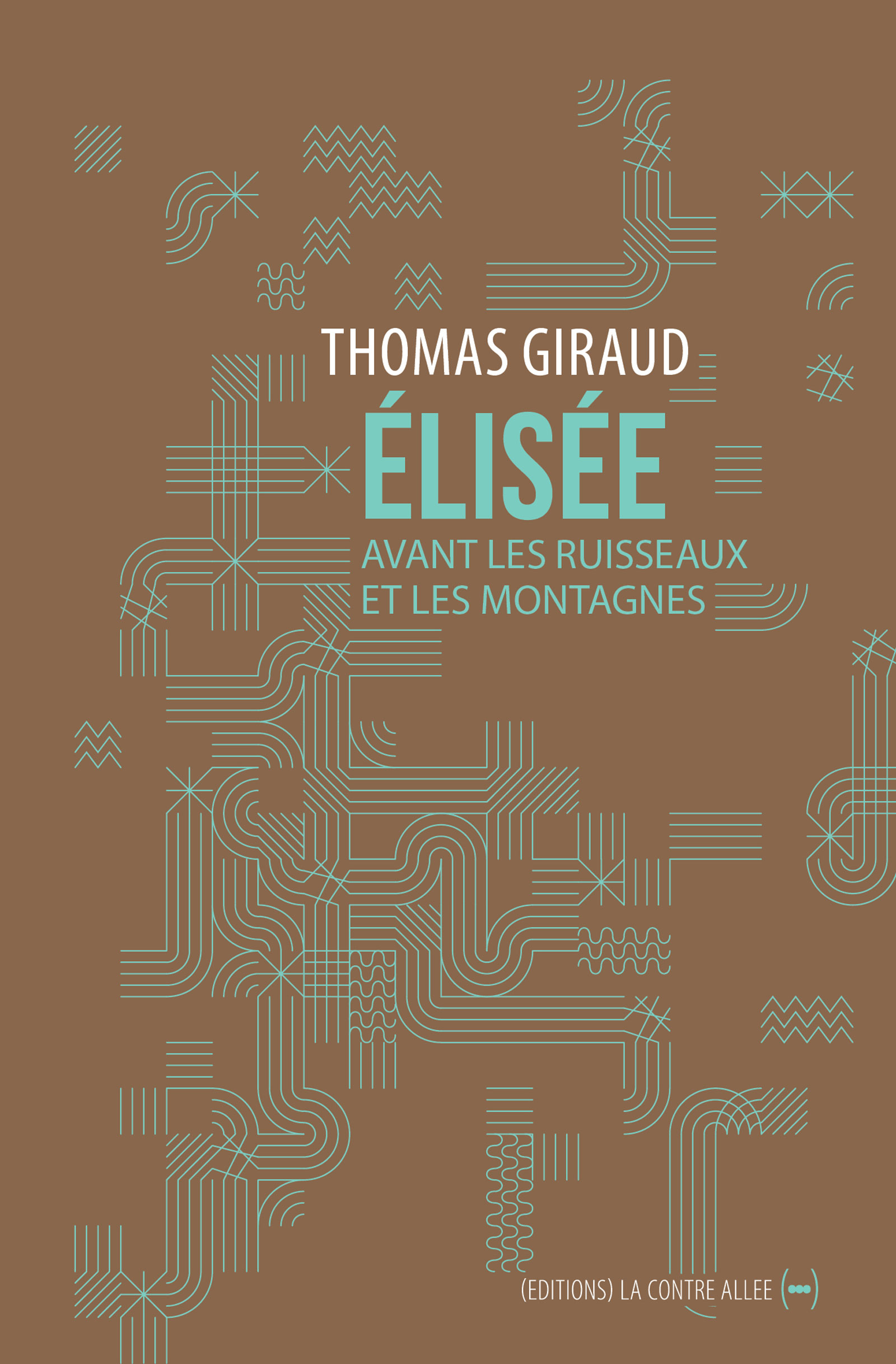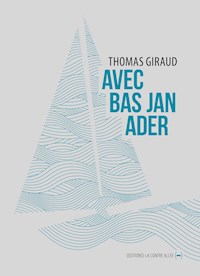
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
D’où lui vient cette fascination pour les chutes ? Qu’est-ce qui le pousse à se laisser tomber d’une branche d’arbre, du toit de sa maison ou encore, à vélo, dans un canal ? Faut-il chercher du côté de la petite enfance et de cet équilibre introuvable qui fait tomber à longueur de temps ? Ou est-ce pour être à la hauteur mais plus bas, bien sûr, que celle de son père, ce héros de guerre ? Ou encore uniquement pour le goût d’ aller contre un ordre établi du monde matériel ? De Bas Jan Ader, artiste hollandais (1942-1975), nous savons peu de choses, si ce n’est qu’ il aura mené bon nombre de performances, jusqu’ à cette traversée, ultime, de l’Atlantique, à bord d’un bateau trop léger sans doute,
In Search of the Miraculous.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Thomas Giraud est né en 1976 à Paris. Docteur en droit public, il vit et travaille à Nantes. À La Contre Allée il est l’ auteur de trois romans remarqués :
Élisée, avant les ruisseaux et les montagnes (2016, 2020 pour le format poche),
La Ballade silencieuse de Jackon C. Frank (2018) et
Le Bruit des tuiles (2019). Nominé et lauréat de plusieurs prix littéraires, Thomas Giraud poursuit une œuvre singulière, scrutatrice, en questionnant ce qui fait les parcours extraordinaires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Long afloat on shipeless oceans I did all my best to smile ‘Til your singing eyes and fingers Drew me loving into your isle. And you sang « Sail to me, sail to me, Let me enfold you. »
TIM BUCKLEY/THIS MORTAL COIL, Song to the Siren
Nous tombons. Je vous écris en cours de chute. C’est ainsi que j’éprouve l’état d’être au monde.
RENÉ CHAR, Éloge d’une soupçonnée
1.
Tu étais seul, tu as toujours été seul. Ça n’a jamais été d’une solitude déprimée et déprimante mais ce fut une solitude qui je suppose s’est imposée par la force des choses, la mort d’un père, la sortie de la guerre, une adolescence rebelle, bref une solitude orgueilleuse. Il y a une série de photographies de toi où l’on te voit sur une chaise, derrière une table, au coin du feu. Tu mimes les grandes manières pour le photographe à qui tu as donné des instructions pour attraper ces grandes manières, celles auxquelles s’adonnent les dandys, les vampires, ou plutôt celles qui les font : des dîners à de grandes tables rectangulaires, sans personne ni rien d’autre qu’un bol de soupe de potimarron, un verre de vin et quelques fromages patiemment affinés. Sobre, distancié, le menton relevé, un port altier donc. Il y a de l’ironie mais entre l’ironie que tu y mets et le fond de ton caractère la distance est très courte. Tu n’es pas snob mais tu as toujours été isolé, même avec les autres autour et avec toi. Tu ne sais pas tout à fait comment t’y prendre pour avoir l’air commun ou, au contraire, hors des limites.
2.
Tu as dit à tout le monde que la traversée de l’Atlantique durerait soixante jours. Ça pourrait évidemment être cinquante-cinq ou soixante-treize mais c’est soixante que tu as sorti de ton chapeau, pour le plaisir du chiffre rond, qui pourrait être biblique ou un arrangement avec la Bible pour te faire marcher sur l’eau mais qui ne l’est pas. Soixante parce qu’il faut dire les choses nettement, pour que tout le monde comprenne. Brièvement même. D’ailleurs maintenant tu parles de seulement deux mois.
Tout est prêt depuis trois jours : le bateau est en ordre, le reste aussi ; le reste est une catégorie un peu molle et floue qui à la fois englobe généreusement le matériel, les préparatifs, toi, et qui ferme aussi les yeux, discrètement, sur les mouvements de l’âme, les tiens, ceux de Sue, des autres. Tu n’attends que la bonne couleur du ciel et le bon écartement des nuages, les signes encourageants du baromètre, un coefficient de marée idéal, le vol prometteur de quelques oies en formation, la disparition de la trace laissée par un avion dans le ciel, des mouettes enthousiastes pour lever l’ancre. Tu as eu le temps de penser à ce que tu diras à Sue et aux quelques amis, camarades venus assister au grand départ. Plutôt, à ce que tu ne diras pas. Tu ne veux pas dramatiser ton départ. Deux mois. Certes sur l’Atlantique. C’est vrai, sur un petit bateau. Et seul. Quatre choses donc. Ce n’est pas rien mais aucun de ces éléments, isolés ou ajoutés, n’est une raison suffisante pour rendre cette petite cérémonie solennelle. Il n’y aura donc ni mots graves ni esprit de sérieux, pas question d’être le mime raté de soi-même à vouloir fabriquer des moments importants. Même sans costume ni ruban, tu vois assez bien comment avec tes mots, gonflés artificiellement par une émotion que la perspective de deux mois peut créer et le petit roulis de la mer, tu pourrais sortir quelques idées définitives, des phrases trop grandes pour tout le monde. Ce serait un peu gênant, ridicule ; ça finirait même par devenir vaguement inquiétant pour ceux qui restent, qui pourraient penser que tu veux faire passer un message. Tu sais aussi que tu ne veux pas parler trop brièvement, ni trop longuement.
Ne pas faire une blague ni chanter. Tu as prévu un petit discours accroché au mât comme si tu l’étais à la terre. Tu regarderas beaucoup Sue, en souriant, en souriant beaucoup, et tu alterneras ce qu’il reste de temps et de sourire sur les visages de John, Fred, Emma, Michael et Alberta. Tu seras concentré car la navigation est une affaire sérieuse. Ce sera banal car tu es déjà concentré.
Tout a beau être très clair pour toi, au moment de partir, de dire c’est le moment de partir et de voir ce que cela fait de le dire, le sérieux, le silence, le trivial, les inquiétudes s’emmêlent. Les premiers mots dits plus vite que la respiration te font la voix trop aiguë au départ et essoufflée à la fin. Combinaison bleue, gilet de sauvetage rouge, la main droite tenant le mât, ou le mât te retenant car tu trépignes, les nuages se sont ouverts et les mouettes sont avec toi, la main gauche enroulée dans cette corde que les marins appellent, que tu appelles, un bout qui vous tient encore le Guppy 13 et toi reliés au ponton, à la terre donc, tu ne retrouves pas ce que tu voulais dire et, sans savoir pourquoi, tu te mets à évoquer sottement les sirènes, leurs mouvements, leur parenté évidente avec les dauphins et les sagittaires, et, surtout, cette chose plus terrible que leurs chants, leur silence, car c’est de ne pas les entendre qui fait s’élancer les aventuriers, les mélomanes, les océanographes et les héros des épopées à leur poursuite. C’est un peu emphatique, un peu définitif, pas très contenu et surtout étrange. D’ailleurs, ni Sue ni les autres ne disent quoi que ce soit. Tu pourrais presque les entendre t’appeler, Bas, Bas, tu es là, que veux-tu dire Bas.
Ils ne dirent rien, et toi rien de plus. Pas de paroles, pas de sons, mais quand même des mouvements de bouche, de doigts étirés. Certes, l’inquiétude n’est pas formulée mais au moins, c’est clair, personne n’est rassuré. Sans doute n’y avait-il rien d’autre à faire, à dire, en tout cas en ce qui concerne les paroles. On ne peut pas dire que tu aies détourné le regard, tu continuais de passer les yeux sur Sue, John, Fred, Emma, Michael et Alberta (ou plutôt un seul regard qui englobait deux personnes, Sue et JohnFredEmmaMichaelAlberta), mais il ne faisait que passer, tu étais occupé, pris ailleurs : en effet, il est ailleurs, tu es déjà parti. Il n’est pas le seul à confirmer que tu n’es plus tout à fait là : tes cheveux ont curieusement frisé depuis quelques semaines, ton corps s’est durci avec les exercices de navigation, tes mains sont creusées par la mer, les bouts tenus fermement, et ta peau, déjà brûlée, reconstituée par cette nouvelle peau du dessous, plus rose, plus épaisse, lumineuse et émouvante comme seule celle des marins peut l’être. Tu murmures tout est prêt. Tu peux y aller, tu peux te rejoindre.
Ces deux mois pour traverser l’Atlantique sont la deuxième partie d’une performance, In Search of the Miraculous, qui doit en comporter trois. La première, achevée il y a un an, est une marche dans la ville constituée de dix-huit photographies prises entre le coucher du soleil et l’aube et s’intitule One Night in Los Angeles. La troisième n’a pas de nom, pas encore en tout cas, et c’est un trajet probablement en ferry puis en autobus de Falmouth en Angleterre jusqu’au Groninger Museum aux Pays-Bas au terme duquel tu dois chanter. Peut-être que ton discours inattendu sur les sirènes n’est pas sans lien avec ce chant que tu dois donner et qui on le suppose doit entretenir un lien ténu avec la mer, les écailles des poissons et donc pourquoi pas ces femmes poissons. La deuxième, c’est donc l’Atlantique, toi, seul sur un bateau dont tu as affirmé qu’il était inapproprié pour une telle traversée, un Guppy 13, un bateau de 3,81 mètres, avec deux petits hublots de chaque côté. Ton Guppy est un des trois cents qui ont été produits en Californie entre 1974 et 1975 par les chantiers Melen Marine et commercialisés pour ce que ses concepteurs appellent la navigation de poche. À Sue qui t’avait montré ce que la notice disait sur l’usage du bateau tu avais répondu que les poches ne font pas toutes la même taille.
Sans que ce ne soit tout à fait clair sur ce qui t’a porté sur le Guppy 13, budget ridicule ou passion pour cette coquille de noix qui, coque jaune, quille rouge et barrée d’un trait horizontal blanc probablement censé marquer la limite de flottaison, avec son air de bateau de poupée qui n’est pas qu’un air, le bateau tangue comme un bateau de poupée quand tu es dessus, celui-ci possède un charme certain. Au moment de partir tu ne doutes pas de ton choix. C’est que vous faites une bonne équipe : un petit bateau rapide et nerveux avec lequel tu as l’impression que tu te mélanges, un peu comme si tu parvenais à tenir, quand tu barres, ses mains et sa colonne vertébrale, et que le frémissement des voiles et des bouts te disait beaucoup sur son système nerveux et ses instincts. Tu ne doutes pas de ce que lui aussi aura de l’intérêt et de la bienveillance pour toi, qu’il te donnera des indices, partagera ses intuitions silencieuses.
Pour le nom In Search of the Miraculous, tu t’es inspiré d’un morceau, Searchin’, des Coasters. Tu aurais pu conserver cette forme progressive, mais ce changement dans la tournure donne à ton titre une majesté d’aventurier, un petit air venteux, en mouvement, allongé. Pour le miraculeux, on va dire que ça allait de soi. Il te fallait au moins chercher de ce côté-là pour justifier ce que tu avais fait, ce que tu faisais, ce que tu ferais : te faire enfermer dans une boîte, tomber, pleurer, traverser l’Atlantique ou seulement la nuit de Los Angeles avec une lampe de poche. Et bien sûr, il fallait que tout soit accompli ainsi : avec intelligence et distance. Mais aussi avec l’effronterie de laisser le sentimentalisme traverser tout ça. Que ce soit accompli de cette façon, c’est-à-dire façonné ainsi comme disent les couturières car il s’agit bien de relier, de tenir sur la peau un habit majestueux.
Quand on sonde tes inquiétudes possibles ou qu’on s’interroge sur la manière dont tu comptes t’y prendre, sachant que personne autour de toi n’a d’autres idées de ce genre de traversée que celle d’une prouesse physique, d’une aventure folle, avec la nécessité d’un coup de pouce divin, tu souris. Tu as l’impression de le connaître l’océan. L’océan, l’océan répètes-tu. C’est plus que la mer. Ça ne chante pas de la même façon. Sa profondeur et ses horizons illimités, ses mouvements lents et immenses, ses chaussures et ses bouts de plastique transportés, ses histoires et ses bois d’ailleurs qu’on retrouve autre part ne fredonnent pas de la même façon quand ils se frottent. Effectivement tu le connaissais un peu. Aux inquiets, à Sue, à ta mère et ton frère notamment tu disais : je l’ai déjà fait. Cette description du passé, la plus minimale et la plus radicale des démonstrations de tes chances de réussite te semblait aussi la plus forte des justifications : l’avoir déjà fait, le dire, le répéter sans claironner, d’une voix calme, je l’ai fait, devait suffire de manière à la fois logique, puisqu’en creux cela signifiait que tu étais encore vivant pour pouvoir l’affirmer, mais aussi magique ou performative à rassurer tout le monde. Avec Sue tu avais été un peu plus précis. Une carte à la main, en faisant glisser lentement ton doigt, tu lui as montré les courants, les rochers et les îles qui servent de repères aux marins, les détails techniques qui devaient s’ajouter à la magie et à la logique. Tu n’avais pas besoin de mentir ou d’inventer, les souvenirs de la même traversée, en sens inverse du Maroc pour San Diego, il y a quelques années, sur un yacht, le Felicidad, étaient encore frais : plusieurs mois, plusieurs tempêtes – dont certaines où vous vous étiez imaginés mourir. Ce n’était pas que l’imagination, vous auriez pu mourir, mais en tant qu’équipier tu avais tant à faire pour ne pas chavirer que l’idée de mourir n’avait pas fait son chemin. Il faut dire que tu avais vingt et un ans, l’âge où l’immortalité et le sentiment d’immortalité sont la même chose. Et puis on ne meurt pas sur un bateau appelé Felicidad, on se réjouit de surmonter les tempêtes, de rire du démon et des mers toujours trop immobiles.
Et puisque tu n’étais pas toujours optimiste, tu avais lu que se noyer n’était pas aussi impressionnant que ça. Une légère angoisse pendant quelques secondes, ensuite, c’est comme si on tombait de haut, de très haut, sur du duvet. Et puis, plus rien, absolument rien. Et si je meurs, je mourrai sans mourir, avais-tu murmuré avec les yeux très grands ouverts pour taquiner Sue, et peut-être aussi en croyant à quelque chose de métaphysique qui ne s’avouait pas, avec un peu d’orgueil également. À vrai dire, tu ne cherchais pas à rassurer. Personne n’est jamais revenu pour raconter sa mort par noyade. Cette petite histoire de duvet t’évite seulement de passer un temps inutile à parler de tout ça car seule la traversée de l’Atlantique dans ces conditions compte. Quitte à être un peu rationnel, il était plus important de se préparer que de discuter. Acheter le bateau, les cartes, une veste de quart, un pantalon imperméable, un gilet de sauvetage, un harnais, envisager la fabrication de matériel étanche pour t’enregistrer ou te filmer puis y renoncer. T’entraîner quelques nuits à naviguer avec le bateau que tu trouverais pour voir comment tout ça tenait la route. Le déchaînement dans l’immensité, la solitude fragile, les journées de plus en plus seul, les nuits plus sombres, les vagues plus proches ne t’effrayaient pas plus que ça. « Ça » étant un instrument de mesure dont toi seul connaissais la conversion en langues admissibles pour les autres. Tu parviendrais toujours à t’en sortir. Et puis à un moment donné, il fallait faire. À l’eau, dans le vide, peu importe mais se jeter sinon on finirait par s’habituer à tout de soi-même.
3.
Plusieurs détonations confondues, une ou deux en retard ou seulement l’écho. Bastiaan Ader a senti que ses genoux n’étaient plus capables de soutenir le reste de son corps, ses rotules ne retenaient ni les tibias ni le fémur. Il a eu en tête les poulains à la naissance et leurs jambes désarticulées, il a même eu l’impression de sentir l’odeur chaude du sommet de leur tête. Son ventre, dont il découvre de manière fortuite, inattendue et presque déplacée qu’il est le centre de gravité de son corps, le tient debout encore un instant. Bastiaan se demande s’il est déjà un peu plus bas car il ne voit plus les branches des pins et des épicéas tout à fait de la même manière, presque par en dessous, la route au loin se tord. Même si c’est trop tard, il ne peut s’empêcher de se dire qu’il aurait peut-être fallu regarder autrement, retourner à des tailles enfantines ou adolescentes avec nos perceptions d’adultes pour tenter de comprendre mieux les arbres et les visages. Ses yeux se voilent. Ils sont humides. C’est la tristesse. Il chute encore, le sol dans son œil droit devient une diagonale. Tout va s’arrêter. Lui et sa chute. Il ne verra plus ses deux garçons, Bas, deux ans, dont les traits commencent à se dessiner, les lèvres charnues, la trace des pommettes dans ce visage encore brouillé, barbouillé par la petite enfance, ni Erik, à peine quelques mois. Il ne sentira plus la lavande sur les bras et les cheveux de Johanna avant de s’endormir.
La chute s’est accélérée ; déstabilisé, son corps est tombé. Bastiaan n’a pas eu le temps d’inspirer, de renifler l’odeur du sol de la forêt à cet endroit-là car il est mort une fraction de seconde avant. Peut-être a-t-il fermé ses yeux émus dans une irrationnelle peur d’avoir mal en heurtant le sol, pressentiment du pénible immédiat à venir, anticipant le choc et le contact avec l’humidité de la terre détrempée qui probablement formait un voile léger au-dessus du sol.
Le ciel ne peignait plus rien. Plus exactement, le ciel n’avait plus rien à peindre car tout se passait ailleurs. Il pouvait y avoir du vent, il n’y en avait plus, des nuages, le ciel était clair et d’un bleu lavé, la lumière crue du soleil n’était ni la lumière ni le soleil. Le mouvement n’était plus dans ce qui d’habitude bougeait. C’était lui le mouvement et il était devenu le mouvement en tombant. Il s’est écroulé.
Bastiaan Ader né en 1909 est mort en novembre 1944 des balles tirées par des soldats allemands pour le punir – avec les effets réels de la punition sur son corps, définitifs, et ceux supposés sur le comportement des autres. On a voulu le réprimer, le réduire, les faire disparaître, lui et ses intentions, lui et ses manières, lui qui a aidé des Juifs à s’enfuir, qui en a caché dans sa maison, dans la forêt autour, dans des petits boyaux qu’il creusait avec des camarades et qui faisaient des cachettes temporaires, lui qui indiquait les chemins, les ciels et les heures par lesquels on pouvait sauver sa peau, passer la frontière entre l’Allemagne et les Pays-Bas sans avoir à danser entre les balles des fusils-mitrailleurs. Lui, Bastiaan Jan Ader, pasteur depuis 1938 de la petite ville de Nieuw-Beerta, aux Pays-Bas.
Peut-être qu’à la place de cette vie de courage, celle qui fera de lui un Juste, il aurait préféré, modestement, vivre plus longtemps : voir grandir ses deux fils, en avoir d’autres, planter des rangées de cosmos sur le côté sud du jardin pour la légèreté des grandes tiges avec leur air dégingandé dans le vent, toutes ces couleurs, et surtout aller à bicyclette jusqu’à Jérusalem. C’était sa grande affaire ce périple à vélo. Pour ce que l’histoire semblait lui imposer, pour Jérusalem qui devait certainement être quelque chose avec ces lieux aux noms un peu fous Judée, Bethléem, pour la traversée de tous les pays mais surtout pour la bicyclette dont il aimait le déplacement mesuré, le bruit souple sous la roue. À bicyclette, dans un petit ermitage tranquille avec lui et lui-même, ses interrogations, ses réponses et surtout le silence imposé au reste, il se sentait au bon endroit pour mettre en ordre sa pensée et écouter mieux celle des autres. Au lieu de ça, il a fallu, sans même avoir trente-cinq ans, s’affaler dans le mélange de feuilles qui pourrissaient, d’humus, de glands moisis au milieu d’une forêt, près de chez lui, par un petit matin de novembre, probablement humide et déjà froid comme l’hiver. On ne sait rien de la météo mais un 20 novembre là-bas, là-haut, ça devait être glacial.