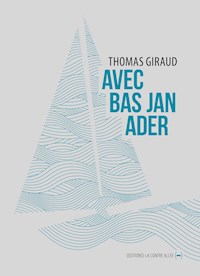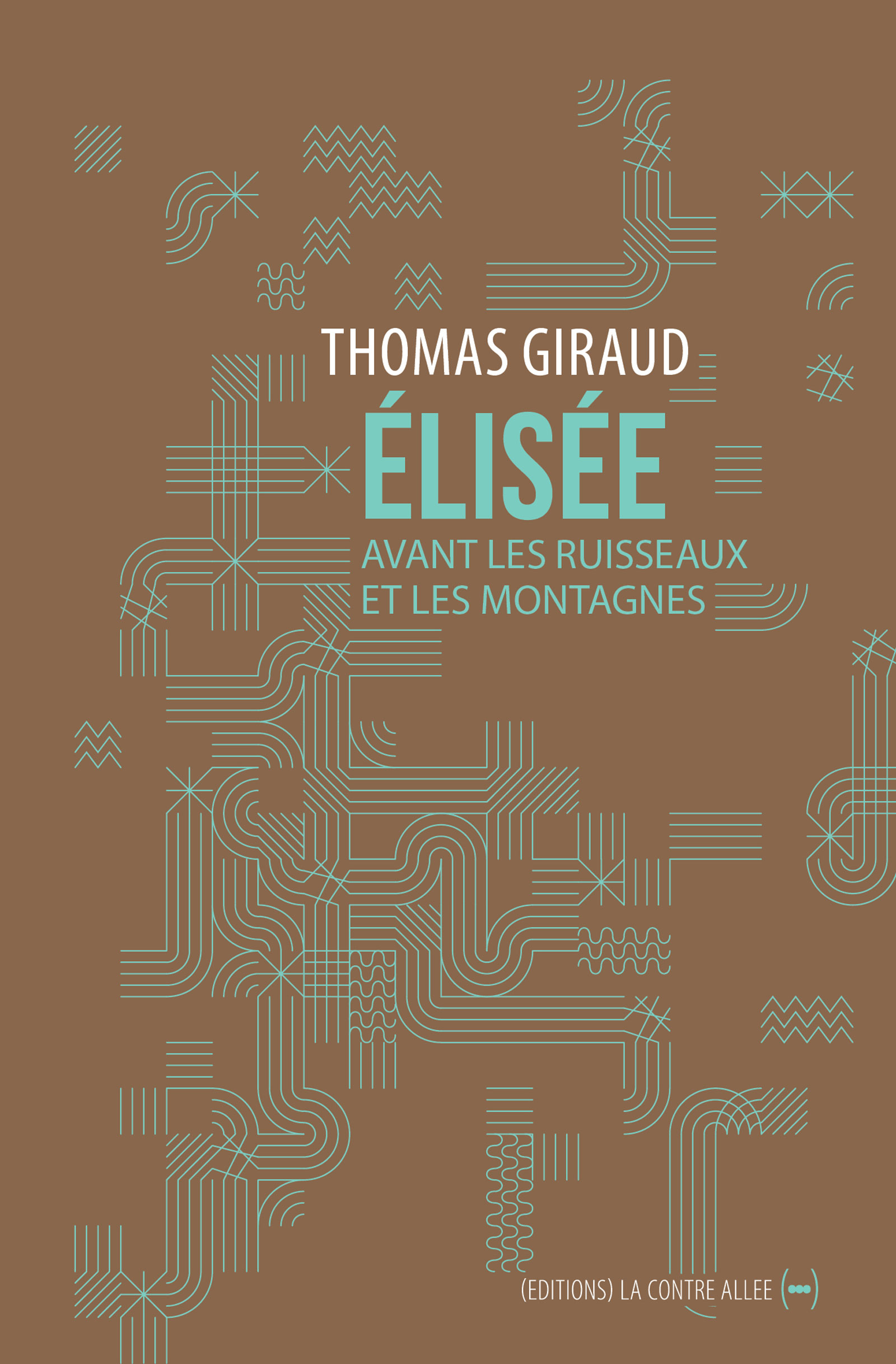
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
En imaginant ce qu’ont pu être certains épisodes de la vie d’Elisée Reclus (1830-1905), avant qu’il ne devienne l’auteur d’
Histoire d’un ruisseau et
Histoire d’une montagne, ce premier roman nous met dans les pas d’un personnage atypique et toujours d’une étonnante modernité.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Thomas Giraud est né en 1976 à Paris. Docteur en droit public, il vit et travaille à Nantes. Depuis le bel accueil réservé à son premier roman,
Elisée, avant les ruisseaux et les montagnes, Thomas Giraud contribue à
Remue.net, 303, La moitié du Fourbi ou encore le
Yournal. Il a obtenu le Prix Climax avec
La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank et publié un troisième roman aux éditions La Contre Allée,
Le Bruit des tuiles, paru le 21 août 2019.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
ça qui devient sec ; pas vraiment.
On peut garder
Les mots longtemps. On les mange.
C’est
à travers de drôles de gestes
Qu’on reste vivant.
James SACRÉ, « Comme en disant c’est rien, c’est rien » in La nuit vient dans les yeux, éditions Tarabuste, 1996.
À Barbara
Chapitre I
Il y en avait beaucoup d’autres ; douze, en plus d’Élie et de celui qui n’a pas vécu, c’est beaucoup d’enfants. Peut-être furent-ils quinze. La maison familiale de Sainte-Foy-la-Grande était trop petite pour tous ces enfants. C’est autour, dans les limites de la Rance, du Vinairols et de la Dordogne, dans les paysages de ce début de Périgord qu’Élisée s’est indiscipliné, en marchant, en courant et regardant plus que les promeneurs, en ramassant beau coup de pierres.
On est loin des Alpes qu’il va tant aimer, de cette grande architecture, de leur raideur accidentée et de leur sourd mouvement. L’horizon à Sainte-Foy-la-Grande est ouvert même s’il n’est pas sans limites ; il n’est pas fermé, cluse, comme on dira de certaines vallées, dans les montagnes ; des montagnes, presque des murs, qui ne proposent comme chemins que de périlleux passages. Ici la Dordogne en se déroulant offre l’horizon de l’autre rive et son cours à remonter ou descendre. La ligne du ciel est dégagée et les vignes ne sont pas loin. Il y a de quoi jouer à se cacher lorsque les feuillages des vignes sont épais et roux, ou ramasser des bouts de calcaire, de gravier, d’argile en hiver. Pas d’inquiétantes forêts pour un jeune enfant, pas d’eaux tumultueuses. Et puis, en 1830, on ne se bat pas, on ne se bat plus, on l’a déjà beaucoup trop fait par ici ; il faut dire que les conditions étaient idéales, toutes les guerres dans lesquelles les vies des nations se trouvent engagées se sont déroulées dans les plaines1. Et là, au loin et tout près, des plaines ou à peine quelques vallons très doux.
Dans cette enfance, c’est le moment où, selon les préoccupations paternelles qui sont en fait des prescriptions paternelles, il peut être pasteur, il doit être pasteur. Élisée peut encore être maintenu dans le chemin que son père choisit ou que son père, Jacques, voudrait bien. Il peut encore marcher sur ça, par là. Par-là, c’est assez vague mais, par là, ça commence par l’Allemagne, Neuwied, première étape pour devenir pasteur et reprendre sa part du flambeau calviniste : lumière sèche, pointue, ferme et qui dure.
Il ne l’a pas reprise. En revenant à Sainte-Foy, à cinquante et quelques années, il n’est pas pasteur. Il est géographe d’une manière peu orthodoxe, aimant les ruisseaux et les montagnes, les détails dans leur étendue. Il écrit en voulant faire vibrer la terre et ne peut toujours cantonner son lyrisme qui déborde. Selon les points de vue on dit que c’est un grand savant, un humaniste à la Diderot, touche-à-tout curieux ou bien on le décrit comme un original, confus et dilettante, dispersé, toujours impécunieux. Ses convictions philosophiques et politiques sur l’anarchisme le desservent, c’est le moins que l’on puisse dire, puisqu’il va connaître l’exil, la prison (et l’exil encore). Tout ça, et peut-être plus encore son air de moujik tendre un peu fou, lui ferment la porte de toute carrière universitaire. Si l’Université libre de Bruxelles lui offrira une chaire de géographie comparée à la Faculté des sciences, avant même qu’il ait commencé à prononcer le premier mot de son premier cours, elle prendra la décision de le suspendre pour de sombres histoires politiques. Il n’a pas la prestance sévère d’un Michelet, l’air propret d’Alexander von Humboldt ou la sécheresse rude dans les yeux de son cadet Paul Vidal de Lablache.
C’est son regard, celui que l’on voit sur les photographies prises de lui par Nadar, qui frappe en premier lieu. Le noir et blanc n’éteint pas ce bleu, on dirait les pointes, pleines d’éther et de vapeur, des Pyrénées : c’est coupant, ciselé mais il n’y a rien d’agressif, on ne devine aucune envie de heurter, de blesser. C’est un regard d’enfant ému, même à la fin de sa vie, qu’offrent ces yeux, presque ceux d’un mystique. Ce sont aussi des yeux accueillants. Attentifs et directs. Ce sont les yeux d’un homme qui regarde mais ils ont dû mettre mal à l’aise de temps en temps. Les yeux qui regardent, traversent, gênent un peu ; on n’est jamais sûr de ce qu’ils sont en mesure de voir. Auscultent-ils ou ne font-ils que traverser ? En regardant ces photographies, sans faire d’effort, on trouve également de la bonté. Et on ne se trompe pas, car si l’on ne s’accorde pas toujours sur ses talents, paresseux solaire ou savant pointilliste, personne n’a jamais rapporté qu’il aurait pu se comporter en cuistre.
Sa barbe est aujourd’hui fournie, savante et large. Comme ses mâchoires sont menues, c’est une barbe qui allonge horizontalement son visage alors même que sur d’autres mâchoires elle aurait donné des airs de légionnaire. Tout dans son apparence est dans un léger désordre : barbe et cheveux longs. Il doit peigner tout ça avec ses doigts. Au final, il a davantage l’air d’un peintre voyageur que d’un éminent professeur de géographie allant lire sa leçon introductive à l’académie (ce qu’en tout état de cause il ne fera jamais). On aurait envie qu’il ait un chapeau de paille. Il l’a sûrement et l’a ôté pour les photographies de Nadar.
C’est sans raison expressément formulée qu’il a décidé de faire le trajet jusqu’à Sainte-Foy, cinq semaines plus tôt. Le besoin de voir le lieu des siens, au moins des siens du départ ? Sentir la bonne odeur de poussière d’été de la maison, retrouver la Dordogne ? Ou seulement, peut-être, refaire le trajet pour faire revivre les souvenirs de ces lieux déjà traversés : les arbres poussés ou ceux abattus, les ponts construits, bref, observer le changement qui s’est produit sur ce chemin entre Sainte-Foy et Neuwied ou entre Neuwied et Sainte-Foy. Sa traversée de la France, ce retour entre Neuwied et Sainte-Foy, à l’âge de quatorze ou quinze ans (il ne sait plus très bien), à pied, est déterminante pour sa vie. Les images sont peu ordonnées, les rencontres mélangées : le souvenir a été fignolé avec les années, certainement avec quelques ajouts, mais il demeure avec toute sa nécessité et toute la nostalgie de ce qui s’éloigne. Reprendre le chemin c’est peut-être retrouver sur celui-ci, dans la mémoire des pierres, des routes empruntées, des souvenirs précis de ce monde qui lui semble aujourd’hui si lointain, changé, transformé. À cinquante et quelques années, il se sent dépassé par les changements du monde. Banalement, c’est un peu de sa jeunesse qu’il cherche peut-être à sentir, étourdi d’appartenir à un monde en train de disparaître. En tout cas, sous la chaleur d’un mois d’août éprouvant, il est de retour, et il a fait, de nouveau, le trajet de son adolescence.
Bien avant ce départ à douze ans, pour l’Allemagne (où il va rester deux ou trois ans), l’enfant obéissant qu’est Élisée peine à obéir bien. Il gagne du temps, il fait les choses à moitié, ou ne les fait pas, il oublie (le pain à acheter, les tomates à cueillir, un livre à rendre). C’est un enfant. C’est un enfant distrait. Progressivement des oppositions souvent inutiles, serrées sur des détails, les accompagnent, son père et lui : parce que son père perd patience, parce que la rigueur de la réflexion calviniste veille sur tous les deux, même si elle ne les emmène pas au même endroit. Les prescriptions du quotidien qu’Élisée mâche trop vite, les rêveries qu’il voudrait plus rêveuses et plus longues, les remarques de Jacques, le père, tout ça et d’autres choses encore, et aussi la maison trop petite, poussent Élisée à des départs enfiévrés sur les chemins alentour. Il y rumine des colères qui ne sont jamais des coups de sang (il n’appartient pas aux cogneurs de sang), mais plutôt des frustrations et des tiraillements d’enfant, jusqu’à ce qu’Élisée parvienne à construire des bouts de pensée qui sont des réflexions d’enfant, prémisses d’une littérature à venir, et qui lui permettront de contenir ses agacements.
Bout de pensée : Est-ce que je n’ai pas le droit de rester assis à regarder les feuilles des arbres ?
Bout de pensée : Je voudrais passer ma vie à transporter les pierres dorées et à ne plus avoir à exécuter les ordres de mon père.
Bout de pensée : Que sait-il de la fraîcheur de l’eau ? Que sait-il de l’odeur des raisins mûrs dans les vignes ? Il ne fait que marcher, traverser, sans s’arrêter. Il ne sait ni sur nous ni sur les choses.
Les vraies disputes avec son père, Jacques, ne sont pas tout à fait prêtes. Il faut attendre qu’elles se préparent, on ne se dispute vraiment que lorsque l’on est capable de prendre prétexte de l’accessoire, du détail, pour remettre en cause tout un système de pensée, toute une manière de vivre. Il n’en est pas du tout là. À l’âge où il est encore cet enfant, où sa peau est claire des voyages qu’il n’a pas faits, où ses bras qui seront toujours relativement chétifs l’étaient déjà, avec sa petite taille et sa chevelure soyeuse, il s’enfuit ruminer ses frustrations et tiraillements, déplacer des pierres. Pas déplacer des montagnes, juste ramasser des pierres et les faire voyager. De petits actes mesurables.
Il lui faut du temps pour devenir ce jeune homme qui portera la barbe pour ne pas ressembler à son père – c’est-à-dire, en réalité, pour lui ressembler mais autrement. Pour le moment, il est encore jeune, même si, probablement, il doit déjà avoir l’air plus grave et plus adulte que ne le sont aujourd’hui les enfants au même âge. Jeune homme de vingt ans, on parvient sans mal à imaginer que son regard transperçant et doux, de fer, mais avec de la bonté qui déborde, qui recouvre, est celui que gardent en vieillissant les enfants qui ont toujours été un peu plus vieux que leur âge, décalés d’avec les autres. Finalement, c’est plus vieux, conservant ce même air qu’il avait enfant, qu’il aura, tout à coup, l’air beaucoup plus jeune, qu’il sera décalé encore.
Il est en tout cas établi, décalé du regard ou pas, qu’il marchera par là, là où son père, Jacques, le dit, l’Allemagne, là où Élie, le frère fratrissime, le grand, est allé aussi. Pour le père, Jacques, en perpétuelle rébellion contre l’église évangélique nationale, il n’a jamais été question de discuter la vocation pastorale, une évidence, son évidence. On ne discute pas des évidences (on ne discute pas non plus des vocations, y compris celles que l’on choisit pour les autres), surtout lorsque le poing serre ce flambeau calviniste. Poing de son père, Jacques, poing d’Élisée aussi, car poing et lumière sèche sont déjà des camarades d’alors et de demain. Le poing levé des luttes inégales, où les bras s’offrent plutôt que frappent, la lumière sèche de la persévérance, avec ses notes de jaune et bleu comme tirées au cordeau et qui est celle des chemins escarpés. Poing baissé mais toujours levé, qui deviendra main pour écrire, beaucoup, car l’envie d’écrire et de décrire sera immense.
Pour l’instant, l’envie d’écrire est en préparation. Il conserve, dans sa tête, les bouts de pensée de ses colères non pas pour se façonner une figure de rebelle mais parce que les mots qui lui viennent à l’esprit, dans ces moments de frustration et de tiraillements, continuent de rouler dans sa bouche et de faire des phrases dont il ne se sépare pas facilement. Il a besoin de les écrire. Comme tous les enfants, c’est l’injustice dont il pense être l’objet qui l’accable le plus et, dans ses bouts de pensée, il tente de rétablir l’équilibre brisé par quelques interrogations, quelques phrases. Et puis, il se laisse aussi gagner par ce qu’il aime : les ruisseaux et les pierres qu’il aime lier, ses promenades solitaires.
Bout de pensée : Jusqu’à quand devrai-je lui obéir ?
Bout de pensée : Il ne connaît rien au vide, à l’intérêt du vide. Il ne pense qu’à remplir.
À cause de ce père, de leurs premières incompréhensions réciproques, Élisée fabrique ces bouts de pensée. Il finit par les noter.
1. Les phrases en italique sont des citations d’Élisée Reclus.
Chapitre II
D’avant le départ à douze ans pour l’Allemagne, il reste, outre les bouts de pensée, des souvenirs d’école. Celle de Zéline, sa mère, institutrice privée. C’est une école qu’elle a inventée et où elle fait cohabiter l’apprentissage de la rigueur (sa vie avec Jacques n’est pas un hasard) et de la lecture, la découverte de l’autonomie, des rudiments d’arithmétique et les voyages qu’elle n’a pas faits. Elle mène son école, éduquant ses enfants, mettant au monde d’autres enfants, d’autres pas, élevant ceux qui naissent et les instruisant ensuite en les mélangeant avec ceux de son école. Pour Élisée, cette école a la forme rassurante de sa mère et c’est aussi sa mère, différemment. Non pas que Zéline ait pris le parti d’être un personnage différent à l’école mais, dans ce cadre un peu moins formel que la famille, Élisée perçoit les poussières d’autre chose. Les emportements de ses passions à elle, on ne les voit jamais à la maison, à l’école ni autre part, mais on devine, parfois, et Élisée qui est déjà un regardeur attentif, doit le deviner, qu’une mélancolie de l’ailleurs la tourmente. Il voit bien ces poussières. Parfois, un voile passe sur les yeux de Zéline lorsqu’elle évoque la lumière de la mer ou prononce certains mots. Parfois, c’est l’évocation d’un paysage d’Italie, l’odeur des vendanges qui accélère le rythme de sa voix même si toujours, c’est avec la même équanimité qu’elle mène son petit monde d’enfants, garçons et filles, dans son école.
Elle chuchote : « Élisée ? »
Élisée est un garçon sérieux et sa mère le trouve un élève attentif même si elle aussi, parfois, devine que l’ailleurs, peut-être pas loin, peut-être au-delà de la Dordogne, en la remontant, le long du rivage, d’un pas ferme ou un peu plus loin des vignes, le tourmente. Il est distrait.
Elle chuchote encore : « Élisée ? »