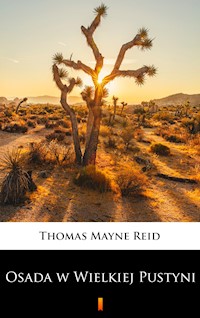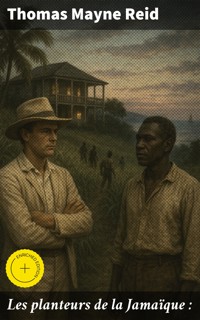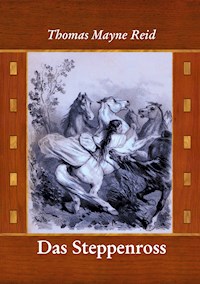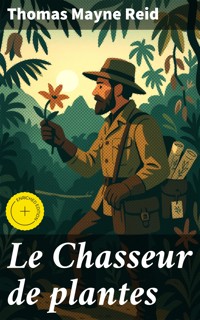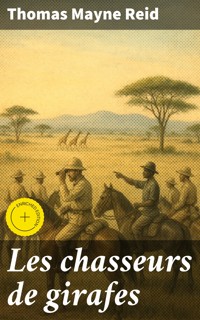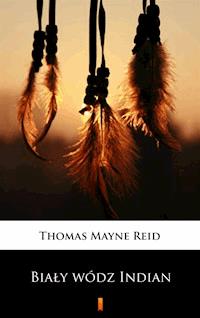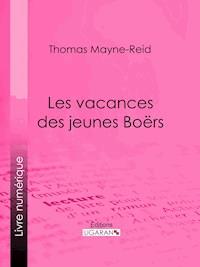1,99 €
1,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Pays du nopal et du maguey, terre de Montézuma et de Malinché ! ton souvenir me domine ! Les années peuvent finir, ma main se dessécher, mon cœur vieillir, mais moi vivant je ne t’oublierai jamais. Pour rien au monde je ne voudrais t’effacer de ma mémoire. Que ton nom soit béni entre tous !
Brillant pays d’Anahuac ! mon esprit monte sur les ailes de l’imagination, et je me retrouve encore sur tes rivages ! Dans tes vastes savanes, j’anime mon noble coursier, dont le joyeux hennissement dit que lui aussi est inspiré.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
LE LIEUTENANT WHEATLEY
I
Souvenirs.
Pays du nopal et du maguey, terre de Montézuma et de Malinché ! ton souvenir me domine ! Les années peuvent finir, ma main se dessécher, mon cœur vieillir, mais moi vivant je ne t’oublierai jamais. Pour rien au monde je ne voudrais t’effacer de ma mémoire. Que ton nom soit béni entre tous !
Brillant pays d’Anahuac ! mon esprit monte sur les ailes de l’imagination, et je me retrouve encore sur tes rivages ! Dans tes vastes savanes, j’anime mon noble coursier, dont le joyeux hennissement dit que lui aussi est inspiré. Je me repose à l’ombre des palmiers, et bois à longs traits le vin de l’acrocomia. Je gravis tes montagnes de porphyre, tes rochers de quartz, d’argent et d’or. Je traverse tes champs de lave aux contours raboteux et couverts d’une végétation étrange, d’acacias et de cactus, de yuccas et de zamias. Je parcours tes plaines hérissées d’aloès gigantesques. Je touche aux neiges éternelles, tandis que je contemple dans la vallée profonde le palmier, l’oranger et les feuilles brillantes du pothos, de l’arum et des bananiers.
Pays de Montézuma ! tu m’as laissé encore d’autres souvenirs plus vifs que ces tableaux de paix ; tu me rappelles des scènes de guerre. J’ai traversé tes champs en ennemi, l’épée à la main, et aujourd’hui, après de longues années, plus d’un épisode barbare de ma vie de soldat surgit devant moi avec toute la puissance de la réalité.
Le bivac ! La nuit, je m’assieds au feu du camp, devant des formes guerrières et des figures martiales. Le bois flambant éclaire les armes et les costumes ; des carabines, des pistolets, des gourdes jonchent le sol ou pendent aux branches des arbres. Les chevaux, attachés aux pieux, prennent de vastes proportions dans l’obscurité et se dessinent vaguement sur le fond de la forêt. Près de là croît un palmier solitaire dont la tête courbée paraît blanchir sous les rayons du feu. Cette lumière brille sur les troncs cannelés des cactus, des agaves et sur les tillandsias argentées qui drapent les arbres d’une sorte de toge. Les échos de la forêt répètent les cris rauques qui effrayent le perroquet craintif et le loup affamé. Là, ces hommes chantent, plaisantent et rient sans souci du lendemain....
L’escarmouche ! L’aurore luit. La forêt odoriférante est silencieuse et les lueurs du matin colorent la cime des arbres. Un coup de feu retentit : c’est le signal d’alarme de la sentinelle perdue qui arrive au galop vers la garde. L’ennemi approche ! A cheval ! La trompette éclate en notes sonores. Les dormeurs se lèvent en hâte, saisissent leurs carabines, leurs pistolets et leurs sabres, s’élancent à travers les foyers presque consumés en soulevant des nuages de cendre. Les chevaux piaffent et hennissent ; en un instant ils sont sellés, bridés, montés, et la troupe se précipite à travers la forêt.
L’ennemi est en vue : c’est une bande de guerilleros revêtus de leurs mangas pittoresques et de leurs serapés écarlates. Les lances aux pointes luisantes et les étendards apparaissent au-dessus des arbres.
La trompette sonne la charge, couverte par les cris des assaillants. Nous rencontrons face à face nos ennemis basanés ; les coups de pistolet répondent aux coups de lance ; nos sabres, s’entre-croisent et résonnent, mais nos chevaux reculent... Nous faisons volte-face et nous nous rencontrons avec une nouvelle énergie. Nous frappons sans remords, nous combattons pour la liberté !...
Le champ de bataille ! Je renonce à dépeindre les colonnes serrées, le bruit du canon et le roulement du tambour, les sons retentissants de la trompette, les cris, la charge, la lutte corps à corps, les gémissements des blessés, la déroute, la retraite et les hourras de victoire....
Terre d’Anahuac ! tu me rappelles d’autres scènes bien différentes. La lutte est terminée ; le tambour de guerre a cessé de battre ; la trompette ne retentit plus ; le cheval se repose et le vainqueur folâtre dans les salles du vaincu.
Terre charmante ! tu ne m’as pas laissé que de gais souvenirs ; mais le temps a adouci les émotions tristes et donné de nouvelles forces aux réminiscences joyeuses ; dans tes bosquets aussi il n’y a point de roses sans épines : j’oublie les épines et ne vois plus que les fleurs.
II
Un village à la frontière mexicaine.
Une pueblita mexicaine sur les rives du Rio Bravo del Norte est une simple rancheria ou hameau. La bizarre et vieille église de style moresque italien, avec sa coupole aux couleurs variées, la cure et la maison de l’alcade sont les seules constructions en pierre de la place et occupent trois côtés d’une plazza assez spacieuse. Le quatrième côté est formé par les échoppes ou les habitations du peuple. Les maisons sont bâties en grosses briques non cuites (adobés) ; quelques-unes sont recrépies à la chaux, d’autres somptueusement peintes comme le proscénium d’un théâtre. mais la plupart ont uniformément un aspect sale et repoussant. Elles possèdent toutes une porte lourde comme celle d’une prison et des fenêtres sans vitres ni châssis. La reja de barres de fer posée verticalement résiste aux attaques des voleurs, mais non aux assauts de l’hiver.
Des quatre coins de la plazza, des ruelles étroites, non pavées, poudreuses et bordées, à une certaine distance, de maisons en adobés, mènent à la campagne. Aux confins du village s’élèvent les habitations fragiles et pittoresques des pauvres péons, les descendants de la race conquise.
Les habitations en briques et en terre ont, au lieu de toit, une terrasse cimentée ou en tuile, parfois vernie avec goût et bordée d’un parapet construit à hauteur de poitrine d’homme. Cette terrasse est l’azotea, signe caractéristique de l’architecture mexicaine.
Quand le soleil se retire à l’horizon et que la soirée est fraîche, l’azotea offre une retraite charmante, surtout si le propriétaire de la maison aime les fleurs ; alors elle est convertie en un jardin aérien où se déploie la flore qui a rendu le paysage du Mexique justement célèbre. On fume, on boit du pinolé ou du catalan. La brise emporte la fumée et le grand air donne de la saveur au breuvage. De plus, on voit ce qui se passe dans la rue sans être aperçu. La foule affairée circule et ne songe pas à lever la tête.
J’occupe l’azotea de l’alcade, et comme elle est la plus élevée du village, je domine toutes les autres. Ma vue s’étend même sur la campagne, dans laquelle je distingue le cactus, le yucca et l’agave. Le village est entouré d’une ceinture de champs cultivés où la brise agite les glands du maïs et les feuilles sombres des capsicums et des fèves (frijoles). Le chapperal avec ses halliers épineux d’acacias et de mimosas, véritable labyrinthe d’arbres légumineux, borde ces champs. Si rapprochées sont ces jungles, que je distingue les palmiers sabal nains, les rhomelias et les feuilles écarlates de la plante pila, qui brille au loin comme des étincelles de feu.
Vous ne découvririez point en eux la plus légère ressemblance. (P. 13.)
Le voisinage de la forêt annonce l’indolence des habitants de la petite pueblita. On doit se rappeler que ces hommes ne sont pas agriculteurs, mais vaqueros (bergers), et que les clairières du chapperal sont remplies de troupeaux de bétail espagnol et de petits chevaux andalous à courtes oreilles. Ce n’est point à dire que ces villageois n’exercent aucune industrie. Mener paître les animaux est leur principale occupation ; ils ne cultivent un peu le sol que pour récolter du maïs, dont ils font des tortillas ; du chilé pour assaisonner ce mets, et des fèves noires pour compléter leur repas. Ces végétaux et des bœufs quasi-sauvages, élevés dans d’immenses pâturages, composent toute la nourriture des Mexicains.
Quant à la boisson, les habitants des plaines septentrionales trouvent un breuvage excellent — le rival du vin de Champagne — dans le cœur de l’aloès gigantesque ; ceux des régions tropicales se rafraîchissent avec le suc de l’acrocomia, ou palmier à courtes feuilles.
Terre privilégiée ! Cérès et Bacchus t’aiment et te comblent de bienfaits. Hélas ! comme dans tous les pays du globe, les vues de la Providence ont été méconnues par la malignité de l’homme.
Pourquoi ces populations sont-elles entassées dans les villes et les villages ? Sous un ciel brillant, un climat salubre et dans des contrées pittoresques où tout semble inviter à la vie rurale, j’ai voyagé pendant de longues heures sans rencontrer une habitation. A de longs intervalles, on aperçoit l’hacienda de quelque riche propriétaire, et bâtie comme une forteresse ; mais où sont les ranchos, les demeures du peuple ? Elles tombent en ruine. Ah ! je me rappelle que je me trouve sur la frontière, que les rives du Rio-Bravo, de sa source à la mer, sur une étendue de quinze cents milles, ont été pendant plusieurs années des champs de guerre. Plus d’une lutte sanglante s’y est engagée entre les Arabes du désert américain — les cavaliers indiens — et les pâles descendants des Espagnols. Voilà pourquoi les ranchos tombent en ruine, voilà pourquoi les haciendas sont percées de meurtrières et les populations réfugiées derrière des murailles. L’Europe féodale revit dans la libre Amérique, sur les rives du Rio-Bravo del Norte !...
Environ à un mille de distance, dans la direction de l’ouest, j’aperçois un bras de la grande rivière qui brille sous les rayons du soleil levant. En cet endroit, le ruisseau décrit une courbe et baigne le pied de la colline, dont le sommet est couronné par les blanches murailles d’une hacienda. Malgré son unique étage, cette habitation a un aspect imposant.
Comme toutes les constructions de ce genre, elle possède une terrasse et un parapet crénelé. De petites tourelles posées aux angles de la grande porte d’entrée coupent la monotonie des lignes du bâtiment. La tour d’une chapelle apparaît au fond. Les haciendas mexicaines sont ordinairement pourvues de ces petites capillas qui permettent aux péons de remplir leurs devoirs religieux. La réverbération des vitres derrière les rejas de fer et la végétation qui se montre au-dessus des murs enlèvent quelque chose de cet aspect lugubre particulier aux maisons de campagne mexicaines. Parmi les arbres qui contribuent ainsi à égayer l’hacienda, figure un gracieux palmier exotique d’une nature toute différente de celui qui croît dans cette zone du Rio-Bravo. Je note ce fait non à cause de la curiosité botanique qu’il m’inspire, mais parce qu’il explique un point de caractère de celui ou de celle qui est le génie de l’hacienda. Je donne un libre cours à mon imagination ; je désire gravir cette colline, et entrer dans cette superbe demeure.
Les sons d’une trompette de vacher m’arrachent tout à coup à cette douce rêverie. Mes pensées prennent un autre cours, mes regards se détournent de l’hacienda et s’attachent à la plazza de la Plueblita, où des scènes bien différentes s’offrent à ma vue.
III
Les tirailleurs en vedette.
Le centre de la plazza est le point saillant du tableau. La, le puits (el poso), avec sa roue gigantesque, ses grands rebords, ses seaux en cuir et son baquet de pierre cimentée, offre un aspect oriental. On est surpris de rencontrer dans cette contrée occidentale une construction originaire de la Perse, mais l’explication de ce fait est facile. La roue persane a voyagé de l’Égypte sur les côtes méridionales de la Méditerranée. Avec les Maures, elle a traversé le détroit de Gibraltar, et les Espagnols lui ont fait franchir l’Atlantique. Le lecteur trouvera dans les Livres Sacrés plus d’un passage applicable aux mœurs des Mexicains. Mes regards se détachent du puits et s’arrêtent sur les scènes animées qui se déroulent autour du poso.
Là, le poblano, l’habitant de la hutte-adobe, avance d’un pas silencieux le long des murailles, en évitant le centre de la place, sur lequel il jette par intervalles un regard curieux et craintif. Il porte de larges calzoneros ; un serapé aux couleurs multiples couvre ses bras et ses épaules, et un chapeau noir à larges bords assombrit encore son teint basané. En pénétrant furtivement dans une maison qu’on lui ouvre avec précaution, il semble heureux d’échapper aux regards. Peu d’instants après, j’entrevois son visage derrière les barreaux de la reja.
Ailleurs, j’aperçois d’autres poblanos, également inquiets. Contrairement à leurs habitudes, ils gesticulent peu et parlent à voix basse. Des événements extraordinaires semblent les préoccuper.
Les femmes sont au logis ; quelques pauvres revendeuses indiennes sont seules assises sur la plazza. Leurs marchandises sont placées devant elles sur une mince feuille de palmier. Une ombrelle, en feuilles de palmier, les défend, elles et leur marchandises, contre le soleil. Des vêtements de laine teinte et d’épais cheveux noirs, ornés de fils de couleur écarlate, leur donnent une apparence de bohémiennes. Aussi insoucieuses que les gypsies, elles rient et babillent toute la journée en demandant à chaque nouvel arrivant d’acheter leurs fruits, leurs légumes ou leur agua dulce. La nature les a douées de voix harmonieuses qui résonnent agréablement à l’oreille.
Çà et là, une jeune fille, portant une olla rouge sur la tête, vole d’un pas léger vers le puits.
En général, les Mexicaines sont aussi courageuses que gaies.
Mais quels sont ces étrangers qui font la terreur du village, dont ils sont les maîtres, à en juger par le ton hautain de leur conversation ?
Jamais hommes plus bizarres ne se réunirent dans un village mexicain. Ils sont quatre-vingts, et si chacun ne portait une carabine, un poignard et un revolver, vous ne découvririez point en eux la plus légère ressemblance. Leurs armes dénotent seules une sorte d’organisation et d’uniformité ; pour le reste, ils diffèrent autant que des vêtements de formes et de couleurs opposées peuvent faire différer des hommes.
Les uns portent des chapeaux de peaux de chat ou d’écureuil ; d’autres, des bonnets de feutre ou de castor.
Quelques-uns sont revêtus de chemises en peaux de daim ; plusieurs ont adopté le véritable costume indien, qui consiste en un vêtement de cuir ouvert à la gorge et serré au corps par une ceinture qui soutient le couteau et le pistolet. On voit aussi la veste des marins, la jaquette en cotonnade bleue du créole de la Louisiane ; la jaqueta en cuir brun de l’Hispano-Américain et l’habit écourté et écarlate du ranchero mexicain. Le serapé pourpre et la gracieuse manga, semblable à une toge, couvrent leurs épaules.
Jetez un coup d’œil sur les jambes de ces hommes. Elles sont aussi singulièrement attifées que la partie supérieure de leur corps. Les uns enveloppent leurs jambes dans une flanelle bleue, écarlate ou verte. D’autres portent des guêtres de peaux de bœuf ou de cheval non tannées ; ici, le pantalon disparaît à moitié dans d’immenses bottes ; ici, le brogans en peaux de veau brutes et des mocassins de coupe différente représentant les modes de chaussure de mainte tribu indienne. Plusieurs ont adopté les lourdes bottes des cavaliers mexicains, qui rappellent les jambières des anciens preux.
Leurs éperons ne sont pas moins curieux que leurs costumes. Les légers éperons d’argent et d’acier, aux fines molettes, contrastent avec le lourd éperon mexicain, pesant plusieurs livres et muni de molettes de cinq doigts de diamètre et de dents qui perceraient les côtes d’un cheval.
Mais ces éperons, ces bottes, ces calzoneros, ces mangas et ces serapés ne sont points portés par des Mexicains ; leurs propriétaires appartiennent à d’autres races. Ces hommes robustes ont vu le jour dans le Kentucky, le Tennessee ou dans les fertiles plaines de l’Ohio, de l’Indiana et de l’Illinois. Parmi eux figurent les squetters et les chasseurs des forêts, les fermiers des grands monts Alleghanys, les bateliers du Mississipi, les pionniers de l’Arkansas et du Missouri, les trappeurs 1 des prairies et les voyageurs des lacs, les jeunes planteurs du Sud, les créoles français de la Louisiane et les colons aventureux du Texas. Le vieux monde a fourni son contingent à cette troupe cosmopolite. Je reconnais le blond enfant de la Germanie, l’Anglais robuste, l’Écossais fier, l’Italien tapageur, le Français léger, le Suisse ferme et le Polonais sombre et silencieux. Quels sujets d’étude pour un ethnologiste ! Mais quels sont ces hommes ?
Trois fois déjà vous avez posé la question. J’y réponds : Ces hommes forment un corps de « tirailleurs », la guerilla de l’armée américaine.
Et moi, que suis-je ? Je suis leur capitaine, leur chef.
Oui, je suis le commandant de cette troupe, et j’ose affirmer que l’on ne trouverait nulle part, malgré leur aspect étrange, des hommes plus forts et plus audacieux. Cette guérilla se compose d’aventuriers qui ont passé la moitié de leur existence à guerroyer contre les Indiens ou les Mexicains ; de gentlemen ruinés, d’individus qui n’ont pu s’accoutumer à la vie civilisée, et de proscrits, — éléments détestables pour coloniser, mais excellents pour conquérir.
Je déclare avec orgueil qu’une sorte de sentiment d’honneur guide ces hommes. Il est vrai que de longues barbes des cheveux en désordre, des faces couvertes de poussière, des chapeaux rabattus, des vêtements étranges et un véritable arsenal de poignards, de revolvers, de carnassières et de gibecières, leur donnent un aspect sauvage, terrible même. Mais on aurait tort de les juger sur leur physionomie. Çà est là bat un noble cœur sous une enveloppe grossière.
Le patriotisme meut les uns ; l’amour d’une indépendance complète guide les autres, et quelques-uns, enfin, n’agissent que par esprit de vengeance. Ces derniers sont surtout des Texiens qui pleurent un ami ou un frère traîtreusement mis à mort par les Mexicains. Ils n’ont pas encore oublié le cruel assassinat de Goliad, ni la sanglante boucherie d’Alamo.
Quant à moi, le hasard, l’amour des émotions et des aventures, peut-être même un faible attrait pour la puissance et la célébrité, m’engagent à prendre part à cette expédition. Pauvre aventurier, sans amis, sans toit, sans patrie, car ma terre natale n’est plus une nation libre, le patriotisme ne me stimule pas.
Je n’ai ni injustice à combattre, ni cause publique, ni patrie à défendre.
Ces tristes réflexions me viennent aux heures d’inaction et m’affligent.....
Les hommes ont attaché leurs chevaux dans l’enclos de l’église, aux arbres ou aux barreaux des fenêtres. Ces chevaux forment, comme leurs maîtres, un assemblage d’êtres variés, de tailles, de couleurs et de races différentes : on y voit le coursier fringant du Kentucky et du Tennessee, le cheval tranquille de la Louisiane et le mustang à demi-sauvage, récemment capturé dans les savanes. On remarque également deux espèces de mules : la grande mule des États-Unis et celle du Mexique.
Mon cheval noir se trouve au centre de la place.
J’admire ses belles proportions. Il redresse fièrement la tête et frappe avec impatience le sol. Il sait que mes yeux sont attachés sur lui !
Nous nous trouvons à peine depuis une demi-heure dans la rancheria, à laquelle nous sommes étrangers. Notre troupe est la première qui y soit arrivée, quoique la guerre sévisse depuis plusieurs mois au bas de la rivière.
Nous formons un parti d’éclaireurs. Notre mission principale consiste à protéger les mexicains inoffensifs contre un troisième ennemi commun, les sauvages Comanches. On rapporte que ces Indiens ismaélites ravagent la partie supérieure du fleuve dont ils se sont emparés et viennent de piller une grande ferme. On ajoute qu’ils ont, suivant leur coutume, massacré les hommes, emporté les femmes, les enfants et les meubles. Bref, nous nous trouvons ici pour conquérir les Mexicains, mais nous devons les protéger en les conquérant. Cosas de Mexico !
Ces Indiens ismaélites ravagent la partie supérieure du fleuve. (P.16.)
IV
La poursuite.
Je songeais au singulier caractère de cette triple guerre lorsque ma rêverie fut troublée par le bruit du sabot d’un cheval qui accourait au galop. Je me penchai au-dessus de l’azotea, dans l’espoir d’apercevoir le cavalier. Je ne fus pas désappointé. Ce cavalier, qui paraissait très jeune, était imberbe et avait des traits gracieux, le teint brun, les yeux vifs et des joues vermeilles. Ses épaules étaient recouvertes d’une manga écarlate qui retombait sur les hanches du cheval ; son chapeau était un léger sombrero. Quant au cheval, c’était un petit mustang, bien proportionné, et tacheté comme un jaguar, un véritable coursier andalous.
Le cavalier avançait hardiment au galop. Il regarda par hasard l’azotea sur laquelle je me trouvais. L’éclat de mon uniforme fixa son attention, et il s’arrêta tout à coup.
En ce moment, le tirailleur posé en vedette dans cette partie du village lui commanda de faire halte. Au lieu d’obéir, le cavalier reprit sa course, mais dans une direction nouvelle.
Une balle allait probablement mettre un terme à son existence ou à celle de sa monture, lorsque j’ordonnai à la sentinelle de ne pas faire feu.
J’avais réfléchi : le gibier était trop noble et trop beau pour être mutilé ; mieux valait le capturer en bon état. Je me décidai à l’essayer.
Mon cheval, sellé et bridé, se trouvait près du puits. Au lieu de perdre un temps précieux à descendre l’escalier, je sautai sur le parapet et de là dans la plazza. Le groom, devinant mon intention, se dirigea à ma rencontre avec le cheval.
Saisissant les rênes, je sautai rapidement en selle. Quelques tirailleurs suivirent mon exemple, ce dont je me souciais peu, car je n’ignorais pas que la vitesse importait plus en ce moment que la force. Mon cheval était le plus agile de toute ma troupe, et les bonds du mustang m’avait donné la conviction que seul je pouvais lutter avec lui.
Je me trouvai bientôt dans les champs à la poursuite du cavalier écarlate. Il avait évidemment l’intention de contourner le village et de continuer la course que notre présence avait interrompue.
La chasse menait à travers un champ de milpas. Mon cheval enfonçait profondément dans la terre molle, tandis que le mustang, plus léger, bondissait sur le sol comme un lièvre. Il me devançait, et je commençais à craindre qu’il ne m’échappât, lorsque je vis que la route était interceptée par une haie de magueys s’étendant transversalement à droite et à gauche. D’une végétation luxuriante et haute de huit à dix pieds, ces plantes aux puissantes feuilles s’entre-croisaient et formaient des chevaux de frise naturels.
Au premier coup d’œil, cette barrière semblait infranchissable. Elle força, en effet, le Mexicain à s’arrêter. Il s’apprêtait à la longer, quand il s’aperçut que je prenais une ligne diagonale et devais infailliblement l’atteindre. Alors il lança son cheval dans les magueys, et l’un et l’autre furent en un instant hors de vue ; mais en m’approchant j’entendis les feuilles épaisses craquer sous le sabot du mustang ; il fallait l’imiter ou abandonner la poursuite. Je n’hésitai pas.
Mon honneur et la réputation de mon cheval n’étaient-ils pas en jeu ? Têtes baissées, nous nous précipitâmes dans les magueys.
Nous arrivâmes déchirés et ensanglantés de l’autre côté. A ma vive satisfaction, je m’aperçus que j’avais fait un meilleur emploi du temps que le cavalier écarlate ; sa halte avait diminué la distance entre nous. Mais il fallut traverser un nouveau champ de milpas et il regagna le terrain perdu.
Parvenu à l’extrémité du champ, j’aperçus quelque chose de brillant devant moi — c’était de l’eau — un large fossé ou zequia pour irriguer les champs. Comme les magueys, il s’étendait transversalement à notre course.
— Cet obstacle l’arrêtera, pensai-je ; il doit prendre à droite ou à gauche, et puis...
Mes réflexions furent interrompues.
Au lieu de tournera droite ou à gauche, le Mexicain dirigea son cheval vers la zequia, et le noble animal la franchit d’un bond.
Je n’avais pas le temps d’admirer cet exploit, je me préparai à l’imiter. Mon brave coursier n’avait besoin ni de la cravache ni de l’éperon ; il savait ce que l’on attendait de lui.
D’un bond il se trouva de l’autre côté et reprit la course avec une nouvelle ardeur.
Une vaste plaine verdoyante, une savane, s’étendait devant nous.
Les sabots des deux chevaux résonnaient maintenant sur un sol ferme. La poursuite devenait donc une simple question de vitesse qui aurait été tranchée en ma faveur, si un nouvel obstacle ne s’était présenté. Un troupeau de bétail et de chevaux couvrait la prairie ; ces animaux, effrayés par notre galop sauvage, prirent la fuite dans toutes les directions. Beaucoup vinrent de notre côté. Maintes fois je dus arrêter mon cheval pour éviter les longues cornes d’un taureau ou d’un bœuf furieux. Maintes fois aussi je dus me détourner de mon chemin.
Dans cette course irrégulière, je vis avec chagrin que le mustang, par habitude peut-être, avait l’avantage sur moi et qu’il gagnait sans cesse du terrain. Quand nous échappâmes enfin au troupeau, nous approchions de l’extrémité de la plaine. Devant moi était le chapparal, derrière lequel apparaissaient de grands arbres et une colline dont le sommet était couronné de murailles blanches. Ces murailles étaient celles de l’hacienda déjà mentionnée et vers laquelle nous nous dirigions en droite ligne.
Je devenais inquiet sur le résultat de la lutte. Je ne pouvais me dissimuler que le cavalier était sauvé s’il atteignait le bois. Je n’osais pas le laisser échapper. Que diraient mes hommes si je ne le ramenais pas ? J’avais empêché la sentinelle de tirer, et facilité ainsi la fuite de quelque espion peut-être, sinon d’un personnage important. Les efforts désespérés que celui-ci tentait appuyaient encore la supposition qu’il était l’un ou l’autre. Il devait donc être pris.
Puisant une nouvelle énergie dans ces réflexions, je pressai les flancs de mon cheval avec ardeur. Ma monture parut, comprendre mes pensées. Je ne tardai pas à me trouver à portée de fusil du cavalier poursuivi. Je tirai alors mon revolver de la ceinture,
— Alto ! o yo tiro ! Halte ! ou je tire ! criai-je à haute voix.
Pas de réponse : le mustang continuait à courir.
Halte ! criai-je de nouveau, ne voulant pas tuer un être humain, halte ! ou vous êtes un homme mort !
Toujours pas de réponse.
Six yards à peine me séparaient du cavalier mexicain. Courant en droite ligne derrière lui, je pouvais lui envoyer une balle dans le dos. Quelque instinct secret me retint. Je ne sais quel pressentiment arrêta mon bras. Mon doigt reposait sur la détente, et je ne pouvais me résoudre à la mouvoir.
Cependant je résolus d’abattre le cheval plutôt que de lui permettre d’entrer dans le bois, où il m’aurait échappé. En ce moment il prit une nouvelle direction et me présenta le flanc. Je saisis ce moment pour lui envoyer d’une main sûre une balle mortelle dans le ventre. Cheval et cavalier roulèrent aussitôt sur le sol.
Ce dernier se dégagea rapidement et se releva.
Craignant qu’il ne tentât encore de s’échapper dans le bois, je me précipitai vers lui, le revolver à la main. Mais il n’essaya ni de fuir ni de résister. Il croisa les bras, contempla froidement l’arme que je dirigeais sur son visage, et me dit avec sang-froid :
— No mata me, amigo ! Soy muge ! Ne me tuez pas, ami ! je suis une femme !
V
Ma captive.
« Ne me luez pas, ami ! je suis une femme ! » Cette déclaration m’étonna peu ; j’y étais à demi préparé. Pendant notre galop, j’avais noté une ou deux particularités qui m’avaient amené à croire que le prétendu espion que je poursuivais était une femme. Lors du saut du fossé, le mantelet du cavalier s’étant soulevé, j’avais entrevu un corsage de velours, une sorte de tunique, et j’avais aperçu un éperon d’or et le talon d’une petite botte rouge. Ses efforts violents avaient délié ses cheveux, qui retombaient en deux longues tresses sur la croupe du cheval. Sa déclaration mit un terme à mes conjectures, mais, comme je l’ai dit, m’étonna peu.
Je fus surpris cependant de son accent et de ses manières. Elle prononça ces mots avec autant de sang-froid que si toute cette scène n’avait été qu’une plaisanterie.
Un ton de tristesse et non de prière prévalait dans ses paroles lorsqu’elle s’agenouilla, qu’elle passa ses lèvres sur le museau du mustang et qu’elle s’écria :
— Pobre yegua ! muerte ! Hélas ! pauvre jument ! morte !
— Une femme ! dis-je en feignant la surprise. Ma question demeura sans réponse ; elle ne leva pas même les yeux.
— Pobre yegua ! pobre Lola ! répéta-t-elle, comme si le mustang eût été le seul objet de ses pensées et que moi, l’assassin armé, je me fusse trouvé à cinquante milles de là.
— Une femme ! repris-je dans mon embarras, ne sachant que dire.
— Oui, Monsieur. Que désirez-vous ?
En faisant cette réponse, elle se leva et me regarda sans le moindre indice de peur. Si inattendue était la réponse, que je ne pus m’empêcher de rire.
— Vous êtes gai, Monsieur. Vous m’avez affligée ; vous avez tué ma favorite !
Je n’oublierai jamais le regard qui accompagna ces mots. Il exprimait à la fois l’affliction, la colère, le mépris et le défi. Mon rire fut aussitôt réprimé. Cette fière contenance m’humiliait.
— Senorita, répartis-je, je regrette profondément la pénible nécessité où je me suis trouvé... Il aurait pu arriver pis.....
— Et comment cela, je vous prie ? interrompit-elle.
— Mon revolver aurait pu être dirigé sur vous-même, si un soupçon...
— Ah ! s’écria-t-elle en m’interrompant de nouveau, il ne pouvait arriver rien de plus fâcheux ! J’aimais cette créature tendrement, comme j’aime la vie, comme je chéris mon père ! Pobre yegua !
Et en s’exprimant ainsi, elle s’agenouilla, passa ses bras autour du mustang et baisa le museau velouté du pauvre animal. Puis elle lui ferma doucement les paupières, se releva, croisa les bras, et contempla d’un air triste et sombre le corps inanimé. Je ne savais que faire. Je me trouvais dans une position embarrassante. J’aurais volontiers rendu la vie à la jument au prix de mes gages d’un mois ; mais la chose étant impossible, je songeai à donner une indemnité à sa propriétaire. Offrir de l’argent eût été indélicat. Que faire alors ?
Je conçus une pensée qui promettait de me tirer d’embarras. L’ardeur des riches Mexicains à obtenir nos grands chevaux américains — les frisones, comme ils les appellent — était bien connue dans l’armée. Les riches propriétaires qui aimaient à parader sur le paseo en donnaient souvent des prix fabuleux. Nous avions plus d’un excellent cheval demi-sang dans la troupe.
Un troupeau de bétail et de chevaux couvrait la prairie. (P. 21.)
— Je lui offrirai un de ceux-là, pensai-je.
Je fis l’offre aussi délicatement que je pus. Elle fut rejetée avec mépris.
— Quoi ! senor, répliqua-t-elle en frappant le sol de son talon résonnant, quoi ! un cheval à moi ? Regardez ! continua-t-elle en montrant la plaine ; regardez là-bas, Monsieur. Il y a là mille chevaux : ce sont les miens. Pesez maintenant la valeur de votre offre. Ai-je besoin d’un cheval ?
— Mais, senorita, balbutiai-je, ce sont des chevaux de race indigène, tandis que celui que je vous offre.....
— Ah ! poursuivit-elle en désignant la jument, je n’aurais pas échangé ce cheval indigène pour tous les frisones de votre troupe. Aucun n’était son égal !
A une injure personnelle, je n’aurais pas répondu, mais ce dédain pour ma monture produisit son effet. Elle avait touché la corde sensible de ma vanité, je puis dire de mon affection. Piqué, je répliquai :
— Pas un seul, Mademoiselle ?
Je regardais Moro (ma monture) en parlant. Ses yeux suivirent les miens, et elle le contempla pendant quelques instants en silence. J’observai l’expression de sa physionomie, sur laquelle se peignit bientôt une vive admiration. Mon noble coursier paraissait superbe dans ce moment ; l’écume qui couvrait son cou et ses épaules contrastait avec le noir étincelant de sa robe ; ses flancs se soulevaient et retombaient en ondulations régulières ; la vapeur s’échappait de ses naseaux, son œil était en feu et son cou fièrement voûté comme s’il avait eu conscience de son récent triomphe et de l’intérêt qu’il excitait.
Longtemps elle l’examina, et quoiqu’elle ne prononçât pas un mot, je vis qu’elle découvrait ses qualités.
— Vous avez raison, cavalier, dit-elle d’un air pensif ; il fait exception et il était digne de lutter avec ma pauvre jument.
Différentes pensées entrèrent alors dans mon esprit et me remplirent d’inquiétude ; je regrettais d’avoir attiré si minutieusement son attention sur le cheval. Je craignais qu’elle me le demandât.
Je n’aurais pas échangé Moro contre son troupeau de mille chevaux ; mais que penserait-elle de l’offre que je lui avais faite si je ne consentais à lui donner le cheval qu’elle me demanderait ? Du reste, malgré mon attachement à ma monture je l’aurais accordée à ma captive.
Ma position était délicate. Heureusement, un incident porta nos pensées dans un autre sens : en ce moment parurent les troupiers qui avaient quitté le village avec moi, mais que j’avais promptement distancés.
Elle sembla inquiète de leur présence, chose peu étonnante à considérer leurs vêtements étranges et leurs visages farouches. Je leur ordonnai de retourner à la rancheria. Ils regardèrent un instant le mustang et sa riche housse ensanglantée, son ancien cavalier et son gracieux costume ; puis ils murmurèrent quelques mots à voix basse et se retirèrent. Je me trouvais seul de nouveau avec ma captive.
VI
Isolina de Vargas.
Aussitôt que les hommes furent hors de portée de voix, elle me demanda si c’était des Texiens,
— Oui, lui répondis-je, quelques-uns sont Texiens.
— Vous êtes leur chef ?
— Je le suis.
— Capitaine ? je présume.
— Telle est ma qualité.
— Et maintenant, capitaine, suis-je votre captive ?
La question me prit à l’improviste, et je ne sus d’abord que répondre.
L’ardeur de la poursuite, cette rencontre et ses suites curieuses, m’avaient lait oublier le but de mon expédition. La question me rappela que j’avais un devoir délicat à remplir. Il fallait savoir si cette femme était ou non un espion.
Cette supposition n’était pas invraisemblable, comme de vieux militaires pourraient l’attester. Maintes dames ont déjà servi leur patrie de cette manière. Elle portait peut-être quelque dépêche importante à l’ennemi. Dans ce cas, sa mise en liberté pouvait avoir des conséquences sérieuses et fâcheuses même pour moi.
D’autre part, je n’aimais pas à l’emmener prisonnière, je craignais d’encourir son mécontentement. Je ne savais que répondre. Voyant que j’hésitais, elle posa de nouveau la question :
— Suis-je votre captive ?
Je luttais entre le devoir et une excessive courtoisie ; un compromis s’offrit :
— Madame, dis-je en m’approchant d’elle, si vous me donnez votre parole que vous n’êtes pas un espion, vous êtes libre. Votre parole, je ne demande rien de plus.
Je dictai ces conditions d’un ton de prière plutôt que de commandement. J’affectai une fermeté que ma contenance démentait sans doute. Un rire presque insolent s’empara de ma prisonnière ; elle répliqua :
— Moi ! un espion.,. un espion ! Ah ! ah ! ah ! capitaine, plaisantez-vous ?
— J’espère, senorita, que vous serez de bonne foi. Vous ne portez donc pas de dépêche secrète à l’ennemi ?
— Rien de pareil, capitaine. (Et elle continua de rire.)
— Dans ce cas, pourquoi avez-vous tenté de fuir ?
— Ah ! cavalier, n’êtes-vous pas Texien ? Ne soyez pas offensé de ce que j’ose vous dire, que vos concitoyens n’ont rien moins qu’une bonne réputation au Mexique.
— Mais votre tentative de fuite était imprudente et téméraire ; elle aurait pu vous coûter la vie.
— Oh ! je le vois. (Et elle jeta un regard significatif sur la jument morte). Tous mes regrets sont inutiles maintenant. Je ne pensais pas que votre troupe possédât un cavalier qui pût atteindre à la course ma jument. Merced ! il y en avait un seul. Vous m’avez vaincue. Vous seul le pouviez.
En prononçant ces derniers mots, elle m’examina de la tête aux pieds. Je suivis son regard et cru voir disparaître son mépris.
Alors elle baissa la tête et contempla le sol comme si d’autres pensées la préoccupaient.
Pendant quelques instants nous fûmes silencieux. Nous serions peut-être restés longtemps ainsi, si je n’avais songé que j’agissais grossièrement envers la dame qni était encore ma captive. Je ne lui avais pas accordé la liberté. Je m’empressai de le faire.
— Espion ou non, senorita, je ne vous retiendrai pas. Je supporterai les risques de ma conduite ; vous êtes libre.
— Gracias, cavalier ! Et maintenant que vous avez agi si généreusement, je veux mettre votre esprit en repos au sujet des risques. Lisez !
Et elle me tendit un papier plié. Du premier coup d’œil je reconnus une sauvegarde du commandant en chef, enjoignant à tous de respecter dona Isolina de vargas.
— Vous voyez, capitaine, que je n’étais pas votre captive, après tout ? Ah ! ah ! ah !
— Madame, vous êtes trop généreuse pour ne pas pardonner les violences auxquelles vous avez été soumise.
— Par ma propre volonté, capitaine.
— A la pensée du danger que vous avez couru, je tremble encore. Pourquoi avez-vous commis une pareille imprudence ? Votre fuite soudaine à la vue de notre sentinelle avait causé des soupçons, et notre devoir nous commandait de vous poursuivre et de vous capturer. Munie de la sauvegarde, vous n’aviez aucune raison de nous craindre.
— Ah ! c’est cette sauvegarde même qui m’a engagée à fuir.
— La sauvegarde, senorita ? Daignez vous expliquer.
— Puis-je compter sur votre discrétion, capitaine ?
— Certes ! je vous le promets.
— Apprenez alors que je n’étais pas sûre que vous fussiez Américain ; certain indice me disait que vous étiez un de mes compatriotes. Que serait-il advenu si ce papier et d’autres que je porte sur moi étaient tombés entre les mains de Canalès, un des chefs les plus barbares de l’armée mexicaine ? Je vous avouerai, capitaine, que nous craignons plus nos amis que nos ennemis.
Dès lors je compris le motif de sa fuite.
— Et puis, vous parlez trop bien l’espagnol, capitaine. Si vous aviez crié : Halte ! dans votre langue maternelle, j’aurais obéi et peut-être sauvé ma favorite. Ah ! pobre Lola !
En poussant cette dernière exclamation, elle redevint triste, et, tombant a genoux, elle passa ses bras autour du cou du mustang raide et froid. Son visage était enseveli dans la longue et épaisse crinière de l’animal, et je la vis verser des larmes brillantes comme des gouttes de rosée.
— Pauvre Lolita ! poursuivit-elle. Je m’afflige avec raison. Que de motifs j’avais pour t’aimer ! Plus d’une fois tu m’as sauvée des mains du Lipan féroce et du Comanche brutal. Que ferai-je à l’avenir ! Je tremblerai au moindre geste des Indiens ; je n’oserai plus m’aventurer sur la prairie, je devrai rester timidement sous le toit paternel. Ma jument chérie ! tu étais mes ailes ; elles sont coupées : je ne volerai plus.
Toutes ces paroles furent dites d’un ton d’affliction extrême, et moi, — moi qui aimais tendrement mon brave coursier, — je pouvais apprécier ces sentiments. Dans l’espoir de lui donner une légère consolation, je renouvelai mon offre.
— Senorita, dis-je, il y a dans ma troupe des chevaux agiles et de race généreuse.
— Je n’attache pas de prix à vos chevaux.
— Vous ne les avez pas tous vus.
— Je les ai vus aujourd’hui, à votre sortie de la rancheria. Vous vous comportiez très bien à la tête de vos hommes. Revenons.
— Senorita, je ne vous ai pas aperçue.
— Vraiment ! Pas un balcon ou une reja n’a échappé cependant à vos regards. Mais à votre offre, je me rétracte. Dans votre troupe, il y a un cheval auquel j’attache du prix.
Je tremblai.
— Le voilà ! continua-t-elle en désignant Moro, ma chère monture.
Il me sembla, à ces mots, que la terre m’engloutissait. La stupéfaction m’empêcha un certain temps de répondre.
Elle remarqua mon hésitation, mais attendit ma réponse.
— Senorita, balbutiai-je enfin, ce cheval est mon favori, un vieil et sincère ami. Si vous désirez cependant le posséder. il est à votre disposition. Je suis heureux de vous l’offrir.
En appuyant sur le si, j’en appelais à sa générosité. Ce fut en vain.
— Je vous en remercie, répondit-elle froidement. Je le soignerai. Il me sera très utile.
Affligé, je gardai le silence.
— Permettez-moi de l’éprouver, continua-t-elle. Donnez-moi ce lazo.
Je le détachai machinalement et l’ajustai de même à ma selle.
— Maintenant, capitaine, s’écria-t-elle en réunissant les rênes dans sa petite main gantée, je vais mettre le cheval à l’épreuve.
Elle sauta en selle en effleurant à peine l’étrier.
Elle avait ôté son manteau. Une ceinture écarlate dont les franges d’or traînaient sur le sable entourait sa taille. Ses yeux exprimaient le calme et le courage, je songeais aux amazones de l’antiquité.
Un taureau d’un aspect féroce, mû sans doute par la curiosité, s’était séparé du troupeau et approchait de l’endroit où nous nous trouvions. Aussitôt l’intrépide amazone galopa vers lui. Effrayé de cette attaque subite, l’animal voulut fuir, mais il ne put échapper au lazo. Le nœud tournoya, retomba et s’enroula autour de ses cornes. Le cavalier prit aussitôt une direction opposée. Le taureau violemment jeté par terre fut étourdi du coup. Sans lui laisser le temps de se reconnaître, l’amazone courut vers lui, et sans descendre de cheval, défit le nœud, reprit le lazo et revint au galop.
— Superbe ! magnifique ! s’écria-t-elle en descendant de selle et en regardant le coursier. Très beau ! Ah ! Lola, pauvre Lola ! je crains que je ne t’oublie bientôt.
Ces derniers mots furent adressés au mustang.
Se tournant ensuite vers moi, elle ajouta :
— Et ce cheval est à moi ?
— Oui, senorita, répliquai-je tristement, comme si j’allais perdre mon meilleur ami.
— Mais je ne le veux pas, reprit-elle d’un air déterminé.
Puis elle ajouta en riant :
— Ah ! capitaine, je connais vos sentiments. Croyez-vous que je ne puisse apprécier le sacrifice que vous voulez faire ? Conservez votre favori. Il suffit que l’un de nous souffre. Gardez votre noble cheval. Vous savez le manier. S’il m’appartenait, aucun mortel, je vous l’assure, ne pourrait m’en séparer. Mais je dois vous quitter. Adieu.
— Ne puis-je vous accompagner ?
— Merci ! senor cavalier. Voilà la maison de mon père. J’habite l’hacienda de cette colline. Nous devons nous séparer. Rappelez-vous que vous êtes un ennemi. Je ne dois pas accepter votre offre aimable et ne puis vous donner l’hospitalité. Ah ! vous ne nous connaissez pas. Vous ne connaissez pas le tyran Santa Anna. En ce moment, ses espions sont peut-être.... (Elle regarda avec crainte autour d’elle en parlant.) O ciel ! s’écria-t-elle avec un tressaillement à l’aspect d’un homme qui descendait de la colline, c’est Ijurra !
LE CAPITAINE WARFIELD
— Ijurra ?
— Oui, mon cousin ! mais....
Elle hésita, et, changeant tout d’un coup de ton, elle me dit d’une voix suppliante :
— Laissez-moi, por amor Dios ! laissez-moi. Adieu ! adieu !
Vaincu par l’expression de sa prière, je dis simplement : Adieu ! sautai en selle et m’éloignai.
Quand je parvins à la lisière du bois, la curiosité me fit regarder derrière moi.
J’aperçus un homme de haute taille, à la figure basanée. Il était revêtu du costume habituel des riches Mexicains, c’est-à-dire d’une veste de drap sombre, d’un pantalon bleu, d’une ceinture écarlate et d’un chapeau à longs bords. Ijurra paraissait avoir trente ans. Il portait une barbe et des Moustaches. C’était en somme un bel homme. Cependant son âge, sa physionomie et son costume n’attirèrent guère mon attention en ce moment. Je ne surveillai que ses actions. Dona Vargas semblait le redouter beaucoup. Il tenait un papier à la main, et je vis qu’il le désignait en parlant. Sa figure avait une expression féroce, et, même à cette distance, je pus juger au son de sa voix qu’il était irrité.
Pourquoi le craignait-elle ? pourquoi se soumettait-elle à un pareil traitement ? Cet homme devait avoir un étrange Pouvoir sur cet esprit fier pour le forcer à écouter timidement ses reproches.
Telles étaient mes réflexions. Mon premier mouvement fut de retourner auprès de dona Vargas. Si cette scène s’était Prolongée, j’eusse agi ainsi ; mais je vis la jeune Mexicaine se lever tout à coup et se diriger rapidement vers l’hacienda.
Je repris alors ma marche ; je pénétrai sous les ombrages de la forêt et suivis le sentier qui menait à la rancheria. Préoccupé de mes aventures, j’avançais en abandonnant mon cheval à lui-même.
Le cri d’une de mes propres sentinelles m’avertit que je me trouvais à l’entrée du village.
VII
Les fourrageurs par ordre.
Mon aventure ne finit pas avec le jour ; elle continua pendant la nuit et se répéta dans mes rêves. Je recommençais la poursuite, je bondissais à travers les magueys, je franchissais la zequia, je galopais dans le troupeau effrayé ; j’apercevais la jument étendue sans vie sur la plaine et sa maîtresse agenouillée en larmes. Par intervalles, apparaissait une sombre vision comme un nuage dans le ciel : c’était la face d’Ijurra.
J’attribuai mon réveil à cette vision, mais le son d’une trompette retentissait à mes oreilles quand je sautai de mon lit.
Pendant quelques instants je fus sous l’impression que cette aventure n’était qu’un rêve ; un objet pendu à la muraille me rappela à la réalité : c’était ma selle, à laquelle était attaché un lazo de crins blancs. Je me souvins du lazo de la veille.
Quand je fus bien éveillé, je repassai mon aventure en revue ; j’essayai d’y penser avec calme et de retourner sérieusement à mes occupations.
Les lois martiales auxquelles le district était soumis m’autorisaient, il est vrai, à pénétrer partout ; mais l’honneur me défendait de violer le domicile des citoyens inoffensifs. Des riches Mexicains nous savaient gré de cette modération, et beaucoup nous auraient témoigné de la sympathie s’ils n’avaient craint la colère et la vengeance de leurs propres compatriotes....
Le cigare ayant une heureuse influence sur mon imagination, j’en allumai un et montai sur l’azotea.
A peine avais-je fait deux tours sur la terrasse qu’un dragon arriva au galop sur la plazza. C’était une ordonnance du quartier général de l’armée, chargée de remettre un message au commandant du poste.
On me désigna. Le dragon accourut à la maison de l’alcade et me remit un papier plié.
Ouvrant la dépêche, je lus :
Quartier général de l’armée d’occupation,... juillet 1846.
« Monsieur, vous prendrez un nombre suffisant de vos hommes et vous vous rendrez à l’hacienda de don Ramon de Vargas, dans le voisinage de votre station. Vous y trouverez cinq mille bœufs que vous amènerez au camp de l’armée américaine et livrerez au commissaire général. Vous trouverez les vachers nécessaires, et une portion de votre troupe formera l’escorte. La note ci-incluse vous servira à comprendre la nature de votre devoir.
» Au capitaine Warfield.
» A. A., adjudant général... »
Fort de l’excuse du « devoir à remplir », je pouvais me rendre hardiment à l’hacienda et y entrer avec l’air confiant d’un hôte bienvenu. Bienvenu, en vérité ! un contrat pour l’achat de cinq mille bœufs à des prix de guerre ! C’était une affaire lucrative pour le vieux don. Il était probable que je le verrais, je l’embrasserais, nous boirions un verre de vin ensemble, je me créerais des relations intimes avec lui et il m’inviterait sans doute à revenir. La réunion du bétail exigerait quelque temps, une heure ou deux au moins. Je pouvais confier la direction de ce travail à mon lieutenant ou à un sergent. Pour moi, je resterais à l’hacienda. Ah ! Ijurra, je l’avais oublié. Serait-il là ?
Le souvenir de cet homme vint troubler mes pensées.
Une dépêche du quartier général demande une prompte attention, et la nécessité d’exécuter l’ordre coupa court à mes réflexions. Sans perdre de temps, j’ordonnai à cinquante hommes de se tenir prêts à monter en selle.
Je me préparais à porter plus de soin que d’habitude à ma toilette, lorsque je réfléchis que je ferais aussi bien de lire d’abord la note mentionnée dans la dépêche. J’ouvris le papier : à ma grande surprise, le document était rédigé en espagnol. Ceci ne m’embarrassa pas et je lus :
« Les cinq mille bœufs sont à votre disposition, suivant le contrat ; mais je ne puis prendre sur moi de les remettre. Ils doivent m’être enlevés avec un semblant de force, et même un peu de rudesse, de la part de ceux que vous enverrez, ne serait pas déplacée. Mes vaqueros sont à votre service, mais je ne dois pas les commander. Vous pouvez les presser.
» RAMON DE VARGAS. »
Cette note était adressée au commissaire général de l’armée américaine. Son contenu, assez obscur pour les non initiés, était aussi clair pour moi que la lumière du jour, et quoique ce document me donnât une haute opinion du talent diplomatique de don Ramon de Vargas, il ne me plut guère.
Il annulait toutes les parties du programme que je m’étais tracé. Au lieu de serrer amicalement la main du don, je devais entrer brutalement dans l’hacienda, menacer le portier tremblant, frapper les péons et enlever cinq mille bœufs.
— Je ferai belle figure, me disais-je, en présence d’Isolina !
Un instant de réflexion cependant me persuada que cette intelligente, personne devait être dans le secret.
— Oui, pensais-je, elle comprendra les raisons de ma conduite ; j’agirai avec toute la douceur que les circonstances comporteront. Je laisserai à mon lieutenant texien tout l’odieux du feint attentat, en lui recommandant sous main beaucoup de prudence. A cheval !
Le cor donna le signal du départ. Aussitôt cinquante tirailleurs, Holingsworth, Wheatley et moi sautâmes en selle, et nous défilâmes sur la place deux à deux.
Un trot de vingt minutes nous amena devant la porte principale de l’hacienda, où nous fîmes halte. Portes et fenêtres étaient hermétiquement closes. On n’apercevait personne. J’avais donné le mot de l’énigme à mon lieutenant texien, et il savait assez d’espagnol pour se tirer d’affaire.
— Ambre la puerta ! (Ouvrez la porte !) cria-t-il.
Pas de réponse.
— La puerta ! la puerta ! répéta-t-il à voix plus haute.
Pas de réponse encore.
— Ambre la puerta ! vociféra-t-il de nouveau en frappant l’huis de son arme.
Quand il eut fini, on entendit de l’intérieur un timide : Quien es ? (Qui est là ?)
— Yo (moi), hurla Wheatley. Ambre ! ambre ! (Ouvrez ! ouvrez !)
— Si, senor, répondit une voix tremblante.
— Anda ! anda ! somos hombres de bien ! (Vite, alors ! nous sommes d’honnêtes gens !)
On entendit un bruit de chaînes et de verrous. Au bout de deux minutes, la porte s’ouvrit et nous aperçûmes le noir portero (le portier), la saguan pavée de briques (le corridor), et une partie du patio ou cour intérieure. Dès que la porte fut ouverte, Wheatley bondit sur le portier tremblant, le saisit par la jaquette, lui donna des coups de poings sur les oreilles et lui commanda ensuite d’une voix tonnante d’appeler le dueno (maître du logis).
La conduite inattendue du lieutenant mit les tirailleurs en belle humeur. On ne leur avait jamais accordé beaucoup de licence dans leurs relations avec les habitants inoffensifs, et les officiers avaient toujours donné l’exemple de cette modération. Ils se plaignaient amèrement de la sévérité des règlements militaires à ce sujet. On comprend que la conduite de Wheatley — qu’ils se proposaient d’imiter sans retard — leur causa une grande joie.
— Senor, balbutia le portier, le du... du... dueno a déclaré qu’il ne recevait personne.
— Ah ! il ne veut pas recevoir ? Allez lui dire que nous l’attendons.
— Oui, mon ami, dis-je amicalement au portier, craignant qu’il ne fût bientôt trop effrayé pour s’acquitter de sa commission, va dire à ton maître qu’un officier américain a besoin de lui pour traiter une affaire.
Sans attendre la réponse, je pénétrai avec Wheatley dans le patio. Holingsworth et les tirailleurs sortirent de l’hacienda avec mission de nous attendre à l’extérieur.
VIII
Don Ramon de Vargas.
Dans la cour, une scène pour ainsi dire nouvelle s’offrit nos yeux. Ici on ne voyait plus de ces portes massives et de ces fenêtres sombres, mais bien des façades peintes à fresque, des verandahs garnies de rideaux et des fenêtres vitrées et posées à fleur de sol. Le patio de la maison de don Ramon était pavé en briques. Au centre coulait une fontaine limpide qui rafraîchissait l’air embaumé par le parfum des orangers et d’autres plantes tropicales. Sur trois côtés de la cour s’étendait une verandah, ou portique en treillage à l’italienne à quelques pouces au-dessus du niveau du pavé. Des colonnes supportaient le toit de la verandah. Le corridor grillé était garni de rideaux soigneusement fermés, ce qui contrariait ma curiosité. Personne ne vint à nous. Plus loin, nous vîmes le grand corral, ou enclos des bestiaux, et de nombreux péons dans leurs sombres costumes en cuir. Ils avaient les jambes nues et des sandales aux pieds. Les vaqueros, dans tout l’éclat de leurs vêtements de velours, de leurs ornements d’or et d’argent, entouraient une troupe de femmes et de jeunes filles en jupons courts. Dans cette partie de la maison régnait une singulière animation.
Le corral était la grande étable de don Ramon, qui, à l’exemple des plus nobles hidalgos mexicains, élevait des bestiaux.
Le corral n’attira mon attention qu’un instant. Je regardai tour à tour l’azotea et la verandah, dans l’espoir d’y découvrir Isolina.