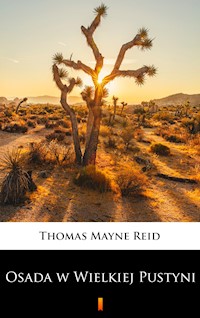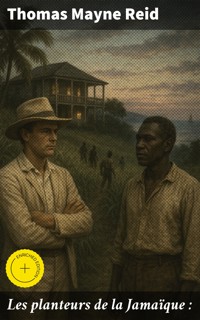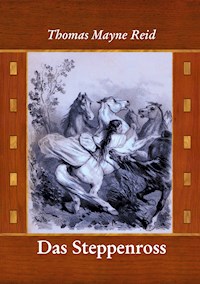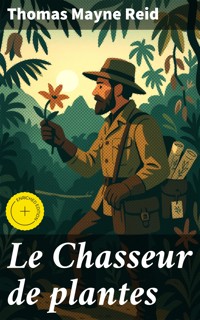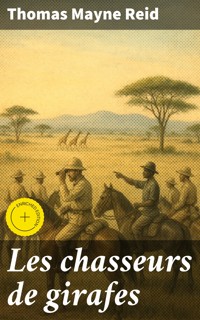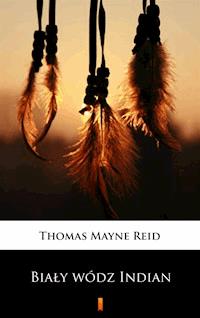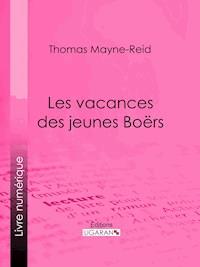
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Près du confluent de la rivière Jaune et de la rivière d'Orange, ces deux grands cours d'eau de l'Afrique méridionale, voyez-vous un groupe de jeunes chasseurs ? Ils sont campés sur la rive gauche du fleuve, dans un bouquet de saules de Babylone, dont le feuillage argenté, s'inclinant avec grâce des deux côtés de la rivière, présente une frange qui s'étend à perte de vue."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Près du confluent de la rivière Jaune et de la rivière d’Orange, ces deux grands cours d’eau de l’Afrique méridionale, voyez-vous un groupe de jeunes chasseurs ?
Ils sont campés sur la rive gauche du fleuve, dans un bouquet de saules de Babylone, dont le feuillage argenté, s’inclinant avec grâce des deux côtés de la rivière, présente une frange qui s’étend à perte de vue.
C’est un arbre d’une beauté rare que le salix Babylonica ; les palmiers, ces princes des forêts, ont à peine une forme plus gracieuse. Lorsque nous le regardons en Europe, une teinte de mélancolie vient assombrir nos pensées ; nous sommes habitués dès l’enfance à le considérer comme un emblème de tristesse ; nous l’avons nommé saule pleureur, et nous avons drapé les tombes de son pâle feuillage comme d’un linceul brodé d’argent.
Mais le sentiment qu’il nous inspire au milieu des karrous de l’Afrique méridionale, est d’une nature bien différente ; là-bas, les sources et les rivières sont peu nombreuses, très éloignées les unes des autres, et le saule pleureur, qui est un signe certain de la présence de l’eau, fait naître la joie au lieu d’éveiller la tristesse.
La plus franche gaieté règne en effet dans ce bivac abrité par les saules qui couvrent les bords de la rivière d’Orange, ainsi que le prouvent les éclats de rire continus qui retentissent dans l’air et que se renvoient les échos des deux rives.
« De qui donc proviennent ces éclats de rire si joyeux et si bruyants ?
– De nos jeunes chasseurs.
– Et de quels chasseurs ? »
Approchons de l’endroit où ils sont campés, nous les verrons ; il fait nuit, mais à la clarté du feu qu’ils entourent, il nous sera facile de distinguer leur visage et de décrire leur personne.
Ils sont six, la demi-douzaine est complète, et pas un des membres de cette bande joyeuse ne paraît avoir accompli sa vingtième année. Leur âge est entre dix et vingt ans ; néanmoins, il en est parmi eux deux ou trois, peut-être davantage, qui ont la prétention d’être des hommes faits.
Au premier coup d’œil, vous reconnaissez dans le nombre trois de vos anciens amis : Hans, Hendrik et Jan, nos ci-devant bush-boys.
Plusieurs années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous les avons vus ; ils ont beaucoup grandi, bien qu’ils ne soient pas arrivés au terme de leur croissance ; le dernier, que nous appelions autrefois le petit Jan, reçoit encore aujourd’hui cette qualification qui n’a pas cessé de lui être applicable ; il faut qu’il se tienne bien droit pour qu’en le mesurant on lui trouve un mètre vingt ; je crois même qu’il ne peut y arriver qu’en se mettant sur la fine pointe de ses orteils.
Hans est plus grand qu’à l’époque où nous l’avons quitté ; peut-être a-t-il maigri ; dans tous les cas, il est plus pâle ; car il a été pendant deux ans au collège, où, se livrant à l’étude avec ardeur, il a remporté tous les premiers prix de sa classe.
Quant à Hendrik, il a complètement changé : plus grand et plus fort que son frère aîné, c’est maintenant un jeune homme ; il a dix-huit ans révolus, il est droit comme un jonc, et vous remarquerez dans sa tournure et dans sa physionomie, quelque chose de martial qui n’a rien d’étonnant, car depuis l’année dernière, il est porte-drapeau dans les carabiniers du Cap ; vous pouvez vous en assurer en jetant les yeux sur sa casquette d’uniforme dont le fond est brodé d’or.
Tels sont aujourd’hui les bush-boys que nous avons connus autrefois.
Mais les trois autres que nous voyons assis avec eux autour de la flamme, qui sont-ils ? Évidemment leurs camarades, car ils paraissent être ensemble dans les termes de la plus franche amitié. Comment les appelez-vous ? Je vais vous le dire en deux mots : Ce sont les trois fils de Diédrik Van Wyk.
Et ce Van Wyk, quel est-il ? – C’est un riche Boërs qui chaque soir enferme dans ses vastes kraals plus de trois mille têtes de gros bétail, y compris les chevaux, et cinq fois autant de chèvres et de moutons ; Diédrik Van Wyk, en résumé, passe pour être le plus riche éleveur de bestiaux de tout le village de Graaf-Reinet.
Il se trouve précisément que la ferme, ou pour mieux dire, le territoire de Diédrik est limitrophe de l’exploitation de notre vieille connaissance, Hendrik Von Bloom, et que les deux voisins sont des amis inséparables. Il n’est pas de jour qu’ils ne se voient au moins une fois ; chaque soir Hendrik enfourche son bidet pour aller chez Diédrik, ou celui-ci pour se rendre chez l’autre, dans le but de fumer ensemble leur énorme pipe d’écume de mer, ou de boire une petite goutte de brandewyn, distillé de leurs propres pêches.
Ce sont de vieux camarades dans toute la force du terme ; tous deux ont été militaires dans leur jeunesse, et comme tous les anciens soldats, ils aiment à parler de leurs campagnes et à retracer dans leurs causeries les batailles qu’ils ont vues.
Il est donc bien naturel, en pareille circonstance, que l’intimité la plus grande règne entre les enfants des deux voisins. D’ailleurs, outre l’affection qui rapproche les deux pères, un autre lien cimente encore l’union des deux familles : Mmes Van Wyk et Von Bloom avaient pour mère les deux sœurs, d’où il résulte que leurs enfants sont cousins issus de germains, ce qui est un degré de parenté des plus intéressants. Il est même probable qu’un jour les relations de famille des Von Bloom et des Van Wyk deviendront encore plus étroites et plus intéressantes ; car Hendrik a pour fille, ainsi que chacun pourra vous le dire, la charmante Gertrude aux admirables cheveux blonds ; aux joues roses, et Diédrik de son côté est le père de Wilhelmine, jolie brunette aux yeux noirs et au minois piquant. Le hasard a voulu qu’il y eût trois fils dans chacune des deux familles, et bien que les filles et les garçons soient trop jeunes pour songer à se marier, le bruit court au dehors qu’à une époque plus ou moins rapprochée, les Von Bloom et les Van Wyk resserreront leur alliance par un double mariage qui ne déplaira nullement aux deux vieux camarades.
Il y a donc trois fils dans chacune des deux maisons ; vous connaissez les Von Bloom, Hans, Hendrik et Jan ; permettez-moi de vous présenter les Van Wyk ; ils s’appellent Willem, Arend et Klaas.
Willem est l’aîné ; ses dix-neuf ans ne sont pas encore révolus, mais c’est un homme par la taille ; d’une corpulence qui l’a fait surnommer le gros Willem, sa force est en proportion de sa grosseur. Il est loin d’être soigné dans sa toilette : une veste de drap grossier filé chez son père, une chemise à carreaux, un pantalon de cuir d’une ampleur excessive flottent vaguement autour de sa personne et le font paraître beaucoup plus gros qu’il ne l’est en réalité. Son chapeau de feutre, à larges bords, lui couvre le front jusqu’aux yeux ; ses souliers sont trois fois trop grands pour lui, et son caractère est tout aussi facile que ses habits sont aisés. Bien qu’il soit fort comme un buffle et qu’il ait conscience de sa force, le gros Willem ne ferait pas de mal à une mouche, et par sa nature aussi bienveillante que dévouée, il s’attire l’affection de tous les gens qui le connaissent.
Chasseur de premier ordre, il porte l’un des plus gros fusils qui existent, un véritable roer hollandais ; il est en outre chargé d’une poire à poudre gigantesque et d’un sac rempli de balles. Un jeune homme de force ordinaire fléchirait sous un pareil fardeau, mais tout cela n’est rien pour les épaules du gros Willem.
N’oublions pas qu’Hendrik Von Bloom est également un chasseur de haut titre ; je vous le dis en confidence, je ne peux pas me servir du mot jalousie, car ils s’aiment trop pour cela, mais un léger sentiment de rivalité existe entre les deux Nemrods.
Hendrik préfère la carabine, Willem un fusil pur et simple ; et de longues discussions, parfois très animées, s’élèvent fréquemment entre les deux chasseurs à propos du mérite respectif de leurs armes, toutefois sans jamais sortir des convenances, car, en dépit de son extérieur débraillé, le gros Willem n’en est pas moins un garçon de bonne compagnie.
Arend, le second fils des Van Wyk, montre dans sa personne et dans toutes ses manières beaucoup plus de soin et d’élégance que Willem.
D’une beauté mâle qui vous frappe tout d’abord, il peut rivaliser à cet égard avec Hendrik lui-même, bien qu’il n’y ait pas entre eux la plus légère ressemblance. Hendrik est blond, tandis qu’Arend a la peau brune, les yeux et les cheveux de couleur foncée. Tous les Van Wyk sont bruns ; ils appartiennent à cette partie des habitants de la Hollande que l’on a quelquefois désignés sous le nom de Hollandais noirs. Mais cette teinte brune va bien aux traits délicats d’Arend et vous ne trouveriez pas dans toute la colonie un plus bel adolescent. On dit tout bas que c’est l’opinion de Gertrude Von Bloom ; commérage de voisine, car la jolie blonde n’est encore que dans sa treizième année, et il est impossible qu’à son âge, elle ait une opinion en pareille matière.
Le costume d’Arend est élégant et lui sied à merveille ; il se compose d’une veste de peau d’antilope, d’une coupe gracieuse, piquée avec soin, galamment tailladée, passementée de peau de léopard ; et d’un pantalon de même étoffe, orné de larges bandes de fourrure pareille aux agréments de la veste, et d’un effet des plus riches. Arend, ainsi qu’Hendrik, porte la casquette militaire, car il est également cornette dans les carabiniers du Cap ; et c’est, je vous assure, un charmant officier.
Mais faisons le portrait de Klaas, le dernier des Van Wyk. Il est juste du même âge que Jan, et tout à fait de la même hauteur ; quant à la circonférence, la chose est différente ; Jan est, comme vous le savez, un bambin nerveux et délié ; tandis que son ami Klaas est trapu et tellement gros dans sa petite taille, que la ceinture de Jan, plus que doublée, égalerait à peine son diamètre.
Tous les deux ont de petites vestes rondes, des pantalons flottants et des chapeaux à larges bords ; ils vont à la même école et, malgré leur peu de ressemblance physique, ils sont tous deux fort habiles à la pipée et dans tout ce qui concerne la capture et le dénichement des oiseaux. Comme ils ne sont armés que de fusils de petit calibre, à un seul coup, leur ambition ne va point jusqu’à tuer des antilopes ; mais, quelle que soit la petitesse de leur arme, et la finesse de leur plomb, j’ai pitié des perdrix et des pintades qui leur permettront d’approcher à belle portée.
Nous avons insinué dans l’une des pages précédentes qu’un sentiment d’émulation un peu vif existait entre les deux aînés de la bande, en matière de grande chasse. Une rivalité pareille, que relève un zeste de jalousie, existe depuis longtemps entre les deux piqueurs, et amène parfois entre eux un refroidissement soudain, qui, d’ordinaire, est cependant de courte durée.
Hans et Arend n’ont jamais éprouvé nul sentiment d’envie à propos de leurs cousins ; Hans est bien trop philosophe pour jalouser personne ; sa spécialité, d’ailleurs, est d’être naturaliste, et il n’a pas de rival parmi ses compagnons ; toute la bande s’incline devant sa science et accepte, sans mot dire, l’opinion qu’il émet.
Arend, quant à lui, n’a aucune prétention ; c’est le plus modeste des jeunes gens qu’on puisse voir ; et cependant il est beau, élégant, brave, généreux et bien fait pour être aimé.
J’ai dit, en commençant, que nos jeunes amis étaient campés sur le bord de la rivière d’Orange ; mais dans quel but sont-ils venus s’y établir ?
L’endroit où ils se trouvent est à une bien grande distance de la maison paternelle, à bien des journées de marche de la colonie du Cap. Il n’y a pas une seule ferme dans le voisinage, pas un blanc n’a pénétré jusque-là, si ce n’est parfois un de ces trafiquants aventureux qui vont troquer leurs marchandises jusqu’au centre de l’Afrique ; ou bien un pasteur nomade qui a conduit son troupeau dans ces lieux à peine connus ; mais le pays n’en est pas moins complètement inhabité ; c’est toujours le désert.
Et dans quelle intention les Van Wyk et les Von Bloom ont-ils pénétré dans cette région déserte ?
C’est tout simplement pour chasser.
Il y a longtemps que cette expédition est résolue ; depuis leur grande chasse à l’éléphant, les bush-boys n’ont poursuivi aucun gibier ; Hendrik et Arend sont retournés sous les drapeaux, Hans et Jan sont allés au collège, ainsi que notre ami Klaas ; il n’y a que le gros Willem qui, de temps à autre, ait chassé l’antilope et différents animaux que l’on trouve encore aux environs des fermes. Mais cette fois, l’intention de nos chasseurs est de s’éloigner des frontières de la province du Cap. Ils ne se sont pas fixés de limites, et doivent aller jusqu’où bon leur semblera, sans s’inquiéter de la distance ; ils en ont la permission, et leurs familles leur ont donné tout l’équipement nécessaire pour réaliser leur projet ; ils possèdent chacun un bon cheval ; de plus, chacune des deux triades est suivie d’un grand chariot ou wagon, destiné au transport des objets de campement, et qui doit, en outre, servir de tente à nos amis. Les chariots, à leur tour, ont chacun leur conducteur et leur attelage composé de dix bœufs à grandes cornes ; vous pouvez les voir non loin des jeunes gens, en compagnie d’une petite meute de chiens à l’air rogue, au poil rude, et qui doivent servir à chasser l’antilope ; les bœufs et les chevaux sont attachés aux wagons ou à des arbres, et les chiens sont groupés autour du feu dans des attitudes variées.
Le bivac renferme encore deux singuliers individus qui méritent bien quelques lignes ; ce sont en effet deux personnages importants, car sans eux les wagons seraient une chose embarrassante. Je parle des conducteurs de ces deux véhicules, et jamais automédon sur son siège armorié ne fut plus fier de son poste qu’ils ne le sont eux-mêmes de l’emploi qu’ils occupent.
Vous connaissez l’un de ces deux personnages : cette grosse tête, ces pommettes saillantes, ce nez épaté, ces narines élargies, ces petits yeux fendus obliquement, ainsi qu’on l’observe dans la race mongole, ces mèches courtes de laine frisée plantées çà et là sur cet énorme crâne, ce teint d’un jaune fuligineux, ce corps informe et trapu, d’un mètre vingt de hauteur, à peine couvert d’une chemise de flanelle rouge et d’une culotte de peau brune, tout cela vous rappelle certainement Facetanné, votre ancien favori.
C’est lui-même en effet ; et bien que trois hivers aient passé sur sa tête nue depuis que nous l’avons quitté, Facetanné, le Bushman, n’offre pas le moindre changement ; les touffes minuscules de sa toison parsèment toujours son crâne et son occiput ; elles ne sont ni plus claires, ni moins brunes ; son visage a conservé cette grimace joyeuse et bienveillante qui chez lui remplace le sourire ; c’est toujours le fidèle serviteur, l’adroit charretier, l’homme de ressources qu’il était autrefois ; et comme à l’époque où vous l’avez connu, c’est lui qui dirige le chariot des Von Bloom.
Quant à l’individu qui mène le wagon Van Wyk, il diffère autant de Facetanné qu’un cerf d’un ourson.
Il a d’abord un mètre quatre-vingts, c’est-à-dire qu’il est d’un tiers plus grand que le Hottentot, et cela sans souliers, car il n’en a jamais eu, mais non pas sans chaussures, puisqu’il porte des sandales.
Beaucoup plus foncé que le Bushman, il est cependant plutôt couleur de bronze que véritablement noir ; ses cheveux, bien que légèrement crépus, sont plus grands que la laine de son camarade, et n’ont pas cette tendance marquée de la toison du Hottentot à prendre racine par les deux bouts. Le nez du Bushman est concave, celui de l’autre est convexe, on peut dire aquilin ; un œil perçant et bien ouvert, des dents blanches et régulièrement rangées, des lèvres d’une épaisseur moyenne, un corps et des membres bien proportionnés, une attitude pleine de noblesse et de fierté, donnent à cet individu un air de grandeur qui contraste de la manière la plus frappante avec le tronc massif et l’aspect grotesque du Bushman.
Son costume n’est pas sans grâce ; il est composé d’une petite jupe serrée à la taille et tombant à mi-cuisse, j’étoffe de cette jupe est singulière ; ce n’est pas même un tissu, mais une frange, une draperie formée de longs poils blancs qui flottent en liberté ; véritable costume de sauvage, cette draperie est constituée par la réunion d’un certain nombre de queues d’une espèce d’antilopes appelées gnous et qui sont suspendues tout simplement à la ceinture ; une sorte de palatine du même genre couvre les épaules de cet homme, qui porte des anneaux de cuivre aux chevilles et aux poignets ; un bouquet de plumes d’autruche se balance sur sa tête, et un collier de grains de verre forme le complément de sa parure, il s’appelle Congo, appartient à la nation des Cafres, et c’est lui qui est chargé de conduire le wagon des Van Wyk.
« Un Cafre, conducteur de chariot ! c’est impossible, dites-vous ; un guerrier dont l’âme est si haute ne peut pas descendre à un pareil office. » La chose est vraie pourtant ; des Cafres, et par milliers, servent maintenant dans la province du Cap, et y remplissent des fonctions beaucoup moins relevées que celles de conducteur de chariot, qui ne sont nullement considérées comme infimes par les habitants de la colonie ; on rencontre souvent les fils des plus riches boërs montés sur le siège d’un wagon et maniant le fouet de bambou avec l’adresse d’un bouvier consommé.
Il ne faut donc pas être surpris de ce que le chariot de Van Wyk est dirigé par un Cafre. C’est d’ailleurs pour fuir le joug despotique de Chaaka, monstre sanguinaire, dont la tyrannie lui était odieuse, que Congo s’était réfugié sur le territoire anglais où il fut accueilli et protégé par les colons. Il est devenu, depuis cette époque, un membre utile d’une société civilisée, bien que le souvenir de la patrie soit toujours assez puissant dans son cœur pour lui faire garder son costume national.
Qui pourrait l’en blâmer ? Drapé dans son ample kaross de peau de léopard, qui retombe de ses épaules comme une toge, avec sa jupe flottante de poils argentés, ses anneaux de métal, brillant à la clarté de la flamme, il présente un aspect sauvage, il est vrai, mais d’une grandeur étrange. Assurément, personne ne blâmera Congo le Zoulou de tenir à montrer sa belle taille dans un costume qui la fait si bien valoir.
Et tout le monde l’approuve en effet ; du moins parmi nos jeunes boërs, tous l’admirent sans lui porter envie.
Je me trompe ; il est quelqu’un, parmi ceux qu’il accompagne, dont les sentiments à son égard ne sont rien moins qu’affectueux, quelqu’un qui ne saurait écouter de sang-froid les louanges du magnifique Zoulou : c’est Facetanné le Hottentot. Nous avons dit la rivalité qui existe entre le gros Willem et Hendrik à propos de chasse, entre Klaas et le petit Jan au sujet de la pipée ; mais réunissez les sentiments des quatre jeunes chasseurs, multipliez-les plusieurs fois les uns par les autres et vous n’arriverez pas à la somme d’émulation jalouse qui se manifeste sans cesse entre les fouets rivaux du Bushman et du Zoulou.
Congo et Facetanné sont les seuls serviteurs qui aient suivi les jeunes boërs. Non pas que le riche Von Bloom, qui est maintenant landdrost, c’est-à-dire premier magistrat du canton, et son ami Van Wyk, dont la fortune est plus grande encore, ne fussent en position de fournir à leurs fils une vingtaine de domestiques. Ils n’en ont rien fait cependant, non par économie, je vous l’assure ; mais les deux vieux soldats ne sont pas hommes à dorloter des garçons et à leur prodiguer tous les raffinements du luxe.
« Ces jeunes gens veulent aller à la chasse, dirent un jour les deux amis ; fort bien, mais qu’ils en aient la peine en même temps que le plaisir. » Et là-dessus ils leur souhaitent bon voyage en leur donnant ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leur projet, c’est-à-dire un bon cheval qui les porte, et un chariot et des bœufs qui traînent leurs provisions et les dépouilles des animaux qu’ils auront la chance de tuer.
Nos jeunes boërs, au surplus, n’ont pas besoin de domestiques ; ils savent fort bien se servir eux-mêmes. Le plus jeune d’entre eux pourrait, au besoin, dépouiller une antilope et en faire griller les côtelettes sur le feu qu’il aurait allumé. C’est à cela, d’ailleurs, que se borneront tous leurs procédés culinaires, leur estomac vigoureux n’en demande pas davantage, et leur bon appétit, aiguisé par la chasse, leur tiendra lieu des sauces les plus savoureuses que le génie des Carême ait jamais inventées.
Il y a déjà plusieurs semaines que nos jeunes gens sont partis de Graaf-Reinet ; mais bien qu’ils aient déjà beaucoup chassé, ils n’ont pas encore aperçu de gros gibier ; c’est à peine s’il leur est arrivé quelque aventure qui mérite d’être citée.
Depuis deux jours ils sont en grande discussion ; traverseront-ils la rivière, et, se dirigeant vers le nord, se mettront-ils en quête de girafes et d’éléphants, ou bien resteront-ils sur la rive méridionale, où ils se contenteront de poursuivre différentes espèces d’antilopes ? Bref, après un long débat, il fut décidé qu’on franchirait la rivière d’Orange et qu’on passerait au nord du fleuve tout le reste du temps dont on pouvait disposer, c’est-à-dire la fin des vacances.
Le gros Willem avait été l’ardent promoteur de cette proposition, qui avait été chaudement soutenue par le naturaliste. Willem éprouvait un vif désir de chasser le buffle et l’éléphant, car il n’avait jamais eu l’occasion d’affronter d’une manière sérieuse ces géants de la forêt ; et le jeune savant n’était pas moins désireux que le chasseur de pénétrer dans une région où il se trouverait en face d’une flore nouvelle.
Quelque bizarre que cela paraisse, il n’en est pas moins vrai qu’Arend opinait pour qu’on revînt à Graaf-Reinet, et, chose plus étrange encore, Hendrik, malgré sa passion pour la chasse, était du même avis.
Mais il n’est pas de phénomène que l’on n’arrive à comprendre lorsqu’on l’examine savamment et avec attention, et la conduite des deux cornettes finit par s’expliquer.
Hans Von Bloom insinua qu’une petite brune qu’on appelait Wilhelmine pouvait bien être pour quelque chose dans l’opinion de son frère ; et le gros Willem qui avait l’habitude de parler sans ambages, affirma carrément que c’était sa sœur Gertrude qui attirait le bel Arend du côté de la maison.
Toujours est-il que l’affirmation de l’un et la supposition de l’autre suffirent pour empêcher Hendrik et Arend de s’opposer plus longtemps au projet du gros Willem ; et que, rougissant jusqu’aux oreilles, ils s’estimèrent bien heureux de terminer la discussion en approuvant l’itinéraire qui leur était présenté.
« En avant donc et au nord ! s’écrièrent les chasseurs ; au nord, où l’on rencontre l’éléphant et la girafe ! »
C’est au moment où les jeunes boërs viennent de se rallier à ce mot d’ordre que nous les trouvons sur la rive gauche de la rivière d’Orange, en face d’un gué bien connu qu’il s’agit pour eux de franchir. Malheureusement le fleuve a grossi tout à coup, et il a fallu camper au bord de l’eau en attendant que la crue ait baissé, de manière à permettre le passage.
Le lendemain matin nos chasseurs étaient levés au point du jour, et leur premier mouvement fut d’aller voir où en était la rivière ; à leur grande satisfaction, l’eau avait baissé de plus d’un mètre, ainsi qu’il était facile de s’en convaincre par la trace qu’elle avait imprimée aux arbres de la rive.
Toutes les rivières du midi de l’Afrique, ainsi que tous les cours d’eau qui arrosent les régions tropicales, surtout lorsque le pays est montagneux, grandissent beaucoup plus rapidement que celles de la zone tempérée. On explique ce fait par l’énorme quantité d’eau que répandent les pluies des tropiques, où elles ne tombent pas comme ici par gouttes éparses, mais où littéralement elles se versent en nappe abondante pendant plusieurs heures de suite, d’où il résulte que le sol est complètement saturé d’eau et que les fleuves sont torrentiels.
Nos orages nous en fournissent un exemple, lorsqu’en été leurs gouttes volumineuses transforment, en quelques minutes, les ornières en ruisseaux et ceux-ci en rivières.
Chez nous ces averses ne sont pas de longue durée, c’est à peine si elles se prolongent pendant une demi-heure ; mais figurez-vous qu’elles puissent durer sept ou huit jours et vous comprendrez les inondations effrayantes qui se produisent sous les tropiques.
Il n’est pas moins facile de vous expliquer la cause du prompt abaissement des rivières africaines, ce sont les nuages qui la plupart du temps les alimentent, et non pas, comme chez nous, les sources, les glaciers et les neiges ; il est donc naturel que, dès l’instant où la pluie a cessé, les rivières diminuent tout à coup ; ajoutez-y l’évaporation produite par un soleil brûlant, la quantité d’eau qui est naturellement absorbée par un sol desséché, et vous ne serez pas surpris de la rapidité avec laquelle diminuent les eaux gonflées de ces rivières.
Nos jeunes chasseurs trouvèrent donc à leur réveil que Gariep (c’est ainsi que les indigènes nomment la rivière d’Orange) avait baissé pendant la nuit ; mais ils ne savaient pas si elle était guéable ; ils avaient bien la certitude que les Hottentots, les Béchuanas, les trafiquants et les boërs nomades passaient ordinairement la rivière en cet endroit ; il restait toujours à savoir quelle était la profondeur actuelle du fleuve, aujourd’hui qu’il se trouvait débordé. Aucun signe, aucun indice ne pouvait le leur apprendre ; l’eau épaisse et jaune, comme il arrive en général après une crue subite, ne permettait pas qu’on pût en voir le fond ; il était possible qu’elle n’eût pas plus d’un mètre, mais elle pouvait en avoir deux ; le courant était rapide, et la prudence conseillait de ne pas s’engager à l’aventure.
Comment faire ? ils étaient impatients de se trouver sur l’autre rive, mais par quel moyen traverser le fleuve sans courir de dangers ?
Hendrik proposait de franchir le gué à cheval ; si sa monture perdait pied, elle n’en arriverait pas moins, disait-il, sur l’autre bord en se mettant à la nage ; le gros Willem, ne voulant pas en fait d’audace être battu par Hendrik appuyait cette proposition ; mais Hans, qui était l’aîné de tous nos chasseurs et dont les conseils pleins de sagesse étaient généralement bien accueillis, s’opposait à ce que l’expérience fût tentée. Une fois les chevaux à la nage la rapidité du courant pouvait les entraîner à la dérive, dans un endroit où il leur serait impossible de gravir les bords du fleuve, et cavaliers et montures seraient infailliblement perdus.
D’ailleurs, ajoutait le naturaliste, en supposant même que les chevaux pussent se rendre en nageant sur la rive opposée, la chose était impraticable aux bœufs et aux wagons, et il devenait inutile de traverser la rivière dès l’instant que ceux-ci ne pouvaient pas la franchir. Il valait mieux attendre que le fleuve eût repris le niveau qu’il avait ordinairement ; ce qui, après tout, ne les retiendrait pas plus de vingt-quatre heures à l’endroit où ils étaient campés.
Le conseil était bon ; Hendrik et le gros Willem le reconnurent ; mais celui-ci n’en désirait pas moins vivement se trouver au milieu des buffles et des girafes, et en dépit du danger, il éprouvait la tentation la plus grande de passer à l’autre bord ; Hendrik partageait cette envie, moins par amour pour la chasse que par passion pour les aventures, car s’il avait un défaut, c’était la témérité.
Comme il était évident que la traversée, même à la nage, était impossible aux bœufs qui traînaient les chariots, le gros Willem et l’audacieux Hendrik se résignèrent, bien que d’assez mauvaise grâce, à passer un jour de plus sur la rive gauche du fleuve.
Mais ils n’attendirent pas même jusqu’au soir ; une heure après, non seulement les cavaliers et les montures, mais les wagons et les bœufs avaient passé l’eau et parcouraient la plaine qui s’étendait sur l’autre rive.
Qui avait pu motiver ce changement de résolution de la part de nos chasseurs ? Comment s’étaient-ils assurés que la rivière était assez basse pour être franchie par les bœufs ? C’est à Congo qu’ils en étaient redevables.
Tandis qu’ils se demandaient quelle pouvait être la profondeur du fleuve, le Zoulou était sur le bord de l’eau et jetait de gros cailloux dans la rivière ; nos amis, supposant qu’il s’amusait, ou qu’il se livrait à quelque pratique superstitieuse, ne firent pas attention à lui et continuèrent à discuter ; mais le Hottentot suivait des yeux l’opération du Cafre et témoignait par son visage attentif du profond intérêt qu’il prenait à la chose.
Bientôt un éclat de rire méprisant de Facetanné, suivi de paroles quelque peu ironiques, attirèrent les regards des jeunes gens sur le Bushman et sur le Zoulou.
« Congo ? s’écriait Facetanné, pauvre fou ! toi chercher à connaître la profondeur en s’y prenant de la sorte ! y penses-tu, vieux craqueur ! »
Le Zoulou n’accorda pas la moindre attention à cette apostrophe insultante et continua de lancer des pierres dans l’eau du fleuve. Les chasseurs, qui maintenant avaient les yeux sur lui, observèrent qu’il ne jetait pas ses cailloux avec indifférence, mais de façon à prouver qu’il agissait dans un but déterminé. Chaque fois qu’il avait jeté l’une de ces pierres, il se penchait en avant, l’oreille inclinée à la surface de l’eau, et paraissait écouter avec soin le bruit que faisait son projectile en plongeant dans la rivière. Il se relevait dès qu’il n’entendait plus rien, et lançait, mais au-delà du précédent, un nouveau caillou dont il suivait la chute avec la même attention.
« Qu’est-ce que fait donc ton Zoulou ? demanda Hendrik à Willem, qui était l’un des maîtres de Congo.
– Je n’en sais rien, répondit le jeune Van Wyk ; c’est probablement quelque ruse de son pays, il en a pour toutes les circonstances ; mais je ne devine pas, quant à présent, quel peut être le motif de son opération. Ohé ! Congo, s’écria Willem, qu’est-ce que tu fais là, mon garçon ?
– Moi trouver la profondeur de la rivière, répondit le Zoulou d’un air grave.
– Crois-tu y parvenir en t’y prenant de la sorte ? »
Le nègre fit un signe affirmatif.
« Boush ! s’écria Facetanné, dont la jalousie ne pouvait supporter l’attention qu’on accordait à son rival ; vraie sottise, vieux fou ! rien connaître, et lui rien pouvoir dire. »
Le Cafre, cette fois encore, supporta en silence les paroles du Bushman, qui néanmoins commençaient à l’irriter, et continua son opération jusqu’au moment où le dernier de ses cailloux tomba dans l’eau à peu près à un mètre de la rive opposée, c’est-à-dire à plus de cent mètres de l’endroit où il se trouvait lui-même. Se redressant alors et se tournant du côté des boërs, il leur dit avec une assurance, toutefois mêlée de respect :
« Menhir, vous pouvoir passer le gué. »
Nos amis le regardèrent avec des yeux incrédules.
« Quelle profondeur penses-tu qu’il puisse avoir ? » lui demanda l’aîné des Von Bloom.
Le Cafre posa la main sur sa hanche, voulant dire ainsi qu’il aurait de l’eau jusqu’à la ceinture.
« Boush ! s’écria Facetanné ; l’eau être deux fois plus profonde : lui vieux fou et vouloir tout noyer.
– Toi…, ce serait possible, » répondit le Zoulou avec calme, en toisant du regard le Hottentot, dont la taille peu élevée excitait son mépris.
Les chasseurs éclatèrent de rire, et Facetanné, piqué au vif, resta quelques instants sans pouvoir répondre à son rival ; mais quand il retrouva la parole : « Vieux nègre, lui dit-il, baliverne que tout ça, et bon pour les discours ; toi bien prudent, n’est-ce pas ? faire emporter les chariots et noyer tous les bœufs ; mais toi essayer le passage, puisqu’il n’est pas profond ; traverse-le d’abord, grand faiseur d’embarras. »
Facetanné croyait avoir triomphé du Zoulou ; il ne supposait pas que ce dernier osât franchir la rivière en dépit de son assurance, et il était loin de penser à l’humiliation qui l’attendait.
À peine avait-il défié son rival de traverser l’eau du fleuve, que le Zoulou descendit la berge et se trouva immédiatement au bord du gué.
Les chasseurs, devinant son intention, lui crièrent de rester sur la rive et de ne pas commettre une imprudence qui pouvait lui être fatale.
Mais le Bushman avait piqué l’amour-propre de Congo, et celui-ci n’écouta point les avertissements qui lui étaient adressés ; toutefois, il ne se précipita pas dans le fleuve d’une façon irréfléchie ; mais agissant avec le calme dont il ne se départait jamais, il se baissa et prit au bord de l’eau une énorme pierre qui ne pesait pas moins de cinquante kilogrammes ; puis, l’élevant au-dessus de sa tête, et la maintenant dans cette position, il s’engagea dans la rivière d’un pas ferme et hardi.
Les chasseurs, que cette manœuvre avait d’abord étonnés, comprirent bientôt dans quel but le Zoulou s’était muni de cette grosse pierre ; il voulait augmenter son propre poids, afin d’opposer plus de résistance au courant du fleuve. Le succès ne tarda pas à couronner son audace ; car, au bout de cinq minutes, il abordait sur l’autre rive, où il se trouvait sain et sauf.
Recevant les acclamations des chasseurs, auxquelles le Bushman ne mêla pas sa voix, Congo revint sur le bord où l’attendait son attelage, et où il fut salué de nouveau par les applaudissements des boërs. Les bœufs furent mis immédiatement aux wagons, les chevaux harnachés, les cavaliers se mirent en selle, et les chasseurs, les chiens, les chevaux et les bœufs, eurent bientôt franchi le fleuve et se dirigèrent vers le nord.
Jusqu’à présent, nos chasseurs n’avaient pas eu la moindre aventure qui méritât d’être relatée ; mais ils n’eurent pas plus tôt laissé derrière eux la rivière d’Orange, qu’ils furent témoins d’un fait assez intéressant pour mériter qu’on le rapporte, et qui se passa précisément en face du premier endroit où ils s’arrêtèrent après avoir traversé le Gariep.
Ils avaient choisi, pour y établir leur bivac, le bord d’une mare située au milieu d’une vaste plaine où se trouvaient réunies de l’herbe et de l’eau, condition excellente pour des voyageurs, bien que toutes les deux fussent d’une qualité médiocre. Çà et là, des buissons, des massifs d’arbustes peu élevés couvraient la plaine, et, dans l’intervalle qui séparait ces massifs et ces broussailles, apparaissaient les forteresses des termes mordax, ou fourmis blanches, dont les dômes s’élevaient à plusieurs mètres au-dessus du sol.
Les jeunes boërs venaient de terminer leurs préparatifs d’installation et de détacher leurs bœufs, afin que ceux-ci pussent brouter l’herbe qui croissait autour de la mare, lorsqu’ils entendirent crier par le Bushman :
« Des lions, des lions ! »
Tous les regards se dirigèrent du côté que désignait le Hottentot ; la chose était réelle, et nos chasseurs aperçurent un gros lion à crinière noire qui traversait la plaine de l’autre côté de l’endroit où pâturaient les bœufs. Il avait découvert ces derniers en débuchant des broussailles, et après avoir fait quelques pas, il s’accroupit dans l’herbe et guetta ces animaux, comme un chat fait d’une souris, ou comme une araignée guette une mouche insouciante.
Les chasseurs avaient à peine eu le temps de faire l’observation que je viens de vous transmettre, lorsqu’un autre lion sortit du même fourré et, trottant d’un pied furtif, se dirigea du côté de celui que nous avons déjà vu ; c’était une lionne, ainsi que le prouvait l’absence de crinière, et la forme de son corps qui se rapprochait de celle du tigre ; elle était peu inférieure à son compagnon pour la taille, et n’avait ni moins de puissance, ni moins de férocité.
Lorsqu’elle fut arrivée à l’endroit où le lion était assis dans l’herbe, elle se plaça auprès de lui, et tous deux, la face tournée vers le camp des chasseurs, jetèrent sur les bêtes à cornes des regards de convoitise.
Les chevaux, les hommes et les chiens étaient en vue des lions, mais qu’importait à ces derniers. Une proie plus appétissante se trouvait en face d’eux, et ils n’attendaient qu’une occasion favorable pour la saisir ; évidemment ils comptaient bien souper d’un morceau de bœuf ou tout au moins d’un quartier de cheval.
C’était la première fois, depuis qu’ils étaient partis de Graaf-Reinet, que nos chasseurs apercevaient des lions ; ils avaient à diverses reprises découvert la piste ou entendu le rugissement du roi des animaux qui rôdait près de leur bivac ; mais c’était la première fois, nous le répétons, que Sa Majesté Léonine apparaissait à leurs regards, et la présence du monarque chevelu et de sa compagne éveilla dans le camp des jeunes boërs une émotion assez vive, qui, tranchons le mot, pouvait passer pour de la peur.
Ils tremblèrent tout d’abord pour eux-mêmes ; et Facetanné et le Zoulou ne furent pas exempts d’une certaine inquiétude à l’égard de leur peau noire ; toutefois cette crainte personnelle ne tarda pas à se dissiper ; on pouvait affirmer que les lions n’attaqueraient pas les chasseurs ; il est tellement rare que pareille chose arrive ! C’était des animaux dont ils méditaient la perte ; et les hommes n’avaient rien à craindre, tant que les lions trouveraient à leur portée un bœuf ou même un cheval ; aussi nos jeunes chasseurs, après un instant de réflexion, recouvrèrent-ils leur sang-froid.
Mais ce n’était pas un motif pour que nos boërs permissent aux félins de dévorer l’une ou l’autre de leurs bêtes ; ils se seraient trouvés dans un grand embarras si leurs attelages avaient été décimés ; il fallait au plus vite aviser au moyen de protéger les bœufs et les chevaux, et construire un kraal où ces derniers pourraient être à l’abri.
Les lions étaient toujours à la même place, où ils conservaient leur attitude menaçante ; il n’était pas probable, néanmoins, qu’ils vinssent attaquer les bœufs tant que ceux-ci resteraient dans le voisinage du camp. Jamais les lions n’avaient aperçu de chariots, et cet énorme objet, dont ils ignoraient l’usage, était assez redoutable à leurs yeux pour les tenir à distance ; ils attendaient l’un et l’autre que les bœufs s’éloignassent de cette machine, qui leur causait une certaine inquiétude, ou que l’obscurité leur permît de se glisser auprès d’eux sans que personne ne pût les voir.
Dès qu’il fut bien avéré qu’ils n’avaient pas le projet de s’emparer immédiatement de leur proie, Hendrik et Willem, montant à cheval, se dirigèrent avec précaution vers l’endroit où paissaient les bêtes à cornes, et les ramenèrent tout doucement du côté opposé de la mare. La garde du troupeau fut confiée à Klaas et à Jan, tandis que tous les autres, y compris les deux nègres, s’armant de haches et de cognées, s’en allèrent dans un hallier voisin, d’acacia detinens, arbuste couvert d’énormes épines qui l’ont fait surnommer : attends un peu. Une demi-heure après nos amis avaient assez de broussailles pour constituer, avec le secours des wagons, un kraal fortifié où les chevaux et les bœufs furent conduits sans délai.
Nos chasseurs étaient complètement rassurés ; ils tirent un grand feu de chaque côté de l’enceinte qui renfermait les bestiaux ; la flamme, il est vrai, ne suffit pas toujours à éloigner les lions, mais c’était une bonne mesure, et en cas d’attaque, ils se fiaient à leurs armes.
Quant à eux personnellement, ils couchaient dans les chariots, où ils n’avaient rien à craindre ; il aurait fallu qu’un lion fût terriblement affamé pour chercher à s’introduire dans le kraal où étaient maintenant les bœufs, et quelle que soit la faim dont il puisse être dévoré, jamais ce terrible animal n’attaquera un wagon, il n’y pensera même pas.
Cette besogne terminée, les chasseurs vinrent s’asseoir auprès du feu et s’occupèrent de préparer leur souper.
Il ne leur restait pas autre chose à faire cuire que de la viande boucanée. Le dernier morceau de la venaison qu’ils s’étaient procurée en deçà de Gariep avait été mangé la veille, et il fallait avoir recours à la viande séchée qu’ils emportaient comme réserve. Ils avaient bien, il est vrai, du reitbok, ainsi appelé à cause de l’habitude où est cet animal de fréquenter les roseaux qui bordent les rivières.
Cette antilope, que les naturalistes appellent eleotragus, n’a pas plus de 80 centimètres de hauteur ; ses formes se rapprochent beaucoup de celles du springbok, mais sοn poil est plus rude, sa robe est d’un gris cendré sur le cou, les épaules, le dos, la croupe, sur toute la partie supérieure du corps, et d’un blanc d’argent sur la poitrine et le ventre. Ses cornes, au lieu de former une lyre, comme chez le springbok, s’élèvent d’abord sur la même ligne que le front, puis elles s’incurvent à la pointe et se dirigent en avant ; elles ont à peu près 30 centimètres de longueur, sont ridées à la base, fortement annelées au milieu et lisses à leur extrémité.
Ainsi que nous l’avons dit, le reitbok se rencontre dans les bas-fonds marécageux qui se trouvent au bord des rivières, où il se nourrit des plantes qui croissent dans ces régions humides ; il en résulte que sa chair est d’une qualité médiocre, et c’est pour cela que nos chasseurs lui préféraient la viande séchée, abandonnant aux deux nègres la venaison de l’antilope de roseaux.
Hendrik et Willem auraient volontiers couru à la recherche de quelque gibier poil ou plume ; mais la présence des lions rendait la chose impossible, et nos amis, ayant coupé une baguette pour s’en servir en guise de broche, suspendirent leur viande boucanée, appelée biltong, au-dessus des charbons ardents.
Le lion et la lionne, pendant ce temps-là, conservaient la position qu’ils avaient prise dans la plaine, et attendaient avec impatience que la nuit fût arrivée.
Le gros Willem et son rival Hendrik étaient d’avis de chasser les deux félins ; mais cependant ils cédèrent aux conseils du naturaliste qui leur rappelait ces paroles de leurs pères : « N’attaquez jamais un lion à moins d’y être obligé, et laissez entre vous et lui autant d’espace que possible. » Il est très rare qu’un lion se jette sur un homme sans y être provoqué, et l’avis qu’avaient reçu nos chasseurs était rempli de sagesse.
Tout à coup les regards des boërs furent attirés par un nouvel objet ; deux charmants animaux s’avançaient dans la plaine ; chacun était à peu près de la taille d’un âne, et leur robe était fauve. Bien qu’ils fussent vigoureusement taillés, leurs formes n’en étaient pas moins gracieuses ; ils avaient la tête et la face blanches, mais rayées de quatre bandes de couleur sombre, disposées de façon à figurer la têtière d’une bride ; la première de ces bandes descendait sur le front, une autre traversait les yeux et rejoignait les coins de la bouche, une troisième entourait le nez, tandis qu’une quatrième, partant de la base des oreilles et passant sous la gorge, complétait la ressemblance que ces lignes présentaient avec un licou.
Une crinière renversée, une raie noire sur le dos, une queue épaisse, également noire et tombant jusqu’à terre, se faisaient remarquer chez ces deux belles créatures ; mais ce qui les caractérisait surtout, c’étaient les admirables cornes qu’elles portaient toutes les deux ; ces cornes étaient droites, minces, dirigées en arrière presque horizontalement, et couvertes d’anneaux réguliers jusqu’à 8 ou 10 centimètres de la pointe, qui était aiguë comme un fleuret. D’un noir d’ébène, et polies comme de l’acier, elles n’avaient pas moins de 90 centimètres ; et, chose singulière, c’était le moins grand des deux animaux, car il y avait entre eux quelque différence de taille, qui avait les cornes les plus longues.
Ainsi la femelle se trouvait mieux armée que le mâle, ce qui est complètement anomal parmi les animaux de cette famille, car les deux arrivants étaient des antilopes.
Il avait suffi d’un coup d’œil à nos amis pour distinguer leur espèce et pour reconnaître l’oryx, l’un des plus charmants animaux d’Afrique, l’un des mieux réussis de la création tout entière.
En apercevant les gemsboks, tel est le nom que les boërs ont donné à l’oryx, la première pensée de nos chasseurs fut de chercher par quel moyen ils pourraient s’emparer de l’une des deux antilopes. Quelque charmant effet que ces deux belles créatures produisissent dans la plaine, nos amis auraient mieux aimé les voir à la broche, car ils savaient par expérience que la venaison de l’oryx est la plus délicate et la plus savoureuse que l’on puisse trouver en Afrique, toutefois après celle de l’élan.
Nos chasseurs, disons-nous, pensaient à se procurer une tranche de venaison pour leur repas du soir ; leur dîner en serait nécessairement retardé ; mais il y avait une si grande différence entre un bifteck d’oryx et le morceau de viande séchée qu’ils avaient en perspective, que nos amis ne demandaient pas mieux que d’attendre.
Les tranches de biltong, déjà presque à moitié cuites, furent retirées du feu, et les chasseurs, quittant la broche, saisirent immédiatement leurs fusils.
Mais comment faire pour parvenir au but que se proposaient nos jeunes gens ?
Il était presque impossible de traquer les deux gemsboks ; la prudence de ces animaux est si grande qu’ils approchent rarement d’un fourré, d’un buisson quelconque où pourrait s’abriter un ennemi ; c’est la plaine découverte qui est leur séjour habituel. Rien n’est plus difficile que de les surprendre, et c’est en les forçant, au moyen d’un excellent cheval, et après une course effrénée, que les chasseurs finissent par les atteindre. Quelquefois même le cheval le plus vite ne parvient pas à les rejoindre, car tout d’abord, et pendant un ou deux milles, la course du gemsbok est aussi rapide que le vent ; un bon cavalier néanmoins, dont la monture a du fond, et qui sait la diriger, est presque toujours sûr de se rendre maître de l’oryx après un temps plus ou moins long.
Nos amis devaient-ils seller leurs chevaux et poursuivre les deux gemsboks ? Ils n’auraient pas hésité à le faire, s’ils n’avaient observé que les antilopes se dirigeaient de leur côté.
À la manière dont elles couraient alors, elles seraient bientôt arrivées auprès d’eux, et cette circonstance, qui leur évitait la peine de les forcer, était d’autant plus agréable à nos jeunes gens qu’ils avaient une faim dévorante, et qu’après avoir marché depuis le matin, leurs chevaux étaient fatigués.
Il n’y avait rien d’impossible à ce que la chose se passât comme le désiraient les chasseurs ; leur kraal était caché au milieu des broussailles, la fumée seule indiquait l’endroit où il était situé, et cet indice ne devait pas effrayer les antilopes, en supposant qu’elles y fissent attention. Hendrik et le gros Willem pensaient d’ailleurs que c’était vers la mare que se dirigeaient les deux gemsboks ; mais le naturaliste détruisit cette opinion en répondant aux chasseurs que l’oryx ne boit jamais ; c’est l’un des animaux qui ont été créés pour habiter le désert où l’eau n’existe pas ; et il était probable que les deux gemsboks avaient une autre intention que de se rendre à la mare.
Quoi qu’il en soit, ils approchaient du camp des jeunes boërs et n’en étaient pas maintenant à plus d’un kilomètre ; c’est à peine si les chasseurs auraient eu le temps de préparer leurs chevaux avant que les deux oryx fussent à portée de leurs halles ; aussi, abandonnant le projet qu’ils avaient eu d’abord, nos amis gagnèrent en rampant, le bouquet d’arbres le plus rapproché d’eux, et s’agenouillant derrière les broussailles, ils attendirent les antilopes.
Les pauvres bêtes ne se doutaient pas du péril et continuaient d’avancer du côté du bivac ; il fallait qu’elles n’eussent pas aperçu le kraal, dont la vue aurait à coup sûr éveillé leur effroi ou leur curiosité ; elles marchaient avec le vent qui, sans cela, aurait pu les avertir de la présence de l’ennemi, et se rapprochaient de l’endroit où les fusils de nos chasseurs étaient braqués sur elles.
Toutefois il n’était pas de leur destinée de mourir de la main des hommes.