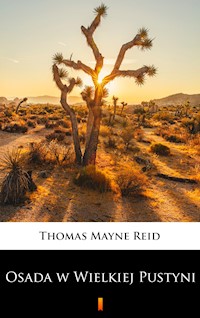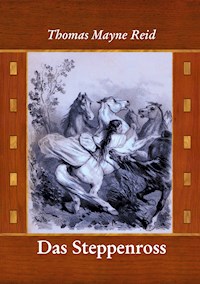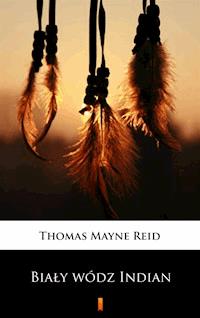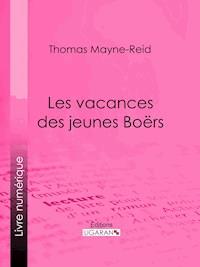Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je venais d'avoir seize ans lorsque je m'enfuis de la maison paternelle pour m'engager comme matelot. Ce n'était pas que je fusse malheureux dans ma famille ; je quittais, au contraire, des parents affectueux et remplis d'indulgence, des sœurs et des frères qui m'aimaient et qui me pleurèrent longtemps après que je fus parti."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
(Voir l’application des lettres et des chiffres à la page suivante)
Je venais d’avoir seize ans lorsque je m’enfuis de la maison paternelle pour m’engager comme matelot. Ce n’était pas que je fusse malheureux dans ma famille ; je quittais, au contraire, des parents affectueux et remplis d’indulgence, des sœurs et des frères qui m’aimaient et qui me pleurèrent longtemps après que je fus parti.
Mais dès ma plus tendre enfance, la mer m’avait toujours attiré, moins par envie d’être marin que pour voyager sur l’Océan, dont je voulais contempler les merveilles. Il fallait que ce vif désir fût inné chez moi, car mes parents étaient loin d’encourager mes dispositions maritimes ; ils faisaient même tout ce qui était en leur pouvoir pour me détourner de la carrière que je voulais suivre, et ils me destinaient à une profession tout opposée à la vie que je rêvais ; mais les conseils de mon père, les supplications de ma mère furent complètement inutiles ; je dirai plus, et je l’avoue à ma honte, ils produisirent un effet diamétralement contraire à celui qu’ils en attendaient : loin d’éteindre en moi cette passion du vagabondage qui me poussait à courir le monde, ils me firent chercher avec plus d’ardeur que jamais tous les moyens possibles d’arriver à mon but. Il en est souvent ainsi chez les natures obstinées, et l’entêtement, quand j’étais jeune, constituait mon principal défaut. L’amour du fruit défendu est, il est vrai, commun parmi les hommes, et peut-être, en ne rêvant qu’à l’objet qui m’était interdit, ressemblais-je à beaucoup d’autres. Toujours est-il qu’en dépit des remontrances de mon père et des efforts qu’il faisait pour me détourner de la marine, toutes mes pensées, toutes mes aspirations étaient dirigées vers l’Océan. Mais personne n’eut jamais autant de motifs que moi de regretter d’avoir désobéi à ses parents : je ne tardai pas à me repentir et à songer avec amertume au chagrin que j’avais causé à tous ceux qui m’aimaient.
Il me serait impossible de me rappeler comment cette passion m’était venue ; je la retrouve, dans ma mémoire, unie à mes premiers souvenirs, et comme antérieure à tous les faits qui reviennent à mon esprit. Je suis né au bord de la mer ; tout enfant je m’asseyais à la fenêtre regardant sans cesse les bateaux avec leurs voiles blanches, et suivant des yeux les beaux navires aux mâts élancés qui passaient à l’horizon. Pouvais-je ne pas admirer ces vaisseaux à la fois pleins de force et de grâce ? Pouvais-je ne pas désirer d’être à bord de l’un de ces édifices mouvants, qui m’emporterait bien loin sur l’eau transparente et bleue ?
Plus tard, j’eus entre les mains des livres qui avaient rapport à la mer ; ils m’entretenaient de pays enchantés que l’on trouve sur ces rivages, d’animaux singuliers, d’hommes étranges, de plantes curieuses, de palmiers, de figuiers aux larges feuilles, de bananiers, de baobabs gigantesques, de merveilles sans nombre, qui augmentaient le désir que j’éprouvais de traverser l’Océan. De plus, j’avais un oncle qui était un vieux capitaine de la marine marchande, et qui n’avait pas de plus grand bonheur que de rassembler tous ses neveux autour de lui et de leur raconter ses voyages, que nous écoutions tous avec avidité. Que de longues soirées d’hiver passées au coin du feu à l’entendre avec une émotion toujours nouvelle ! car, ainsi que la Shéhérazade des contes arabes, il avait mille et une histoires à nous dire : aventures de terre et de mer, d’ouragans et de naufrages, longues courses en bateaux non pontés, rencontres de pirates combats avec des Indiens, avec des baleines plus grosses que des maisons, luttes sanglantes avec les requins, les ours, les lions, les loups, les crocodiles et les tigres. Mon oncle avait eu toutes ces aventures, ou du moins il le disait, ce qui était la même chose pour son auditoire rempli d’admiration.
Il ne faut pas s’étonner si, après de semblables récits, la maison paternelle me sembla trop étroite, la vie quotidienne fastidieuse, et si ne pouvant plus résister à la passion qui m’entraînait, je partis enfin un beau jour pour aller vivre en mer.
J’avais alors seize ans, comme je l’ai dit plus haut. Ce qui m’étonne, c’est que j’aie attendu jusque-là ; mais ce n’était pas ma faute : depuis que je pouvais parler, j’avais constamment supplié mon père et ma mère de me laisser embarquer ; ils auraient pu facilement trouver à me caser d’une manière avantageuse, à me placer comme apprenti à bord de quelque grand navire faisant voile pour les Indes, ou à me faire entrer comme aspirant dans la marine royale, car ils n’étaient pas sans influence ; mais ni l’un ni l’autre n’avaient jamais voulu écouter mes prières.
Persuadé à la fin qu’ils n’y consentiraient pas, je résolus de m’enfuir et de m’engager sur le premier vaisseau où l’on voudrait me recevoir. Depuis l’âge de quatorze ans, je m’étais donc offert maintes et maintes fois aux navires qui se trouvaient dans le port voisin, mais j’étais trop jeune, personne ne voulait de moi. Quelques-uns des capitaines auxquels je m’adressai me refusèrent, parce qu’ils savaient que ma famille s’opposait à mon départ. C’était précisément avec ceux-là que j’aurais voulu partir ; la conscience dont ils faisaient preuve m’eût assuré de bons traitements : toutefois puisqu’ils persistaient dans leurs refus, je n’avais pas d’autre ressource que d’aller frapper ailleurs, et je finis par m’arranger avec un homme beaucoup moins scrupuleux, qui m’accepta comme apprenti sans la moindre difficulté. Il savait parfaitement que je me sauvais du toit paternel, et ne m’en aida pas moins à exécuter mon projet, en me faisant connaître le jour et l’heure où il s’éloignerait du port.
Je me rendis au navire avec exactitude, et avant qu’on eût pu faire des recherches, avant même que ma disparition eût pu être remarquée, le vaisseau avait déployé ses voiles, et nulle poursuite ne pouvait plus m’atteindre.
Il n’y avait pas douze heures que j’étais à bord, douze minutes, pour mieux dire, que ma fièvre maritime était complètement guérie ; j’aurais volontiers donné ma meilleure dent pour me retrouver sur la terre ferme. À peine avais-je mis le pied sur le vaisseau que le mal de mer s’était emparé de moi, et je me trouvais si malade que je me croyais près de mourir.
Le mal de mer est toujours fort déplaisant, même pour un passager de première classe, bien installé dans une bonne cabine, et entouré des soins du chef qui sympathise à ses souffrances ; mais qu’il est bien autrement pénible pour un pauvre garçon isolé comme je l’étais, rudoyé par le capitaine, souffleté par le contremaître, raillé par l’équipage, et quel équipage ! Le navire se serait ouvert que je n’aurais pas même essayé d’échapper à la mort.
Néanmoins, au bout de quarante-huit heures, les vomissements s’arrêtèrent : car il en est de ce triste mal comme de tous les autres, il passe d’autant plus vite qu’il a été plus violent ; et deux jours après mon embarquement, je pouvais me lever et parcourir les ponts.
Le capitaine était méchant et bourru, le contremaître d’une brutalité sans égale, et je n’exagère pas en disant que l’équipage se composait de bandits. À l’exception d’un ou deux hommes qui s’y trouvaient par hasard, je n’ai jamais rencontré une bande de pareils coquins, et le sort a voulu pourtant que je fusse parfois mêlé à d’étranges compagnons.
Non seulement le capitaine était bourru par nature, mais il devenait féroce quand il avait bu ou qu’il était en colère, et il était bien rare qu’il ne fût pas ivre ou furieux. Malheur à qui l’approchait alors, surtout malheur à moi ! car c’était principalement sur les êtres faibles et sans résistance qu’il déchargeait sa rage.
Il était impossible que je ne fisse pas tout d’abord quelque méprise qui m’attirât sa mauvaise humeur, et j’eus bientôt un échantillon de sa cruauté, qui ne se démentit plus à mon égard. Implacable dans ses rancunes, lorsqu’une fois sa colère était éveillée contre quelqu’un, rien au monde ne parvenait à l’apaiser.
C’était un homme trapu, ayant un visage régulier, des joues rondes et grasses, des yeux saillants et le nez légèrement retroussé ; une de ces figures que l’on emploie souvent dans les tableaux comme types de bonhomie, et qui passent pour appartenir à de braves gens, d’une gaieté pleine de franchise, mais qui sont trompeuses. L’expérience m’a toujours montré, derrière ces masques d’une trivialité joviale, la perfidie la plus cynique s’alliant au caractère le plus violent et le plus cruel ; et c’était aux mains d’un pareil homme que je m’étais imprudemment livré !
Le contremaître était la doublure du capitaine, dont il faisait l’écho. La seule différence qu’il y eût entre eux, c’est que le premier ne buvait jamais. Leur liaison n’en était que plus intime. À jeun quand son chef était ivre, le contremaître supportait patiemment les injures que le capitaine lui adressait alors, et pas la moindre dispute ne diminuait la cordialité de leur entente ; chien couchant du skipper, dont il léchait les bottes, suivant l’expression des matelots, il renchérissait encore sur la brutalité de son chef, et quand celui-ci disait : « Frappe ! » il répondait : « Assomme ! »
Nous avions un troisième officier, mais des plus insignifiants, qui ne mérite pas qu’on en parle, et qui se confondait presque avec les hommes d’équipage, sur lesquels il n’exerçait qu’une autorité fort restreinte.
Il y avait encore un charpentier, grand buveur, dont le nez était rougi et gonflé par le rhum, et qui faisait partie de la société du capitaine ; puis un gros nègre effroyablement laid, qui était à la fois cuisinier et commissaire des vivres ; hideux personnage, dont l’aspect et la nature étaient assez diaboliques pour lui mériter une place dans les cuisines de l’enfer. Tels étaient les officiers de l’abominable équipage dont je faisais maintenant partie ; et c’était pour me trouver à la merci de pareilles gens que je m’étais arraché à la tendre affection de ma famille, à la société de mes amis et de mes frères ! Combien je me reprochais ma folie ! comme je détestais mon pauvre oncle, ce vieux loup de mer qui m’avait séduit par ses contes fantastiques, dont je maudissais aujourd’hui l’influence ! combien je me repentais de l’avoir écouté, d’avoir cédé à mes folles visions ! Plût à Dieu que je ne l’eusse jamais connu ! je serais encore chez mon père.
Mais à quoi bon le remords ? Il arrivait trop tard ; il me fallait supporter l’existence que je m’étais faite ; c’était moi qui l’avais voulu. Que de temps encore à souffrir ! que de longs jours de tortures ! que de longues années, plutôt ! car je me rappelais que ce misérable capitaine m’avait fait signer un engagement que je n’avais même pas lu, et par lequel, ainsi qu’il me l’avait dit plus tard, je devais rester cinq ans à bord en qualité d’apprenti ; cinq ans d’esclavage, cinq ans à la disposition de cette brute infernale, qui pouvait me gronder, me souffleter suivant son bon plaisir, me fouetter ou me mettre aux fers, s’il lui en prenait fantaisie !
Et pas moyen d’échapper à cette perspective effrayante ! séduit par les visions qui m’attiraient vers l’Océan, j’avais tout accepté, ma signature en faisait foi ; j’étais lié sans appel, le capitaine me l’avait dit et le contremaître me l’avait confirmé. Si j’essayais de m’enfuir, je devenais déserteur, et je serais ramené impitoyablement pour subir la punition que j’aurais alors encourue ; même un port étranger ne pouvait me servir d’asile, en supposant que je pusse m’échapper du navire : j’y serais bientôt reconnu. Pas d’autre espoir de mettre un terme à cette existence qu’en me jetant à la mer ou en me pendant au bout d’une vergue. J’y songeai sérieusement, et le suicide me tenta plus d’une fois ; mais j’en fus détourné par les principes religieux qui m’avaient été donnés dès l’enfance, et qui me revenaient à l’esprit au milieu de ces épreuves.
Il me serait impossible de détailler les cruautés sans nombre, les indignités révoltantes dont j’étais accablé ; mon existence n’était qu’une série de mauvais traitements ; jusqu’au sommeil dont j’avais tant besoin, et qui m’était refusé ! Je ne possédais ni matelas, ni hamac ; j’étais venu à bord n’emportant que les habits dont j’étais couvert ; ma veste d’école et ma casquette. J’étais sans argent et sans bagage, n’ayant pas même l’équipement du fugitif : le paquet dans un mouchoir de poche au bout d’un bâton, encore moins un hamac, et pas d’endroit où me coucher. Tous les cadres étaient pris, la plupart avaient deux occupants ; les matelots qui étaient seuls ne voulaient pas de compagnon, et ces gens sans cœur étaient si durs qu’ils ne me permettaient pas de reposer sur les coffres qui étaient rangés devant leurs cadres, et qui occupaient tout l’espace ; je n’avais pas même le droit de m’étendre sur le plancher ; d’ailleurs il était souvent mouillé par le lavage, ou, pis encore, par des crachats nombreux. Il y avait bien un coin du pont où j’avais la chance de n’être pas dérangé, mais il y faisait si froid que je ne pouvais pas y rester. Je n’avais pour couverture que mes habits fort minces, presque toujours imbibés d’eau ; je grelottais sans pouvoir dormir, et je revenais m’étendre sur l’un des coffres du gaillard d’avant, d’où le propriétaire me jetait brutalement sur le plancher, bien heureux quand il ne me renvoyait pas sur le pont.
Ajoutez à cela que je travaillais continuellement la nuit tout aussi bien que le jour, et il n’y avait pas de sale besogne qui ne me fût imposée. Je n’étais pas seulement l’esclave des officiers : chaque homme de l’équipage se croyait le droit de me donner des ordres, jusqu’à Boule-de-Neige, l’affreux nègre, qui, du fond de la cambuse, me commandait avec arrogance, tout fier qu’il était d’avoir un blanc à son service. J’étais le cireur de bottes du capitaine et des contremaîtres, le rinceur de bouteilles du cuisinier et le valet de tous les matelots ; triste rôle que la plupart des mousses ont à remplir, surtout quant ils se sont engagés eux-mêmes, ainsi que je l’avais fait. Oh ! j’étais bien puni de ma désobéissance, bien guéri de ma passion pour la mer.
Je subis longtemps sans rien dire cette affreuse existence. À quoi bon me plaindre ? À qui d’ailleurs pouvais-je parler de ma misère ? Je n’avais personne à implorer, personne qui voulût prêter l’oreille à mes paroles ; tout le monde, autour de moi, était indifférent à mes souffrances, ou du moins paraissait l’être, puisque personne n’essayait d’en alléger le fardeau, ou même de parler en ma faveur.
À la fin, cependant, une circonstance imprévue me fit en quelque sorte le protégé de l’un des matelots, qui, s’il ne pouvait rien contre les brutalités du capitaine, était du moins assez fort pour faire cesser à mon égard les indignités dont ses pareils m’accablaient journellement. Cet homme s’appelait Ben Brace. J’ignore si c’était son véritable nom, ou s’il l’avait pris en mer ; toujours est-il que je ne lui en ai jamais connu d’autre, et que c’était sous le nom de Ben Brace qu’il était porté sur le livre de bord. Du reste, il n’est pas rare de voir des matelots s’appeler Tom Bowline, Bill Buntline, etc., noms de famille que leur ont transmis une longue série d’aïeux, simples matelots comme ils le sont eux-mêmes.
Mon protecteur s’appelait donc Ben Brace, et, bien qu’un autre ait rendu ce nom fameux, je le lui conserve par amour pour la stricte vérité. Ce n’est certainement pas mon mérite qui m’attira la protection de Ben ; ce ne fut pas davantage l’effet d’une tendre sympathie : son cœur avait depuis longtemps perdu cette sensibilité qui s’émousse au contact des misères affreuses que l’on rencontre ; il avait d’ailleurs supporté lui-même d’odieux traitements, dont l’injustice l’avait endurci à l’égard des autres ; et si, à l’époque où je l’ai connu, ses manières étaient rudes et son humeur farouche, c’est à ce qu’il avait souffert qu’il fallait l’attribuer ; car on trouvait en lui ce fonds de bienveillance et de bonté qui appartient à la plupart des hommes.
C’était un beau loup de mer que Ben Brace, le meilleur matelot qui fût à bord, de l’aveu même de tous ses camarades, bien qu’il ne fût pas sans un ou deux rivaux. Il fallait le voir, à l’approche de la rafale, escalader les haubans pour carguer une voile de perroquet, sa belle chevelure épaisse et frisée flottant derrière lui, et laissant voir sur ses traits énergiques cette expression à la fois pleine de calme et d’audace qui semblait défier la tempête. Il était grand et bien proportionné, souple et nerveux plutôt que robuste, et avait la tête couverte d’une masse énorme de cheveux bruns ; car il était jeune, et l’âge n’avait encore ni éclairci ni pâli cette chevelure opulente. Sa figure, hâlée par le vent et le soleil, était loyale et bonne, en dépit de sa rudesse, et, bien que ce fût étrange pour un marin, qui n’a guère le temps de se raser, il ne portait ni barbe ni moustache ; il aimait, disait-il, qu’on eût la figure propre, et la sienne en fournissait la preuve. Ce n’est pas qu’il fût l’un de ces fashionables de bord que l’on voit en belle jaquette bleu de ciel, à collet de fantaisie ; jamais, au contraire, il ne portait, même les jours de fête, qu’une chemise de Guernesey bleu foncé, juste au corps, et dessinant les proportions heureuses de son buste et de ses bras. Un statuaire aurait admiré la ligne hardie et pure de son cou, sa poitrine large et pleine, qui malheureusement, comme celle de tous les matelots, était défigurée par le tatouage ; on y voyait, de même que sur ses bras nerveux, les hiéroglyphes que l’on rencontre en pareille circonstance : une ancre, deux cœurs réunis et percés d’une flèche, deux BB accompagnés de nombreuses initiales, et, sur le côté gauche de la poitrine, une figure de femme grossièrement dessinée par des lignes de points bleus, ayant l’intention de représenter quelque Sallie aux yeux noirs, ou quelque Suzanne de la côte d’Angleterre.
Tel était mon ami Ben Brace, et voici à quelle occasion il devint mon protecteur.
Peu de temps après mon arrivée à bord, j’avais découvert avec surprise que plus de la moitié de l’équipage était composée d’étrangers. Cela m’étonna beaucoup ; j’avais toujours pensé qu’un navire anglais était monté par des matelots nés dans les trois royaumes, et il se trouvait que les trois quarts des hommes de la Pandore, c’est ainsi qu’on appelait notre vaisseau, appartenaient à des nations différentes. Il y avait des Français, des Espagnols, des Portugais, des Hollandais, des Suédois, des Américains, des Italiens ; on aurait dit que chaque peuple maritime s’était fait représenter, dans cette réunion de bandits, par le plus affreux sacripant qu’il eût pu trouver parmi ses membres. Des quarante individus qui formaient l’équipage de la Pandore, je ne fais d’exception qu’en faveur de Ben Brace et d’un Hollandais qui n’avait aucune malice, pauvre homme dont l’existence était bien malheureuse.
Au nombre des Américains était un nommé Bigman, qui mérite une mention particulière. Son nom lui allait à merveille : c’était un homme gras et trapu, grossier de corps et d’esprit, au visage féroce, couvert d’une barbe qu’un pirate aurait pu envier. Du reste, j’ai su plus tard qu’elle appartenait effectivement à un écumeur de mer.
Bigman était d’humeur querelleuse, et, chaque fois qu’il trouvait moyen de chercher noise à quelqu’un, il n’y manquait jamais ; c’était d’ailleurs un homme courageux, bon marin, et l’un des deux ou trois individus qui se partageaient, avec
Ben Brace, le droit de battre les autres et de redresser les torts. Il est inutile d’ajouter qu’ils étaient nécessairement rivaux, et que le préjugé national était au fond des sentiments qu’ils nourrissaient l’un contre l’autre. C’est à leur rivalité que je dus la protection de Ben Brace.
J’avais, sans le vouloir, fait quelque chose qui avait blessé l’Américain, je ne me rappelle plus à quel propos, mais c’était une bagatelle ; toujours est-il que Bigman se tenait pour offensé et me faisait expier mon tort de mille manières. Il en vint même un jour à me frapper au visage ; Ben était présent ; il sentit son cœur bondir en voyant cet acte de violence d’autant plus cruel qu’il était immérité, et sautant de son hamac, où il se trouvait alors, il se précipita vers Bigman et lui appliqua sur le menton un coup de poing à la John Bull.
L’Américain chancela et vint tomber contre l’un des coffres qui se trouvaient derrière lui ; mais, se remettant aussitôt, il monta sur le pont suivi de mon défenseur, et tous les deux se boxèrent au milieu des matelots attentifs, pour lesquels ce combat était plein d’intérêt. Quant aux officiers, ils ne s’interposèrent ni les uns ni les autres. Le contremaître s’approcha, mais non pour empêcher la lutte, qui semblait au contraire lui offrir un spectacle assez divertissant ; et le capitaine demeura sur le tillac, sans s’inquiéter de la manière dont tout cela finirait. Cette absence de discipline m’étonna bien un peu ; toutefois, il se passait chaque jour tant d’autres choses surprenantes à bord de la Paudore, que je ne m’y arrêtai pas. Le combat dura longtemps, mais il se termina comme il arrive toujours quand une partie de boxe est engagée entre un Anglais et un Américain : Bigman fut affreusement bourré de coups, et la partie de son visage qui n’était pas couverte de barbe devint d’un bleu noirâtre sous les poings fermés de son rude antagoniste ; à la fin il tomba sur le pont comme un bœuf à l’abattoir, et fut obligé de reconnaître que son adversaire l’avait battu.
« Assez pour aujourd’hui, n’est-ce pas ? s’écria Ben en lui donnant le coup final. Eh bien, je te le dis, si tu touches encore l’enfant du bout des doigts, je t’en servirai plus du double ; tiens-toi pour averti. Ce garçon-là est Anglais tout comme moi, et il en supporte assez de la part des autres sans être insulté par un fils de Peau-Rouge ; souviens-toi de mes paroles. Et vous tous, tant que vous êtes, ajouta Ben en regardant ses camarades, ne le touchez pas, ou c’est à moi que vous aurez tous affaire. »
Personne depuis lors ne porta plus la main sur le protégé de Ben ; le châtiment de Bigman avait produit son effet, et mon existence devint plus tolérable. Toutefois mon nouvel ami, assez puissant pour mettre un frein aux brutalités de l’équipage, ne pouvait rien contre les officiers et j’avais toujours le capitaine, le contremaître et le charpentier pour tourmenteurs.
Ma position, néanmoins, s’était bien améliorée ; j’avais maintenant ma part entière de pâté, de lobscous, de plum-duff ; je n’étais plus mis à la porte du gaillard d’avant, on me permettait même de dormir sur un coffre, et l’un des hommes de l’équipage, voulant gagner l’estime de Ben, me fit présent d’une vieille couverture ; un autre me donna un couteau orné d’une ficelle en guise de chaîne, pour le suspendre à mon cou ; bref, chacun y contribuant, je fus bientôt équipé, et grâce à l’influence du patronage de Ben, je ne manquai plus de rien.
Je ressentis une vive reconnaissance des brimborions qui m’étaient donnés, bien qu’ils me vinssent, pour la plupart, d’individus qui ne m’avaient épargné ni les coups de pied, ni les soufflets ; mais je n’ai jamais eu de rancune, et, dans l’isolement où je me trouvais alors, il m’était bien facile de pardonner à ceux qui me faisaient quelques avances ; j’avais d’ailleurs beaucoup souffert de la privation des objets dont on venait de me faire cadeau, et je ressentais une joie réelle d’en être enfin pourvu. On ne s’embarque jamais sans vêtements de rechange ; on est muni d’assiettes, d’un couteau, d’une fourchette, d’un gobelet, en un mot, de tout ce qui est nécessaire ; mais, dans l’empressement que j’avais mis à fuir la maison paternelle, je n’avais songé à me pourvoir d’aucun des objets les plus indispensables ; j’étais parti les mains vides, sans même emporter de chemise.
J’avais donc été dans un affreux embarras jusqu’au moment où Ben Brace avait battu mon agresseur, et changé ma position par le patronage qu’il m’avait accordé ; aussi lui en avais-je une profonde gratitude. Mais bientôt un nouvel incident accrut ma reconnaissance plus que je ne saurais vous le dire, et parut augmenter l’affection que mon protecteur ressentait à mon égard.
L’incident que je vais raconter avait souvent eu lieu avant que j’en fusse le triste héros, et probablement il se renouvellera jusqu’à ce que des lois plus sages aient réglé le service de la marine du commerce, et posé des limites au pouvoir trop absolu dont jouissent aujourd’hui les capitaines des vaisseaux marchands. Il est certain que la plupart des skippers s’imaginent pouvoir infliger les traitements les plus cruels à tous les malheureux qu’ils emploient, et qu’ils le peuvent en effet, sans avoir la moindre punition à encourir à propos de la conduite barbare qu’ils ont envers leur équipage ; leur brutalité n’a d’autre limite que la patience et la résignation de leurs victimes. En général, ceux qui, parmi les matelots, ont un caractère indépendant, une humeur audacieuse, n’ont rien à craindre de l’arbitraire des officiers, qui reconnaissent leurs droits et qui leur accordent des privilèges. Mais les natures faibles et timides ont énormément à souffrir quand elles se trouvent sous la domination d’un capitaine brutal ; et, je le dis avec regret, il en existe beaucoup de cette espèce parmi les skippers de la marine anglaise.
On ne peut se figurer la somme de souffrances qui peut être subie en pareil cas ; la vie des mousses, des matelots novices, des vieux marins eux-mêmes qui ne savent point résister à cette odieuse tyrannie, est vraiment insupportable : forcés de travailler sans cesse, accablés de fatigue jusqu’à pouvoir en mourir, flagellés pour la moindre faute, et parfois sans motifs, ils sont traités en esclaves par un maître qui ne s’intéresse même pas à leur conservation.
Le châtiment qu’on leur inflige, si toutefois on peut appeler de ce nom les coups donnés à un homme qui ne les a pas mérités, est souvent assez grave pour mettre en danger la vie du malheureux qui est contraint de le subir ; il n’est pas très rare qu’une mort immédiate en soit la conséquence, et il résulte dans presque tous les cas des germes de maladies qui prennent plus tard un développement fatal.
Chacun admet que l’autorité d’un capitaine de vaisseau doit être plus étendue que celle d’un chef d’usine ou du directeur d’une entreprise quelconque ; la sûreté du navire en dépend ; on l’a répété sur tous les tons, et personne ne le conteste. Mais ce n’est pas la nature du pouvoir accordé au capitaine qui a jamais fait l’objet des réclamations élevées à cet égard, c’est l’absence de responsabilité relativement à l’emploi de ce pouvoir sans limite, l’absence de lois pénales suffisantes pour réprimer les abus qui en déroulent.
Jusqu’ici, la peine encourue en pareille circonstance n’a jamais été appliquée, ou bien s’est trouvée tellement disproportionnée au crime qu’elle était destinée à punir, que, loin de servir d’exemple aux autres, elle les a confirmés dans cette idée qu’ils n’étaient pas responsables des actes de violence commis par eux à bord. En outre, le capitaine, appuyé par ses contremaîtres, protégé à la fois par son argent et par la terreur qu’il inspire à l’équipage, principalement à ceux qui ont à se plaindre de lui, peut toujours donner un démenti à la victime de sa cruauté, victime qui elle-même n’ose pas dénoncer le fait dont elle a eu à souffrir, dans la crainte de ne pas obtenir justice et d’avoir plus tard à expier cette démarche imprudente. Souvent aussi la joie de se retrouver à terre, de revoir sa famille, ses amis, de se sentir délivré de ses tourments, fait perdre de vue tous les projets de vengeance que l’on avait formés à bord, et le malheureux qui avait résolu de porter plainte laisse repartir son bourreau sans l’avoir fait punir.
L’histoire de l’émigration abonde en faits odieux de toute espèce dont les pauvres exilés furent victimes en se rendant au désert. Que de récits navrants, de chapitres douloureux ne pourrait-on pas écrire sur les indignités auxquelles ces innocentes créatures ont été soumises de la part de ceux qui devaient, au contraire, les protéger et les soutenir ! Il est à regretter que les gouvernements n’agissent pas à cet égard d’une manière plus énergique, et ne veillent pas avec plus de sollicitude sur l’infortuné à qui la misère fait chercher une nouvelle patrie.
De bonnes lois qui restreindraient l’arbitraire des capitaines de navires marchands seraient d’autant plus utiles, qu’en dehors de l’autorité qu’ils exercent dans leurs navires, les skippers sont généralement honnêtes et ne manquent pas d’humanité. C’est parce que leurs pouvoirs sont mal définis, parce qu’ils savent qu’ils n’auront pas à répondre de leurs actes, qu’ils abusent de leur position ; et, ne connaissant d’autres règles que leur bon plaisir, ils ne tardent pas à suivre la pente commune à tous les hommes, et finissent par devenir des tyrans de la pire espèce.
On a fait depuis peu, il est vrai, quelques exemples salutaires, et l’un de ces capitaines inhumains, qui l’avait certes bien mérité, fut même condamné au dernier supplice ; mais il est à craindre que l’on ne retombe dans l’indifférence accoutumée, et que la tyrannie du skipper et de son contremaître ne continue comme autrefois à faire de nombreuses victimes.
Les observations qu’on vient de lire n’étaient pas même applicables à l’incident qui me concerne ; les démons qui me torturaient n’en auraient pas moins exercé leurs cruautés en dépit des tribunaux les plus sévères : ils vivaient en dehors de toutes les lois divines ou sociales, et ne connaissaient ni le remords du crime, ni l’appréhension du châtiment qu’il entraîne. On verra par le fait suivant qu’ils se faisaient un jeu de m’exposer à la mort.
L’une des choses les plus pénibles pour celui qui débute dans la carrière maritime est l’obligation où il se trouve de monter en haut des mâts. Si le capitaine avait la moindre bienveillance, il permettrait au novice de vaincre peu à peu le vertige dont il est saisi en gravissant les haubans, et commencerait par ne l’envoyer qu’aux étages inférieurs, tout au plus au mât de hune ; il lui donnerait le temps d’habituer ses mains et ses pieds aux cordages qui doivent lui servir d’appui, et le laisserait passer un certain nombre de fois par le trou du chat, au lieu de le forcer à descendre par les haubans de revers.
La pratique ne tarderait pas à le délivrer du vertige ; et, lui interdisant alors le passage du trou du chat, on l’enverrait par degrés jusqu’au perroquet volant et à la pomme de girouette, sans qu’il y eût pour lui ni terreur ni péril ; c’est ainsi que, du reste, agissent les capitaines qui ont une certaine humanité.
Mais, hélas ! il y en a bien peu qui soient assez bons ou assez prudents pour y songer. Que de pauvres élèves, en mettant le pied pour la première fois sur le pont du navire, sont envoyés aux grandes vergues de perroquet, plus haut encore, s’il est possible ! et combien d’entre eux ont été victimes de cet ordre cruel, qui, dans tous les cas, les soumet à une affreuse torture !
Quinze jours s’étaient écoulés depuis mon départ de la terre ferme, et le capitaine ne m’avait pas encore adressé le mot aloft. Si j’avais escaladé les premiers haubans, c’était moi qui l’avais bien voulu, parce que j’avais le désir de m’habituer à grimper aux cordages ; avant de monter sur la Pandor, je n’avais jamais dépassé les branches de nos pommiers, et je comprenais la nécessité d’apprendre le plus tôt possible à me mouvoir avec aisance au milieu de tous les agrès du navire.
Malheureusement, je n’avais pas eu l’occasion d’exercer ma bonne volonté ; une ou deux fois j’avais grimpé aux enfléchures, et, passant par le trou du chat, j’étais arrivé jusqu’à la grande lune, expédition qui m’avait paru assez glorieuse, car le vertige m’avait saisi plus d’une fois pendant que je l’accomplissais ; j’aurais poussé plus loin mon escalade, mais la voix du capitaine ou celle du contremaître m’avait toujours rappelé sur le pont, où ils m’ordonnaient, en jurant, de frotter leur cabine, de nettoyer le tillac, de cirer leurs bottes, ou de me livrer à quelque autre occupation du même genre.
Je commençais à m’apercevoir que mon ivrogne de commandant n’avait nulle intention de m’enseigner la moindre des choses qu’un marin doit apprendre, et qu’il m’avait engagé tout simplement pour me transformer en esclave à tout faire, bon à recevoir les coups de pied de tout le monde, et particulièrement les siens.
Cette détermination du capitaine, qui devenait chaque jour de plus en plus évidente, me causait un vif chagrin ; non pas que je voulusse alors rester dans la marine : si j’avais pu à cette époque me retrouver en Angleterre, il est probable que jamais je n’aurais remis le pied sur le pont d’un vaisseau ; mais je savais que nous étions partis pour faire un long voyage. Combien devait-il durer ? c’est ce que je ne pouvais dire ; et, en supposant qu’il me fut possible de déserter de la Pandore, projet que je nourrissais au fond du cœur, que deviendrais-je en pays étranger, sans amis, sans argent, sans rien savoir, ni du commerce, ni d’autre chose ? Comment vivrais-je, et par quel moyen revenir en Angleterre ? Si j’avais au moins su mon métier de matelot, j’aurais pu offrir mes services pour payer mon passage, afin de rentrer dans ma famille. J’étais incapable de le faire, et voilà pourquoi je regrettais si vivement de ne pas savoir ce qu’en définitive j’étais convenu d’apprendre.
J’ignore d’où me vint cette audace, mais un matin j’en parlai au capitaine, et je lui reprochai, avec toute la délicatesse dont j’étais susceptible, de ne pas remplir les conditions de mon brevet d’apprentissage. Pour toute réponse, je fus immédiatement jeté sur le dos, accablé de coups de pied qui me marquetèrent de taches bleues ; et le seul résultat de mon imprudence fut d’être encore plus maltraité que je ne l’étais auparavant.
Moins que jamais il m’était permis de gravir aux cordages et de m’exercer à la pratique des manœuvres. Une fois cependant, au lieu de m’entendre crier : à bas ! on m’ordonna d’aller en haut ; et je puis dire que j’en eus ce jour-là beaucoup plus que je ne l’aurais voulu.
Profitant de l’heure où je pensais que le contremaître et le capitaine faisaient la sieste, j’étais monté jusqu’à la grande hune.
Quiconque a jeté les yeux sur un navire dont le gréement est complet, a dû remarquer, à une certaine hauteur au-dessus du pont, une plateforme qui entoure le grand mât ; si c’est un grand vaisseau, la même chose existe au mat de misaine et à celui d’artimon. Cette plate-forme s’appelle hune ; elle a pour objet de tendre les échelles de corde appelées haubans, qui partent de son bord extérieur, et vont se fixer à la tête du mât qui s’élève au-dessus d’elle. Un navire ou une barque a trois mâts ; le mât de misaine, qui est à l’avant ; le grand mât, qui se dresse au milieu, et le mât d’artimon, qui est à l’arrière. Mais chacun de ces mâts se divise en plusieurs parties, c’est-à-dire en plusieurs mâts qui portent des noms différents dans le vocabulaire du marin : pour celui-ci, le grand mât n’est pas l’ensemble de cette énorme perche qui se dresse au milieu du navire, et qui s’élève jusqu’aux nuages, le grand mat se termine un peu au-dessous de la plate-forme que nous venons de mentionner, et qui, par ce motif, se nomme la grande hune ; là commence un autre mât tout à fait distinct de celui qui le supporte, dont la longueur est à peu près égale à celle du précédent, mais qui est plus mince, et qui s’appelle mât de la grande hune ; un troisième est superposé à celui-ci au moyen de barres qui le soutiennent ; il est plus court, plus mince que le mât de hune, et s’appelle mât de perroquet ; il supporte à son tour, et de la même façon, le mât de cacatois, seulement en usage sur les plus grands vaisseaux ; l’extrémité du cacatois est ordinairement couronnée d’une pièce de bois circulaire nommée pomme de girouette ou de pavillon, et qui est le point le plus élevé du navire.
Les mâts de misaine et d’artimon sont divisés de la même manière : seulement celui-ci est plus court que les autres ; il porte rarement des voiles de perroquet, et plus rarement encore des voiles de cacatois.
J’ai donné cette explication afin que vous puissiez comprendre qu’une fois à la grande hune, j’étais bien loin d’être arrivé à la plus grande élévation qu’on pût atteindre sur le navire, mais seulement à la plate-forme qui couronne le grand mât, tel que l’entendent les marins.
La grande hune est souvent nommée le berceau par les hommes de l’équipage, et avec assez de raison, car un navire dont le vent gonfle les voiles est fortement bercé d’un côté à l’autre ou de l’avant à l’arrière, d’après les mouvements qui lui sont imprimés. Le berceau est l’endroit le plus agréable du navire pour celui qui aime la solitude ; vous ne voyez plus sur le pont, à moins de regarder par-dessus le bord ou de vous incliner vers le trou du chat, dont j’ai parlé plus haut ; et le bruit des voix, qui vous arrivent à peine, se confond avec celui du vent qui siffle au milieu des cordages ou qui tambourine sur les voiles. Mon plus grand bonheur était de passer quelques minutes dans cet endroit solitaire ; le cœur soulevé par l’horrible compagnie à laquelle je m’étais si imprudemment associé, dégoûté des blasphèmes continuels qui frappaient mes oreilles, j’aurais donné tout au monde pour que chaque jour il me fût permis de rester quelques instants dans ce berceau aérien ; mais je n’avais pas de loisir, carmes tyrans ne me laissaient ni repos ni trêve. Le contremaître surtout paraissait prendre plaisir à me tourmenter sans cesse ; il découvrit ma prédilection pour la grande hune, et décida que, de tous les endroits du navire, ce serait précisément celui où je ne m’arrêterais pas.
Toutefois, un jour, persuadé que le capitaine et le contremaître étaient allés dormir, je saisis cette occasion pour monter à mon berceau favori ; j’allongeais mes membres fatigués sur les planches de la hune, et j’écoutais les soupirs du vent qui se mêlaient à ceux des vagues ; une brise pleine de douceur rafraîchissait mon front, et malgré le danger qu’il y avait à s’endormir sur cette plate-forme dont rien n’entourait les bords. Je fus bientôt dans le royaume des songes.
Mes rêves n’étaient nullement agréables, et la chose est facile à comprendre ; le cœur accablé de regrets, ployant sous les injures et les dégoûts qui remplissaient ma vie, le corps épuisé des fatigues d’un labeur incessant, il n’était pas possible que je pusse faire de beaux rêves.
Toutefois, les miens devaient être d’une bien courte durée ; il n’y avait pas cinq minutes que j’étais endormi, lorsque je fus brusquement réveillé, non par une voix qui m’appelait, mais par une sensation cuisante d’un instrument que les matelots appellent un bout de corde, et qu’une main vigoureuse m’appliquait sur la hanche.
Un premier coup avait suffi pour me faire bondir, et j’étais sur pied lorsque la main du bourreau se releva pour frapper une seconde fois ; la promptitude avec laquelle j’avais bondi empêcha la corde de m’atteindre, et quelle ne fut pas ma surprise en reconnaissant Bigman dans celui qui m’avait réveillé !
Je savais qu’il était fort disposé à me frapper ; il nourrissait contre moi une rancune implacable, et, si j’avais été seul avec lui dans un endroit écarté, je n’aurais pas été surpris de le voir m’assommer tout à fait ; mais depuis la correction que Ben lui avait infligée, il était muet comme une souris ; et bien que, à vrai dire, son visage devint plus sombre toutes les fois qu’il venait à me rencontrer, je n’avais eu depuis lors à subir de sa part ni injures ni mauvais procédés.
Comment osait-il m’attaquer en cet instant où Ben devait être sur le pont ? Qui avait pu le faire changer ainsi de conduite ? Avais-je, sans le vouloir, offensé mon protecteur, qui m’abandonnait tout à coup à la vengeance de cet affreux bandit ? Bigman s’était-il imaginé que personne ne pourrait le voir de l’endroit où nous étions placés ? Mais non, cette idée ne lui était pas venue, car je pouvais crier, me faire entendre de Ben, ou tout au moins lui raconter plus tard cette odieuse agression, qu’il ne manquerait pas de venger.
Toutes ses pensées traversèrent mon esprit en une seconde ; elles avaient à peine rempli l’intervalle que le bourreau avait mis entre le second et le troisième coup qui m’était destiné, car le bout de corde s’était relevé de nouveau. Je lui échappai d’un bond, et, me précipitant vers le mât, je regardai par le trou du chat si j’apercevais Ben. Je ne vis pas mon protecteur, et j’allais l’appeler, quand mes yeux rencontrèrent deux individus qui, debout sur le tillac, avaient la tête levée et regardaient la grande hune. La voix expira sur mes lèvres : je venais de reconnaître la face ronde et jubilante du skipper, flanquée du visage féroce du contremaître ; il n’y avait pas à s’y méprendre, Bigman et moi nous étions leur point de mire ; c’était l’horrible traitement qu’ils me faisaient infliger qui allumait les regards du capitaine et qui donnait ce rictus de bête fauve à son affreux coadjuteur.
L’attaque imprévue de l’Américain, son audace, tout m’était expliqué : c’était pour les autres, non pour lui, qu’il s’agissait ; à voir le capitaine, son attitude et celle du contremaître, il était évident qu’ils assistaient à l’exécution des ordres qu’ils lui avaient donnés ; et, à l’expression infernale qui éclatait sur leurs figures, il m’était facile de comprendre qu’ils me réservaient quelque nouveau supplice.
À quoi bon appeler Ben ? Sa force ne pouvait rien en pareil cas. S’il avait osé me défendre, élever seulement la voix en ma faveur, ces hommes, qui me faisaient battre pour leur bon plaisir pouvaient le faire mettre aux fers, et s’il était venu à mon secours, ils avaient le droit de le tuer, la loi était pour eux.
Il n’aurait pu qu’assister à mon supplice ; il valait mieux lui en épargner la vue et ne pas l’exposer à lutter avec ses supérieurs ; je gardai donc le silence et j’attendis les ordres qui allaient être donnés ; mon incertitude ne fut pas longue.
« Damné lourdaud, chien de paresseux ! s’écria le contremaître ; réveille-le à coups de corde, Yankee. Ronfler en plein jour ! Frappe encore, encore ! fais-le chanter, mon brave !
– Non, interrompit le capitaine ; fais-le grimper, Yankee ; conduis-le tout en haut ; il aime à s’élever, il veut être marin ; qu’il apprenne le métier !
– Parfait ! répondit le contremaître en ricanant, parfait ! C’est lui qui l’a voulu ; faisons-lui prendre l’air ; courage, Yankee, fais-le grimper, mon brave ! »
Bigman se tourna vers moi la corde levée, et m’ordonna de monter.
Je ne pouvais qu’obéir ; posant les pieds sur les haubans du mât de hune, je saisis les enfléchures à pleines mains, et je commençai ma périlleuse ascension.
Je franchissais les degrés d’un pas nerveux, lentement et par saccades, recevant un coup de corde à chaque fois que je m’arrêtais ; Bigman frappait avec rage ; il cherchait à me faire souffrir le plus possible et parvenait à son but, car les nœuds de la corde me causaient une vive douleur ; je n’avais pas d’autre alternative que d’avancer ou de me soumettre à cet affreux supplice, et je continuai à gravir les haubans.
J’atteignis les barres du mât de la grande hune, j’y posai les pieds ; qu’elle effroyable chose que de regarder bas ! je n’apercevais que l’abîme. Les mâts inclinés par le vent étaient loin d’avoir conservé leur position verticale ; j’étais suspendu au milieu des airs et je ne voyais partout que des vagues qui scintillaient au-dessous de moi.
« Plus haut, plus haut ! » cria l’Américain en agitant sa corde.